25 avril par Nathan Legrand
Le 7e atelier régional du CADTM Asie du Sud s’est tenu avec succès à Colombo, au Sri Lanka, du 6 au 8 avril 2018. Une quarantaine de délégué-e-s représentant divers mouvements sociaux (mouvements paysans, féministes, syndicalistes, etc.) se sont réunis, venant du Sri Lanka, mais aussi d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Népal, ainsi que du Japon, de France et de Belgique (pour le secrétariat international du CADTM). Il ne s’agissait pas simplement d’un atelier organisé par le CADTM, puisqu’il n’aurait pas pu se tenir sans la participation active et le soutien financier d’organisations du Sri Lanka, Law & Society Trust (LST) et Movement for Land and Agricultural Reform (MONLAR). La majorité des participant-e-s venait du Sri Lanka et les deux principaux groupes nationaux – Singhalais et Tamouls – étaient représentés. Ainsi, tout l’évènement s’est déroulé en trois langues (singhalais, tamil, anglais), ce qui a été rendu possible grâce à l’aide précieuse apportée par une courageuse équipe d’interprètes.
Crise politique au Sri Lanka
L’atelier a eu lieu dans un contexte de crise politique au Sri Lanka. En février 2018, la coalition libérale qui dirige le gouvernement national, composée du Sri Lanka Freedom Party (SLFP) et du United National Party (UNP), a été sévèrement battue lors des élections locales. Le parti de droite nationaliste singhalaise, Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), a gagné 249 conseils locaux sur un total de 340, permettant à l’ancien président et nouvel homme fort du SLPP, Mahinda Rajapaksa, de revenir sur le devant de la scène politique tout en restant, sur les bancs du parlement national, membre de l’opposition.
Après dix ans au pouvoir, Mahinda Rajapaksa avait été battu lors de l’élection présidentielle de 2015, alors que son régime, qui favorisait le népotisme et la corruption, prenait un tournant de plus en plus autoritaire après l’écrasement final (au cours duquel des crimes de guerre furent commis), en 2009, de l’insurrection menée par les Tigres de libération de l’Îlam Tamoul (LTTE, aussi connus sous le nom de Tigres tamouls). Depuis, son ancien allié Maithripala Sirisena occupe la fonction présidentielle. Celui-ci, élu sur des promesses de réformes démocratiques et de fin de la corruption, n’a fait ni l’un ni l’autre. Au lieu de cela, il a prolongé les politiques néolibérales au Sri Lanka, notamment en développant les partenariats public-privé – un compromis permettant à chacun des deux groupes formant l’alliance gouvernementale de prétendre qu’ils sont fidèles à leur idéologie, le SLFP ayant une façade sociale-démocrate tandis que le néolibéralisme de l’UNP est particulièrement agressif.
Le président Maithripala Sirisena doit maintenant gérer une alliance gouvernementale affaiblie, le SLFP et l’UNP se blâmant mutuellement pour leur échec. Dans le même temps, des groupes d’extrême droite organisés autour du fondamentalisme bouddhiste se sont sentis pousser des ailes après la victoire du SLPP et ont mené de graves attaques contre les communautés musulmanes du pays.
Politiques d’endettement public du Sri Lanka
Lors de l’atelier ont d’abord été présentées les politiques d’endettement public du Sri Lanka (en). À hauteur de 7 000 milliards de roupies (47 milliards de dollars US), la dette publique totale du pays représente désormais 81,6 % du PIB , le forçant à consacrer la majeure partie de ses revenus au service de la dette. La dette publique externe représente 36 % du PIB, dont près de deux tiers sont des parts multilatérale et bilatérale. En prenant en compte la dette externe privée (due principalement par des entreprises privées), la dette externe totale représente 57 % du PIB. Son paiement risque de poser des difficultés étant donné les revenus relativement bas du Sri Lanka et la dépréciation régulière de sa devise.
Le Sri Lanka est membre de plusieurs institutions financières internationales représentant ses créanciers multilatéraux, notamment le FMI, la Banque mondiale
et la Banque asiatique de développement. Ainsi, en échange des prêts contractés, les gouvernements de l’île acceptent de mettre en œuvre l’ajustement structurel
réclamé par le FMI. Respectant les exigences du Fonds, le Sri Lanka a développé un modèle économique d’exportation et est poussé à privatiser ses entreprises d’État, ce qui passe notamment par la mise en œuvre des partenariats public-privé. Mais la balance commerciale et la balance des paiements restent fortement négatives, poussant le pays dans un piège de la dette. Jusque-là, le Sri Lanka n’a pas été capable d’attirer assez d’investissements pour développer son économie et faire face à son niveau élevé de dette publique. La principale source de revenus qui maintient l’économie à flot est constituée des envois de fonds de Sri Lankais travaillant à l’étranger, qui représentent désormais plus de 7 milliards de dollars US.
Le FMI a signé un premier accord de prêt avec le Sri Lanka en 2009. Initialement, le gouvernement de Mahinda Rajapaksa ne souhaitait pas s’endetter auprès du FMI et accepter ses conditions. Certainement pas parce qu’il aurait été opposé à la mise en œuvre du modèle économique préconisé par le Fonds, mais parce que cela aurait diminué le budget de l’État, donc la capacité pour ce gouvernement corrompu à financer et soutenir ses fidèles. Finalement, le besoin de financements afin d’écraser la résistance des Tigres tamouls a poussé le gouvernement de Mahinda Rajapaksa à accepter le prêt du FMI – un prêt qui n’a peut-être pas été utilisé directement pour financer les dépenses militaires, mais qui a au moins permis de dégager d’autres ressources pour ces dépenses. Ces politiques d’endettement ne sont pas propres au régime précédent : en 2016, le gouvernement de Maithripala Sirisena a signé un autre contrat de prêt avec le FMI, à hauteur d’environ 1,5 milliard de dollars US.
Historiquement, le Sri Lanka s’endettait principalement auprès de la Banque mondiale et des anciennes puissances coloniales, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Les dix dernières années ont vu s’opérer un changement, de nouveaux créanciers prenant la place des anciens. Le Sri Lanka a commencé à emprunter sur les marchés financiers et auprès de banques commerciales , prenant des risques puisque les taux d’intérêt y sont plus élevés et les périodes de remboursement plus courtes. De plus, sous le gouvernement de Mahinda Rajapaksa, la Chine, l’Inde et la Russie sont devenues des créanciers bilatéraux du pays. Non seulement ces puissances émergentes n’imposent pas les conditions d’ajustement macroéconomique demandées par les puissances du Nord en accord avec les critères du FMI, mais elles sont aussi moins exigeantes que la Grande-Bretagne et les Pays-Bas quant au respect des droits humains dans le pays débiteur (quand bien même ces exigences seraient purement esthétiques). En l’espace de dix ans, la Chine est devenue le premier créancier bilatéral du Sri Lanka. Cette dépendance permet à la Chine de prendre pied dans l’économie sri lankaise et d’y faire avancer ses propres intérêts stratégiques.
Les nouveaux emprunts servent principalement à rembourser les emprunts précédents. En ce qui concerne les investissements, le gouvernement utilise notamment la dette publique pour développer des infrastructures, ce qui permet aux bureaucrates de toucher d’importantes commissions en retour – ce qu’une école ou un hôpital ne permettrait pas. Le paiement de la dette publique du Sri Lanka et la mise en œuvre des politiques dictées par le FMI sont sources d’importantes difficultés pour l’économie et la population. En effet, l’État est ainsi empêché d’investir dans les secteurs productifs afin de développer un modèle de substitution aux importations et de moderniser l’économie du pays (où 80 % de la population est rurale mais l’agriculture représente 8 % du PIB). Cela empêche également l’État de financer correctement les secteurs de l’éducation et de la santé, qui doivent de plus en plus se reposer sur le financement privé par les usagers des services publics.
Prêts et investissements chinois en Asie du Sud
Durant l’atelier ont été débattues les politiques agressives de prêts et d’investissements directs à l’étranger de la Chine en Asie du Sud (Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh et Népal – l’Inde étant quant à elle moins affectée de par ses relations prudentes avec la Chine, sa principale rivale en tant que puissance émergente dans la région et ancienne ennemie). Contrairement aux politiques de prêt des institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, les prêts chinois ne contiennent pas de conditions visant à mettre en œuvre des politiques d’ajustement structurel. Cependant, elles sont généralement accompagnées d’investissements directs de la Chine dans les pays débiteurs. Ces investissements, qui privilégient les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles, sont souvent critiqués en raison des violations du droit du travail et des conséquences en termes de dégradation de l’environnement qu’ils impliquent. Les entreprises chinoises utilisent une force de travail chinoise, dont le lieu de travail est organisé à la manière d’une caserne, si bien que les investissements bénéficient peu aux pays récipiendaires. De plus, les prêts sont souvent garantis par des biens publics des pays débiteurs, ce qui permettrait à la Chine de s’accaparer encore plus de richesses des pays débiteurs si ceux-ci déclaraient un défaut de paiement.
La stratégie de développement actuelle de la Chine va bien au-delà de l’Asie du Sud, étant mise en œuvre dans le cadre large du projet One Belt, One Road (en) (OBOR, aussi connu sous le nom de l’initiative Belt and Road ou, en français, sous celui de la Nouvelle route de la soie). Robin Lee, qui milite dans les mouvements sociaux à Hong-Kong, décrit OBOR de la manière suivante : « OBOR comprend la Ceinture économique de la route de la soie (Silk Road Economic Belt, SREB), reliant la Chine et l’Europe à travers l’Asie centrale et le Moyen-Orient, et la Route de la soie maritime du 21e siècle (21st Century Maritime Silk Road, MSR) menant vers l’Afrique et vers le Pacifique. L’objectif est de construire des réseaux de commerce et d’infrastructure, prenant avantage des routes internationales de transport, des villes centrales et des ports. » Robin Lee ajoute : « Les secteurs clés pour la construction et les investissements sont les ports, les centrales énergétiques, les oléoducs et gazoducs, les lignes de chemin de fer, les routes, les ponts, les réseaux internet et l’agriculture. [1] » La Chine exporte agressivement ses capitaux à l’échelle mondiale, avec pour objectifs de construire et de contrôler d’importantes routes commerciales et de prendre pied dans le plus grand nombre possible de marchés nationaux. Cela soulève des inquiétudes liées aux impacts sociaux et environnementaux du projet ainsi qu’aux relations de domination que cela créera pour les pays dont les économies sont faibles.
En Asie du Sud, le Pakistan est le pays où le projet OBOR est le plus développé à ce jour : le corridor économique sino-pakistanais (China-Pakistan Economic Corridor, CPEC), désormais intégré au cadre OBOR, est antérieur à ce dernier. Le CPEC est l’un des six corridors économiques (qui s’étendent à travers l’Asie et l’Europe) du projet OBOR, et « s’étend sur 3 000 kilomètres entre Kashgar en Chine occidentale et le port de Gwadar au Pakistan. Le long du corridor, d’imposants projets d’infrastructure sont en cours de préparation et de construction, comprenant des routes, des voies de chemin de fer, des centrales énergétiques ainsi qu’un réseau de câbles à fibre optique. Ces projets sont largement financés par des capitaux et des prêts chinois. » [2] Gwadar est un port maritime situé en eau profonde et bénéficiant d’un accès direct au golfe arabo-persan. L’accès au port et son contrôle présentent ainsi un intérêt géostratégique puisqu’ils permettent un accès facilité vers la péninsule arabique et vers l’Afrique. Les activités du port sont désormais opérées par une entreprise d’État chinoise. Le CPEC est source d’un alourdissement de la dette externe du Pakistan (en) à l’égard de la Chine, dans une période où la dette publique pakistanaise provoque des inquiétudes (afin d’obtenir des prêts d’institutions financières internationales, le pays a dû récemment hypothéquer des biens publics tels que des autoroutes ou des aéroports). Les entreprises chinoises actives dans le développement du CPEC ne font pas appel aux entreprises pakistanaises et leur main-d’œuvre vient de Chine. Dans le même temps, ces entreprises chinoises bénéficient d’exemptions de taxes et de violations des règles d’attribution des marchés publics, la Chine exerçant sur le Pakistan un chantage par la dette afin que les entreprises chinoises obtiennent certains contrats.
Un exemple récent des politiques prédatrices de la Chine en Asie du Sud n’est pas passé inaperçu au Sri Lanka, en lien avec les infrastructures de Hambanthota, une ville située au Sud du pays. Des entreprises d’État chinoises y ont construit un port maritime situé en eau profonde et rénové un aéroport à proximité. Ces deux projets ayant à peine servi, ils ont causé des pertes importantes pour les autorités sri lankaises qui les géraient et devaient rembourser la dette contractée pour les travaux de construction. En 2017, la Chine et le Sri Lanka ont signé une conversion de dette d’un montant de 8 milliards de dollars US, permettant à une entreprise d’État chinoise d’acquérir 70 % des parts du port afin de gérer ses activités pour une durée de 99 ans ! Lorsqu’elle avait été annoncée en 2016, cette conversion de dette avait provoqué de vives protestations dénonçant le non-respect de la souveraineté du Sri Lanka par la Chine. Maigre consolation, ces manifestations ont conduit à la diminution des parts chinoises dans les affaires du port, initialement prévues à 80 %. Il ne fait aucun doute que la Chine sera capable de développer le port afin de l’utiliser le plus possible dans le cadre de sa stratégie OBOR… avec peu de bénéfices à la clé pour le Sri Lanka.
Dettes des grandes entreprises et secteur bancaire
Avant d’aborder le sujet des dettes privées, les participant-e-s ont discuté des perspectives – peu positives – quant à l’évolution de la situation financière mondiale en lien avec les dettes des grandes entreprises, et des risques que cette situation fait porter sur l’économie réelle. Depuis 2010, les politiques de bas taux d’intérêt pratiquées par les banques centrales ont permis aux grandes entreprises privées d’augmenter massivement leur endettement sur les marchés financiers, par l’émission d’obligations d’entreprises. Aux États-Unis, la dette des entreprises non-financières a augmenté de 7 800 milliards de dollars US (ce qui représente environ sept fois la dette publique totale de l’Inde) ! Ces énormes dettes ne créent pas valeur réelle puisqu’elles ne sont pas investies dans des activités productives. Les grandes entreprises utilisent l’argent emprunté afin de racheter leurs propres actions
. De cette manière, elles peuvent rémunérer leurs actionnaires sans que ces derniers soient soumis à un impôt sur un revenu. Cela permet également de faire monter le cours des actions. Ainsi, la valeur de ces entreprises en bourse augmente artificiellement, sans lien avec leur situation dans l’économie réelle. Une imposante bulle boursière s’est donc développée ces dernières années. De plus, ces grandes entreprises utilisent également l’argent emprunté afin d’acheter les obligations émises par d’autres acteurs (obligations d’entreprises, produits structurés tels que les asset-backed securities et mortgage-backed securities, des obligations d’acteurs publics tels que les municipalités) à une très large échelle : les trente principales entreprises non-financières des États-Unis actives dans le marché des dettes détiennent ensemble 423 milliards de dollars US de dettes d’entreprises privées, 369 milliards de dollars US de dettes publiques et 40 milliards de dollars US de produits structurés. Cherchant les meilleurs rendements, ces grandes entreprises sont poussées à investir dans la dette d’entreprises relativement fragiles. Si ces entreprises faisaient défaut sur le paiement de leurs dettes, cela pourrait facilement conduire à des défauts en chaîne de la part des grandes entreprises. Cette bulle du marché des obligations d’entreprises pourrait exploser rapidement si les banques centrales décidaient d’augmenter leurs taux d’intérêt.
Le cas de l’Inde (en) a illustré les risques liés à la dette des grandes entreprises. La récente escroquerie à la Punjab National Bank (affaire dans laquelle un magnat du diamant, Nirav Modi, a pu détourner 1,77 milliard de dollars US de la deuxième plus grande banque du pays, avec la collusion de responsables de l’établissement) a mis en lumière le manque de contrôle exercé par les agences de régulation gouvernementales. Cette escroquerie ne constitue pas un cas isolé, et la situation actuelle en lien avec les prêts non-performants (non-performing loans, NPLs, aussi dénommés non-performing assets) des banques indiennes est révélatrice des comportements abusifs de grandes entreprises privées. Les NPLs s’élèvent désormais à 145,6 milliards de dollars US, soit 12,6 % de l’ensemble des prêts. Il s’agit largement de crédits accordés à de grands conglomérats d’affaires. En Inde, le secteur public bancaire domine l’industrie bancaire, et est ainsi le premier concerné par ces prêts non-performants. Les grands capitalistes et d’importants membres du gouvernement central d’extrême-droite saisissent l’occasion pour dénoncer la prétendue inefficacité des banques publiques et prôner leur privatisation. En vérité, ces NPLs sont largement dus à la prégnance du capitalisme de connivence dans le pays : des prêts importants ont été distribués sans compter à des politiciens et à des conglomérats d’affaires soutenus par ceux qui sont au pouvoir. Certaines grandes entreprises empruntant de l’argent font maintenant défaut volontairement, sachant qu’elles pourront s’en tirer puisque le gouvernement qui les soutient recapitalisera les banques grâce à de l’argent public – il s’agit d’une socialisation de pertes privées. La porte de sortie de crise ne se trouve pas dans la privatisation de ces banques publiques, mais dans leur transformation de banques gérées à la manière du privé en réelles banques publiques qui se chargent de délivrer un service à la collectivité. Les contrôles et les pouvoirs de régulation des autorités devraient être renforcés et respectés. Au-delà de ces mesures d’urgence, nous devrions lutter pour la socialisation du secteur bancaire, à travers laquelle les citoyen-ne-s, les responsables politiques démocratiquement élu-e-s et les employé-e-s de banques décideraient ensemble du fonctionnement du système de crédit.
Microcrédit au Sri Lanka
Au Sri Lanka, l’emprise de la microfinance sur les populations provoque une situation extrêmement alarmante, dans laquelle on retrouve les effets les plus pervers des prêts de microcrédit. Au Nord et à l’Est du pays (les régions où la population est majoritairement tamoule et qui ont été les plus touchées par la longue guerre civile), la microfinance n’existait pas avant la fin de la guerre en 2009. Dans ces zones, où de nombreux individus sources de revenus pour les ménages sont morts et où de très nombreuses personnes ont perdu leurs habitations et leurs terres en raison des déplacements forcés et des destructions, la microfinance s’est développée rapidement après la fin de la guerre (tout en continuant son développement dans le reste du pays), rendant ses effets particulièrement aigus et visibles. Comme dans le reste du monde et en particulier dans les pays du Sud, les prêts de microcrédit ont été présentés comme la meilleure solution pour parvenir à la résilience et au développement. Et, comme dans le reste du monde, les prêts de microcrédit ont en réalité apporté plus de désespoir et de marginalisation.
Alors qu’on a fait la publicité des prêts de microcrédit comme étant de petits prêts permettant aux personnes pauvres de devenir entrepreneurs, de gérer de petites affaires et de sortir de la pauvreté, il est clair que les emprunteuses et emprunteurs de microcrédit au Sri Lanka contractent des prêts afin de financer des besoins de nécessité tels que des produits de consommation de base, des dépenses en frais de santé ou d’éducation, ou encore le loyer de leur habitation. Comme dans le reste du monde, une grande majorité des personnes contractant des emprunts sont des femmes qui travaillent dans le secteur informel ou dont le travail n’est pas reconnu comme tel, et qui n’ont donc pas ou peu de revenus. Plusieurs d’entre elles ne sont pas informées des conditions de l’emprunt au moment de signer leur contrat. La plupart d’entre elles ne connaissent pas les taux d’intérêt auxquels elles ont contracté leurs emprunts, et savent seulement le montant des remboursements qu’elles doivent effectuer à intervalles réguliers. Celles qui sont informées des taux d’intérêt n’ont accès qu’aux taux officiels communiqués par les agences de microfinance – qui s’élèvent aux alentours de 20 à 28 %. De tels taux sont abusifs, mais les taux d’intérêt réels sont encore plus élevés.
Les taux d’intérêt réels sont clairement abusifs, s’élevant généralement entre 60 et 70 % (mais ils peuvent dépasser les 100 % dans certains cas). Cela ne peut qu’amener les emprunteuses et emprunteurs à tomber dans un piège de la dette, d’autant plus qu’elles et ils manquent de revenus. Afin de rembourser leurs dettes, les victimes du microcrédit doivent contracter de nombreux emprunts supplémentaires auprès d’autres agences de microfinance, de voisins ou d’usuriers locaux. L’un des arguments utilisés afin de promouvoir le microcrédit était que cela mettrait fin à l’existence de tels prêteurs usuriers. En réalité, le microcrédit a donné naissance à des réseaux entiers de ces prêteurs.
Étant donné le harcèlement des créanciers et la pression sociale exercée par les familles, ami-e-s et voisin-e-s des emprunteuses, les taux de défaut de paiement sont très bas. Afin de ne pas faire défaut, les victimes doivent réaliser d’importants sacrifices qui mettent en danger leurs vies et celles de leurs familles : hypothéquer ou vendre leurs habitations ou leurs terres (qui peuvent être source de nourriture pour les ménages) lorsqu’elles en possèdent, ou bien renoncer à se nourrir.
À Jaffna, la principale ville du Nord du pays, les femmes victimes de l’arnaque du microcrédit ont organisé une manifestation qui a réuni plus de 2 000 personnes en février 2018. Elles exigent la mise en œuvre d’un moratoire sur leurs prêts, ou même leur annulation, ainsi que l’introduction et la généralisation d’autres formes de crédit qui seraient justes et régulées. Certaines des victimes essaient de construire des alternatives au microcrédit à travers la création de coopératives. L’élan du mouvement de résistance au microcrédit n’est pas encore très fort au Sri Lanka, mais celui-ci est porteur d’espoirs pour le futur puisque le discrédit de la microfinance semble de plus en plus partagé dans le pays.
Perspectives pour la résistance à la dette dans la région
D’autres sujets ont été présentés et discutés lors de cet atelier, tels que la situation précaire dans laquelle se trouvent les paysans du Sri Lanka, d’Inde, du Pakistan en raison des politiques néolibérales qui les ont poussés dans l’endettement ; les dangers que portent les banques de développement multilatérales existantes et la forme que pourrait prendre une vraie banque de développement ; ou encore le problème des dettes étudiantes au Japon.
Des perspectives d’actions concrètes contre les dettes illégitimes ont été soulevées. À l’échelle du Sri Lanka, un réseau va se développer afin de travailler sur ces sujets, et en particulier pour combattre le microcrédit. Les membres du CADTM ont mis en avant la perspective d’auditer les dettes publiques et privées, et notamment le microcrédit. Un tel audit, initié par les victimes de la dette et les militant-e-s actifs
sur ces questions, pourrait aider à l’établissement d’un rapport de forces en faveur des emprunteuses et emprunteurs afin de suspendre les remboursements et de répudier les dettes illégitimes. Cela nécessite un fort niveau d’organisation face aux créanciers et aux autorités – nous espérons que cet atelier a contribué à avancer vers cet objectif.
Ainsi de nombreux et nombreuses militant-e-s, venant de différents pays et engagés dans différentes luttes en faveur de l’émancipation des peuples, se sont réuni-e-s durant trois jours pour s’organiser contre les politiques d’endettement. C’est un succès en soi. Le capitalisme et le système dette qui en fait partie ne connaissent pas de frontières : il est donc nécessaire de s’unir au niveau international pour les combattre !
Ce texte est en grande partie basé sur les apports des participant-e-s – en particulier Sushovan Dhar, Niyanthini Kadirgamar, Abdul Khaliq, B. Skanthakumar, Éric Toussaint – lors du 7e atelier régional du CADTM Asie du Sud qui s’est tenu du 6 au 8 avril 2018, ainsi que sur des discussions que nous avons eues le 11 avril 2018 avec des femmes sri lankaises victimes du microcrédit. Merci à toutes ces personnes.
Notes
[1] China’s overseas expansion – An introduction to its One Belt, One Road and BRICS strategies. URL : http://www.cadtm.org/China-s-Overseas-Expansion-An (en)
[2] Ibid.


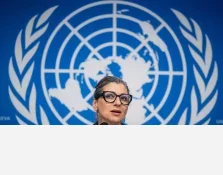



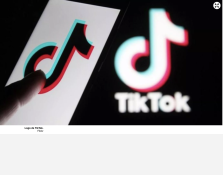



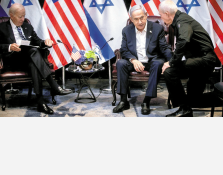

Un message, un commentaire ?