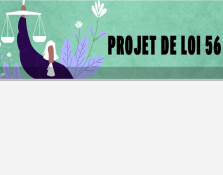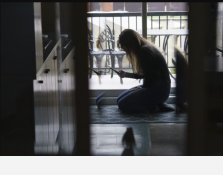Vous avez fait savoir votre agacement lorsqu’on vous somme d’expliquer de quelle manière vous « articulez » féminisme et combat social. Peut-on commencer là-dessus ?
Sauf pour les militants socialistes ou marxistes les plus orthodoxes, ils ont un peu arrêté. Pour les gens de gauche, qu’ils soient théoriciens ou non, c’était une façon d’évacuer le féminisme en nous demandant, en effet, de quelle façon nous l’articulions avec l’anticapitalisme. Et si nous n’y arrivions pas, nous étions éjectées. Ma réponse était : il faut déjà admettre qu’il y a une exploitation patriarcale car, pour ma part, j’ai toujours été d’accord sur le fait que le capitalisme existait. J’attendais donc le jour où ils allaient admettre l’existence du patriarcat. Pourquoi était-ce forcément à nous de chercher cette articulation ; pourquoi n’avaient-ils pas, eux, à chercher – à trouver, même – la manière d’articuler l’anticapitalisme au féminisme ? Au fond, ce n’était rien d’autre qu’une tactique pour évacuer la question de l’exploitation des femmes.
C’est une querelle dépassée ?
En partie, oui. À cause des rapports de forces. Regardez la façon dont, aujourd’hui, on parle des musulmans et de l’islam ; on demande systématiquement si l’islam est compatible avec la démocratie. Imaginons un rapport de forces inversé : on pourrait se demander si la démocratie est compatible avec l’islam. Qui pose la question à qui ?
Dans les deux tomes de L’Ennemi principal, vous évoquez les féministes d’extrême gauche qui refusent d’avoir à traiter avec les « femmes bourgeoises » au nom de la seule défense des femmes ouvrières. En quoi cela vous posait-il problème ?
« Il faut déjà admettre qu’il y a une exploitation patriarcale car, pour ma part, j’ai toujours été d’accord sur le fait que le capitalisme existait. »
Pour les mêmes raisons. C’était une manière d’évacuer une question plus profonde, celle de l’oppression des femmes en tant que femmes. Il fallait donc dire qu’il n’existait aucune unité entre les femmes, en leur sein, en tant que classe de femmes. Elles refusaient de voir la caractéristique qui les unissait – d’autant qu’une bourgeoise ne l’était que par la classe de son mari ! Bien sûr que les femmes ne forment pas un groupe homogène, mais quel est celui qui l’est ? Cela dit, de nos jours, je pense qu’on n’évoque plus le débat en ces termes – je m’exprimais là dans les années 1980 et 1990. Rosa Luxemburg, par exemple, qui traitait les « femmes bourgeoises » de « parasites » et estimait n’avoir rien à faire avec elles, devait prouver qu’elle était du « bon côté » et, pour ça, tenait à se désolidariser complètement et violemment des bourgeoises : oui, elles étaient des parasites, c’est vrai, mais comme l’étaient les grands valets de pied décrits par Proust que l’on payait pour être décoratifs ! Mais ça ne veut pas dire qu’ils étaient libres…
Angela Davis disait ne pas se reconnaître, quand elle commença à militer, dans ce qu’elle appelait les féministes bourgeoises, blanches, etc.
Elle était au Parti communiste, il était donc normal qu’elle ne se sente aucune affinité avec. Les divisions de genres n’étaient pas encore reconnues. Si vous ne connaissez pas cette division, vous ne pouvez pas identifier les points communs qui existent dans une même classe de genre : vous êtes obligée d’admettre que, oui, d’accord, les femmes ont un sort un peu plus dur que les hommes de la même classe sociale, mais votre univers théorique, et donc votre vision au quotidien, reste orientée vers une seule et même division : bourgeois et prolétaires. Elle ne dirait sans doute plus la même chose aujourd’hui.
Dans le Manifeste du parti communiste, Marx et Engels évoquent de façon positive le patriarcat. Ils parlent des relations « patriarcales et idylliques » que la bourgeoisie a détruites au profit du « calcul égoïste » et du « paiement comptant ». Comment percevez-vous ça ?
Ce n’est pas que Marx, d’ailleurs : Victor Hugo et d’autres en font le même usage à cette période. Le patriarcat n’était pas une époque de l’Histoire mais la reconstitution d’une vie rurale, centrée autour de la famille, avec un chef bienveillant à barbe blanche et une économie frugale.
Dans un de vos textes, vous avez séparé le féminisme socialiste du féminisme radical. Tout en vous réclamant du second et en vous revendiquant du marxisme et du matérialisme. Pour les personnes extérieures à ces questions, ces mots sonnent souvent comme bonnet blanc et blanc bonnet !
« J’ai toujours lutté pour qu’aucune femme ne puisse être rejetée du mouvement, sur quelque base que ce soit. »
Il faut dire en plus que le mot « radical » a un sens différent dans chaque pays ! Il n’est pas le même en France, aux États-Unis, etc. La notion de féminisme radical, c’est un petit groupe, dont j’étais, qui l’a mise en circulation en France. Je venais, avant cela, d’un groupe qui se nommait, au début des années 1970,« Féministes révolutionnaires ». Il y avait différentes tendances au sein des mouvements féministes à cette époque. Notre position à nous était de dire : nous prenons toutes les femmes, nous refusons d’en exclure certaines pour des raisons sociales ou économiques, nous refusons d’en laisser sur le bord de la route. J’ai toujours lutté pour qu’aucune femme ne puisse être rejetée du mouvement, sur quelque base que ce soit. Ce qui m’a d’ailleurs conduite à m’opposer à quelques groupes de lesbiennes radicales qui estimaient que les femmes hétérosexuelles étaient des « collaboratrices » de l’ordre patriarcal. J’ai lutté contre ça à l’intérieur même de ma propre revue, qui a éclaté à cause de ça – c’est pour cette raison qu’elle est passée de Questions féministes à Nouvelles questions féministes. Et, de la même façon, je lutte contre l’idée que les femmes musulmanes, parce qu’elles portent un foulard, doivent être exclues de l’école ou des mouvements féministes.
Vous vous diriez toujours « révolutionnaire » ?
Militer, c’était cafés, bières, cigarettes, et des réunions interminables… Mais j’ai arrêté de fumer ! (rires) Militer, à cette époque, c’était tous les soirs. Mais oui, je continuerais à me définir comme ça. Et encore plus maintenant. Ce mot n’est pas passé de mode ; il ne signifie pas massacres et camps. Il renvoie à un changement radical. Et, justement, comme nous ne voulions pas reprendre le mot « révolutionnaire », car ce groupe avait cessé de fonctionner, on a parlé de« féminisme radical ». Mais c’était la même idée – « radical », c’est prendre les choses à la racine.
Votre article sur les femmes et l’Afghanistan a fait date. Vous l’aviez publié dans Le Monde diplomatiqueen 2002. Puis vous vous êtes impliquée, en 2004, sur la loi contre les signes ostentatoires à l’école, jusqu’à devenir une des voix les plus entendues du féminisme sur ces questions, liées, d’une façon ou d’une autre, aux musulmans…
… Car ce sont celles qui se posent ! Le féminisme n’a pas un chemin tracé d’avance – sauf pour les sectaires qui restent coincés sur des questions qui n’ont plus de sens à l’heure qu’il est. On avait fondé la Coalition internationale contre la guerre – qui a compté jusqu’à douze personnes, quand même ! (rires) Je voyais les images tourner en boucle sur ma télévision, je devenais folle : personne ne disait rien sur les déclarations ahurissantes de Bush et sur la guerre que l’on sentait arriver. En rentrant à Paris, j’ai contacté Willy Pelletier et on a écrit un texte. J’avais employé le mot « impérialiste » mais il le trouvait un peu vieux jeu : le mot n’était plus employé nulle part ! Y compris à gauche. C’était trois semaines après les attentats du 11 septembre. On nous a reproché, à la première lecture devant la fondation Copernic, de ne pas faire preuve de compassion à l’endroit des victimes. Mais il n’y avait que ça, depuis trois semaines, de la compassion ! On pouvait en faire six volumes. On était d’accord, mais rien n’obligeait à commencer, nous aussi, par une prière. On nous a dit que la guerre n’aurait peut-être pas lieu. Bien sûr qu’elle allait éclater ! On a donc monté cette coalition, avec Daniel Bensaïd, Jacques Bidet, Catherine Lévy, etc. Internet était encore sous-développé ; je regardais la BBC, je lisais The Guardian et The Independent. Je lisais aussi beaucoup les travaux de Robert Fisk. Il fallait donner une contre-information face au déluge d’informations proatlantistes qui inondait la France. La presse française n’avait même pas de correspondants en Afghanistan, ni même au Pakistan ! Les journalistes envoyés ne connaissaient rien à l’histoire de l’Afghanistan, et ça n’a pas changé. Prenez seulement la burqa : comme si elle était l’œuvre des talibans !
Dans le film Je ne suis pas féministe, mais..., vous parlez de la dimension « totalitaire » d’une certaine forme de laïcité et…
… Oui, ce que les laïcards appellent « la laïcité à la française » ! Pas la laïcité en tant que telle. Elle est un dévoiement de la laïcité. Je ne suis pas la seule à le dire : le sociologue Jean Baubérot, qui n’est pas un extrémiste, parle lui aussi de « laïcité falsifiée ». Elle n’a plus rien à voir, malheureusement, avec la loi de 1905, qui, au contraire, garantit la liberté religieuse et la liberté d’opinion. On parle tout le temps de liberté d’expression, on défile pour ça dans les rues suite aux attentats contre Charlie Hebdo, mais leur liberté d’expression ne concerne pas celle d’être religieux ! En tout cas, de croire en une religion particulière : l’islam. L’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est clair là-dessus : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé. » C’est simple, ça prend trois lignes. Mais le nouveau catéchisme nous explique que la religion doit rester dans le privé. Pas du tout ! Dire qu’on est libre de faire ce qu’on veut dans le privé, ce n’est pas de la liberté : chacun est déjà libre de faire ce qu’il veut dans sa salle de bains. Et Hollande est même allé jusqu’à dire que la religion était de l’ordre de l’intime ! Où a-t-il vu ça ? Il n’est pas capable de payer un conseiller pour lire les textes fondateurs ? Je m’excuse, mais pratiquer sa religion, ce n’est pas comme sa toilette intime ! On devrait donc pratiquer sa religion dans un bidet ? (rires)
Dans Classer, dominer, vous imaginez un féminisme qui puisse être avec et non pas contre l’islam. Que faites-vous de ces féministes, comme l’anarchiste Emma Goldman, qui considéraient la religion comme une source d’oppression et d’aliénation des femmes, et qu’il fallait en finir avec les religions pour libérer les femmes ?
« Le nouveau catéchisme nous explique que la religion doit rester dans le privé. Pas du tout ! Dire qu’on est libre de faire ce qu’on veut dans le privé, ce n’est pas de la liberté. »
Ou bien on prend le monde tel qu’il est, et on essaie de le changer – pacifiquement, si possible –, ou bien on essaie d’éliminer les religions – mais on a vu ce que cela donne, en Union soviétique ou ailleurs : l’Église devient un lieu de résistance contre la tyrannie d’État. On n’y peut rien, la plupart des gens dans le monde ont foi en une religion. Alors, sauf à vouloir les éliminer, il faut faire avec… Ou on travaille avec la réalité, ou on est dans l’imaginaire. Et je vous dis ceci alors que, personnellement, je ne crois pas en Dieu. Il y a quelque chose de ringard dans ce débat. On retrouve les mêmes choses avec les femmes musulmanes, aujourd’hui. On parle d’elles sans leur parler. Ce sont des femmes comme les autres. Ils disent qu’elles veulent rester au foyer mais les mêmes veulent les virer des universités – pourquoi y vont-elles si elles n’ont pas l’intention de travailler ? On a créé un collectif qui s’appelle le Collectif des féministes pour l’Égalité, avec des femmes qui portent le foulard et d’autres non.
Comment réagissez-vous lorsque vous entendez des femmes, issues de milieux musulmans, qui dénoncent violemment le voile comme symbole sexiste et patriarcal (elles sont nombreuses, mais l’exemple le plus célèbre est sans doute le petit pamphlet Bas les voiles ! de l’écrivaine franco-iranienne Chahdortt Djavann) ?
On dit, à propos du foulard : « Il y a des pays où on oblige à le porter. » Mais nous parlons de la France, du cas français, de jeunes filles françaises et de l’école française ! Le voile n’est pas obligatoire ici, à ce que je sache. On ne peut pas mélanger les plans, les temps et les territoires. Est-ce parce que le voile est obligatoire en Iran qu’il faut l’interdire en France ? Dans certains pays, l’eau n’est pas potable ; est-ce une raison pour ne pas en boire au robinet ici ? C’est le message que j’ai le plus de difficultés à faire passer. Et j’aurais un tout autre discours si je vivais en Iran, justement : je m’adapte à la température locale. On demande aussi si le voile est avant tout culturel ou religieux. Prenez la cathédrale de Chartres et faites savoir que vous allez la détruire : vous croyez que seuls les catholiques vont s’indigner ? Bien sûr que non. On va dire que ça fait partie du patrimoine architectural commun. Donc à quel moment un symbole religieux devient-il un symbole culturel ?
Vous acceptez qu’une femme puisse porter le voile au nom du libre choix, mais vous semblez contester le libre choix d’une femme qui tient à se prostituer : certain.e.s vous reprochent cette position.
Il semble que ça soit à la mode de lier ça ! Je ne suis pas d’accord ; ça ne relève pas du même ordre. Il n’est pas question, à mes yeux, d’interdire aux femmes de se prostituer. Seulement de pénaliser les clients. On m’objecte ce sophisme : pénaliser les clients, c’est pénaliser les prostituées. Comme si, du jour au lendemain, il n’y aurait plus de clients ! J’entends ça sans arrêt. On dit que ça conduira les prostituées vers des endroits plus dangereux, comme si un endroit était, en soi, dangereux : il l’est parce que des gens le rendent dangereux. Autrement dit : le danger potentiel pour une prostituée, c’est donc de se retrouver seule avec un homme, un client. Dans les bordels allemands, il existe des « boutons de panique » dans les chambres. Pourquoi ? On nous dit pourtant que c’est un endroit surveillé, prévu pour ça. Le danger, c’est donc le client – et ça, les défenseurs de la prostitution ne veulent pas l’admettre. Le livre Elles ont fait reculer l’industrie du sexe explique les résultats concrets des pays scandinaves en matière d’abolitionnisme : aucun client n’a été en prison, ils ont seulement eu des amendes. Mais ça commence à changer la vision des gens sur l’achat de services sexuels. Notre idée, en soutenant cette loi de pénalisation, est d’entamer une rééducation du pays – mais douce, pas comme les camps viêtnamiens (rires). La honte doit changer de bord.
Acceptez-vous le terme de « travailleurs du sexe » que le syndicat du STRASS utilise ?
« La prostitution nuit à toutes les femmes, et pas seulement à celles qui la pratiquent, car elle induit une croyance : celle que les hommes ont un droit d’accès au corps des femmes. »
Non, non, non ! Ce n’est pas un travail comme un autre. Est-ce qu’un esclave est un travailleur comme un autre ? Je dis simplement : il ne vaut mieux pas que ça devienne « un métier comme un autre », mais il ne faut pas l’interdire. Si c’est un métier comme un autre, comme ils le disent, il est très spécial : il est réservé aux femmes et on ne peut pas le dissocier de l’oppression et de l’exploitation économique des femmes.
Il y a aussi des hommes prostitués. À commencer par Thierry Schaffauser, qui a écrit La Lutte des putes.
Les femmes sont la grande majorité, tout le monde le sait. Vous savez combien ils sont au STRASS ? Faut pas se foutre du monde ! On en fait des tartines avec eux, comme s’ils représentaient quelque chose. Et je dis bien « ils », car ils comptent beaucoup d’hommes et de transsexuels. Ce qu’on pourrait faire, d’un point de vue légal, c’est augmenter les aides pour permettre aux prostituées, femmes, hommes et transsexuels, de trouver d’autres professions. 90 % des prostituées, ici, sont issues de la traite (des femmes d’Europe de l’Est, d’autres d’Afrique noire – avec ce que ça comporte d’atrocités, de menaces et de réseaux mafieux) : pourquoi les défenseurs de la prostitution ne parlent-ils, systématiquement, que des 10 % (ou 8, ou 12, qu’importe) de prostituées volontaires ? D’autant que les policiers estiment que ce n’est pas possible de rester dans la rue plus de six mois sans proxénète. La prostitution nuit à toutes les femmes, et pas seulement à celles qui la pratiquent, car elle induit une croyance : celle que les hommes ont un droit d’accès au corps des femmes. Pénaliser permettrait de diminuer ce privilège. Sans parler du fait que je trouve immoral qu’on puisse acheter des individus.
Les anti-abolitionnistes vous diront que vous tombez là dans le « moralisme ».
Une politique a toujours une morale ! La protection des ouvriers, leur défense en cas de licenciements, leurs conditions de travail, ce n’est pas une morale, ça ? Tout a une dimension morale.
Vous avez fait état de votre désaccord avec Judith Butler, quant à son rapport à la domination, au pouvoir et à la sexualité. D’autres divergences vous séparent-elles de sa pensée ?
Butler ne parle jamais des conditions matérielles, de l’oppression économique. Tout ça n’existe pas pour elle. Elle ne considère que la domination sur un plan idéologique. C’est le problème du postmarxisme, aux États-Unis et maintenant en France. Butler écrit des choses parfois stupéfiantes : on pourrait ne plus consentir à la violence – il y a des tas de cas où l’agresseur ne se soucie pas vraiment du consentement… Je conteste aussi sa vision du genre, dans sa vision queer : elle ne veut pas abolir les genres, elle est très claire là-dessus, elle veut les élargir, les « brouiller ». Imaginez que vous parliez comme ça des classes. On « brouille » les classes ? Un patron passe une heure comme fraiseur et un ouvrier une heure en réunion avec d’autres patrons ? Il ne faut pas « brouiller » les lignes : il y a un système d’oppression, il faut le démolir. Je suis un petit peu carrée là-dessus. Butler ne veut pas détruire la division de genres mais la rendre moins « binaire » (tous les queers parlent sans cesse de « binarité ») : il y en aurait cinquante, des genres, que ça serait la même chose ! Aux États-Unis ou au Brésil, il y a des gens de toutes les couleurs mais, au final, ça va de blanc à noir. C’est une seule dimension sur laquelle vous pouvez avoir des notes différentes, mais la notation existe : il vaut mieux être tout blanc.
Vous sentez-vous minoritaire, voire mise à la marge, dans le féminisme contemporain ?
Oui et non. Commençons par le plus évident : je suis entre deux chaises. Je ne suis pas d’accord avec les mouvements anti-foulard (comme la Marche mondiale des femmes, le Collectif national pour les droits des femmes – même s’ils sont peut être en train de changer) et, d’un autre côté, bien des femmes que je connais, et qui sont favorables au droit de porter le foulard, sont favorables à la prostitution (et, donc, contre la pénalisation)… Je suis minoritaire dans tous les groupes. Ce qui m’empêche parfois d’aller dans un endroit ou dans un autre.
Vous aviez critiqué Bourdieu comme faux-ami de l’émancipation féminine. Il existe une querelle terminologique : un homme peut-il être « féministe » ou doit-il seulement se dire « pro-féministe » ?
« Je suis minoritaire dans tous les groupes. Ce qui m’empêche parfois d’aller dans un endroit ou dans un autre. »
Les hommes vraiment féministes que je connais – il n’y en a pas des masses – se déclarent d’eux-mêmes pro-féministes. Ils estiment qu’ils ne peuvent pas être dans les chaussures d’une femme, et c’est vrai. Ils essaient donc de faire leur part et, surtout, de ne pas parler à la place des femmes – ce que j’avais pointé du doigt dans mon texte « Nos amis et nous ». Et Bourdieu, c’était ça ! Il parlait de domination et non d’exploitation, de violence symbolique (comme si les femmes ne recevaient pas des coups !), et il déniait aux femmes la capacité d’analyser leur propre oppression – car elles seraient aliénées.
Vous avez dit : « Je vois plus ce qui manque que ce qui a été fait. » Concluons cet entretien sur « ce qui manque », justement…
Oui, je me dis ça, quand je vois comment, encore, les femmes sont traitées. Quand je vois que la majorité des prostituées et des enfants abusés sont des femmes ou des filles, que 80 % du travail à la maison est assuré par les femmes, quand je vois qu’elles sont moins payées que les hommes… Les éléments ne manquent pas. Mais les gens ne s’en rendent pas compte ; ils ne savent toujours pas ce qu’est l’oppression des femmes.
Source : Ballast (http://www.revue-ballast.fr/christine-delphy/)