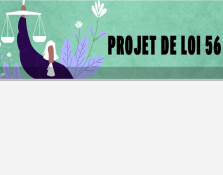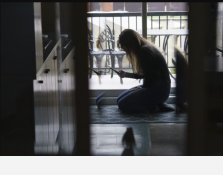Sylvia Duverger. Dans les textes rassemblés dans Classer, dominer, Qui sont les autres ? (La Fabrique éditions, 2008), vous avez montré comment la société française produit des « autres » qu’elle discrimine - femmes, noir.es et arabes, homosexuels et lesbiennes.
Les femmes portant un foulard ou un voile sont doublement altérisées : elles demeureraient, dit-on, assujetties au patriarcat islamique tandis que les compagnes des hommes blancs – ces êtres humains paradigmatiques – se seraient libéré de toute emprise masculine.
Le port du voile intégral est sanctionné depuis 2011 dans l’espace public en France – les gares, squares, magasins, etc., même la rue, en fait partout sauf dans les maisons privées –, mais celles qui en ont fait le choix – et c’est semble-t-il le cas de la majorité des Françaises qui revêtent un niqab ou un sitar [1] –, refusent d’y renoncer. Comment expliquez-vous cette résistance ? Pourrait-elle s’interpréter comme une visibilisation de l’altérisation et des discriminations ?
Christine Delphy. Le port du voile intégral est un phénomène très récent. Il est pratiqué par une population différente de celle qui porte le foulard. D’abord, elle est infiniment plus petite que la seconde. Ensuite elle est plus jeune. Enfin, elle est composée, au moins pour un tiers, de femmes qui ne sont pas descendantes de colonisé.es, par des « Françaises de souche » – ce qui est un euphémisme pour « Blanches » [2] ; des femmes donc qui étant classées par la population dominante comme faisant partie d’elle-même, ne sont pas atteintes par le stigmate raciste, ne sont pas « altérisées ».
On a donc affaire à une variété de situations, et partant, de motivations personnelles possibles.
Le contexte historique cependant est le même pour toutes : l’apparition de jeunes femmes nées en France, et citoyennes françaises, portant le niqab, se produit quelques années après l’interdiction du foulard dans les écoles publiques. Avant cette interdiction, on ne voyait pas de « niqab ». Après cette interdiction et l’exclusion de nombreuses jeunes filles des lycées et collèges, on voit le port du foulard, de l’objet interdit, non pas diminuer dans la rue, mais au contraire augmenter. Ce qui est une réaction qu’on pouvait attendre au tort fait aux collégiennes et lycéennes. Une réaction classique pourrait-on dire, de la part d’une population dominée, qui n’a pas les moyens politiques et sociaux d’une protestation juridique ou de rue, car elle est en fait – et contrairement à ce qu’on dit de son « communautarisme » supposé – très peu, voire pas, organisée.
Le caractère de protestation du foulard, puis, quand celui-ci est interdit dans les lycées, du niqab, est clair. Cette protestation contre le racisme prend des formes différentes de celle de groupes qui ont des organisations fortes, et peuvent se faire entendre des médias et des dirigeants politiques. Le racisme subi n’est souvent même pas invoqué parmi les raisons données par les individues de leur nouvelle façon de se vêtir.
Car l’exclusion, la discrimination, la marginalisation, ne sont pas vécues directement comme telles par les individues. Ce qui est ressenti, ou en tous les cas invoqué, c’est un besoin de spiritualité, et de réunion avec d’autres personnes sur la base de ce besoin, vécu comme une nécessité individuelle. On retrouve ce processus chez les adeptes des « nouvelles » religions : les versions « évangéliques » du christianisme, par exemple, dont la croissance extraordinaire est due à l’adhésion des pauvres et des exclu.es, et ceci dans le monde entier. Adhérer à une religion elle-même dévalorisée – que ce soit les églises chrétiennes mal notées, voire persécutées ou traitées de sectes, ou l’islam – est une façon indirecte de se reconnaître soi-même comme mal noté ou persécuté. Chez les populations de tradition chrétienne, comme en Europe, en Amérique du Sud et du Nord, ou par exemple dans certaines parties christianisées de l’Indonésie, ce sont les formes dominantes de la religion qui sont ainsi rejetées : l’Église catholique, ou les formations protestantes traditionnelles, qui sont liées aux puissants. Chez les populations d’origine immigrée, et surtout chez les descendants d’anciens colonisés dont la majorité étaient musulmans et qui vivent en Europe, on rejette un islam ritualiste et tiède, associé à ce qui est perçu comme un manque de combativité des parents, en faveur d’un islam intellectuel et exigeant ; et du même coup on met en cause, par la pratique, le climat anti-religieux et particulièrement anti-musulman de la société dominante.
Cette réislamisation des jeunes générations n’est pas propre à l’Europe, elle a lieu dans tous les pays, y compris ceux qui sont majoritairement musulmans, pour diverses raisons — mais il faut noter que tous ces pays ont été colonisés par des puissances occidentales, et, dans l’histoire récente, souvent attaqués militairement par ces mêmes puissances. En Europe, la réislamisation devient, tant subjectivement qu’objectivement, une façon de se positionner sur des aspects de la culture qui sont perçus comme faisant partie de la société dominante, blanche ; mais ce ne sont pas forcément les mêmes aspects qui sont refusés par les un.es et les autres. De plus, aucun de ces refus n’est spécifique aux musulman.es. Là où certain.es critiquent une évolution qui érode le rôle central de la famille et la notion de « complémentarité des sexes », ce qui les rapproche des traditionnalistes, notamment catholiques, d’autres critiquent la demande faite aux femmes de se comporter à tout moment de façon séductrice et sexuellement disponible, ce qui les rapproche des féministes. L’hypothèse à la fois la plus globale, car elle s’applique à tous les cas de réislamisation en France, et la plus spécifique, en ce qu’elle est fondée sur la communauté d’oppression de ces descendants de colonisé.es., a été formulée par Farad Khosrokhavar [3]. Il dit en effet que, se sentant rejeté.es et exclu.es de la communauté nationale par les discours et les pratiques racistes qui les traitent à jamais comme des étranger.es, certain.es de ces jeunes Français.es choisissent alors de se rattacher à « l’oumma », la communauté universelle des Musulman.es.
SD. Parmi les raisons de porter un foulard ou un voile, certaines consonnent avec le féminisme, qui dénonce la constitution des femmes en objets sexuels. Néanmoins, celles d’entre les féministes qui défendent les droits de circuler, d’étudier et de travailler des porteuses de foulard ou de voile intégral sont, me semble-t-il, plutôt des féministes « pro-sexe » que des féministes radicales, abolitionnistes et anti-pornographie. Comment analysez-vous ces paradoxes ?
C.D. Cette division existe bien en ce moment dans le féminisme, en France et dans certains pays francophones influencés par la France. Elle n’est pas absolue : certaines féministes, dont je fais partie, sont à la fois contre les lois discriminatoires qui retirent les libertés fondamentales aux musulmanes, et « abolitionnistes ».
L’abolitionnisme, c’est le projet d’une société sans prostitution, mais ce n’est en aucune façon la volonté de s’en prendre aux prostitué.es, bien au contraire. Dans l’analyse qui sous-tend ce projet, la prostitution est conceptualisée comme un des effets du patriarcat. Dans les sociétés patriarcales, les femmes sont des possessions des hommes, qui les utilisent comme ils veulent. Les femmes ne sont pas conçues dans les cultures de ces sociétés comme des sujets, mais comme des ‘compléments’ – des appendices – des hommes ; en d’autres termes, leur seule raison d’être, c’est leur utilité pour les hommes, qui sont vus comme les seuls sujets de la société. Tout ceci est assez bien connu [4].
En revanche, ce qui est mal analysé, c’est le rôle de la sexualité dans l’histoire. La sexualité continue d’être abordée comme quelque chose d’a-social ; les sciences sociales n’ont encore pas fait grand-chose pour la sortir de l’emprise de l’instinctivisme freudien ou du déterminisme darwinien. On voit souvent les formes violentes ou marchandes de la sexualité – le viol, la prostitution – comme une utilisation des femmes au service de besoins des hommes, besoins qui sont posés comme physiques et non pas comme sociaux. On commence à voir, avec les analyses féministes du viol, qu’il n’en est rien. Le viol ne correspond pas à un « besoin » physique, mais à une volonté d’humilier, de rabaisser, de nier l’humain chez les femmes. Dans tous les systèmes de domination, il se crée une idéologie qui justifie la domination : les dominé.es sont des êtres inférieur.es. Mais une idéologie n’est pas quelque chose qui flotte en l’air : elle existe dans les cerveaux, ceux des dominants et ceux des dominé.es. D’autres éléments culturels la modèrent ou la contrebalancent – par exemple l’affection qui peut exister entre personnes de genres différents. Cette idéologie est là, disponible chez tout le monde, mais elle ne débouche pas sur des pratiques chez tout le monde.
Chez certains, cependant, elle prend la forme d’une véritable haine. On trouve cette configuration, de mépris et d’hostilité allant jusqu’à l’agression, dans le racisme aussi ; les récentes agressions contre des femmes portant le foulard et le niqab ont été accompagnées d’injures haineuses.
Le viol, loin de correspondre à une irrépressibilité du « désir masculin » constitue la pointe de l’iceberg de mépris et d’hostilité du groupe dominant pour le groupe dominé, mépris et hostilité qui encore une fois n’existent pas au même degré chez tous les membres du groupe.
La volonté d’acheter les services sexuels d’une femme – ou d’un homme, qui sera traité comme une femme – fait partie du même continuum. Il s’agit de nier l’égalité de l’autre personne, de nier ses désirs (en l’occurrence de nier son absence de désir, qui relève elle aussi de la sphère du désir), il s’agit de la contraindre, dans le viol par la menace et la violence, dans la prostitution par l’argent. Les hommes savent que les femmes ont peu d’argent, et qu’eux en ont plus. En payant une femme (ou un homme), ils démontrent leur pouvoir. Ils pourraient le démontrer autrement : en s’achetant une glace, ou une montre, ou une voiture, que l’autre ne peut pas se payer ; là, en achetant ses services sexuels, pour le prix de trente esquimaux, ils achètent le droit d’humilier cette autre personne. C’est la même démarche – l’utilisation d’une situation de pouvoir pour humilier davantage une personne déjà infériorisée, qui est à la base du harcèlement sexuel.
Alors, s’agit-il de sexualité ? Oui, aussi, car la sexualité, le désir et le plaisir génitaux sont protéiformes : beaucoup de choses les suscitent, beaucoup de choses les satisfont. La sexualité de la prostitution, comme la sexualité du viol, est une forme violente de sexualité ; violences physique, psychologique et symbolique sont mêlées dans des proportions diverses. Là, c’est le tort fait à autrui qui suscite l’excitation sexuelle : ce que Catharine MacKinnon appelle l’érotisation de la domination [5].
SD. Que pensez-vous de l’auto-dénomination « pro-sexe » des féministes qui s’opposent à la stigmatisation de la prostitution et produisent ou consomment de la pornographie [6] ?
C.D Comment dire que les personnes favorables à l’achat de services sexuels sont « pro-sexe » ? Elles ne sont pas « pro-sexe » pour la prostitué.e, car la sexualité de celle-ci, son désir et son plaisir, ne sont pas pris en compte. Au contraire, ils sont niés, et c’est cette négation qui est à la base du désir et du plaisir de l’autre personne : le client. Il est donc abusif de parler de « sexe » ou de « sexualité » comme si ce type d’interaction était « sexuel » pour les deux personnes. Il y a là un mauvais jeu de mots sur « sexuel » : car la sexualité ne désigne pas les organes « sexuels » (aussi appelés « génitaux »), mais le désir et le plaisir.
En outre, cette dénomination « pro-sexe » laisse penser que les abolitionnistes seraient « anti-sexe ». Non : elles et ils ne veulent pas favoriser ou cautionner ce type de sexualité patriarcale, fondée sur la haine, le mépris et l’humiliation d’autrui. Elles et ils pensent qu’il existe beaucoup d’autres formes de sexualité ; le désir peut être suscité, et il est suscité par beaucoup d’autres sentiments que la volonté de dominer. Tout le monde, y compris les clients des prostitué.es, peut trouver ces autres sexualités.
Le pouvoir est-il coextensif à la sexualité ?
SD. D’où vient selon vous la thèse récurrente, et largement médiatisée [7], qui attribue aux hommes des besoins sexuels impérieux ?
C.D. La notion culturelle, largement répandue, que la prostitution est « inévitable » – « obligatoire » dit le chanteur Patrick Bruel [8] – repose elle-même sur l’idée, également culturelle, que la sexualité fonctionne de façon très différente chez les femmes et les hommes ; que le désir des hommes est « irrépressible », doit être satisfait, au moment même où il se manifeste, et satisfait par la copulation avec un autre être humain.
C’est faux, non seulement parce que la moitié de la population – les femmes – n’a pas de telles exigences, et parce que les hommes non plus, dans de nombreuses circonstances et pour de nombreuses raisons, ne peuvent ou ne veulent obtenir ce type de « soulagement ».
Cette idée est liée à une conception des rapports sexuels entre les femmes et les hommes, selon laquelle ces rapports expriment, symbolisent, ou même fondent la domination des femmes par les hommes. Dans le coït hétérosexuel, tel qu’il est interprété, et pratiqué, l’homme « possède » la femme, qui est donc « possédée ».La copulation est vécue comme une victoire sur un.e autre, et parfois même comme une mise à mort symbolique.Cette satisfaction narcissique enivrante est facile à obtenir, et sa poursuite engendre les comportements de chasseurs des hommes à la poursuite de femmes avec qui ils pourront « conclure », et qu’ils appelleront des « conquêtes ».
Le pouvoir est donc intimement lié à la sexualité telle que nous la connaissons dans notre culture patriarcale.
Le pouvoir n’est pas seulement un moyen d’obtenir des rapports sexuels ; la sensation en « baisant » une femme (ou un homme) de vaincre et soumettre un autre être humain, est au cœur de la jouissance patriarcale. Et il est difficile pour certains – la plupart des hommes, mais aussi certaines femmes – de vivre et même d’imaginer des rencontres sexuelles dénuées de rapports de pouvoir. Ainsi, depuis 30 ans, certaines féministes américaines, au premier rang desquelles Gayle Rubin, suivie par Judith Butler, elle-même suivie par le sociologue français Éric Fassin, présentent le pouvoir comme élément essentiel de la sexualité, du désir et du plaisir [9]. Ce qu’il faut souligner, c’est que le pouvoir est considéré dans cette analyse comme faisant partie de la sexualité de façon intrinsèque [10] ; aucune explication du lien postulé entre désir, plaisir et pouvoir n’est proposée. Une rencontre sexuelle d’où le pouvoir est absent est considérée dans cette approche comme « a-sexuelle » [11] . Ce n’est pas seulement que tout rapport avec le pouvoir économique et politique détenu par les groupes dominants est passé sous silence ; c’est plus généralement la structure sociale qui est volontairement ignorée. Ces auteur.es, sociologues et philosophes de grande culture, qui admettent le caractère construit de la domination masculine, et du genre, excluent sans autre forme de procès la sexualité de cette construction ; ils et elles refusent d’admettre que la rencontre « sexuelle » est comme toutes les interactions un comportement social donc construit. Au contraire, elles et ils adoptent sur ce sujet une vision anti-constructiviste et essentialiste. La sexualité dans leurs écrits est traitée comme indépendante de la culture et de la société ; elle aurait un lien ontologique – naturel, pré-social – avec le pouvoir.
Cette exclusion des pratiques et des idéologies qui se rapportent au désir et au plaisir du champ des pratiques sociales n’est jamais justifiée. C’est de façon implicite que ces auteur.es font l’hypothèse qu’il n’y a aucun rapport entre la domination dans la sexualité et la domination générale des femmes dans les sociétés patriarcales et qu’elles/ils adoptent sur ce sujet une approche naturaliste. Cet implicite est en contradiction flagrante avec leurs positions constructivistes affichées par ailleurs.
S.D. Mais les féministes queer qui assument l’héritage foucaldien, Gayle Rubin et Judith Butler, notamment, ne sont-elles pas, tout au contraire, les dernières à pouvoir accréditer la fable d’une sexualité qui serait pré- ou a-sociale, et comme un empire dans un empire ? Si la sexualité est une pratique sociale, comment pourrait-elle ne pas être traversée par du pouvoir [12] ?
C. D. Elles ne disent pas qu’il n’y a pas de pouvoir, elles disent que ce pouvoir-là n’est pas relié au pouvoir dans la société, elles voient la sexualité comme une enclave – évidemment elles ne le disent pas, elles ne disent pas non plus que la sexualité est pré ou a-sociale, mais, comme Fassin, ce qu’elles en disent revient à cela. Elles l’expriment en disant que blâmer ou proscrire les pratiques sadomasochistes revient à brimer la sexualité elle-même. Quant à Foucault, il était tout à fait séduit par le modèle de la Grèce antique ; or les éphèbes tant célébrés y étaient des adolescents utilisés sexuellement par les hommes adultes, mais cet aspect d’utilisation ne choque pas Foucault. Le pouvoir, dans la sexualité, ne le dérangeait pas, et il disait que rien de sexuel ne devait être pénalisé. Dans cette définition implicite du « sexuel », seul le désir et le plaisir des dominants (par le genre ou la situation sociale) comptent [13].
Notes
[1] Voir les enquêtes sociologiques menées sur les porteuses de voile intégral par Agnès De Féo et Maryam Borghée (Voile intégral en France, sociologie d’un paradoxe, Paris, Michalon, 2012) ; voir ici le témoignage de Hind Ahmas, recueilli par Agnès de Feo, et le documentaire également réalisé par Agnès De Féo en 2012, « Niqab hors la loi ».
[2] Voir Christine Delphy, « Les Uns derrière les autres » in Classer, dominer. Qui sont les « autres », Paris, La fabrique éditions, 2008, pp. 7-52.
[3] Voir L’islam des jeunes, Paris, Flammarion, 1997.
[4] Voir Christine Delphy, L’ennemi principal. Tome 1 : économie, politique du patriarcat, Paris, éditions Syllepse, 2009 et L’ennemi principal. Tome 2 : Penser le genre, Paris, éditions Syllepse, 2009.
Les deux tomes, épuisés, seront réédités en septembre 2013. Une présentation de la nouvelle édition sera faite le 28 septembre par les éditions Syllepse et l’auteure au Lieu-Dit, rue Sorbier, Paris 20e, à 17 heures ; voir aussi C. Delphy, S. Duverger, « La possibilité du don, c’est l’égalité », Revue du MAUSS, n° 39, 2012.
[5] Voir C. MacKinnon, Le Féminisme irréductible, Paris, Des femmes, 2004 et Andrea Dworkin, Pouvoir et violence sexiste, Sisyphe, 2007.
[6] Cette appellation a émergé au cours des années 1980, aux États-Unis, dans le contexte des « sex wars », des guerres du sexe entre les féministes radicales, pour lesquelles la sexualité était le lieu par excellence où s’exerçait la domination masculine et les féministes qui considéraient que la sexualité pouvait être émancipatrice.
[7] Elle a par exemple été développée à plusieurs reprises sur le plateau de Ce soir ou jamais, notamment par le neurobiologiste Jean-Didier Vincent ; émissions du 6 décembre 2011 et le 8 mars 2013.
[8] Le 29 novembre 2012 sur MFM radio, Patrick Bruel, qui est aussi un fervent défenseur de DSK a déclaré : « Je suis tout à fait pour la réouverture des maisons closes. Cela évitera à ces pauvres filles de se geler dans la rue. Ce sont des situations toujours très dangereuses, je pense que ça régulera les choses. (…) Comme la prostitution est absolument obligatoire, autant que ce soit bien, que ce soit clean, que ce soit sympa. » L’interview est réécoutable ici.
[9] Voir, par exemple, « Une éthique de la sexualité », entretien avec Judith Butler, réalisé par Eric Fassin et Michel Feher, Vacarme, n° 22, hiver 2003.
[10] J. Butler dit, dans cet entretien de 2003 : « Je ne voudrais certainement pas vivre dans un monde sans séduction. Et la séduction, cela suppose des stratégies, des manœuvres pour déstabiliser la personne désirée, pour la conquérir ; et encore une fois, c’est très bien ainsi. (…) Pour ma part, j’irais même jusqu’à dire, avec Michel Foucault, que le pouvoir et la sexualité sont co-extensifs ; qu’on ne trouvera pas de sexualité sans pouvoir. Je dirais que le pouvoir est une dimension très excitante de la sexualité. »
[11] Éric Fassin évoque « les expérimentations sexuelles à la fois érotiques et politiques » de la « sous-communauté » lesbienne de San Francisco à laquelle appartient Gayle Rubin. « C’est, estime-t-il, sans doute inverser la logique du féminisme lesbien, qui dans les années 70 proposait aux femmes un entre-soi rassurant, d’une douceur harmonieuse, mais presque désexualisée », « L’avenir sera-t-il queer ? », La Revue du Projet, n° 15, mars 2012 ; extraits de « L’avenir sera-t-il queer ? », Sciences Humaines n° 163, août-septembre 2005.
[12] (Cette note n’engage que Sylvia Duverger.) Dans « Une éthique de la sexualité », Judith Butler précise notamment que « la sexualité résulte toujours d’une négociation prise dans des forces, sociales et inconscientes, qui parfois se moquent de nos choix. Notre capacité d’agir consiste à nous frayer un chemin parmi des désirs qui sont pour une part contraints, pour une part libres. Notre liberté n’est pas « libre » des conditions sociales. Ce qu’il y a d’humain ici, c’est la négociation même, le fait que nous faisons des choix, qu’il nous faut choisir, même quand notre choix est contraint selon des modalités que nous n’avons pas choisies. »
Pour aller plus loin dans cette direction, voir Lisa Duggan, Nan D. Hunter, Sex wars : sexual dissent and political culture, New York, Routledge, 1995 ; Brigitte Lhomond, « Sexualité », in Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2004 ; Clarisse Fabre, Éric Fassin, Liberté, Égalité, Sexualités, Paris, 10/18, 2004 ; Gayle Rubin, Surveiller et jouir, anthropologie politique du sexe, Paris, Epel, 2011 ; Raphaël Bourge, « Sex Wars and Queer Theory : le laboratoire pornographique », Magphilo, hiver 2012.
[13] Ainsi que l’ont montré Monique Plaza dans « Nos dommages et leurs intérêts » et Josée Néron dans « Foucault et l’histoire de la sexualité et l’occultation de l’oppression des femmes… », respectivement in Questions féministes, n° 3, mai 1978, republié dans Questions féministes, 1977-1980, Paris, éditions Syllepse, 2012, pp. 364-375 et Nouvelles Questions féministes, volume 17, n° 4, 1996, pp. 45-97. Article consultable sur JSTOR.
10:12 Écrit pa