Malgré un chômage officiel bas, 4,1% en décembre, l’économie des Etats-Unis n’est ni au plein-emploi ni limitée par l’offre d’emploi, comme certains l’ont argumenté. Le taux d’emploi sur population (taux d’activité) a augmenté de son creux d’après la crise d’environ 58% à juste au-dessus de 60%, mais il est toujours encore trois points de pourcentage en dessous de son niveau de 2007 et cinq points de pourcentage en dessous de son sommet de 2000. Si de nombreux travailleurs ont pris leur retraite pendant et après la récession qui a suivi la crise, certains pourraient être attirés à nouveau vers un emploi étant donné le besoin de revenus. Et si l’immigration nette s’est ralentie, elle reprendrait si « on » avait besoin de plus de travailleurs.
Puisque l’investissement dans l’infrastructure et un protectionnisme commercial sérieux ont (apparemment) été retirés du programme, la stratégie de croissance préconisée par Trump et les républicains du Congrès est réduite maintenant à la loi fiscale qu’ils se sont précipités à voter en décembre.
La loi prévoit surtout une baisse majeure du taux d’imposition des entreprises et une dépréciation accélérée des investissements en capital. Cela fait que la loi pourrait avoir deux effets distincts : un effet de politique fiscale sur la demande agrégée et un effet sur la capacité d’offre productive de l’économie.
Durant les quatre premières années, quand les baisses d’impôts nettes de la loi équivaudront environ à 0,9% du PIB par année, l’effet stimulant va dépendre de la fraction du revenu privé additionnel dépensée dans une année donnée et du multiplicateur budgétaire appliqué à cette dépense. Considérons, généreusement, que 60% du revenu additionnel sont dépensés chaque année, et que le multiplicateur budgétaire est de 1,5, la baisse d’impôts ajouterait initialement presque un point de pourcentage au taux de croissance du PIB. Mais cela serait un effet d’une seule fois. Le PIB annuel s’élèverait une fois mais la croissance à long terme ne serait pas affectée.
Qui plus est, si le revenu perdu est compensé par des coupes automatiques des prestations de Medicare [système d’assurance-santé pour les personnes de plus de 65 ans ou répondant à certains critères] ou de la Sécurité sociale, ou par des réductions des dépenses des gouvernements locaux et des Etats, le paquet fiscal aura encore moins d’effet budgétaire net parce qu’il pousserait à la baisse les achats publics et privés de biens et services. En outre, en postulant encore plus généreusement (et de manière problématique) que la Réserve fédérale ne réagisse pas, la baisse d’impôts pourrait maintenir le taux de croissance réel au-dessus de 3% tout au long de 2018, et peut-être aussi au long de 2019.
La question de la croissance
Pour déterminer si la législation fiscale va avoir un effet cumulatif sur le taux de croissance à long terme, il faudrait nous tourner vers un débat, publié en décembre par Project Syndicate, entre Robert J. Barro et ses collègues de Harvard Jason Furman et Lawrence H. Summers. Dans la première contribution au débat, Barro a utilisé un modèle néoclassique de croissance pour calculer que la loi fiscale va booster le taux de croissance d’environ 0,3% par année, ce qui implique un gain de 2,8% du PIB par habitant (per capita) sur les dix années à venir.
Dans leur réponse, Furman et Summers ont accepté le modèle de croissance de Barro, tout en critiquant l’application qu’il en fait. Leur stratégie était brillante dans la mesure où cela rétrécissait le champ de leur contre-argumentation. Après avoir opéré diverses corrections aux postulats sous-jacents de Barro à propos du plan fiscal, ils ont employé son propre modèle pour montrer que son calcul était erroné « d’un ordre de grandeur ». Un effet modeste était ainsi rendu essentiellement négligeable.
Mais Furman et Summers n’ont pas contesté les postulats théoriques centraux de Barro. Ainsi tandis qu’ils démolissaient sa thèse que la loi fiscale aurait un effet significatif sur la croissance à long terme, ils semblaient concéder qu’un plan avec des avantages encore plus grands pour les profits des entreprises et des dispositions d’amortissement encore plus généreuses aurait fait encore plus. A mon avis cette déduction est fausse et pourrait dangereusement égarer les dirigeants politiques dans les débats futurs à propos de la législation fiscale.
Pour comprendre pourquoi, il nous faut d’abord considérer le modèle de Barro. Il insiste pour le déclarer conforme aux pratiques habituelles de la profession des économistes. Par conséquent, il considère l’effet de la loi fiscale sur le « coût d’utilisation que les entreprises attachent à l’investissement » comme égal au « produit marginal du capital » dans « le modèle de croissance économique le plus populaire chez les économistes ». Il évalue ensuite une élasticité de 1,25 pour le « rapport capital/travail sur coût d’utilisation » dans une « fonction de production Cobb-Douglas (communément utilisée par les économistes). Dans tout cela, ce qu’il semble réellement vouloir dire, c’est : Ne m’embêtez pas avec des chicanes à propos de la théorie.
Ensuite viennent les chiffres. En se basant sur ses postulats à propos de l’élasticité et d’autres facteurs, Barro calcule un accroissement de 25% dans le rapport capital/travail à long terme pour les structures d’entreprises non-résidentielles : bâtiments de banques, centres commerciaux, et ainsi de suite – et un accroissement de 17% de l’équipement d’entreprise. Disons que l’accroissement global serait quelque part au milieu, aux alentours de 20%. Cela signifie que Barro s’attend à ce que le paquet fiscal ajoute 10’000 milliards de dollars de plus au stock de capital des Etats-Unis qui aujourd’hui s’élève à environ 50’000 milliards de dollars.
Après avoir fait un modeste ajustement à la baisse, Barro conclut que ce stock de capital supplémentaire stimulerait à long terme le PIB de 7%, soit environ 1’200 milliards de dollars à leur valeur de 2009. Cela veut dire qu’il s’attend à ce qu’une baisse d’impôt nette de 1500 milliards de dollars sur dix ans – dont 644 milliards seulement iraient aux entreprises – engendrerait finalement un gain six fois plus grand en stock de capital, et 80 cents par dollar de produit annuel réel après environ 14 ans.
Cela serait vraiment le miracle de la multiplication des poissons et des pains. Manifestement, les chiffres de Barro sont absurdes et Furman et Summers ont bien raison de les contester. Et pourtant, ils décrivent néanmoins le modèle sous-jacent de Barro comme « sensé ». Peut-être adhèrent-ils au code de politesse de Cambridge qui commande de ne pas appeler les choses par leur vrai nom.
Idées néoclassiques fallacieuses
Le modèle de Barro postule que les baisses des impôts des entreprises, en accroissant la productivité de leur stock de capital après impôts, vont induire les entreprises à créer plus de capital jusqu’à ce que le produit marginal de leur capital (unités de production par unité d’intrants) retourne à son niveau d’équilibre à long terme, tel que le déterminent les taux d’escompte et d’amortissement. Si le travail est pleinement employé, les augmentations de capital vont gonfler la production totale. Et, entre-temps, la part du capital dans l’output total va croître avec le déclin de la part des salaires, parce que l’investissement initial en capital doit être payé par des baisses de salaires, des impôts plus élevés sur les salaires, des coupes dans les dépenses des programmes sociaux, ou par l’emprunt et la charge des coûts des intérêts futurs et de l’amortissement du principal. Après tout, dans la théorie économique néoclassique, rien ne vient de rien.
Le principal problème avec ce modèle, c’est qu’il n’y a aucune bonne raison de penser que des profits après impôts plus élevés vont engendrer des investissements dans plus de modes de production à forte intensité de capital. Barro confond la profitabilité après impôts de l’activité existante avec la profitabilité future attendue de nouveaux investissements. Furman et Summers comprennent cela, et c’est pourquoi ils proposent plus de déductions pour l’investissement de nouveau capital et une réduction plus faible du taux d’impôts sur les entreprises.
Mais Barro ajoute encore plus de confusion avec son traitement de la profitabilité attendue de nouveaux investissements et le taux capital/travail qui en résulte. Son modèle considère le capital comme homogène et ne fait de distinction qu’entre structures et équipement. Mais le fait est que les entreprises basent leurs décisions d’investissement pas seulement sur leur appréciation des profits futurs mais sur l’état de la technologie à ce moment donné.
Normalement, les nouvelles technologies déterminent le bon dosage de structures, équipement, et travail. Et puisque les technologies digitales tendent à économiser tant le capital que le travail, un prix relativement plus bas des biens de capitaux ne conduit pas nécessairement à un plus grand emploi relatif de « capital ». Si les prix de la construction ou de l’équipement, par exemple les ordinateurs, ou les écrans tactiles, baissent mais pas les salaires, l’activité industrielle qui en résulte apparaîtrait en fait plus intensive en travail qu’avant. En fait, cela semble décrire de nombreuses situations industrielles aujourd’hui. La faible part de l’investissement dans le PIB ces récentes années reflète le coût relativement bas de la nouvelle machinerie électronique, ce qui a déplacé sur la consommation une plus grande part de la charge de maintenir la croissance.
C’est une fallacieuse thèse néoclassique de penser que les entreprises peuvent simplement échanger des structures contre du travail comme un moyen de faire monter le taux capital/travail pour atteindre leur objectif de résultat au coût désiré. Tout le sens de construire une structure non-résidentielle – que ce soit un hôpital, une usine, ou un grand magasin – c’est de la remplir de travailleurs et de machines. Si les entreprises profitent de dispositions fiscales de déductions pour construire ou acheter des structures supplémentaires sans les machines et les travailleurs, elles ne vont augmenter ni leur production ni leur productivité ; elles vont juste prendre plus de place.
En outre, du fait que la nouvelle machinerie électronique est physiquement compacte et tend à éliminer du travail de bureau et administratif, les structures industrielles sont aujourd’hui moins nécessaires qu’à l’époque des âges d’or de la fabrication des automobiles, de l’assurance, ou de la banque. Et du fait que tant de nouveaux équipements sont aujourd’hui importés, le multiplicateur de nombreux investissements ne sera pas perçu aux Etats-Unis mais plutôt dans les pays qui produisent des biens de capital. Aucune loi fiscale ne va changer ces faits.
Par conséquent, même si des investissements futurs ont bien lieu, ils ne vont probablement pas faire monter le taux capital/travail ou le taux réel de croissance. Et même si Barro, Furman, et Summers argumentaient que le nouveau capital d’équipement est « meilleur » et correspond donc à « plus », cela ne change pas le fait que le coût effectif de l’équipement et la part de l’investissement dans le produit (en termes de dollars) peuvent tous les deux diminuer.
Retour à la réalité
C’est clair que le modèle de Barro – et pas seulement l’usage particulier qu’il en fait – est absurde. Une alternative meilleure se concentrerait sur l’économie politique et le comportement des entrepreneurs. Une telle analyse fournit des conclusions qui sont moins absolues dans leur certitude ; et c’est une bonne chose.
Dans le monde réel, les entreprises investissent pour deux raisons : pour augmenter la production et pour diminuer les coûts. La première requiert une confiance dans la croissance future des ventes. On pourrait s’attendre à ce que la nouvelle loi fiscale stimule les ventes à court terme, du fait de son effet fiscal en une fois. Et pourtant, elle semble viser directement le pouvoir d’achat de la classe moyenne, en fixant une limite aux déductions dans l’impôt fédéral des payements d’intérêts des hypothèques et des taxes locales et d’Etat (SALT). Cela va en retour aboutir à moins de demande des consommateurs et des dépenses plus faibles en services publics. Au lieu de créer un climat favorable à la consommation privée et à l’investissement, la vaste redistribution vers le haut des revenus et de la richesse ne peut que déprimer les dépenses, indépendamment du fait que les entreprises soient autorisées à garder pour elles une plus grande part de leur cash-flow.
Ce qui complique les choses encore plus, c’est qu’il reste à voir quelle sera la réaction de la Fed à la loi fiscale et les effets qu’auront sur l’économie des ajustements de politique monétaire. Historiquement, il y a eu des occasions où une hausse du taux d’intérêt a créé les conditions d’un boom des affaires à long terme, comme en février 1994, quand la Fed a poussé les banques à s’éloigner des produits sûrs pour revenir aux prêts commerciaux et industriels. Mais à l’époque, la révolution technologique commençait seulement à se percevoir et les banques avaient besoin d’être poussées pour diminuer leur dépendance de courbes de revenus à forte croissance. Le même schéma ne va guère se répéter aujourd’hui.
Aujourd’hui, si la Fed décide d’augmenter les taux d’intérêt plus rapidement, la valeur du dollar va augmenter et les biens de capital importés deviendront encore plus attractifs comparés à ceux produits aux Etats-Unis, ce qui freinera la croissance. En outre, certains analystes sont en souci pour une crise de financement qui menacerait dans le reste du monde, ce qui déclencherait une fuite vers des actifs plus sûrs comme les bons du Trésor, ce qui intensifierait encore plus la hausse du dollar. Si cela conduisait à une nouvelle crise financière, la position de faiblesse de certaines des plus grandes banques du monde serait exposée et la période de croissance s’arrêterait. Le modèle de Barro n’a pas de place pour le risque financier. Mais les entreprises encouragées à faire des nouveaux investissements, elles, certainement s’en préoccupent.
Un domaine où la loi fiscale pourrait effectivement engendrer une croissance, c’est la construction commerciale, si les entreprises actives décident collectivement de s’étendre pour protéger leur part de marché, un processus anti-compétitif que l’économiste Joseph Schumpeter appelait « comportement co-respectif ». Pareillement, le traitement fiscal favorable des structures pourrait permettre à des entreprises dominantes de se renforcer dans la part restante du marché des petits détaillants, restaurants, et autres fournisseurs de services. Si cela a lieu, on peut s’attendre à une bulle dans les structures commerciales, suivie d’un écroulement.
Les chances que cela ait lieu ne sont pas négligeables. Comme les architectes du nouveau paquet fiscal le savent sûrement, les deux dernières expansions économiques, à la fin des années 1990 et au milieu des années 2000, furent le résultat de bulles d’actifs engendrées par le comportement co-respectif, la première de la part des investisseurs dans la technologie, la seconde de la part des spéculateurs sur les hypothèques corrompues. C’est sûr qu’une nouvelle bulle susciterait quelques applaudissements et bénéfices politiques sur le court terme. Mais la suite ne serait pas jolie.
Oligarques, soyez tranquilles
Mis à part une bulle de la construction, il y a deux autres possibilités pour les mois et années qui viennent. Pour commencer, la loi pourrait susciter une montée des cash-flows après impôts des entreprises qui seront détournés (« volés » pourrait être un mot trop fort, mais à peine) vers les rémunérations des dirigeants, les rachats d’actions, et les holdings immobiliers, particulièrement, si les logements, ayant perdu leur traitement fiscal privilégié, sont vendus et transformés en propriétés locatives. Dans ce scénario, l’oligarchie des Etats-Unis peut même devenir un peu plus nombreuse et plus diverse et ses dépenses pourraient même procurer une modeste stimulation à court terme du PIB réel, mais un dégonflement s’ensuivrait inévitablement.
L’autre possibilité, c’est que les entreprises, s’étant assuré un traitement fiscal plus favorable, vont en fait diminuer leurs investissements. Leurs dirigeants ne seront pas aveugles face à la perspective d’un ralentissement général de la consommation après l’effet fiscal initial de la loi, tout particulièrement si les gouvernements locaux et des Etats sont forcés de diminuer leurs dépenses sous la pression des secteurs des dites classes moyennes qui ne pourront plus déduire leurs impôts locaux de leurs impôts fédéraux.
Dans ce deuxième scénario, s’appliquera l’adage de l’économiste polonais Michal Kalecki : « les capitalistes obtiennent ce qu’ils dépensent ». Les profits après impôts pourraient ne pas augmenter beaucoup et les oligarques des Etats-Unis resteront gras et heureux tout en faisant encore moins. Le coût sera supporté par la classe moyenne [au sens de salarié ayant un emploi dit stable] qui a des hypothèques à payer et des logements qu’elle voudrait maintenant vendre et, comme toujours, par les pauvres qui souffriront de la hausse des TVA, des coupes dans les dépenses sociales et du chômage.
Et pourquoi quelqu’un devrait-il s’attendre à un autre résultat ? Après tout, cela n’est pas seulement le plan fiscal de Trump. C’est ce qu’a toujours voulu la classe qui finance les républicains. (Article publié sur le site social-démocrate Social Europe, le 26 janvier 2018)
James K. Galbraith (1952) est professeur à l’Université du Texas à Austin où il dirige le University of Texas Inequality Project. Il est un adversaire déclaré de l’orthodoxie du Consensus de Washington et a appliqué une interprétation keynésienne à la crise de 2007-2009. Il est le fils de l’influent économiste keynésien, et homme politique démocrate de gauche, John Kenneth Galbraith (1908-2006).





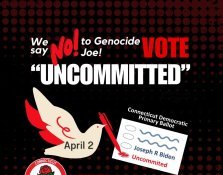

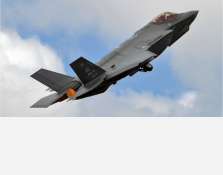
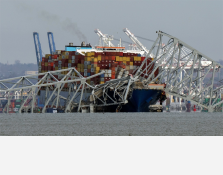


Un message, un commentaire ?