Franck Gaudichaud : Dans la dernière période, ont eu lieu de nombreux débats sur la fin du cycle des gouvernements progressistes et nationaux populaires en Amérique latine, sur leur possible reflux et perte d’hégémonie politique. Que pensez-vous de ce débat ? Pouvons-nous envisager que ce débat sur la fin d’un cycle est dépassé ? Et que dire de la conjoncture actuelle face à l’expérience dite « progressiste » des années 1998-2015 ?
Edgardo Lander : Effectivement, il s’agit d’un débat très intense, surtout en Amérique latine, parce qu’il y avait de nombreux espoirs de possibilités de transformation profonde de ces sociétés à partir de la victoire de Hugo Chávez au Venezuela en 1998. Ce fut le point de départ d’un processus de changement qui mena à ce que la majorité des gouvernements latino-américains soient identifiés à une orientation dénommée progressiste, ou de gauche, dans diverses versions. Ces attentes de transformations, qui conduiraient à des sociétés post-capitalistes, posèrent de graves défis à affronter, tant du fait de l’expérience négative des socialismes du siècle passé que des nouvelles réalités comme le changement climatique et les limites de la planète Terre. Penser la transformation aujourd’hui signifie nécessairement quelque chose de très différent de ce que cela signifiait au siècle passé. Alors que le discours sur le socialisme avait pratiquement disparu du langage politique dans une bonne partie du monde, il est réapparu dans ce nouveau moment historique en Amérique du Sud. En particulier à partir des luttes des peuples indigènes, qui dans plusieurs de ces processus paraissent incorporer d’une manière centrale un profond questionnement de ce qu’avait été le socialisme du XXe siècle. Dans une partie des imaginaires de la transformation, des thèmes comme la pluriculturalité, d’autres formes de rapports avec les autres réseaux de la vie, l’idée de droits de la nature et le buen vivir, le « bien vivre », deviennent essentiels. Ils pointent une possibilité de transformation capable de rendre compte des limites des processus antérieurs et d’ouvrir de nouveaux horizons pour aborder les nouvelles conditions de l’humanité et de la planète.
Franck Gaudichaud : Tu parles donc là de la période initiale, du point de départ, au début des années 2000, lorsque se sont combinées les fortes résistances de celles et ceux d’en bas et la création de dynamiques sociopolitiques plus ou moins rupturistes et post-néolibérales, selon les cas, qui ont réussi à émerger y compris sur le plan électoral national et gouvernemental.
Edgardo Lander : Oui, cette période a fait naître de grandes espérances sur le début de transformations radicales de la société. Dans les cas de l’Équateur et de la Bolivie, les nouveaux gouvernements furent la conséquence de processus d’accumulation de force des mouvements et des organisations sociales en lutte contre des gouvernements néolibéraux. Les expériences du soulèvement indigène dans le cas équatorien et de la guerre de l’eau en Bolivie furent des expressions de sociétés en mouvement où des secteurs sociaux – qui n’étaient pas les plus typiques de l’action politique de la gauche – jouèrent des rôles fondamentaux. Il s’agit d’une émergence populaire : des secteurs sociaux auparavant « invisibles » – indigènes, paysans, couches populaires urbaines – viennent occuper une place centrale sur la scène politique. Cela a généré des attentes extraordinaires.
Néanmoins, avec le temps, de grands obstacles sont apparus. Au-delà de beaux discours, des secteurs importants de la gauche qui jouèrent des rôles dirigeants dans ces processus n’avaient pas soumis l’expérience du socialisme du XXe siècle à une réflexion suffisamment critique. Beaucoup des vieilles formes de compréhension de la direction, du parti, de « l’avant-garde », des rapports de l’État avec la société, du développement économique, des rapports de l’être humain avec les autres éléments de la nature, étaient présentes dans ces projets de transformation. Sans parler du poids des visions du monde eurocentées, monoculturelles et patriarcales. Les formes coloniales historiques d’insertion dans la division internationale du travail et de la nature se sont approfondies. Il est évident que tout projet prétendant dépasser le capitalisme dans le monde actuel doit nécessairement se confronter aux défis sévères posés par la profonde crise de civilisation que vit aujourd’hui l’humanité : en particulier, la logique hégémonique de la croissance sans fin de la modernité qui a conduit à dépasser la capacité « de charge » de la planète et qui est en train de détruire les conditions rendant possible la reproduction de la vie.
L’expérience des gouvernements dits progressistes a lieu à un moment où la globalisation néolibérale s’accélère et où la Chine se transforme en usine du monde et en principale économie planétaire. Cela produit un saut qualitatif dans la demande et le prix des matières premières : biens énergétiques, minéraux et produits de l’agro-industrie comme le soja. Dans ces conditions, tous ces gouvernements progressistes ou nationaux-populaires optent pour financer les transformations sociales préconisées par la voie d’un approfondissement de l’extractivisme destructeur. Cela n’a pas seulement des implications évidentes dans la non-remise en question de la structure productive de ces pays, mais aussi dans l’approfondissement de ses formes néocoloniales d’insertion dans la division internationale du travail et de la nature. Ceci accentue également le rôle de l’État comme principal récepteur des recettes produites par l’exportation des ressources. Ainsi, par-delà le contenu des textes constitutionnels sur la plurinationalité et l’interculturalité, prévaut une conception de la transformation centrée prioritairement sur l’État et sur l’identification de l’État avec le bien commun. Cela conduit inévitablement à des conflits autour des territoires, des droits indigènes et paysans, à des luttes pour la défense et l’accès à l’eau et à des résistances contre l’intense exploitation minière. Ces luttes populaires et territoriales ont été vues par ces gouvernements comme des menaces contre le projet national présenté, pensé et dirigé par l’État comme représentant l’intérêt national. Pour faire avancer ces projets néo-développementistes, malgré ces résistances, les gouvernements ont recouru à la répression et ont assumé des tendances autoritaires croissantes. En définissant centralement les priorités et en voyant comme une menace tout ce qui pourrait les affronter, s’est installée une logique de raison d’État qui requiert d’étouffer les résistances.
Dans les cas de la Bolivie et de l’Équateur, cela a conduit à une certaine démobilisation des organisations sociales, ainsi qu’à des divisions (suscitées par les gouvernements) des mouvements sociaux, générant des fragmentations de leur tissu social, affaiblissant l’énergie de transformation démocratique qui les caractérisait.
Franck Gaudichaud : Face à cette analyse, et particulièrement quant à la raison d’État, les militants et les intellectuels participant à ces processus dans les gouvernements et dans les rangs des partis progressistes officiels affirment que, finalement, l’unique manière de construire un authentique chemin post-néolibéral en Amérique latine consisterait à « récupérer » l’État, premièrement grâce aux mobilisations sociales qui ont délogé les vieilles élites partidaires et, ensuite, obtenir de nettes victoires électorales anti-oligarchiques, pour commencer à partir de l’État (mais avec des liens avec ceux d’en bas) à distribuer les rentes et reconstituer la possibilité d’une alternative au néolibéralisme « réel ».
Miriam Lang : Avant de commencer à traiter ce point, je voudrais revenir un peu sur ce que disait Edgardo. Car le terme « fin de cycle » pourrait suggérer que l’on voit toute la région à partir des expériences argentine et brésilienne, où la droite est effectivement revenue au pouvoir. Néanmoins, la lecture la plus adéquate consisterait à regarder comment au cours de ces gouvernements progressistes le projet de transformation sociale a changé et pourquoi maintenant, de toute manière, nous nous trouvons dans une autre conjoncture qu’il y a 10 ou 15 ans, y compris dans les pays où des progressismes se trouvent toujours au gouvernement, comme la Bolivie ou l’Équateur. Je me réfère à ce que certains appellent « la transformation des transformateurs » et aussi à la diversité des tendances politiques au sein de ces gouvernements, où réellement les gauches transformatrices ne sont plus nécessairement hégémoniques. Car ces processus se sont convertis en projets de modernisation réussis des rapports capitalistes et de l’insertion au marché mondial.
Franck Gaudichaud : En définitive, vous avez une position clairement critique sur la division internationale du travail, les ressources naturelles, l’usage de l’extractivisme, sur le problème de l’État (souvent autoritaire et clientéliste jusqu’à aujourd’hui) : des phénomènes qui certes n’ont pas disparu et se sont même consolidés sur divers plans avec les progressismes. Mais vous ne mentionnez pas ici les « Bolsas familia » [programmes d’aide aux familles pauvres], l’importante réduction de la pauvreté et même très légèrement de l’inégalité, l’incorporation des classes sociales subalternes à la politique, la reconstruction de systèmes essentiels de services, de santé publique, la croissance spectaculaire des infrastructures (en Équateur, etc., durant cette décennie de « l’âge d’or » des progressismes. En résumé, et je reprends ici les paroles polémiques du vice-président bolivien García Linera (afin d’alimenter le débat), vous seriez des « intellectuels critiques de bistrot » (4), que García Linera dénonce comme n’ayant pas une réelle empathie envers les secteurs populaires et leurs conditions de vie matérielle quotidienne. C’est du moins un classique dans l’argumentation des défenseurs des progressismes au moment de disqualifier la gauche critique ou radicale.
Miriam Lang : Ça dépend un peu de la manière dont chacun regarde la réalité. Il faut voir, par exemple, que dans les Constitutions bolivarienne et équatorienne le projet de transformation allait bien au-delà de la réduction de la pauvreté. Tout ce que les luttes sociales antérieures ont accumulé aspirait à plus qu’une distribution d’une petite partie de la rente. Par là, je ne veux pas méconnaître que la vie quotidienne de nombreuses personnes a pu devenir plus facile, au moins durant les années de prix élevés des hydrocarbures. Mais il faut aussi regarder au-delà des statistiques. Selon la définition de la pauvreté, nous pouvons dire que tant de personnes en sont sorties et cela est parfait. Mais nous devons aussi regarder d’un peu plus près et nous demander : de quel type de pauvreté parlons-nous ? En Amérique latine, on mesure d’abord la pauvreté en fonction des revenus et de la consommation. Cette donnée évalue dans quelle mesure un foyer participe au mode de vie capitaliste et, en réalité, dit peu de chose sur la qualité de vie dans ce foyer. Elle rend invisibles la dimension des économies de subsistance, la dimension de la qualité des rapports humains, etc. Dans quelle mesure les gens peuvent-ils exprimer réellement leurs besoins dans ce contexte ? Dans quelle mesure ces politiques redistributives ont-elles renforcé ou étendu territorialement les logiques du marché capitaliste dans des pays où la vie d’une bonne partie de la population, du fait de l’énorme diversité culturelle existante, n’était pas vraiment sous-tendue par les principes capitalistes ?
Nous pourrions dire que cette diversité des modes de vie constituait un important potentiel transformateur pour les horizons de dépassement du capitalisme. Y compris si nous regardons les conditions écologiques de la planète, au lieu d’être étiquetées comme « pauvres » et « sous-développées », de nombreuses communautés paysannes, indigènes, noires ou populaires des villes pourraient être vues comme l’exemple de comment consommer moins et être mieux satisfait. Au contraire, ce qui s’est passé, c’est ce que j’appelle le « dispositif du sous-développement » (5) ; dans le cadre de l’« éradication de la pauvreté », on leur dit : votre mode de vie qui nécessite si peu d’argent n’a pas de valeur, vous devez ressembler à la population urbaine, capitaliste, vous devez utiliser l’argent, la seule forme d’échange est le marché capitaliste, il n’existe pas d’autre forme d’échange valide. Ce qu’ils ont appelé « l’alphabétisation financière », qui fait partie de la politique progressiste contre la pauvreté, a aidé le capital financier à établir de nouveaux marchés de crédit pour les plus pauvres, à des taux d’intérêt qui sont souvent très élevés. Et la fameuse inclusion par la consommation se fait habituellement dans des conditions subordonnées. Et nous avons finalement des populations endettées par la consommation, pour des besoins que sans doute elles n’avaient pas avant. Autrement dit, tout cela dépend un peu d’où on regarde… C’est un problème de valeurs et de perspective : comment voulons-nous que vivent les générations futures ? Il ne s’agit pas seulement de démocratiser la consommation, mais le pari consiste à construire un monde soutenable pour au moins cinq, six, sept générations futures et j’ai de sérieux doutes quant au fait que cette manière d’éradiquer la pauvreté ait contribué à ces fins.
Edgardo Lander : Dans le cas vénézuélien, l’utilisation de la rente pétrolière selon une manière différente de celle dont elle avait été utilisée historiquement a eu d’énormes conséquences durant la première décennie du gouvernement de Chávez. La dépense sociale est arrivée à représenter environ 70 % du budget national. Cette dépense publique dans la santé, l’éducation, l’alimentation, le logement et la sécurité sociale a effectivement signifié une transformation profonde des conditions de vie de la majorité de la population. Comme le reste de l’Amérique latine, le Venezuela a été historiquement un pays de profondes inégalités. Non seulement il a réussi à réduire très significativement les niveaux de pauvreté (mesurés en termes monétaires), il a aussi réussi à réduire notoirement l’inégalité. La CEPAL a signalé que le Venezuela a réussi à devenir, avec l’Uruguay, l’un des pays les moins inégaux du continent. Il s’agit d’une transformation très importante, qui s’exprime sur des aspects aussi vitaux que la réduction de la mortalité infantile et l’augmentation du poids et de la taille des enfants. Ce ne sont pas des questions secondaires.
D’autre part, du point de vue politique cela a été accompagné par des processus d’organisation populaire à la base, extraordinairement larges, auxquels ont participé des millions de personnes. Quelques-unes des plus importantes politiques sociales furent élaborées de telle manière que pour fonctionner elles avaient besoin de l’organisation des gens. Le meilleur exemple en fut la mission « Barrio Adentro », un service primaire de santé couvrant largement les secteurs populaires de tout le pays, mené à bien avec la participation importante de médecins cubains. Un programme qui a représenté la possibilité de comprendre d’autres formes de politiques publiques, non clientélistes, impliquant la participation des gens.
Avec la mission « Barrio Adentro », des pas importants ont débuté dans la transformation du système de santé dans le pays. On passe d’un système médical fondamentalement hospitalier à un régime décentralisé avec des services primaires basés dans les quartiers populaires. D’une situation où, par exemple, un enfant déshydraté dans un quartier de Caracas au milieu de la nuit, en dehors des horaires du transport public, devait être transporté à l’hôpital le plus proche où la famille devait affronter les scènes dramatiques des salles d’urgence, on passe à une situation où le module de soins primaires, où vit le médecin, est à une faible distance de la maison et à toute heure on peut frapper à la porte et être soigné.
« Barrio Adentro » fut conçu comme un projet requérant pour fonctionner la participation de la communauté. Le médecin lui-même, surtout s’il s’agissait d’un médecin cubain qui ne connaissait ni le quartier ni la ville, ne pouvait travailler qu’avec l’appui de la communauté. Cela impliquait, entre autres, un recensement de cette communauté, l’identification des femmes enceintes, des enfants avec des problèmes de malnutrition, des personnes âgées, et en général des gens avec des besoins particuliers. C’est une conception de la politique sociale complètement différente d’une aide qui vient d’en haut, parce qu’elle comprend la communauté comme coparticipante de son fonctionnement. Il y avait dans cette dynamique une potentialité extraordinairement riche.
Franck Gaudichaud : Donc, cette potentialité constituante et potentiellement émancipatrice du processus s’est épuisée ? C’est ce que tu dis ?
Edgardo Lander : Durant les années du processus bolivarien, non seulement la structure productive du pays n’a pas été modifiée, mais le pays est devenu encore plus dépendant des exportations pétrolières. Les politiques publiques dirigées vers les secteurs populaires ont toujours été caractérisées par leur nature distributive, avec une impulsion très limitée de processus productifs alternatifs à l’extractivisme pétrolier. Cette dépendance à l’égard des recettes pétrolières élevées a imposé de sévères limites au processus bolivarien (6).
Le caractère dynamique, incitatif, des processus d’organisation populaire des politiques publiques s’est épuisé pour différentes raisons. D’abord parce que toutes les « missions » (nom générique des différentes politiques sociales) n’ont pas été aussi remarquables que les programmes d’alphabétisation et « Barrio Adentro ». Mais aussi parce que les processus organisationnels à plus grande échelle, qui se sont développés jusqu’aux conseils communaux et aux communes, ont toujours connu une forte tension entre d’une part les tendances à l’autogestion, à l’autonomie, à l’auto-organisation, etc., et d’autre part la dépendance envers le transfert de ressources venues d’en haut, depuis une institution de l’État. Cela a généré des tensions récurrentes entre le contrôle politico-financier d’en haut et les possibilités d’auto-organisation plus autonome. Ces tensions étaient très diverses, en fonction des conditions existantes : la présence préalable ou non de directions locales, l’existence ou non d’expériences politiques d’organisation de la communauté avant le processus bolivarien, les conceptions politiques des fonctionnaires et des militants du Parti socialiste uni du Venezuela(PSUV) responsables des rapports entre les institutions de l’État et ces organisations. De fait, il y a eu une dépendance extraordinaire du transfert de ressources à partir de l’État. Il n’y avait pas de possibilité d’autonomie pour la majorité des organisations populaires de base, parce que celles-ci n’avaient pas de capacités productives propres.
Lorsque les transferts de ressources à ces organisations populaires se sont réduites, avec l’actuelle crise économique qui commence en 2014, elles ont eu tendance à s’affaiblir et beaucoup sont entrées en crise. Un autre facteur de cet affaiblissement a été la création des Comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP) en tant que mécanisme de distribution des aliments de base, fortement subventionnés, aux secteurs populaires de la population. En pratique, les CLAP se sont transformés en système d’organisations clientélistes, vouées exclusivement à la distribution d’aliments, sans l’autonomie, et ils tendent à remplacer les conseils communaux.
es politiques de solidarité et de coopération latino-américaines (comme l’ALBA) ont également été très dépendantes des revenus pétroliers. Pour mener à bien des politiques internationales tels les programmes de livraison subventionnée de pétrole à des pays d’Amérique centrale et de la Caraïbe, l’appui financier à la Bolivie et au Nicaragua, et d’autres initiatives diverses prises par le gouvernement vénézuélien sur le terrain latino-américain, il était nécessaire de garantir à court et à moyen terme une augmentation des revenus pétroliers. Quand Chávez meurt en 2013, le pétrole représentait 96 % de la valeur totale des exportations, ce qui fait que la dépendance du pays par rapport au pétrole était plus élevée que jamais auparavant.
Dans l’histoire pétrolière vénézuélienne, la première décennie de ce siècle fut le moment où existèrent les meilleures conditions possibles pour débattre, réfléchir et commencer à expérimenter d’autres pratiques et d’autres futurs possibles pour la société vénézuélienne au-delà du pétrole. Ce fut une conjoncture où Chávez bénéficiait d’une extraordinaire capacité de direction et de légitimité. Il était en mesure de donner un cap à la société vénézuélienne et, avec des prix du pétrole atteignant jusqu’à 140 dollars le baril, les ressources existaient pour répondre aux besoins de la population et faire les premiers pas d’une transition, ne serait-ce qu’initiale, au-delà du pétrole. C’est tout le contraire qui a eu lieu. Durant ces années, nous avons vu la répétition des discours de l’époque du premier gouvernement de Carlos Andrés Pérez au cours des années 1970 : une intoxication à propos de l’abondance et de l’imaginaire d’un Venezuela « saoudien ». Personne au Venezuela ne pensait possible de fermer par décret tous les puits de pétrole d’un jour à l’autre. Mais, loin de faire ne serait-ce que des pas timides et initiaux pour dépasser la dépendance du pétrole, les politiques gouvernementales n’ont fait que l’approfondir. Dans des conditions de surabondance de devises et afin de tenter de freiner la fuite des capitaux, une parité de change contrôlé absolument insoutenable fut établie. De cette manière, s’est accentuée la « maladie hollandaise » (7) qui a contribué au démantèlement de la capacité productive du pays.
Les politiques redistributives et les initiatives politiques de l’État ont réussi à améliorer les conditions de vie de la population et ont suscité le renforcement des tissus sociaux, avec d’importantes expériences de participation populaire. Néanmoins, ce ne fut pas accompagné par un projet de transformation de la structure productive du pays. Cela a marqué les limites du processus bolivarien comme projet de transformation de la société vénézuélienne. Autrement dit, les processus organisationnels de base, impliquant des millions de personnes, étaient fondés sur la redistribution et non sur la création de nouveaux processus productifs.
Franck Gaudichaud : Maintenant – en reprenant à nouveau García Linera sociologue et homme d’État bolivien (car il résume selon moi plus intelligemment cette orientation que d’autres faiseurs d’opinion, et ceux que j’appelle les « intellectuels de palais »),– ces tensions entre l’État et l’auto-organisation, entre gouvernement et mouvements, entre revendication du « bien vivre » et extractivisme à court terme seraient des tensions normales et « créatives » d’un long processus de transformation révolutionnaire en Amérique latine (8). Selon lui, les critiques de la gauche radicale aux processus progressistes veulent proclamer le socialisme par décret et ne comprennent pas qu’il s’agit de tensions nécessaires d’une expérience de long terme.
Miriam Lang : Un problème, c’est que les gouvernements progressistes – dans la mesure où leurs membres étaient issus de mouvements sociaux et de protestation avec une identité politique de gauche – ont assumé une sorte d’identité d’avant-garde. Comme s’ils savaient déjà mieux ce dont les gens ont besoin. Les espaces de dialogue réel, où des personnes diverses peuvent faire effectivement des propositions, ont ainsi disparu. Et la participation politique s’est transformée en une espèce d’acclamation du projet de l’exécutif. C’est précisément là où elle s’appauvrit. Il existe de nombreux exemples dans l’histoire européenne qui me font penser qu’il s’agit d’une dynamique inévitable, que nous sous-estimons trop souvent. Les gauches qui arrivent à gérer les appareils d’État sont finalement immergées dans de puissantes dynamiques propres à ces appareils et les militants se transforment, dans les nouveaux espaces où ils évoluent, parce que les logiques de cette charge leur apportent d’autres expériences et ils commencent à modeler leurs horizons politiques et aussi leur culture. Leur subjectivité se transforme, elle intègre l’exercice du pouvoir. Et alors, s’il n’existe pas de correctif de la part d’une société organisée forte, qui puisse protester, corriger et également critiquer, cela fait obligatoirement dévier le projet initial.
D’autre part, il ne s’agit pas tellement de critiquer les délais dans lesquels changent les choses – parce que je suis d’accord que les transformations profondes prennent beaucoup de temps, elles ont besoin d’un changement culturel et cela peut même durer des générations. Il s’agit de regarder la direction prise par un projet politique de transformation, c’est-à-dire s’il va ou non dans la bonne direction, à son rythme. Et là je crois que la question d’approfondir l’extractivisme et de détruire la nature dans un pays annule simplement d’autres possibilités futures de transformation. Si nous annihilons certaines options importantes du futur au profit de calculs à court terme, ou bien en raison des difficultés qui se présentent à un moment donné, nous ne pouvons alors pas dire qu’il s’agit d’une question de temporalité. C’est une question d’orientation. Tu peux marchandiser ou démarchandiser, mais si tu dis d’abord que tu vas tout marchandiser pour ensuite démarchandiser, ça ne paraît pas très logique. Il serait mieux de dire : je suis en train de démarchandiser, mais ça va me prendre beaucoup de temps, néanmoins vous pouvez voir que je fais des pas dans la direction indiquée. C’est pour cela que je crois qu’il y a là une différence fondamentale dans la lecture des processus.
Edgardo Lander : Dans les débats critiques sur l’extractivisme, l’un des points que je crois important est de savoir ce que nous entendons par « extractivisme ». Si nous le concevons seulement comme un modèle économique ou, comme le dit Alvaro García Linera, comme « un rapport technique avec la nature » compatible avec n’importe quel modèle de société, on pourrait en conclure qu’il est nécessaire d’approfondir l’extractivisme non seulement pour répondre aux demandes sociales, mais aussi afin d’accumuler les ressources nécessaires pour investir dans des actitivités productives alternatives qui permettent de dépasser l’extractivisme. Mais si on comprend l’extractivisme en termes plus larges, si on comprend que l’extractivisme est une forme de rapport des êtres humains avec la nature, qu’il fait partie d’un modèle d’accumulation du capital global, qu’il est une forme spécifique d’insertion dans le système capitaliste mondial et dans la division internationale du travail et de la nature ; si on comprend que l’extractivisme génère et reproduit un certain type d’institutions, des modèles d’État, des modes de comportement de sa bureaucratie ; si on comprend que l’extractivisme génère des sujets sociaux et des subjectivités, qu’il construit une culture, on arrive nécessairement à d’autres conclusions.
Il suffit de regarder les cent ans d’extractivisme au Venezuela : nous avons installé profondément une culture de pays riche, de pays d’abondance. Comme nous avons les réserves pétrolières les plus grandes de la planète, nous méritons que l’État satisfasse non seulement tous nos besoins, mais aussi nos aspirations de consommation. Nous imaginons possible une société ayant des droits, mais sans responsabilités. Nous méritons que l’essence soit gratuite, etc... Ces modèles culturels, une fois fermement enracinés dans l’imaginaire collectif, constituent un obstacle sérieux à la possibilité d’une transformation, non seulement pour dépasser le capitalisme mais aussi pour affronter la crise de civilisation que vit aujourd’hui l’humanité.
Ces imaginaires d’abondance matérielle servent toujours de manière croissante de substrat à des conceptions économicistes et consuméristes de la vie, laissant à l’écart une large gamme des questions fondamentales que nous devons affronter aujourd’hui. Cela bloque la possibilité de reconnaître que les décisions prises aujourd’hui ont des conséquences à long terme dans un sens absolument divergent du discours officiel proclamé comme horizon du futur de la société vénézuélienne.
À partir de cet imaginaire de l’Eldorado, d’une terre d’infinie abondance, on assume comme nécessaire, par exemple, l’exploitation minière à grande échelle dans l’Arc minier de l’Orénoque. Début 2016, un décret présidentiel de Nicolás Maduro a décidé d’ouvrir 112 000 km2 – un territoire de la surface de Cuba, représentant 12 % du territoire national – aux grandes entreprises minières multinationales. Il s’agit d’une zone faisant partie de la forêt amazonienne (avec l’importance de celle-ci dans la régulation des systèmes climatiques globaux). C’est une zone où habitent divers peuples indigènes, dont les territoires auraient dû être délimités conformément à la Constitution de 1999 et dont la culture et y compris la vie sont aujourd’hui gravement menacées. C’est un territoire où se trouvent une bonne partie des bassins des principales rivières du pays et les principales sources d’eau, d’une extraordinaire diversité biologique et où se trouvent les entreprises hydroélectriques produisant 70 % de l’électricité consommée dans le pays. Tout cela est menacé par une ouverture qui a commencé avec l’appel fait à 150 entreprises multinationales.
C’est conçu comme une zone économique spéciale, où des aspects fondamentaux de la Constitution et les lois de la République – les droits des peuples indigènes, la législation sur l’environnement et le droit du travail – ne doivent pas être appliqués.
Tout cela afin de créer les conditions les plus favorables possibles pour attirer l’investissement étranger. On prend ainsi des décisions qui dessinent un projet de pays qui probablement aura des conséquences pour les cent prochaines années.
Franck Gaudichaud : À mon avis, un autre thème essentiel de cette discussion est la problématique géopolitique, et dans ce cas les avancées sur le plan de l’intégration régionale liéés à l’évaluation des nouvelles stratégies de l’impérialisme et de son ingérence sur le continent. Très souvent, on critique les critiques de gauche (marxistes, éco-socialistes, féministes) en leur disant : vous sous-estimez et vous ne mesurez pas correctement l’impact de l’ingérence ou de la déstabilisation menée par les États-Unis dans la région, en vous centrant essentiellement sur une critique interne des processus, de l’Etat et des gouvernements. C’est ce qu’affirme, parmi d’autres, le sociologue argentin Atilio Borón : plusieurs de ses textes insistent sur le fait que, malgré leur modération, les gouvernements progressistes ont ouvert une nouvelle vague d’intégration latino-américaine sans les États-Unis (UNASUR, ALBA, CELAC) et que cela représente un pas gigantesque dans l’histoire régionale selon une perspective bolivarienne. Alors, que penser de l’état de cette intégration, quelles sont les avancées et les limites aujourd’hui sur ce plan ?
Miriam Lang : Il y a dix ans, il y eut réellement des impulsions et des propositions intéressantes et porteuses d’espoir au niveau mondial à partir de l’Amérique latine. L’intégration régionale fut proposée d’une autre manière que celle de l’Union européenne avec sa Constitution néolibérale, surtout dans les termes de ce que fut la Banque du Sud qui allait impulser des projets de souveraineté et de soutenabilité et non d’un développement en termes classiques, ou avec le projet de monnaie commune SUCRE. Malheureusement, durant ces dix ans, ces initiatives n’ont pas prospéré, surtout à cause de la résistance du Brésil qui joue évidemment un rôle important dans la région : il s’est orienté davantage vers ses partenaires BRICS et a priorisé ses intérêts de puissance mondiale.
Edgardo Lander : Finalement, le Brésil était d’accord avec la Banque du Sud mais seulement en le considérant comme une banque de développement de plus…
Franck Gaudichaud : Si nous abordons maintenant le cas de la profonde crise vénézuélienne actuelle, thèmatique et drame qui ont beaucoup polarisé les intellectuels de gauche (comme bien sûr aussi la société vénézuélienne elle-même), nous avons constaté la traduction de cette polarisation autour de deux appels internationaux émis en 2017. Premièrement, l’appel réalisé avec la participation active d’Edgardo Lander depuis le Venezuela, denommé « Appel international urgent pour arrêter l’escalade de violence au Venezuela : regarder le Venezuela, au-delà de la polarisation » (9), que vous avez tous deux signé. Deuxièmement, la réponse intitulée : « Qui accusera les accusateurs ? », faite par les membres du « Réseau des intellectuels et des artistes en défense de l’humanité », REDH (10), qui est une réponse assez hostile. L’un des arguments centraux des membres du REDH affirme que la crise vénézuélienne est, selon eux, avant tout le produit d’une agression impérialiste et d’une insurrection de la droite néolibérale, ainsi que d’une « guerre économique ». Ils insistent sur le fait que nous sommes dans un contexte régional de retour des droites, après le coup d’État au Brésil, et que cela oblige la gauche à serrer les rangs derrière les gouvernements affrontant cette agression, en laissant de côté les « contradictions secondaires ». Au contraire, l’appel que vous avez signé dit : « Nous ne croyons pas, comme l’affirment certains secteurs de la gauche latino-américaine, qu’il s’agit aujourd’hui de venir défendre un gouvernement populaire anti-impérialiste. Cet appui inconditionnel de certains activistes et intellectuels ne révèle pas seulement un aveuglement idéologique, mais il est préjudiciable, car il contribue malheureusement à la consolidation d’un régime autoritaire ». Comment lisez-vous ce débat qui a suscité d’autres textes et de nombreux échanges polémiques de part et d’autre ?
Miriam Lang : Récemment, une collègue me disait que les regards géopolitiques occultent les intérêts et les voix des peuples. Et je ne sais pas s’il s’agit d’une contradiction secondaire. La manière dont s’est faite cette confrontation me paraît déplorable, parce qu’elle a fermé des espaces de réflexion au lieu de les ouvrir. Je crois qu’en ce moment nous avons besoin justement d’une réflexion plus profonde, d’espaces de débats et non de fermeture, pour trouver une solution à la crise vénézuélienne. Et j’ai la sensation que les gens les plus éloignés du processus vénézuélien ont davantage besoin d’affirmer une sorte d’identité solidaire, qui représente bien plus une sorte de réflexe anti-impérialiste assez abstrait, déconnecté de ce qui se passe quotidiennement au Venezuela. Je crois que les solidarités que nous avons besoin de construire sont différentes. Elles ne devraient pas tourner autour de nous-mêmes, de nos besoins d’affirmer une identité politique comme une profession de foi, mais de rechercher ensemble des chemins conjointement avec des peuples concrets. La solidarité devrait se faire avec les gens réellement existants, qui souvent n’ont pas les mêmes intérêts qu’un gouvernement.
Et cela m’amène à une autocritique. Je suis récemment rentrée du Venezuela, où j’ai eu l’occasion de discuter avec quelques secteurs du chavisme critique, et c’est seulement à ce moment que j’ai compris comment ce camp s’est transformé ces dernières années. Comment il est compliqué de se solidariser, y compris de manière critique et différenciée, dans le scénario hyper-polarisé existant aujourd’hui. La lettre que j’ai signée aurait dû être plus réfléchie, il aurait fallu discuter plus avant de la faire circuler, et moi-même j’aurais dû prendre plus de temps pour discuter avec les différents secteurs du chavisme critique avant de la signer, justement pour être cohérente avec ma propre manière de voir. Bien que je continue à penser nécessaire la défense de l’institutionnalité démocratique et certaines valeurs de liberté – comme le fait la lettre – nous devons les élargir et les approfondir, tout en les défendant en tant que résultat des luttes antérieures. Et surtout je pense qu’une agression extérieure ne peut jamais justifier les erreurs commises à l’intérieur.
Cette polarisation, survenue au Venezuela et aussi dans d’autres pays, qui ne permet pas des tons gris – au-delà du blanc et du noir – est très négative et très nocive pour la transformation. Elle rend très difficile de se solidariser sans causer de dommage d’un côté ou de l’autre. Comme féministe, je ressens également la forme de ce débat comme extrêmement patriarcale, bourrée de binarismes simplificateurs, de logiques belliqueuses et d’égos autoalimentés, alors que nous devrions construire des liens et d’autres façons de faire de la politique, c’est-à-dire en s’épaulant activement sur les chemins de recherche d’alternatives.
Franck Gaudichaud : Effectivement, il semble qu’une certaine dialectique de la pensée critique ait été perdue dans ce débat (11). Quant à la polarisation du Venezuela, les défenseurs inconditionnels de Maduro soulignent que celle-ci existerait surtout entre la droite alliée de l’impérialisme contre le « peuple » et le gouvernement bolivarien, envisagés en bloc. Une telle analyse se base évidemment sur des éléments concrets des coordonnées du conflit actuel, mais elle ne laisse pas d’espace pour comprendre les tensions, les différenciations et les fortes contradictions internes au chavisme, à l’intérieur du camp populaire, mais aussi entre la population et le gouvernement.
Miriam Lang : Il existe une espèce de construction artificielle de l’unité entre le gouvernement et le peuple, comme cela s’est également beaucoup produit par rapport à Cuba, par exemple. En d’autres termes, le peuple cubain est « un » et celui qui parle pour le peuple cubain est nécessairement le gouvernement. Comme s’il n’y avait pas de rapports de domination et de conflits d’intérêts dans la société cubaine. Entre hommes et femmes, mais aussi entre État et société, ou entre noirs, métis et blancs, ou entre la campagne et la ville. De cette perspective unifiant gouvernement et peuple en un seul bloc symbolique, rien d’émancipateur ne peut naître réellement. Finalement, ce que nous préconisons c’est de réduire ou de dépasser ces rapports de domination, si je comprends notre tâche. Dans cette construction dichotomique, de polarisation, se réactualisent des logiques de guerre, un héritage culturel que les gauches charrient depuis la guerre froide et qui, déjà en ce moment historique, nous a amenés à éviter de nombreux apprentissages nécessaires. Un héritage qui fut peut-être partiellement dépassé par la révolte de 1968 avec ses impacts culturels sur les sociétés, mais qui connaît maintenant une réactualisation que je ressens comme assez douloureuse.
Gaudichaud : Edgardo, sur la situation du Venezuela : comment selon toi tenter d’affronter d’en bas, à gauche la crise vénézuélienne ?
Edgardo Lander : Personnellement, je n’ai signé aucun de ces deux appels internationaux, parce que réellement je sentais qu’aucun ne répondait à la fois à l’urgence de la situation, à la nécessaire dénonciation de l’agression impérialiste, de la droite et de ses secteurs ouvertement putschistes et était en même temps capable de faire une analyse critique ouverte et claire sur les dérives autoritaires du madurisme, de la « boulibourgeoisie » ; mais pas seulement par la défense formelle de la Constitution de 1999, également à partir du sauvetage nécessaire des formes de pouvoir populaire, des expériences d’auto-organisation, du projet communal, qui survivent malgré tout dans les interstices du processus…
Évidemment, il y a eu une offensive soutenue en partie par l’Empire, par les États-Unis. Depuis le début du gouvernement de Chávez des tentatives du gouvernement étatsunien pour étouffer ce processus ont existé, pour des raisons géopolitiques et économiques. Nous savons que les réserves pétrolières du Venezuela, tout comme l’or, le coltan, l’uranium et d’autres réserves abondantes de minerais existant dans le sud du pays sont essentiels pour les États-Unis, pour eux-mêmes ou pour en limiter l’accès à d’autres pays. Depuis 1999, le Venezuela a représenté un point d’entrée pour les changements sur le continent et c’est la raison pour laquelle les États-Unis ont appuyé le coup d’État militaire de 2002 et la « grève pétrolière », c’est-à-dire le lock-out patronal de 2002-2003, qui a paralysé le pays pendant deux mois, avec l’intention évidente de renverser le gouvernement du président Chávez. Nous savons que des groupes et des partis de l’extrême droite vénézuélienne ont bénéficié des conseils et du financement permanent du Département d’État. Le blocus financier et les menaces explicites d’intervention militaire lancées par Trump ne peuvent d’aucune manière être prises à la légère. Il y a eu également des ingérences importantes de l’uribisme (12) et du paramilitarisme colombiens. Ce type d’agression fait partie du panorama de la crise vénézuélienne actuelle et personne à gauche ne peut l’éluder ou le mettre à un second plan.
Maintenant, le problème du processus bolivarien est : que voulons-nous défendre ? Comment faut-il le défendre ? Devons-nous défendre tout gouvernement ayant un discours qui affronte les États-Unis ? Ou devons-nous défendre un processus collectif de caractère démocratique, anticapitaliste et anti-impérialiste, qui pointe un horizon répondant à la profonde crise de civilisation que nous traversons ? Devons-nous défendre le gouvernement toujours plus autoritaire de Maduro ou le processus de transformation surgi en 1999 ? Aujourd’hui, pour préserver le pouvoir du gouvernement Maduro, le clientélisme et les menaces de couper l’accès aux biens de base subventionnés (dans des conditions où, pour une proportion élevée de la population, c’est l’unique manière d’accéder à la nourriture) jouent un rôle beaucoup plus important que l’appel à la participation populaire. Et là, le thème de débat fondamental c’est : qu’entendons-nous aujourd’hui en disant « la gauche » ? Pouvons-nous penser la gauche sans questionner ce qu’a été le socialisme du siècle passé ? Quand des forces qui ont prétendu dépasser la démocratie bourgeoise ont fini par instaurer des régimes autoritaires, verticaux, de caractère totalitaire… Aujourd’hui, au Venezuela, nous devons nous demander si nous allons dans la direction d’approfondir la démocratie ou si les portes se ferment à la participation directe des gens dans l’orientation du destin du pays.
Au Venezuela, en 1999, fut convoquée une Assemblée constituante (AC) avec un très haut degré de participation : un référendum fut organisé pour décider de la tenue d’une AC, les députés à la Constituante furent élus avec une participation élevée, les résultats furent approuvés par une majorité de 62 % des votes, d’énormes ressources ont été dépensées pour moderniser le régime électoral, en établissant un système totalement digitalisé, transparent, avec des mécanismes multiples de contrôle et d’audit. Un système électoral fiable, pratiquement à l’épreuve de la fraude, comme de nombreux organismes internationaux et des experts électoraux du monde entier l’ont reconnu. Mais en décembre 2015 l’opposition a gagné les élections parlementaires par une large majorité, et le gouvernement se trouve devant l’alternative de respecter ces résultats électoraux, en restant fidèle à la Constitution de 1999, ou au contraire faire tout son possible pour rester au pouvoir, bien que cela implique de méconnaître la volonté d’une majorité de la population ou de sacrifier le système électoral qui avait conquis une légitimité si élevée. Il a clairement opté pour rester au pouvoir quoi qu’il advienne.
Pas à pas des décisions sont prises définissant une dérive autoritaire. On empêche la tenue du référendum présidentiel révocatoire en 2016, les élections des gouvernements en décembre de la même année sont postdatées inconstitutionnellement, les attributions de l’Assemblée nationale sont déniées et celles-ci sont usurpées par le Tribunal suprême de justice et le pouvoir exécutif. À partir de février 2016, le président commence à gouverner grâce à un état d’exception – « l’urgence économique » – en violant expressément les conditions et les limites de temps fixées dans la Constitution de 1999, en assumant des attributions qui, selon la Constitution, incombent au peuple souverain ; Maduro convoque une Assemblée nationale constituante et des mécanismes électoraux destinés à garantir le contrôle total de cette assemblée sont définis. Une Assemblée nationale constituante monocolore est élue, avec 545 membres tous identifiés au gouvernement. Une fois installée, cette assemblée s’autoproclame supra constitutionnelle et plénipotentiaire. La majorité de ses décisions sont adoptées par acclamation ou par unanimité sans aucun débat. Au lieu d’aborder la tâche pour laquelle elle est supposée avoir été élue – la rédaction d’un nouveau projet de Constitution – elle commence à prendre des décisions concernant tous les aspects des pouvoirs publics, elle destitue des fonctionnaires, elle convoque des élections dans des conditions destinées à empêcher ou à rendre plus difficile la participation de ceux qui n’appuient pas le gouvernement, elle approuve des prétendues « lois constitutionnelles » par lesquelles la Constitution de 1999 est abolie de fait. Elle approuve des lois de caractère rétroactif, comme la décision de rendre illégaux les partis n’ayant pas participé aux élections de maires en décembre 2017. Elle empêche la participation de candidats de gauche différents de ceux décidés par la direction du PSUV. Entre-temps, le Conseil national électoral a effectué une fraude pour bloquer l’élection de Andrés Velázquez comme gouverneur de l’État de Bolivar…
Ce qui est en jeu ici, ce n’est pas la défense formelle de la Constitution de 1999, mais celle de la démocratie, pas une démocratie bourgeoise formelle, mais l’ouverture vers l’approfondissement de la démocratie que représentait la Constitution de 1999. Sans qu’il se soit produit un événement unique définissant une rupture de l’ordre constitutionnel démocratique recréé en 1999, on en a peu à peu coupé des tranches, comme un saucisson, jusqu’à nous retrouver dans la situation actuelle où il n’est plus reconnaissable.
Franck Gaudichaud : Donc, à partir de ce panorama très complexe où les progressismes connaissent des revers brusques ou graduels, où les gauches critiques et radicales ne réussissent pas à émerger comme force populaire massive, où les forces électorales de rechange réellement existantes sont, pour le moment, les droites néolibérales agressives, même insurrectionnelles dans certains cas comme le Venezuela, comment penser à des alternatives concrètes en cette fin d’hégémonie des progressismes et de relance d’un néolibéralisme tardif ? À partir de la perspective du « bien vivre » et de l’écosocialisme, de la critique anticapitaliste des limites stratégiques et contradictions des gouvernements progressistes, du féminisme populaire ou décolonial ? Bref, comment penser des utopies avec des perspectives concrètes pour Nuestramérica (Notre Amérique) ?
Edgardo Lander : Au Venezuela, l’unique source d’optimisme pour moi en ce moment est le fait que la crise a été si profonde et qu’elle a tellement frappé la conscience collective qu’il est possible que l’enchantement du pétrole, de la rente et de « l’État magique », bienfaiteur et fournisseur, commence à se dissiper lentement. Tout le débat politique gauche-droite dans les dernières décennies a opéré à l’intérieur des paramètres de l’imaginaire pétrolier, à l’intérieur de cette notion du « Venezuela pays riche », maître des plus grandes réserves pétrolières de la planète. La politique a tourné autour des demandes faites par différents secteurs de la société à l’État pour accéder à ces ressources. Je commence à voir des signaux, malheureusement encore faibles, d’une reconnaissance du fait qu’il n’est pas possible de continuer dans cette voie. On commence à assumer qu’un cycle historique arrive à sa fin. Les gens commencent à se gratter la tête : Et maintenant quoi ? Depuis des années, j’ai des contacts avec le processus d’organisation populaire le plus continu et le plus vigoureux au Venezuela, Cecosesola (13). Il s’agit d’un réseau de coopératives opérant dans plusieurs États du centre et de l’ouest du pays, qui relie un large réseau de producteurs agricoles et artisanaux à des consommateurs urbains, en plus d’un centre admirable de santé coopérative et d’une coopérative funéraire. J’ai été frappé par la présence de thèmes comme le sauvetage et l’échange de semences dans les conversations quotidiennes. La reconnaissance d’un avant et d’un après le début de la crise actuelle. Récemment, quand quelqu’un venait d’un village voisin on lui disait : rappelle-toi de m’apporter un seau de semences de tomates. C’était le quotidien. C’étaient des semences de tomates importées, sélectionnées et hybrides, pas forcément transgéniques, mais stériles après les premiers semis. Avec la crise économique, cet accès aux semences a été bruquement fermé. On reprend des pratiques paysannes ancestrales. Des réunions entre paysans où l’on s’interroge : qui a des semences, de quoi ? Des semences autochtones qui n’étaient préservées qu’à petite échelle commencent à s’échanger : des semences de pommes de terre, de tomates, etc. On ouvre ainsi de nouvelles possibilités. Nous allons nous réveiller de ce rêve (qui s’est avéré être un cauchemar) et penser à la possibilité d’être ailleurs, dans un pays différent, dans d’autres conditions et la vie continuera, mais elle va prendre un nouveau chemin.
Franck Gaudichaud : Miriam, ce que dit Edgardo est intéressant, mais il décrit, pour le moment, des embryons très petits de pouvoir populaire, qui peuvent paraître peu opérationnels face aux immenses défis régionaux, à la mondialisation financière et impérialiste, au chaos mondial…
Miriam Lang : Cela dépend là encore un peu d’où tu vois la chose, je crois que par exemple ici, en Europe, ce qu’il faut faire c’est de commencer à prendre conscience des effets que cause dans d’autres parties du monde le mode de vie basé sur la consommation intensive que tout le monde assume assez naturellement. Il me semble que les dimensions de la destruction que ce mode de vie occasionne – non seulement en termes environnementaux, mais également pour le tissu social, pour les subjectivités – sont beaucoup plus importantes qu’on ne le croit en Europe, où tout cela reste pratiquement invisible, camouflé par une consommation agréable, massive et anesthésiante.
Edgardo Lander : Ou par la croyance que le niveau de vie au Nord ne dépend pas de l’extractivisme au Sud.
Miriam : Plusieurs d’entre nous appellent cela « le mode de vie impérial », qui assume automatiquement que les ressources naturelles et le travail bon marché et esclavagisé du monde entier sont au service des 20 % de la population mondiale la plus prospère et vivant dans les centres capitalistes, ou des classes moyennes et supérieures des sociétés périphériques. Et si c’est bon marché, tant mieux... D’où la sensation que la planète va s’effondrer écologiquement et socialement du fait de l’énorme quantité de gadgets produits, dont personne n’a réellement besoin sauf « les marchés », du fait de tout ce que le capitalisme suggère comme besoins artificiellement construits. Ici, dans les centres capitalistes, il y a donc une tâche très importante : réduire la quantité de matière et d’énergie dépensée. Par exemple, les mouvements autour de la décroissance ont une bonne perspective en parlant d’une transformation culturelle, où à cause du mal-être dû au néolibéralisme dont tu as parlé, les gens redécouvrent d’autres dimensions non matérielles de la qualité de vie et aussi la richesse de produire eux-mêmes les vêtements, le miel ou d’autres choses.
Franck Gaudichaud : Aujourd’hui, en France aussi il existe un grand nombre de réseaux alternatifs paysans, des expériences collectives autogérées, des zones à défendre (ZAD), des monnaies alternatives et du troc, etc… C’est extremement riche, essentiel même, mais tout cela reste très petit.
Miriam Lang : Ce sont de petits réseaux pour l’instant, mais l’important c’est que ça agit par contagion, toucher de plus en plus de gens avec ces imaginaires de bien-être différents, pour que le changement ne se fasse pas par la force ou par la crise, mais par leur propre désir. Que les gens puissent sentir, expérimenter dans leur chair qu’il existe d’autres dimensions de bien vivre pouvant facilement compenser le fait d’avoir moins matériellement. Et qu’une décroissance choisie ne doit pas être vécue comme une perte.
Edgardo Lander : Pas comme un sacrifice de cesser d’avoir des choses…
Franck Gaudichaud : De fait, ici, on parle de la conquête nécessaire d’une sobriété heureuse et d’une austérité volontaire et joyeuse face au gaspillage consumériste, c’est un concept intéressant, puissant, qui peut se connecter directement au « bien vivre » et à l’écosocialisme.
Miriam Lang : Chaque fois que je vais en Europe, je sens qu’il existe un très grand mal-être avec ce mode de vie super-accéléré qui y prime. J’ai de nombreux amis qui sont malades, pas forcément physiquement mais psychologiquement : le stress, la dépression, les burn-out, les crises de panique. Les dimensions que cela prend sont assez systématiquement cachées dans les discours dominants qui continuent d’associer le bien-être à la croissance économique, et bien plus encore dans ce qui se perçoit à partir du Sud. Vu de l’Amérique latine, ici dans les pays du centre tout est nécessairement merveilleux. Alors, visibiliser ces mal-être et les autres formes de vie qui en résultent serait un pas important. Parce que dans le Sud, curieusement, tout le monde croit qu’il est meilleur de vivre en ville, alors qu’en Allemagne ou en Espagne, au contraire, les communautés écologiques qui vont à la campagne se multiplient. Ce serait un pas pour contribuer à briser cette hégémonie du développement imitatif, obligeant le Sud à répéter toutes les erreurs déjà commises dans les sociétés du Nord, comme l’engorgement des villes par les voitures, par exemple. Mais ici, dans le Nord, quelques-unes de ces erreurs sont dépassées par les nouvelles générations, comme la division du travail entre hommes et femmes. Maintenant, dans les générations comme la mienne, partager les tâches et les soins non seulement dans le couple, mais au-delà du couple, parfois dans le bâtiment, dans la communauté qui peut naître dans un espace réduit de coexistence, est déjà devenu plus normal.
C’est aussi un autre élément important : construire la communauté contre l’individualisation forcée, à la campagne et à la ville. Je ne me réfère pas à la communauté comprise comme le petit village paysan, ancestral, figé dans le temps, mais à des communautés politiques en mouvement, qui incorporent les tâches de soin comme des tâches collectives et réorganisent alors la vie autour de la reproduction de la vie, et non autour des demandes du marché et du capital. Je crois qu’il faudrait rendre visibles tous les efforts déjà faits en ce sens, où les gens vivent relativement bien, tant au nord qu’au sud. Au sud ce seront en partie des communautés ancestrales, mais aussi d’autres nouvellement créées, alors qu’au nord elles sont en général récemment constituées. Il s’agit de changer une pensée unique et de voir les choses existantes, il ne faut pas tout inventer de zéro.
Par exemple, il existe une vision présentant les quartiers périphériques urbains comme un enfer, surtout au sud. Mais si tu vas y regarder de plus près, il y existe de nombreuses logiques, absolument anticapitalistes, celle de ne pas travailler, celle de prioriser la fête, celle des échanges non mesurés par la logique de l’argent… Ce n’est peut-être pas le modèle, de toute manière il n’existe et il ne devrait exister aucun modèle, c’est très important à souligner. Après le socialisme du XXe siècle, nous n’allons pas avoir une nouvelle recette unique où nous inscrire tous et la suivre ; il s’agit bien plus de permettre cette diversité des alternatives, pour qu’à partir de chaque culture et chaque contexte les gens qui y sont impliqués puissent se construire. Les « bien vivre » sont pluriels.
Nous devons aussi générer une culture d’alternatives, qui nous permette d’errer, de nous tromper, d’apprendre de nos erreurs. Ces espaces d’expérimentation sociale où nous disons : bon, nous allons tenter cela, ça ne fonctionne pas, nous allons tenter autre chose, mais en cohésion et sans compétition, selon le principe de la coopération et non de la concurrence. Un livre, « The future of development » (14) affirme que le pourcentage de la population mondiale réellement inséré dans les circuits du marché néolibéral globalisé c’est à peine la moitié, et que le reste se trouve dans ce que nous appellerions les marges. Ça donne de l’espoir, ça veut dire aussi que la moitié de la population mondiale se trouve ailleurs, au-delà du modèle dominant, alors nous devrions commencer à regarder par là. ■
* Franck Gaudichaud est enseignant-chercheur à l’université Grenoble-Alpes (France). Il est membre du collectif éditorial du site www.rebelion.org et de la revue ContreTemps (papier et web) et co-président de l’association France Amérique latine. Il est militant du Nouveau parti anticapitaliste (NPA, France) et de la IVeInternationale. La transcription de cet entretien a été effectuée par Alejandra Guacaraán, la révision, correction et actualisation par Franck Gaudichaud, Edgardo Lander et Miriam Lang. Le texte original a été publié par la revue Viento Sur le 23 janvier 2018 (http://www.vientosur.info). Traduit de l’espagnol par Hans-Peter Renk.
Notes
1. Ce colloque international s’est tenu à l’université de Grenoble-Alpes (France) en juin 2017 et a été coordonné par l’auteur, ainsi que par Thomas Posado (Université Paris-8). Pour consulter une partie des communications et voir les vidéos des conférences de Pierre Salama, Miriam Lang et Edgardo Lander, cf. https://progresismos.sciencesconf.org
2. www.rosalux.org.ec
3. https://www.tni.org.
4. Cf. Álvaro García Linera, Conferencia Magistral en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, Équateur, 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=DeZ7xtBJT8U
5. Cf. Miriam Lang et Dunia Mokrani (comp.), Más allá del desarrollo, Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala, Quito, 2012, www.rosalux.org.mx/docs/Mas_alla_del_desarrollo.pdf.
6. Edgardo Lander, La implosión de la Venezuela rentista, TNI, 2016, https://www.tni.org/es/publicacion/la-implosion-de-la-Venezuela-rentista
7. La maladie hollandaise est un phénomène économique qui relie l’exploitation de ressources naturelles au déclin de l’industrie manufacturière locale. Ce phénomène est suscité par l’accroissement des recettes d’exportations, qui à son tour provoque l’appréciation de la devise. Le résultat est que dans les autres secteurs, les exportations deviennent moins favorables que les importations.
Inspiré du cas des Pays-Bas des années 1960, le terme maladie hollandaise est utilisé par extension pour désigner les conséquences nuisibles provoquées par une augmentation importante des exportations de ressources naturelles par un pays.
8. Cf. Álvaro García Linera, Las tensiones creativas de la revolución : la quinta fase del Proceso de Cambio, La Paz, 2011, www.rebelion.org/docs/134332.pdf
9. http://llamadointernacionalVenezuela.blogspot.fr/2017/05/llamado-internacional-urgente-detener_30.html et http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/05/31/des-intellectuels-de-gauche-du-monde-entier-se-mobilisent-contre-la-violence-au-Venezuela_5136689_3222.html
10. www.resumenlatinoamericano.org/2017/06/01/la-red-de-intelectuales-redh-responde-a-una-declaracion-en-la-que-se-ataca-al-proceso-bolivariano-de-Venezuela/
11. Pour un premier bilan de la crise vénézélienne, à partir d’opinions plurielles, cf. Daniel Chávez, Hernán Ouviña et Mabel Thwaites Rey (comp.), Venezuela : Lecturas urgentes desde el Sur, CLACSO, 2017.
12. Du nom de Alvaro Uribe Vélez, président de la République de Colombie de 2002 à 2010, élu sénateur en 2014, qui a fait campagne pour le « non » lors du référendum sur l’approbation des accords de paix entre le gouvernement colombien et les FARC en octobre 2016. Il dirige en Colombie le bloc le plus droitier. Cf. Daniel Libreros, « Les raisons du résultat négatif du référendum sur l’approbation des accords de paix entre le gouvernement et les FARC », Inprecor n° 631/632 de septembre-novembre 2016.
13. http://cecosesola.net. En français : https://www.bastamag.net/1200-salaries-pas-de-patron-et-aucune-hierarchie-les-secrets-de-la-cooperative ou https://autogestion.asso.fr/lexperience-cecosesola/
14. Gustavo Esteva, Salvatore Babones, Philipp Babcicky, The Future of Development : A Radical Manifesto, Policy Press, Bristol, 2013.





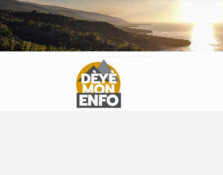






Un message, un commentaire ?