Tiré de Europe solidaire sans frontière.
Patriarche de la littérature philippine, Francisco Sionil José a conservé, à 93 ans, l’ironie mordante, ponctuée d’éclats de rire sonores, de l’écrivain engagé qu’il fut toute sa vie. « Artiste national en littérature », la plus haute distinction attribuée à un écrivain aux Philippines, traduit en 28 langues, il a traversé le siècle en épousant les espoirs et les désenchantements de son pays. Tenaillé par une soif inassouvie de justice sociale et une inlassable quête d’identité nationale, son œuvre majeure, la saga de Rosales, en cinq volumes (Po-on ; A l’ombre de Balete ; Mon frère, mon bourreau ; Les Prétendants ; José Samson, éditions Fayard), est une fresque romanesque qui s’étend de la lutte contre les colonisateurs espagnols – à la fin du XIXe siècle –, qui conduisit à une indépendance aussitôt confisquée par les Etats-Unis, à la proclamation de la loi martiale par Ferdinand Marcos, en 1972. Comme il aime le dire, Francisco Sionil José a cru en « beaucoup de causes perdues ». Son radicalisme ne relève pas d’un engagement marxiste mais d’une rage morale qui trouve sa source dans l’humiliation, l’injustice et l’incapacité des Philippines à se dégager de leur passé colonial. Il replace la présidence de Rodrigo Duterte, entré en fonction le 30 juin 2016, dans l’histoire d’un peuple meurtri.
Philippe Pons – Au lendemain de l’élection de Rodrigo Duterte, vous avez écrit un article intitulé « La révolution Duterte » ? Un an plus tard, écririez-vous la même chose ?
Francisco Sionil José – Je pensais que, finalement, Rodrigo Duterte pouvait changer ce pays, mettre fin aux oligarchies, remédier à une pauvreté endémique et enrayer la corruption. J’ai vu passer 15 présidents au cours de ma vie. Après Ramon Magsaysay (1953-1957), mort dans un accident d’avion, tous ont été manipulés par les oligarchies locales. Rodrigo Duterte était le premier qui n’avait pas leur soutien. Dans son discours devant le Parlement, à la suite de son investiture, il avait eu le courage de lancer à l’assistance : « Sachez que je ne vous dois rien. » Jamais un président n’avait tenu un tel langage aux élus. Il est le premier président qui n’a pas le soutien de l’élite. En tant que personne, Rodrigo Duterte est un homme honnête. Et j’ai pensé que, finalement, une révolution était à portée de main.
Nous avons été victimes du colonialisme espagnol, américain et japonais. Puis, après l’indépendance, nous avons été colonisés par nos propres élites. J’ai toujours dit et écrit qu’une révolution était nécessaire. Et au soir de ma vie, j’en suis plus que jamais convaincu. J’entends par révolution la fin d’un système politique au service des oligarchies. Ce pays est riche en terres, en minerais, la majorité des habitants parle anglais, l’économie croît… et pourtant un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, la moitié avec moins d’un dollar par jour. Dans les bidonvilles, beaucoup ne mangent qu’un repas par jour. Selon l’Unicef, les Philippines figurent parmi les dix pays du monde qui ont le plus grand nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition. C’était déjà le cas il y a trente ans, lorsque Ferdinand Marcos a été renversé. Et depuis, rien n’a changé. Est-ce acceptable pour un pays qui, au lendemain de la guerre du Pacifique, était le plus prometteur de l’Asie et enregistre aujourd’hui une croissance de 6 % par an ?
Cette révolution que vous appelez de vos vœux est-elle terminée avant d’avoir commencé ?
La lutte contre la drogue lancée par Duterte a fait plus de 7 000 morts en un an. C’est inadmissible. La plupart des victimes étaient innocentes. Des consommateurs et des petits dealers, mais rien de plus. Les grands trafiquants, que l’on connaît, restent hors d’atteinte. Autoriser l’inhumation de Ferdinand Marcos au cimetière des héros nationaux est tout aussi inadmissible. Duterte paye vraisemblablement ainsi sa dette au clan Marcos, qui a financé en partie sa campagne présidentielle. Faire d’un dictateur un héros national est une erreur politique qui revient à tirer un trait sur ce que les Marcos ont fait subir au pays. J’ai été choqué par cette décision, mais elle m’a aussi fait réfléchir à la faillite de ma génération à faire comprendre le passé.
En 1986, les Philippins ont renversé une dictature sans appui étranger. Aujourd’hui, Duterte veut réintroduire la peine de mort et recourir, comme Marcos, à la loi martiale : est-on revenu à la case départ ?
En 1986, le people’s power (« le pouvoir au peuple »), qui a mis fin à vingt ans de dictature, a été un grand moment de fierté nationale : le premier depuis l’indépendance. Mais il fut sans lendemain. Rapidement, l’esprit du people’s power s’est évanoui. La corruption a continué à affaiblir les institutions et la structure du pouvoir est restée la même. Ici, on vote moins pour des idéologies que pour des personnes, et Cory Aquino, la veuve de « Ninoy » Aquino, grande figure de l’opposition assassinée par les sbires de Marcos, a été portée au pouvoir autant par la compassion que par de profondes aspirations au changement. Elle démantela le système d’oppression de Marcos et rendit le recours à la loi martiale plus difficile. Mais les grandes familles, l’élite à laquelle elle appartenait, ont continué à dominer le système politique. Il y a eu une forme de redistribution de la richesse : les « barons » de Marcos ont rentré la tête et les oligarques qu’il avait spoliés ont retrouvé leurs privilèges. Il suffit de regarder la composition de la Chambre des représentants aujourd’hui pour s’en convaincre.
Puis, après une suite de désillusions avec les successeurs de Cory Aquino, est arrivé Duterte, proclamant qu’il allait mettre à bas le statu quo. Et, une nouvelle fois, les Philippins ont cru le changement possible. N’oublions pas que son soutien transcende les ethnies, les classes sociales et les générations. Son taux de popularité reste important : il dépasse les 70 %. Beaucoup de Philippins ont voté pour lui parce qu’ils en avaient assez de la corruption du plus haut au plus bas de l’échelle sociale. Ils prenaient le risque, pour certains consciemment, d’un saut dans l’inconnu, avec un homme dont on connaissait les pratiques et qui est devenu, aujourd’hui, un président électron libre. Il se comporte à la présidence comme il le faisait en tant que maire de Davao : avec la brutalité du boss. Son pire ennemi est désormais lui-même.
Comment expliquez-vous cette retombée de ce que l’on a baptisé l’« esprit d’EDSA » en référence à cette gigantesque manifestation populaire (2 millions de personnes) sur l’avenue Epifanio-de-los-Santos (surnommée EDSA) qui a sonné le glas de la dictature de Marcos ?
Les Philippines sont un pays fracturé. Elles sont en Asie sans y appartenir. Les racines de cette partie du monde nous sont étrangères : le bouddhisme, l’hindouisme, le confucianisme… La majorité de la population philippine est chrétienne et une minorité musulmane. Notre passé n’est pas le nôtre : c’est celui des colonisateurs : espagnols (1565-1898) puis américains. Géographiquement, nous sommes un pays éclaté en une poussière d’îles, peuplées par une trentaine d’ethnies qui ont leur propre histoire, leur dialecte, leur culture. Seule la mer nous unit. Les moro (musulmans philippins) sont divisés. La gauche également. Ce fut, notamment, le cas des huks – des partisans communistes qui luttèrent contre l’occupant nippon puis menèrent une insurrection armée pour protester contre une indépendance, à leurs yeux factice, accordée par les Etats-Unis. Ces fractures nourrissent des egos surdimensionnés : chacun veut être le patron et rivalise avec son voisin.
En outre, le colonialisme reste latent. Il se poursuit dans des attitudes de colonisés dont nous ne nous sommes jamais défaits, qui ont nourri un sens diffus d’infériorité, une acceptation des références et du jugement des colonisateurs. Les Américains ne furent pas de « mauvais maîtres », mais leur joug, puis leur tutelle après l’indépendance, a perpétué l’ordre colonial et privé l’élite d’un sens de responsabilité vis-à-vis du pays. Elle n’a même pas vu venir le phénomène Duterte : une rébellion populaire contre l’injustice. Pourquoi José Rizal (1861-1896), notre héros national, qui combattit les Espagnols et fut fusillé par eux, a-t-il tant influencé les nationalistes ? Parce qu’il se battait pour l’indépendance, certes, mais aussi pour la justice sociale et la moralisation de la politique. Trop longtemps, beaucoup de Philippins ont cru qu’il suffisait d’aller à l’église, de fermer les yeux et de prier. Quand nous les avons rouverts, notre pays nous avait été ravi. Donc, pour répondre à votre question, après EDSA, nous n’avons pas été assez vigilants : nous avons cru que la démocratie était acquise et, rapidement, tout est redevenu comme avant.
Vous évoquiez les divisions de la minorité musulmane de Mindanao (5 % de la population), où des groupuscules armés ont fait allégeance à l’organisation Etat islamique (EI). Le radicalisme ne peut-il pas constituer un ferment d’unité ?
Les musulmans, aux Philippines, n’ont jamais constitué une communauté homogène. Ils ont lutté contre les Espagnols, puis les Américains, et enfin contre l’Etat central. Mais ils n’ont jamais surmonté leurs rivalités internes. Les migrations de non-musulmans à Mindanao au lendemain de la seconde guerre mondiale ont exacerbé les discriminations à leur égard. Beaucoup de musulmans ont été spoliés de leurs terres. La « question moro » est moins religieuse que sociale et elle ne peut être réglée militairement. Dans les années 1970, Marcos a militarisé le problème et beaucoup de moro se sont radicalisés au Moyen-Orient. En quarante ans, les affrontements ont fait 150 000 morts. Aujourd’hui, Daech a pris pied à Mindanao comme en Indonésie et en Malaisie. Il faut certes combattre ces groupuscules, mais aussi remédier aux problèmes socio-économiques qui alimentent une radicalisation qui ira en s’accentuant.
Si un ego surdimensionné est une faiblesse des Philippins, quelle est leur force ?
Leur courage à endurer. Leur générosité. Leur don-quichottisme…
Leur patriotisme ?
Le nationalisme philippin est, avec celui des Japonais et des Indiens, le plus ancien d’Asie. A la fin du XIXe siècle, nous nous sommes soulevés : pieds nus et armés de lances en bambou, nous avons fini par chasser les Espagnols. La résistance aux Japonais a été l’une des plus acharnées des peuples qu’ils avaient soumis à leur joug. Nous sommes patriotes face à l’étranger. Mais nous avons été colonisés trop longtemps puis trop dépendants des Etats-Unis et fascinés par l’American way of life pour apprécier suffisamment notre propre culture. Nous avons échoué à créer une langue nationale. J’écris dans une langue qui n’est pas la mienne, l’anglais, car c’est le seul moyen d’être lu. Déjà, il y a un siècle et demi, José Rizal écrivait en espagnol… Or une langue, ce n’est pas seulement des mots, c’est l’héritage d’une culture.
* LE MONDE | 23.06.2017 à 12h00 • Mis à jour le 24.06.2017 à 18h51 |
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/06/23/les-philippines-sont-un-pays-fracture-seule-la-mer-nous-unit_5150024_3216.html#MwjExQWvP9yA7Y8E.99 :
http://abonnes.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/06/23/les-philippines-sont-un-pays-fracture-seule-la-mer-nous-unit_5150024_3216.html?xtmc=sionil&xtcr=1


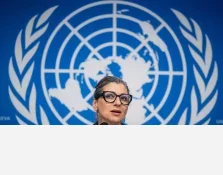



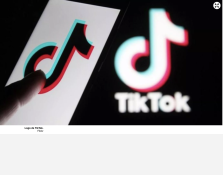



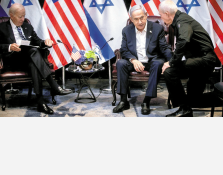

Un message, un commentaire ?