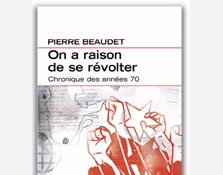Nous venons de voir que ton propos sur l’action et l’émancipation se voulait également une articulation stratégique entre l’histoire collective, la territorialité et les conflits, à ce point de jonction situé entre le monde complexe de l’aliénation (technosociété) et du sujet. En ce sens, peux-tu expliquer l’intérêt de poser son esprit sur le "développement des sciences" plutôt que sur les technosciences ?
Oui je m’appuie ici, en partie tout au moins, sur les réflexions anthropologiques de Leroy Gourhan et plus près de nous sur celles de Bernard Stiegler qui justement prend le contre-pied d’Heidegger, en affirmant que "l’être humain est un être essentiellement technique". Stiegler ajoute même à propos de l’évolution de l’homme, que c’est un peu comme si, avec elle, "l’histoire de la vie devait se poursuivre par d’autres moyens que la vie".
Je dirais de mon côté que ce qui caractérise l’être humain, c’est d’avoir pu échapper à ce qu’on pourrait appeler l’enfermement animal et au fait que chez ce dernier, l’outil fait partie intégrante de son corps, le condamnant de fait à ce qu’on pourrait appeler une spécialité étroite, le rendant du même coup très dépendant de sa niche écologique originaire.
Chez l’être humain, "singe nu marchant debout", l’outil est détaché du corps et peut donc être multiplié à l’infini, l’ouvrant ainsi aux possibles. Je rajouterai cependant que l’être humain n’est pas seulement un producteur d’outils, il est aussi un producteur de signes (de rapports symboliques) et de rapports sociaux et que c’est la combinaison de ces trois types de productions qui fait sa spécificité et détermine ce qui est sa nature propre. Mais on le voit bien, au prisme d’une telle définition, sa nature qui n’est au point de départ, ni fixée, ni déterminée, va bien évidemment être profondément marquée par les caractéristiques et l’évolution de ce réseau de signes, de rapports sociaux et d’outils. Tel est l’arrière fond philosophique à partir duquel j’ai tenté de reprendre à mon compte cette distinction entre sciences et techno-sciences qu’il me semble très important de pouvoir faire aujourd’hui.
Ce qui fait problème en effet, ce n’est pas la science en soi —elle est justement une des expressions de la grandeur humaine—, ce n’est pas non plus la technique -puisqu’elle permet à l’être humain de s’ouvrir aux possibles et qu’elle est ce à travers quoi il peut évoluer. Ce qui fait problème, c’est une certaine science et une certaine technique dont les développements ont été déterminés et surtout arraisonnés chaque fois plus par les logiques marchandes et productivistes du capitalisme historique. Cela se traduit par le fait d’abord que la science se voit assujettie étroitement à la technique, c’est à dire au fait qu’elle n’est valorisée que dans la mesure où elle peut donner naissance à des techniques qui marchent dans le système où elles se déploient —d’où son nom de technosciences—. Puis par le fait que ces techniques toutes puissantes sont à leur tour assujetties aux logiques déréglées du profit capitaliste qui ne favorise le développement que de ce qui est congruent à sa logique.
Voilà pourquoi la technique n’est jamais neutre et qu’on ne peut en faire la critique, ni l’apologie sans faire en même temps la critique du système au sein duquel elle s’insère et qui en a déterminé sa forme et son mouvement. Voilà pourquoi aussi il faut distinguer entre des techniques qui à certaines conditions peuvent avoir un caractère émancipateur (par exemple un certain type de technique solaire, éolienne, informatique développé dans tel contexte, etc.) et d’autres qui au contraire, nous entraînent vers des logiques chaque fois plus mortifères (nucléaires, etc.). Cette distinction me paraît importante, car ainsi on ne voue pas aux gémonies la technique en soi —ainsi qu’ont eu tendance à le faire chacun à leur manière des penseurs comme Ellul, Heidegger, Jonas. On cherche plus simplement à déchiffrer les formes qui font problème aujourd’hui et qu’on ne peut pas séparer du développement capitaliste actuel. D’où d’ailleurs soit dit en passant, la nécessité de tout faire pour en finir avec le capitalisme, d’oser passer à autre chose ! Mais ce faisant, on met nécessairement l’accent sur le fait que le problème est d’abord et avant tout politique et stratégique.
Q- Cela dit les contraintes éducatives, familiales, universitaires, professionnelles, toute l’organisation sociale planétaire, urbaine à 80% vers 2050, seront intégrées/assimilées anthropologiquement au progrès et aux développement des technosciences... tandis que "la portée supérieure des sciences" demeurera accessible à une élite seulement, tout comme aujourd’hui. Tu écriras : "il faut saisir l’importance décisive du travail théorique critique mené au 19ème siècle, par une étrange constellation de penseurs – Marx, Nietzsche et Freud... ". Ton prolongement est surprenant, peux-tu nous éclairer ?
En fait, il s’agissait pour moi d’essayer de me situer de manière plus précise, dans l’histoire de la philosophie occidentale.
De quels auteurs se revendiquer ? À partir de quelle tradition se définir ? Car en philosophie, on ne part jamais de rien. On s’inscrit toujours dans un héritage donné, qu’on le veuille ou non. Sans doute je pouvais m’inscrire dans celui de Marx, j’en ai évoqué au départ une des raisons, moi qui ai toujours vu dans la 11ième thèse de Feueurbach de Marx une perspective de recherche philosophique critique extrêmement féconde : « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde ; mais ce qui importe c’est de le transformer ».
Mais cela ne me paraissait pas suffisant. Marx n’est pas tout, et son oeuvre elle-même, est traversée par des tensions non totalement résolues. D’où cette idée —elle est en rien originale— de combiner son approche à celles d’autres penseurs critiques clefs. C’est Derrida qui disait qu’on ne peut pas penser aujourd’hui sans passer par Marx (ne serait-ce que pour penser contre lui !).
Tout naturellement, j’ai eu envie de rajouter : on ne peut pas penser aujourd’hui sans aussi passer par Nietzsche et Freud, ces 2 autres penseurs du soupçon. Bien sûr on pourrait me demander pourquoi m’arrêter à des auteurs du 19ième siècle européen, et qui plus est à ces seuls trois auteurs.
En fait, ces 3 penseurs jouent un rôle clef dans l’histoire de notre tradition philosophique occidentale —tout au moins est-ce ainsi que je les interprète— parce qu’ils ont su —tout en se reconnaissant des valeurs de la modernité— les passer au crible de la critique rationnelle la plus rigoureuse. D’où leur nom de « penseurs du soupçon ». Ils représentent ainsi une véritable rupture d’avec le passé, un appel à penser sur d’autres bases, et un appel dont nous sommes —quasiment deux siècles plus tard— encore redevables, ne serait-ce que parce que tant de penseurs continuent à s’y référer très directement et que les déterminants qu’ils ont fait apparaître (la société de classes, la vie déclinante, le malaise dans la civilisation) continuent à perdurer à notre époque. D’où leur dénonciation de l’idéalisme et du dualisme du gros de la tradition philosophique occidentale. D’où aussi leur penchant pour une immanence grandissante. D’où enfin leurs efforts —au nom d’une certaine conception de l’émancipation— pour mettre à jour des parades aux problèmes de perte de pouvoir (Marx) ou de puissance (Nietzsche), de malaise (Freud) ou de déclin que semble connaître à leur époque l’être humain.
Résultats : tout en cherchant à se rapprocher de l’homme vivant (de l’homme enraciné dans la vie et sa matérialité sensible), ils vont vouloir annoncer des solutions de dépassement aux maux qu’ils ont diagnostiqués à son sujet : pour Marx, la perspective d’une société sans classes ; pour Nietzsche l’exigence d’un surhomme-artiste créateur ; pour Freud, l’individu affranchi des névroses, individuelles comme collectives issues des malaises de la civilisation.
Mais on le voit, ce qui est nouveau ici dans leur approche respective (au-delà même de leurs fortes différences), c’est que chacun à leur manière, ils changent de plan, en se tournant vers des pratiques nouvelles et un nouveau rapport au monde, cherchant à prendre en compte les facteurs de fond conditionnant les substrats même de l’être humain : la vie et sa généalogie chez Nietzsche ; les pratiques socioproductives et la lutte de classes chez Marx ; la sexualité et le désir chez Freud.
Dans tous les cas, leurs efforts semblent s’orienter autour d’une tâche tout à fait pratique : faire réapparaître les conditions concrètes et pratiques à partir desquelles pourrait être renouvelée la puissance humaine.
Q - Tu associeras, par ailleurs, au chapitre 4 la « Terre-Mère » et son culte dissident indigène à une ressource pour les luttes contemporaines. C’est un bel appel et une riche idée. En tant que rural décroissant je suis sensible a ton propos sur la Terre-Mère qui implique un rapport aux "forces primitives du monde et de l’homme" et qui nourrit durablement la nature immanente de l’homme et son émancipation mais aussi son goût pour l’action collective ; la différence entre "le primitif qui émancipe" et "le primitif qui tue". Mais en traitant la question sur des bases exclusivement eurocentristes et grecques, ne crains-tu pas de passer précisément à coté du médium des luttes indigènes que tu voudrais spontanément acquises à l’universalité ? (…) Ne penses-tu pas que le métissage des traditions d’émancipation et des luttes serait facilité par une désoccidentalisation de tes moyens ? Une indigénisation de tes moyens ?
Oui c’est là une très belle question et je m’y suis confronté très concrètement. Lors d’une rencontre à Guadalajara avec quelques sociologues de l’Amérique latine très engagés et alors que j’étais en train de clarifier mes idées à ce propos, on m’a fait ce reproche : "Mais les auteurs auxquels tu sembles te référer de manière privilégiée (Marx, Nietzsche, Freud) appartiennent exclusivement à l’univers européen et occidental, et tu tombes ainsi dans le travers de l’européocentrisme ou de l’occidentalocentrisme, loin de cette recherche de l’universalité dont se targue pourtant la philosophie".
Et il y a quelque chose de vrai dans cette critique, même si ces 3 auteurs ont indéniablement participé à la mise à jour des limites et points aveugles de la pensée occidentale, ils n’y échappent pas complètement. Et il serait facile de multiplier les citations à cet égard ainsi que d’énumérer les problèmes dont –en s’appuyant sur leurs noms—on a pu hériter : le stalinisme (au nom de Marx) ; la volonté de puissance dominatrice (au nom de Nietzsche) ; l’institutionnalisation conservatrice de la psychanalyse (au nom de Freud).
C’est en partie ce qui explique mon recours aux thèses de Walter Benjamin dans le chapitre 4 de Pour une philosophie de l’action et de l’émancipation. Car ces thèses —me semble-t-il— nous aident à aller encore plus loin, à radicaliser la critique, à bousculer quelques-uns des points aveugles de l’univers philosophique occidental dominant, mais sans pour autant perdre cette perspective de la matérialité ouverte qui me semble si importante, et cela justement parce qu’elle permet de déboucher sur des préoccupations d’ordre pratique dont nous avons tant besoin aujourd’hui pour affronter les problèmes qui sont les nôtres !
Il ne faut pas oublier en effet que si l’on veut changer le monde tel qu’il se donne à nous concrètement, il faut savoir aussi être, si je puis dire, bien « terre à terre », partir donc de ce que ce monde est effectivement (en ce début de 21ième siècle marqué au fer rouge par un néolibéralisme conquérant) pour convoquer les forces réelles qui puissent parvenir à en modifier le cours. Autrement, on reste prisonnier de ce qu’on pourrait appeler une « utopie chimérique », sans prise possible sur le monde. Position d’autant plus difficile à tenir quand on a conscience de l’ampleur des défis qui sont les nôtres aujourd’hui.
Alors dans ce contexte, pourquoi passer par Benjamin ? Certes Walter Benjamin (1898-1940) appartient aussi à l’univers européen, mais d’une manière si paradoxale : il est en effet celui qui —je me réfère ici aux thèses sur le concept d’histoire de la fin de sa vie— nous permet de penser dans toute sa radicalité la critique de la vision de l’histoire « des vainqueurs » (autre mot pour parler de la classe dominante).
Comment ? En concevant l’histoire non pas comme une marche vers l’avant et le progrès (ce qui est l’essence même de l’idéologie bourgeoise contemporaine), mais comme un amas de ruines et de catastrophes qu’elle laisse derrière elle et qui accompagne cette cohorte de vaincus (les exploités, les sans voix, les sans-parts, les oubliés du Sud, etc.) dont les vainqueurs d’aujourd’hui veulent jusqu’à nous faire oublier l’existence. Or si l’on tend, comme le prétend la philosophie, à l’universalité, on voit bien à quoi une telle vision nous appelle : elle nous appelle à « brosser l’histoire à rebrousse-poil », à reprendre à notre compte tout ce qui a été ainsi oublié et réduit à l’état de ruines par les vainqueurs d’hier et d’aujourd’hui : qu’on pense par exemple aux sociétés autochtones de l’Amérique, ou aux esclaves haïtiens du 18ième siècle et à leurs descendants contemporains.
En somme, elle nous appelle à faire renaître et revivre, pour l’ici et maintenant, les aspirations des vaincus d’hier et d’aujourd’hui, leurs aspirations à un autre monde possible, avec tout ce qu’ils étaient et veulent être aujourd’hui. Sauf que cette reprise des aspirations oubliées des vaincus —parce qu’elle est conçue chez Benjamin, comme un effort pour transformer le présent— se donne d’abord sur un mode pratique. Notamment en se retrouvant éventuellement au coude à coude dans de mêmes luttes collectives contre la domination capitaliste néolibérale contemporaine.
Qu’on pense ainsi à l’importance décisive des luttes paysannes, autochtones, féministes, écologistes (ces nouveaux mouvements sociaux) et à toutes les solidarités indispensables qu’il reste à tisser avec elles, au-delà même d’évidentes différences en termes d’idéologies ou de visions du monde. Et ce sont ces pratiques communes –pour changer ensemble le présent— qui nous amènent tout naturellement à oser nous questionner sur nos propres a priori philosophiques.
Impossible de ne pas voir, tout ce qu’ont pu apporter ces dernières années, à la pensée de la gauche occidentalisée ou à celle des révolutionnaires, les apports idéologiques par exemple des peuples autochtones des Amériques ! Mais impossible de ne pas voir aussi comment leurs luttes et expressions sont marquées aussi par l’horizon occidental dans lequel elles se donnent pratiquement, ici et maintenant aux temps présents. Et le Sous Commandant Marcos du Chiapas en sait à sa manière quelque chose !
Aussi réfléchir à cette réappropriation –pour l’ici et maintenant—des aspirations des vaincus implique d’avoir la volonté d’échapper —ainsi d’ailleurs que Marcos est parvenu à le faire----à un métissage bon marché ou au patchwork informe qui combine tout sans rien vraiment combiner et qui nous éloigne des exigences laborieuses d’une critique féconde, c’est-à-dire d’une conception qui puisse déboucher sur d’authentiques alternatives pratiques.
À ce niveau, je vois cet effort de réappropriation plutôt comme une volonté permanente d’interroger les catégories qui ont été traditionnellement les nôtres, a fortiori lorsqu’on se reconnaissait de la gauche ou de la révolution : celle d’une histoire tournée inexorablement vers le progrès (progressiste) ; celle d’une nature dont on se veut –ainsi que le souhaitait Descartes—« maître et possesseur » ; celle enfin d’une humanité pensée à partir du seul univers mâle, etc.
Mais dire cela, ne veut pas dire pour autant passer à côté des apports d’une certaine tradition occidentale, elle aussi bien souvent oubliée et minimisée ou travestie aujourd’hui. Qu’on songe à ce propos à une certaine conception grecque de la démocratie (le pouvoir de l’égal sur l’égal), ou à une certaine raison critique et scientifique occidentale (une raison ouverte à tous les dépassements, conçue comme série d’erreurs rectifiées), ou encore à cette prise en compte affirmative de la réalité sensible et du devenir qui la hante inexorablement. En ce sens, la recherche d’une universalité plus grande (pensée par-delà la seule philosophie occidentale) ne peut pas prendre la forme d’une synthèse rapide et facile du genre « une pincée de « mère terre » , plus une pincée de biopouvoir à la Michel Foucault, et on mélange le tout, etc. ».
Une synthèse authentique comporte ses exigences (d’authentiques dépassements), et surtout doit être appréhendée me semble-t-il à l’aune de la volonté de mettre au jour ce qu’on pourrait appeler « une universalité concrète », c’est-à-dire une universalité qui s’exprimerait dans les faits, dans la réalité, parce qu’on serait parvenu, au fil de luttes collectives décisives, à accoucher pratiquement d’un monde qui redonnerait vie à tout ce qui a été défait dans le passé, un monde qui serait ainsi pratiquement plus ouvert à la diversité et au renouvellement de la vie, infiniment plus tolérant et plus vivant.
C’est en ce sens là par exemple que j’ai volontairement utilisé la formule « mère-terre » dans mon livre, pour montrer comment cette proposition tirée de l’horizon philosophique des sociétés précolombiennes pouvait rejoindre à sa manière les préoccupations écologiques contemporaines, celles par exemple de l’écosocialisme.
Il y a donc des passerelles à trouver, à tisser, à développer entre ces univers si différents … plus que jamais ! Mais pas pour le plaisir de les penser théoriquement ou abstraitement, pour en permettre la réalisation ici et maintenant. En ce sens on peut dire que l’universalité n’est pas un problème métaphysique, c’est un problème pratique.
Sur ce dernier point de "la vie primitive", je trouve ici que le travail d’émancipation collective fourni par les théologiens de la libération en Amérique Latine est très pertinent... accompagnant primitivement Dieu et le Dieu primitif aussi bien dans les profondeurs de la forêt amazonienne, auprès des peuples autochtones, que dans les favelas, authentiques camps de concentration dirigés d’une main de fer par les capos maffieux élus et dont Rio de Janeiro et Sao Paulo sont les expressions les plus cruelles. (…) Très présents au sein des dissidences populaires (ecclésiales ou non), nos théologiens du sud s’allieront au mouvement altermondialiste, que tu connais parfaitement, lors du 3ème forum de Théologie et de Libération de Belem ; ton dernier essai sera du reste préfacé par le Père Houtard.Tu citeras deux fois, je crois, la théologie de la libération. Ce qui bien évidemment ne peut être le fruit d’un désintérêt de ta part, m’apparaîtra cependant comme un "vide" surprenant. Cette absence s’explique-t-elle par ton développement athée ou profane des causes ternaires de la souffrance de notre civilisation : l’aliénation capitaliste, le nihilisme, la névrose ?
Oui la théologie de la libération m’a toujours beaucoup interrogé, fasciné même. Et d’autant plus que j’ai eu l’occasion de travailler comme conseiller et consultant auprès du Président Aristide (ex prêtre et partisan de la théologie de la libération en Haïti) alors qu’il était en exil à Washington, puis à son retour, après juin 94, à Port-au-Prince.
J’ai donc pu voir de près le poids et la force d’un tel courant, plus spécialement dans un pays ou la foi et la religion catholique restent très présentes. Et je dois dire que le constat final est assez partagé.
Dans un sens bien sûr, cette conception d’un royaume de dieu à construire ici et maintenant, cette mobilisation des opprimés conçus comme peuple de dieu en marche, cette volonté de lier la foi à la transformation politique de la réalité, a tout pour séduire quelqu’un comme moi soucieux de transformations sociales pratiques. Mais en même temps —et j’ai pu le vérifier ailleurs aussi— si ce type d’approche religieuse rompt ainsi avec cet « opium du peuple » que dénonçait Marx, elle n’en reconduit pas moins des phénomènes problématiques dont le personnage d’Aristide pourrait être tout à fait le symbole. Car jamais dans les communautés haïtiennes de la théologie de la libération (les Ti-léglize) n’a été remise en cause la place privilégiée qu’on accorde au prêtre (ce représentant de dieu) et partant le rôle démesuré qu’il finit par jouer dans la vie de ses membres, investi qu’il est –comme père— d’un pouvoir qu’aucun autre ne peut questionner comme tel, d’un pouvoir donc essentiellement non démocratique. Avec toutes les dérives paternalistes possibles dont le parcours d’Aristide nous a montré la réalité ! C’est peut-être un des facteurs qui explique cette défiance que je continue à avoir pour la religion, pour toutes les religions (la foi, c’est autre chose !).
En ce sens, dans mon livre il y a un point de départ résolument athée, mais qui se veut pensé loin de tout regard étroit (ou sectaire) sur la foi et la religion. Après tout si Marx a vu, dans les religions européennes de son temps, « un opium du peuple », il y a aussi vu « le cri de détresse de la créature opprimée ».
La religion est donc un phénomène complexe. Et ce qui me gêne en elle, ce n’est pas sa préoccupation pour l’être humain ou son sens éthique, ce n’est pas non plus son holisme et sa volonté d’aider les êtres humains à vivre dans toutes les dimensions de leur vie. Non, de tout cela je crois, nous en avons –dans le monde désenchanté qui est le nôtre— éminemment besoin. Non, ce qui me gêne, c’est cette nécessité qu’elle a toujours de passer –à un moment ou à un autre—par des médiations –non humaines— qui nous éloignent de l’homme (dieu, un autre monde, une autre réalité, etc.), faisant l’économie de celui-ci, de ses forces et ses possibles, lui ôtant de la puissance, finissant toujours par cautionner ou justifier des pouvoirs arbitraires (redevables de personne si ce n’est de dieu) et qui dans la réalité de l’histoire se sont montrés particulièrement odieux (voir l’inquisition !).
La remontée actuelle de l’intégrisme (et pas seulement dans l’islam, mais dans le catholicisme, le judaïsme, l’hindouisme, etc.) le confirme malheureusement, Mais là encore, pour l’ici et maintenant des temps présents, il ne s’agit pas ici d’une question de principe. Et si l’on peut travailler avec des théologiens de la libération ou des partisans d’une foi tournée vers le monde, à s’employer ensemble à changer le monde, à mieux voir les limites de l’horizon capitaliste qui est le nôtre, c’est tant mieux. Comme jamais nous avons besoin de nous remettre ensemble, pour agir sur une base commune, par delà toutes nos différences…
Lors du Forum International de Philosophie du Venezuela de 2006, tu soutiendras les réformes du Président Chavez. Peu après tu sembleras plus hésitant comme beaucoup, redoutant un "chavézisme flambloyant" et un retour au pouvoir unique militaire.
Dans cet essai, le retour à l’action philosophique fondamentale semble de toute évidence te rapprocher de la réalité bolivarienne et des grands défis de l’Amérique latine. Peux-tu actualiser ta position ?
Je ne suis pas un « chaviste » pur et dur, au sens d’être un disciple aveugle de Chavez qui ne jurerait que par cette expérience, et cela même si ces dernières années je suis allé plusieurs fois au Venezuela (encore tout récemment en décembre), observant avec grand intérêt ce qui s’y passait, tout en passant en même temps par des phases d’enthousiasme mais aussi plus récemment –je dois le dire— d’inquiétudes.
Je considère en effet que le processus bolivarien est un processus très important pour le continent latino-américain des années 2000 et qu’il pourrait inaugurer –avec ce qui se passe parallèlement en Bolivie et en Équateur—le début d’une nouvelle période pour « la gauche historique et en marche » du continent. Une période qui lui permettrait de se sortir de cette ère des « démocraties sous tutelle » (durant laquelle les forces populaires du continent se sont trouvées sur la défensive en émergeant lentement des défaites qu’elles avaient vécues sous les dictatures ou durant les guerres de basse intensité), et de reprendre quelque part l’initiative sociale et politique, en s’organisant autour d’un projet sociopolitique positif actualisé, c’est-à-dire en phase avec les défis contemporains posés par le déploiement de l’économie néolibérale mondialisée.
D’où tous les côtés éminemment intéressants de l’expérience bolivarienne. Car sur bien des fronts, les réussites ne manquent pas et paraissent même tout à fait spectaculaires compte tenu du vent de droite soufflant par ailleurs sur tant de pays de la planète : processus participatif donnant naissance à une nouvelle constitution particulièrement avancée (1999) ; lancement de missions dans le domaine de la santé, de l’éducation et de la culture, rendant plus accessible aux secteurs populaires l’aide publique de l’État, jusqu’à présent grugée par la corruption et les politiques de privatisation néolibérale ; redistribution de la rente pétrolière vers les plus défavorisés, faisant baisser de façon significative les taux de pauvreté et de grande pauvreté ; constitution sous les auspices de l’Alba (Alternative bolivarienne pour les Amériques), de nouvelles formes de solidarités internationales Sud-Sud notamment avec Cuba, l’Équateur et la Bolivie.
Ceci dit, il y a actuellement plusieurs questions préoccupantes. J’en ai parlé dans un article récent. Mais la plus importante est sans doute —outre l’oubli manifeste des questions touchant à la vie quotidienne et en particulier à l’insécurité grandissante (le taux d’homicide à triplé depuis 1998)—le fait que c’est par le haut et à travers la seule action « politique » du président et de ses partisans regroupés dans le PSUV que sont impulsées –souvent en réaction à tel ou tel événement décrié par la grande presse— les transformations jugées nécessaires, des transformations qui d’ailleurs restent en termes économiques fort modérées, comme si le geste ne suivait pas toujours exactement la parole.
D’où le peu de place déterminante qu’occupent aujourd’hui dans le processus actuel les mouvements sociaux (syndicats, organisations communautaires, paysannes, indigènes, féministes, etc.), d’où le suivisme d’une majorité de militants de base du PSUV se gardant de toute critique envers leurs leaders, d’où aussi le rôle absolument central du président Chavez qui finit par s’immiscer dans la moindre des décisions de l’État et du parti. Et dans la perspective où l’on pense que le renouvellement de la gauche ne peut que passer par un renforcement des pratiques de démocratie participative, on comprendra que cette tendance pose un sacré problème. D’autant plus si, comme je l’ai souligné, au début de cet entretien, la revalorisation du politique passe nécessairement par une prise en compte des mouvements sociaux et de leur propre pouvoir d’intervention. Pas de doute la démocratie, c’est-à-dire le pouvoir de l’égal sur l’égal a ses exigences !
Q- « Le pouvoir de l’égal sur l’égal » jaillirait donc entre ces espaces de pure dissidence et de pure création politique (…) comme une échappée "hors-les-lois" vers l’immanence ? Peux-tu expliquer ?
Justement non, je ne le crois pas. Il est vrai que je m’appuie sur certaines thèses, très fortes, de Rancière pour que l’on oublie pas que dans la tradition grecque, la découverte de la démocratie recèle un caractère éminemment subversif, dans la mesure où elle rompt en termes conceptuels –de manière radicale—avec les pouvoirs du sang, de l’argent et de l’expertise.
La démocratie prise au sens plein du terme serait donc une déviation plus qu’une transition, une rupture plus qu’une lente évolution. De prime abord elle apparaît donc de l’ordre du jaillissement ! Et je crois qu’il ne faut pas avoir peur de rappeler de telles vérités à une époque où l’on ne fait que parler de démocratie (c’est le régime politique hégémonique par excellence), tout en en foulant l’essentiel aux pieds : cette idée du pouvoir de l’égal sur l’égal.
Les démocraties « de basse intensité » ou sous tutelle militaire en Amérique latine (ou peut-être plus près de nous le pouvoir exorbitant des marchés financiers) nous le rappellent sans ambiguïté aucune. Ceci dit, je crois que cette approche reste insuffisante, surtout si on la pense à l’aune des efforts menés aux temps présents par les couches populaires ou la société civile d’en bas pour tenter justement d’ouvrir de nouveaux espaces démocratiques. C’est ce qui explique cette utilisation que je fais de certaines thèses de Gramsci concernant la conquête ou plutôt la reconquête nécessaire –de la part des couches populaires— d’une contre-hégémonie pour le 21ième siècle, car l’approfondissement de la démocratie ne peut pas qu’être synonyme de « surgissement » brutal et instantané des sans-parts.
Ce n’est que dans la durée qu’au 20ième siècle (globalement entre 1917 et 1970), les couches populaires (syndicats, mouvements sociaux, partis de gauche, États dits socialistes, etc.) ont pu gagner peu à peu des espaces sociaux et politiques grandissants à l’échelle du monde. C’est ce que j‘ai appelé –dans le sillage des thèses de Gramsci— un mouvement ascendant de contre-hégémonie des classes populaires. Un mouvement qui d’ailleurs s’est brutalement affaissé durant les années 80 à la faveur du grand basculement du monde évoqué précédemment. Et ce n’est donc que dans la durée qu’on peut imaginer son redémarrage en ce début de 21ième siècle.
C’est un peu l’horizon dans lequel nous devrions –me semble-t-il— penser les luttes sociales et politiques d’aujourd’hui : comment faire qu’elles aident à la relance de ce nouveau mouvement ascendant d’hégémonie pour le 21ième siècle ?
Ceci dit, on ne peut jamais mettre sur le même plan une démocratie sous tutelle (militaire ou internationale) telle que de nombreux régimes latino-américains ont pu en endosser les oripeaux pendant les années 90-2000, avec une dictature militaire. Pour avoir vécu (et travaillé comme journaliste) sous un régime dictatorial (Chili), il m’est facile de mesurer les différences et d’opter bien évidemment pour une démocratie sous tutelle, aussi imparfaite par ailleurs soit cette dernière (les droits individuels, aussi réduits soient-ils par ailleurs, ne sont en rien inutiles). Le problème, c’est plutôt de vouloir en rester à ce seul stade, ou de s’en contenter, considérant que c’est là, comme on dit en québécois « le boute du boute ». Les expériences Vénézuélienne, équatorienne et bolivienne récentes, semblent indiquer qu’on peut dépasser ce stade (en s’inscrivant justement dans la rupture, mais à partir de nouvelles modalités) et ainsi initier peut-être un nouveau cycle historique de luttes infiniment plus prometteurs.
Observons la question précédente sous un autre angle. Le droit et les lois nous prouvent tous les jours leur déloyauté, leur inefficace social. Slavoj Zizek, Jacques Rancière, Yves Charles Zarka, Giorgio Agamben le disent avec force avec tant d’autres (…)
Q- Ici résiderait le mécanisme de la "puissance défigurée" dont tu parles ? Un mécanisme implacable qui conduira l’humanité aux catastrophes interdisant toute émancipation et toute réconciliation de l’homme avec lui-même (stalinisme, nazisme, fascisme, impérialisme, juridicisation du politique, néolibéralisme, etc...) ?
Oui bien sûr le politique comme puissance émancipatrice a été confisqué (j’en ai évoqué le côté tragique au tout début de cet entretien), et plus particulièrement depuis le 11 septembre, mais je ne partage pas le point de vue d’Agamben pour autant sur « la vie nue » et ses rapports avec la politique d’exception.
À ce niveau, je serai beaucoup plus proche de celui –plus fidèle à la réalité politique empirique, me semble-t-il— de Rancière. Car même après le 11 septembre, même après la multiplication de lois d’exception dans les pays du Nord et même si nous ne vivons pas dans de véritables démocraties (ça c’est évident !), il me paraît difficile d’affirmer que nous vivrions dans « des camps », comme semblent le supposer certains auteurs qui nous voient tous soumis à la loi d’exception du gouvernement biopolitique.
Comme le dit Rancière, nous vivons plutôt « dans des États de droit oligarchique, c’est-à-dire dans des États où le pouvoir de l’oligarchie est limité par la double reconnaissance de la souveraineté populaire et des libertés individuelles ». Et cela est en termes stratégiques ou pratiques, loin d’être négligeable, car on se laisse ainsi la possibilité d’occuper certains espaces (existant effectivement aujourd’hui encore), justement pour tenter de participer à cette relance de ce mouvement ascendant de contre-hégémonie dont j’ai parlé.