Ils en concluent que ce silence concernant la souveraineté explique dans une large mesure les déboires du parti fondé par René Lévesque et donc qu’il faudrait de toute urgence relancer l’option indépendantiste par un discours vigoureux et décomplexé, susceptible de ressouder sa base et aller chercher de larges appuis.
Cette manière de présenter les choses n’est pas tout à fait fausse, elle recèle une part de vérité.
Pourtant, elle néglige un fait essentiel : l’orientation rétrolibérale adoptée par la haute direction péquiste à partir du début des années 1980 et sans cesse confirmée depuis pour l’essentiel, en dépit du discours social-démocrate qui a toujours servi à camoufler auprès de l’électorat la virage à droite du PQ sur les plans social et économique. Le récent (et très relatif) revirement de Jean-François Lisée à « gauche » sent l’opportunisme à plein nez. Il ne trompe personne. Les stratèges péquistes tentent de grappiller le plus de votes possible à Québec solidaire, des votes qui lui seraient très utiles dans la présente conjoncture électorale.
Il est donc révélateur d’examiner la trajectoire péquiste au lendemain des deux référendums perdus, ceux de mai 1980 et d’octobre 1995.
Lors de la consultation de mai 1980, le OUI avait recueilli 41% des votes (dont presque la moitié des francophones) et en 1995, la majorité fédéraliste avait été beaucoup plus faible, 51% contre 49% pour le OUI.
Le camp indépendantiste avait profité en 1980 de l’élan d’un gouvernement péquiste élu par surprise en novembre 1976, de la présence à Ottawa d’un gouvernement libéral très anti-souverainiste et centralisateur dirigé par Pierre-Elliott Trudeau et aussi de quelques mesures progressistes adoptées par l’équipe Lévesque à Québec.
En octobre 1995, les partisans du OUI ont pu miser sur l’échec des Accords du Lac Meech en 1990 et sur l’usure du gouvernement libéral de Robert Bourassa, lequel avait dû traverser au début de la décennie une récession. D’ailleurs à cette occasion, le Parti québécois dirigé par Jacques Parizeau et ensuite Lucien Bouchard avait promis de réinvestir dans le « social » avant de renier cet engagement après le référendum, prétextant que l’état des finances publiques était pire que prévu.
Le parallèle qu’on peut dresser entre ces deux périodes post-référendaires est qu’elles ont été marquées chacune par une grave régression sociale, provoquée à chaque fois en partie par des compressions budgétaires aussi arbitraires que brutales de la part du gouvernement péquiste, par un ratatinement relatif du rôle redistributeur de l’État, un taux de chômage élevé, le tout caractérisé par la duplicité du cabinet péquiste. Bien sûr, ce dernier n’est pas le seul responsable de la déprime économique de 1981 à 1984 ni des difficultés économiques de la première moitié de la décennie 1990 ( le PQ n’étant pas au pouvoir à ce moment-là. Ottawa y a joué un rôle majeur puisque la politique monétaire relève de lui) . Mais le Parti québécois n’a jamais hésité à couper lorsqu’il le jugeait nécessaire. Lucien Bouchard (un ancien conservateur au fédéral) a soutenu contre toute vraisemblance en 1995, lors du retour au pouvoir des péquistes que les électeurs et électrices feraient confiance à un gouvernement capable de remettre de l’ordre dans les finances publiques, sans même se demander si c’était ce qu’attendaient vraiment les gens de la part de son gouvernement.
Ce sont ces revirements sociaux et économiques qui expliquent l’éloignement de nombreux progressistes et d’authentiques gauchistes du parti, et en fin de compte la fondation de Québec solidaire en 2006, précédée par l’apparition de l’Union des forces progressistes et d’Option citoyenne, qui ont fusionné. Il faut souligner que le motif premier de cette alliance était le socialisme plus que l’indépendance, du moins pour plusieurs de ses militants et militantes : en témoigne sa position constitutionnelle. En cas d’arrivée au pouvoir de Québec solidaire, le parti s’engageait à tenir une assemblée constitutionnelle dite « ouverte », bref qui rassemblerait un vaste éventail de groupes chargés de présenter à l’électorat par voie référendaire une option nationale qui ne se limiterait pas nécessairement à l’indépendance.
Mais sous l’impulsion de Gabriel Nadeau-Dubois, le successeur de Françoise David, un souverainiste de stricte obédience, le parti a choisi en mai 2017 une assemblée constituante « fermée », c’est-à-dire réservée aux seuls souverainistes, laquelle présenterait aux Québécois et Québécoises une question portant uniquement sur l’indépendance.
Depuis, le parti qui avait déjà récolté jusqu’à 13% d’intentions de vote dans les sondages est descendu à 8% ou 9%, un niveau où il reste figé.
Pour résumer, après chaque référendum perdu (mai 1980, octobre 1995), l’équipe péquiste en poste a imposé sans ménagement aux Québécois et Québécoises des politiques budgétaires rétrogrades sans en avoir reçu le mandat. Et certains observateurs s’étonnent du déclin péquiste depuis le début de la décennie 2000...
Il y a des limites à la « discipline souverainiste », version péquiste. Depuis plus de trente ans, les directions péquistes successives se sont éloignées de leur base électorale (étudiants, travailleurs syndiqués, employés de la fonction publique) pour tenter un rapprochement avec les adversaires traditionnels de l’indépendance, une grande majorité de gens d’affaires. La gauche s’est donc éloignée du parti mais sans que ses adversaires ne le rallient. Le PQ a donc perdu sur ces deux plans.
Bien davantage que le silence de la direction péquiste sur sa raison d’être, c’est cette schizophrénie politique (discours social-démocrate et pratique rétrolibérale) qui rend compte des présentes difficultés péquistes. Après tout, le gouvernement Lévesque a subi une cuisante défaite électorale (qu’il avait d’ailleurs prévue) en 1985 et ce, en dépit du coup de force constitutionnel de Pierre-Elliott Trudeau en 1982. Le gouvernement Landry, lui, a été battu en avril 2003 après des années de compressions budgétaires et de mesures à saveur rétrolibérales. Le « rééquilibrage » des finances publiques ne semble pas avoir autant profité au Parti québécois que l’escomptaient les stratèges péquistes.
À cet égard, le cas péquiste n’est pas unique en Occident, tant s’en faut. On observe une évolution similaire du côté des grands partis de centre-gauche européens et des démocrates américains. Discours progressiste (mais en même temps « réaliste », c’est-à-dire qu’on fait valoir qu’il importe de tenir compte des impératifs présumés de la mondialisation économique) mais politiques rétrolibérales marquées par l’austérité et le soutien débridé aux financiers.
Pour en revenir au Québec, on peut formuler l’hypothèse très vraisemblable que si les directions péquistes successives, sous René Lévesque d’abord (de 1981 à 1985) et Lucien Bouchard ensuite (de 1996 à 2001) avaient accompagné leurs politiques restrictives d’un « forcing » souverainiste, cette stratégie aurait plutôt exaspéré l’électorat et l’aurait éloigné de l’indépendance encore davantage.
Les gens se seraient demandé à quoi servirait l’accession du Québec à l’indépendance si c’est pour devoir vivre dans une société de type rétrolibéral. La récente « conversion » social-démocrate de Jean-François Lisée est cousue de gros fil blanc.
Depuis sa fondation, le parti s’est toujours trouvé écartelé entre son aile gauche, son aile droite et le centre (gauche et droit). Le Parti québécois a résulté d’une fusion entre le MSA (Mouvement souveraineté-association mis sur pied par Lévesque), et le Ralliement national, un petit parti souverainiste de droite fondé par Gilles Grégoire. Les membres du RIN (Rassemblement pour l’indépendance nationale) de Pierre Bourgault, beaucoup plus à gauche tant sur le plan national que social, ont décidé de se saborder pour rejoindre le nouveau Parti québécois et l’orienter dans le sens de leurs idées, au grand dam de Lévesque, qui voulait un parti indépendantiste « respectable », capable de convaincre la nouvelle classe moyenne québécoise de se rallier à l’indépendance, et notamment les gens d’affaires francophones. C’est ce qui explique les tensions internes qui ont marqué l’histoire du PQ durant toutes les années 1970.
Le parti formait donc une coalition assez fragile dont le seul ciment était l’idéal indépendantiste ; les tergiversations de sa direction sur la question nationale (et le ralliement de celle-ci au « beau risque » fédéraliste à l’époque des Accords du Lac Meech beaucoup plus tard, fin des années 1980)) lui ont beaucoup nui ; René Lévesque d’ailleurs n’était pas un souverainiste strict comme Pierre Bourgault, par exemple. D’autre part, Lévesque n’était qu’un social-démocrate très tiède. S’il croyait à une certaine forme d’interventionnisme étatique, c’était surtout pour la réorganisation de l’État, comme il l’avait fait à l’époque de la nationalisation de l’électricité beaucoup plus que pour mettre sur pied des mesures de redistribution vigoureuses. La facilité avec laquelle il a bazardé les budgets publics au début des années 1980, sous l’impulsion de la récession de 1982-1984 et des « reaganomics » a révélé son relatif conservatisme social. Ce qui lui a coûté le pouvoir en 1985, comme il l’avait lui-même prévu. Le masque social-démocrate péquiste est tombé à cette époque ; on pourrait affirmer avec un brin de vulgarité que le parti a été « déculotté » à cette occasion. Il n’a fait que continuer par la suite sur cette lancée « austère » et l’a même accentuée, « institutionnalisée » lors de son retour au pouvoir de 1995 à 2003.
Toutes ces tribulations et ces reniements expliquent le discrédit qui frappe ce parti bien davantage que son silence sur l’option indépendantiste. Il est de toutes façons peu probable que celle-ci retrouve l’audience qu’elle avait conquise durant la décennie 1970.
Il faut avant tout se demander dans quelle genre de société on veut évoluer, quel que soit le statut constitutionnel de cette dernière. Cette question est devenue prioritaire et la gauche devrait tenter de proposer un projet de société emballant mais sans en faire dépendre exclusivement la réalisation de l’accession du Québec à la souveraineté. Une autre formule que la seule indépendance pourrait être cherchée, moins polarisante et plus rassembleuse. On doit de toute urgence réinventer les voies de la justice sociale.
Jean-François Delisle





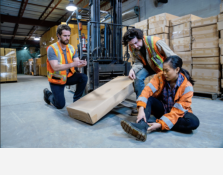





Un message, un commentaire ?