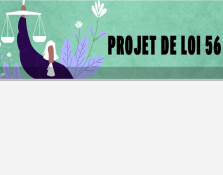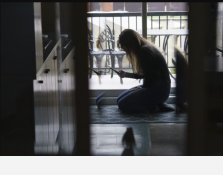À la toute dernière minute, l’équipe de Manon Massé change notre lieu de rencontre. Nous avons désormais rendez-vous à la Station Ho.st sur la rue Ontario, une superbe microbrasserie nouvellement établie dans le quartier. Parfait ! C’est plus près de la maison. C’est une trop-espérée-première journée de printemps et j’avoue que l’idée de boire une bière me fait pas mal plaisir. Arrivée un peu à l’avance, je m’installe à la seule table disponible au fond du bar et me commande une pinte. À l’intérieur, c’est bondé. Beaucoup de jeunes qui, par leur peinture rouge au visage et leurs conversations animées sur l’austérité, me laissent facilement deviner qu’ils reviennent de la manifestation. J’ai lu sur les réseaux sociaux qu’elle n’était pas encore terminée et que ça commençait à brasser à Émilie-Gamelin…
« Hey Manon ! »
Les regards se tournent vers la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Beaucoup se lèvent pour aller la saluer. Je lui laisse le temps d’arriver et la rejoins.
« Allô Manon, comment ça va ?
Elle me sert une poignée de main franche, la main sur l’épaule, tout sourire.
– Allô Djanice ! Ça va super ! Écoute, on va aller dans la deuxième section du bar, ça va être moins bruyant.
– Parfait, je voulais enregistrer l’entrevue ! Je ramasse mes trucs et on se rejoint de l’autre côté ! »
Pendant que Manon fait sa tournée, que plusieurs vont la voir pour jaser de leurs projets, de problématiques du quartier ou de la grève, je passe dans la nouvelle et impressionnante section du bar. Le propriétaire ajoute des tables et des chaises.
On se trouve une grande table près de la fenêtre vitrée.
« Bon, rappelle-moi de quoi on parle.
– De la marche Du pain et des roses !
– Ah ! Oui, c’est ça. Heille excuse-moi, j’ai eu une journée de fou ! »
Effectivement. J’ai vu que plus tôt, Manon avait donné des entrevues, en plus de participer à la manifestation. Plus tard, vers 18 h, un Tweet live est organisé par son équipe. Je regarde l’heure. 17 h 35. Le temps file. Nous avons un peu plus d’une vingtaine de minutes pour faire l’entrevue.
Et c’est parti.
DJANICE – Pour commencer, je crois qu’il serait bien de nous remettre en contexte et d’expliquer comment est venue l’idée de la marche Du pain et des roses.
MANON – En fait, y’a deux affaires à considérer. Le contexte politique au sens large et le contexte politique à l’intérieur même des mouvements de femmes. Le contexte politique d’abord. En 1994, on sortait de neuf ans d’ère libérale sous Bourassa. Le Québec avait été malmené. Après la défaite au référendum de 1980, la population était morose. Les travailleurs de l’État s’étaient fait avoir par leur gouvernement, les partis de la gauche progressiste avaient mangé toute une claque…
Parallèlement à ça, on avait un mouvement de femmes qui battait de l’aile. La Fédération des femmes du Québec était chancelante. Si on se rappelle, en 1990, y’avait eu l’événement Femmes en tête pour le 50e anniversaire du droit de vote des femmes québécoises, un temps d’arrêt et de réflexion. Durant cet événement, on s’est fait brasser pas mal par les femmes immigrantes suite à une sortie de Lise Payette.
On avait vu poindre l’enjeu d’un féminisme blanc et francophone. En 1992, y’avait eu les états généraux, Pour un Québec féminin pluriel, qui se voulaient un moment de réflexion du mouvement féministe au Québec. On voulait un projet social féministe qui améliorerait les conditions de vie des femmes québécoises et de la société dans son ensemble. Mais ça brassait pas mal. Les femmes des régions ne se sentaient pas représentées, les femmes autochtones, on n’en parlait même pas… Les grands réseaux du mouvement des femmes – syndical, communautaire, etc. – se reconnaissaient de moins en moins dans la FFQ.
On était à la croisée des chemins, il fallait se redéfinir. Donc à l’époque, l’R des centres des femmes du Québec, mouvement très important que j’appelle le bras activiste de la FFQ, est arrivé avec Françoise David comme coordonnatrice. Elle a dit : « Écoutez, avant de mettre la hache dans la FFQ, ce grand chapeau qui existe depuis 30 ans, investissons-la. Si ça marche, on en ressortira plus fortes, et sinon, on aura essayé. » L’R des centres des femmes du Québec s’est donc joint au conseil d’administration de la FFQ. 1994, Françoise commence à faire émerger l’idée de la marche Du pain et des roses.
Elle l’a déjà raconté. Un soir, elle est assise dans son salon. Elle regarde un reportage sur Martin Luther King et elle voit une grande marche avec des milliers de personnes et elle se dit :
« C’est ça qu’il faut faire au Québec. » Quand Céline Signori annonce qu’elle se retire du conseil d’administration, Françoise prend la présidence par intérim. Le 17 mars 1994, Françoise réunit une trentaine de femmes de différents réseaux : fédération des familles monoparentales, femmes de syndicats, religieuses… Françoise avait un super réseau… Elle a dit : « Regardez, on a décidé de ne pas mettre la hache dans la FFQ, je suis la présidente par intérim, j’ai un projet, embarquez-vous ? » Et là, l’idée de marcher Montréal-Québec, sur la question de la pauvreté, a commencé à se structurer.
On avait neuf revendications : la mise en œuvre d’un programme d’infrastructures sociales, la hausse du salaire minimum, la création de programmes d’insertion ou de réinsertion à l’emploi, l’accès à des programmes de formation, le gel des frais de scolarité et l’augmentation des bourses aux étudiantes et étudiants, l’adoption d’une loi sur l’équité salariale, la réduction de la période de parrainage par leur mari pour les femmes immigrantes, la mise en place d’un système de perception automatique des pensions alimentaires avec retenue à la source et la création de logements sociaux. Une des revendications en 1995, c’était qu’on avait remarqué que, selon notre analyse politique, dans la sphère publique, la notion de pauvreté était effacée… C’est pour ça qu’on a appelé ça la marche des femmes contre la pauvreté. Pour expliquer simplement, on voulait réinscrire une analyse de classes dans les crises économiques qui se faisaient tout le temps sur le dos du monde.
C’était stratégique. On voyait arriver le référendum, on ne savait pas quand exactement. Mais on savait qu’un gouvernement péquiste qui prenait le pouvoir irait en référendum. Dans notre analyse politique, on savait qu’au dernier référendum, les femmes avaient peu voté. On savait que, pour atteindre la souveraineté, le gouvernement péquiste de Parizeau aurait besoin du vote des femmes, qu’il devrait appuyer les femmes dans nos revendications. On avait un réel rapport de force face au gouvernement.
D – Et comment tu t’es retrouvée à cette rencontre ?
M – En fait, j’y étais parce que ma blonde travaillait à la FFQ et que je travaillais en éducation populaire. Écoute, je me faufile là, comme jeune militante de 31 ans… Ça m’allumait. Ce qui me parlait là-dedans, c’était la lutte des classes. Je viens d’un milieu populaire et là, y’avait un gros événement majeur qui s’organisait pour lutter contre la pauvreté, je me sentais à ma place.
D – C’est ton premier contact avec le milieu féministe ?
M – Ben… je pense que oui ! À ce moment-là, je ne me qualifiais pas de féministe. En fait, je n’avais juste pas encore fait le lien. C’est vraiment à partir de là que j’ai compris que je l’étais profondément. Ç’a pas été ben ben long !
D – Et comment tu conçois le féminisme ?
M – Ben… D’abord, le féminisme pour moi, c’est l’égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes entre elles. Et c’est une manière d’analyser, de voir les choses. Le féminisme, c’est la lutte à l’oppression. Ça inclut les minorités visibles, les personnes LGBT… C’est comprendre et nommer l’oppression patriarcale, peu importe dans quelle sphère de la société on la retrouve.
D – À ton sens, avec la marche, quels gains ont été les plus importants pour les femmes ?
Le plus beau, à mon sens, c’est qu’on est parties gagnantes. On n’avait même pas commencé à marcher qu’on avait déjà une revendication en poche : les pensions alimentaires. Pour moi, au final, cette marche-là a été plus que positive ! Heille ! 850 femmes qui ont marché Montréal-Québec à pied. Avec les intempéries. À dormir dans les gymnases. 15 000 personnes qui nous attendaient devant l’Assemblée nationale. C’était énorme ! Aussi, ça faisait plusieurs années qu’on n’avait presque pas d’augmentation du salaire minimum, et au sortir de la marche, on avait 45¢ d’un coup ! Le sentiment de faire quelque chose pour les femmes était très fort. Je pense que le plus grand gain qui a été fait, c’est le gain de solidarité. On en avait grandement besoin, la FFQ en avait besoin. Les syndicats parlaient moins aux groupes communautaires et au mouvement féministe, on avait oublié que dans les religieuses, on avait des alliées féministes. On a retissé des liens entre les différents milieux de femmes, et ça ! Ç’a été majeur je pense.
D – C’est une belle victoire.
M – Ce qui pour moi est extraordinaire, c’est que cette marche a été une réponse des femmes à l’appauvrissement du peuple québécois. On le sait, quand le peuple s’appauvrit, ce sont tout d’abord les femmes et les populations vulnérables qui s’appauvrissent. C’était beau de voir les femmes se lever et prendre la rue, prendre la parole et s’imposer.
D – Et plusieurs autres marches ont découlé de cet événement. Comme si les femmes avaient réalisé à quel point leur solidarité pouvait être un levier politique.
M – Oui ! Ensuite, il y a eu la Marche mondiale des femmes ! Bon, la lutte féministe est loin d’être gagnée. Nous avons fait d’immenses progrès, mais il reste encore pas mal de travail à faire. À l’Assemblée nationale, entre autres.
D – Notre dernier numéro portait sur la colère… De quelle manière ta colère a-t-elle eu un impact sur ton parcours ?
M – Depuis toujours, mon plus grand moteur, c’est mon indignation. Et plus je deviens consciente, plus il est actif. Tout à l’heure, en revenant de la manifestation, je voyais que les policiers étaient en train de taper sur la gueule des jeunes… Ça, ça me met en marche ! C’était vrai dans le temps de la marche, c’est encore vrai aujourd’hui. Si je dois trouver un moment précis, je dirais la marche de 2000. Ç’a été la plus grande gifle politique que j’ai reçue de ma vie. Heille, on avait organisé une marche d’envergure mondiale pour le mieux-être de toutes les femmes de la planète et le gouvernement du Québec nous avait donné 10¢ / heure d’augmentation ! Je me souviens. C’était le 12 octobre 2000. J’étais au parc Lafontaine sur le terrain des vaches à attacher les derniers morceaux, on attendait 30 000 personnes le lendemain… Je reçois un coup de téléphone d’Alexa Conradi qui à l’époque était la coordonnatrice de la Marche mondiale au Québec. Elle négociait avec Françoise Bouchard. Elle m’appelle et elle me dit : « Tu me croiras pas, ils nous donnent 10¢ / heure. » J’étais en furie. J’ai hurlé dans le parc : « Y’attendent-tu qu’on aille prendre le pouvoir ?! » Pour moi, c’est la première fois où s’est dessinée la nécessité d’avoir un autre parti politique qui prenne le flambeau de la politique à l’Assemblée nationale. Ça me vient de l’insulte de mon gouvernement qui me rit en pleine face. Y’ont alterné depuis, mais ça donne toujours la même affaire…
D – Notre présent numéro porte sur l’économie… Trouves-tu que les femmes ont leur place quand on parle d’économie ?
M – Trop peu. L’économie, c’est encore une affaire d’hommes.
D – Si on analyse la dernière année du gouvernement libéral, penses-tu qu’on retourne en arrière avec le gouvernement Couillard ?
M – Retourner en arrière, sur certains points, oui. J’ai parlé avec des femmes qui se demandent franchement comment financièrement elles vont arriver et si ce ne serait pas plus simple de rester à la maison pour s’occuper des enfants… Dans les maisons, dans la classe moyenne, le calcul se fait. Y’a une chose qui est sûre, c’est qu’on est prêtes à se défendre. Y’a une chose qu’on sait, que vos Françoise savent et que ma Françoise à moi sait très bien parce que c’est une femme expérimentée… les femmes sont essentielles pour l’économie du Québec. On les a sorties de leur maison pour leur donner la possibilité de s’émanciper, oui, mais aussi de participer à l’effort économique du Québec ! Tu sais, si on fait un peu d’histoire, les services sociaux… – et je les mets tous dans le même panier : la santé, l’éducation, les services de garde, les proches aidantes, etc. – ont été mis en place pour rétablir une certaine justice sociale.
Historiquement, c’était des jobs que les femmes faisaient "gratisse" à la maison. Collectivement, on s’est donné des moyens pour faire en sorte que la charge de travail, ce que chez Québec solidaire nous appelons « l’économie domestique », soit soutenue collectivement. On voyait ça comme une responsabilité collective. Le problème actuellement, c’est que le discours qui est véhiculé, c’est que le système de santé, l’éducation… c’est de l’économie privée, donc perçu comme une dépense. Et c’est ce que les grands penseurs, ceux qui formatent la pensée collective, continuent de rentrer dans la tête du monde. Les services publics, c’est vu comme une dépense, alors que c’est un outil de redistribution de la richesse, un outil d’équité sociale, un outil d’égalité entre les femmes et les hommes. Le gouvernement actuel tient un discours d’égalité entre les femmes et les hommes, il le répète ad nauseam, mais c’est de la rhétorique.
D – Si on regarde ce qui se passe actuellement avec les politiques d’austérité… est-ce que tu penses qu’on peut faire des liens entre 1995 et 2015 ? Y’a une certaine ressemblance, non ?
M – Effectivement ! Y’a des ressemblances. Si on compare certains aspects de 1995 avec aujourd’hui, on peut remarquer ce qu’on pourrait appeler les premiers signes d’une organisation politique de l’austérité. La première fois qu’on a entendu parler du déficit zéro, c’était de la bouche du gouvernement de Lucien Bouchard, péquiste conservateur, mais tout de même péquiste. Lors d’un grand forum socioéconomique, où tout le monde était assis ensemble, il invitait la société civile à se faire hara-kiri. Le gouvernement Bouchard parlait de rendre le marché plus flexible, de créer un secrétariat pour relancer l’économie et la rendre plus accessible… ce qui finalement a privé le Québec de 5 milliards d’impôts. Et, souviens-toi de ça, les trois groupes qui ont été exclus du forum socioéconomique de Bouchard ? Les femmes, les étudiants et les mouvements sociaux.
« Manon, le Tweet live, c’est dans 5 minutes. »
C’est le responsable des communications qui nous rappelle que nous devrons nous arrêter. Depuis le début de notre entretien, une jeune équipe s’est jointe à la table. Je dis jeune… j’évalue la moyenne d’âge à 35 ans. Maximum. Je le fais remarquer à Manon qui me sourit.
« Ce sont mes jeunes ! Ils sont allumés, ils sont impliqués, ils sont bons ! C’est ça l’espoir ! Une chance qu’ils sont là, moi j’suis pas trop bonne avec ces affaires-là ! Moi, je raconte des histoires, je m’étends ! (Rires) Twitter, c’est 140 caractères, c’est une mécanique ! Une chance qu’ils m’aident à être concise ! »
J’ai l’impression que notre discussion n’est pas tout à fait terminée. Je lui propose qu’on termine après le Tweet live. Je ne suis pas pressée, il fait beau, je viens de me commander une deuxième pinte…
« Sûr ! »
Durant l’heure qui suit, je discute avec chacune des personnes à la table. S’il y a une chose qui m’impressionne, c’est la bonne humeur qui se dégage du groupe. Des optimistes. C’est un vent de fraîcheur sur la morosité politique ambiante et ça me fait un bien fou. Entre deux questions sur Twitter, Manon se joint aux conversations.
« On peut se morfondre, ou ben essayer de faire avancer la démocratie. Si on s’implique pas, y’a pas grand-chose qui va changer ! » me dira l’une des demoiselles.
On reproche souvent aux jeunes de ne pas s’impliquer, d’être individualistes et de se foutre de la politique. C’est une impression bien personnelle, mais depuis 2012, il me semble que les jeunes sont plutôt mobilisés, contrairement à ce qu’on dit.
« On dirait que c’est ce qu’ils veulent nous faire croire, qu’on se fout de la politique. Mais pourtant, quand on regarde les dernières années, les jeunes se sont levés pour l’égalité, pour conserver les acquis sociaux, pour s’opposer au néolibéralisme. »
Le Tweet live se termine. On continue de discuter un bon moment avant de reprendre.
Et ça repart.
D – Avant de se quitter, on parlait des ressemblances entre 1995 et maintenant.
M – Oui, on disait qu’il y avait des ressemblances, mais y’a quand même des points de rupture.
La répression est beaucoup plus radicale en ce moment. La répression a toujours été là, mais jamais autant banalisée que maintenant. C’est la radicalisation de la droite qui nous amène à nous révolter.
Et puis, la radicalisation, c’est pas juste des manifestants qui cassent des vitrines. Y’a aussi le gouvernement qui trouve des stratégies encore plus pernicieuses pour contrôler la population. Souvent je compare ça, et comme féministe, ça va te parler… je compare ça avec mon expérience dans l’évolution de la conscience dans la dynamique de violence conjugale. J’étais intervenante sur le terrain dans un centre de femmes et une chose que j’ai apprise, c’est que plus les filles développaient leur autonomie et leur empowerment, plus leur conjoint violent développait des stratégies de contrôle subtiles et diversifiées.
Je prendrais comme exemple le dernier budget Leitão.
C’est un budget dans lequel, si déjà on a une grille d’analyse solide, on est tout à fait capable de faire les calculs, comme Québec solidaire le fait, pour se rendre compte que l’atteinte du déficit zéro se fait sur le dos des femmes. C’est possible parce qu’ils imposent à des employés un gel salarial pendant deux ans, qu’ils gèlent l’embauche, le tout dans les services publics, et que majoritairement, ce sont des jobs de femmes : la santé, l’éducation, le milieu communautaire. Donc, l’atteinte du déficit zéro se fait en grande partie sur le dos des femmes… Comprends-tu le niveau d’analyse que ça demande ?
D – L’IRIS a d’ailleurs fait une étude sur les impacts des mesures libérales depuis 2008 sur les femmes.
M – Oui ! Ça reste tout de même très ardu à comprendre pour le citoyen. Ça demande d’être lu, d’être analysé. Surtout qu’après ça, le gouvernement va investir 4 millions pour l’intimidation et 24 millions en économie sociale. Et tant mieux ! Ce sont des mesures qui ne sont pas inintéressantes en soi, mais qui font écran aux coupures de fond. Il demeure quand même que l’équilibre budgétaire s’atteint grâce au 0% d’augmentation sur la masse salariale et d’une diminution dans les ministères, principalement celui de la santé et de l’éducation. Des jobs de femmes ! Les intentions du gouvernement étaient plus faciles à déchiffrer en 1995.
D – Et plus c’est difficile à comprendre, plus c’est difficile de s’opposer…
M – C’est que c’est plus exigeant de déconstruire les discours dominants. La rhétorique en politique, c’est fondamental… Ils peuvent faire passer ce qu’ils veulent en donnant l’impression d’un consensus social… Je vais prendre un autre exemple : le système de santé. Le ministre Barrette a lancé ses deux projets de loi en disant : « Nous avons un problème d’accessibilité. Je fais tout ça pour que tous les Québécois aient accès à un médecin. » C’est sûr que le monde va être d’accord. Tout le monde est d’accord avec l’accès à un médecin de famille. Sauf qu’on sait qu’en bout de ligne, ce n’est pas le seul objectif. C’est idéologique. On veut au passage laisser la porte ouverte à la privatisation du système de santé. Il ne s’en cache même pas. Le ministre fait de la rhétorique pour faire passer la pilule.
Une chance que vous existez avec votre média, comme bien d’autres, pour prendre le temps de nous laisser parler !
C’est que les médias de masse sont crissement contrôlés et crissement monopolisés. J’en veux pas aux journalistes, même si parfois je trouve qu’ils manquent de rigueur. Pour avoir jasé avec certains qui me disaient « Regarde Manon, c’est même pas moi qui choisis où je vais. Oui, j’aimerais ça aller à ta conférence de presse sur les consignes à la SAQ et promouvoir une économie plus verte au Québec, mais quand je reçois un téléphone du patron parce que PKP fait une conférence de presse et qu’il me dit « Oublie Manon Massé », j’ai zéro choix là-dedans. Oui, j’ai le choix et le contrôle sur ce que j’écris. En même temps, j’ai 15 minutes pour l’écrire parce qu’avec les nouvelles technologies, il faut que je produise 1-2-3 articles par jour ! » Donc y’a comme une complaisance, une complicité du monde journalistique, mais ce sont des machines ! Et avec l’avènement du journalisme en ligne, les exigences sont terribles ! Il se passe de quoi, il faut que tu écrives avant l’autre. C’est très dommageable pour la démocratie.
Je me souviens, en 1995, pendant la marche, on n’était pas là. Paul Roy, journaliste à La Presse, a été 10 jours avec nous autres dans le contingent de marche ! On n’aurait pas ça aujourd’hui ! On est en campagne électorale et on a de la misère à avoir un journaliste deux jours avec nous autres.
Tous ces éléments-là font en sorte que l’austérité d’aujourd’hui est plus pernicieuse, les moyens de communication se sont diversifié, certes ! Ça impose par contre que le journaliste de recherche soit beaucoup plus efficace et plus rapide. Comment on va se sortir de tout ça… J’espère que c’est pas ta prochaine question ! (Rires)
D – Je crois qu’on va s’arrêter ici ! (Rires)
À partir de ce moment, l’entrevue devient plutôt informelle et se transforme davantage en conversation. On parle des trop insuffisantes places en CPE. On jase du manque de logements sociaux et de l’absurdité du supplément au loyer qui n’avantage pas les locataires, mais les propriétaires. On parle de privatisation des services publics, des absurdes propos de Stéphanie Vallée, la ministre de la Condition féminine, de la sous-représentation des femmes en politique…
Je rentre chez moi, contente.
Manon est dense. Profonde. Intelligente. Je suis heureuse de voir que ma députée s’implique, qu’elle n’a pas peur d’aller à la rencontre des citoyens, de répondre aux questions, de se tenir debout. J’aurais aimé l’entendre me parler de bien d’autres choses : du projet de loi 20, du texte « Comment lutter contre agressionsnondénoncées avec austériténondénoncée » qu’elle a écrit dans le Huffington Post Québec, de la ligne de parti, du mode de scrutin, du milieu LGBT… C’est ce qui arrive avec Manon, elle allume la curiosité.
Pique-nique pour les 20 ans de la marche Du pain et des roses
Toutes les informations se retrouvent sur la page Facebook des 20 ans de la marche