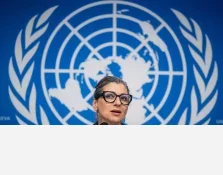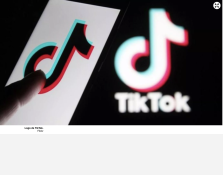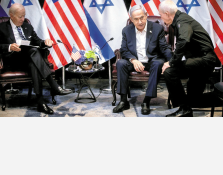A partir du milieu du XIXe siècle et jusqu’aux premières décennies du XXe siècle, les travailleuses des Etats-Unis et d’Europe ont réclamé une journée de travail de 10 eures, des congés de maternité et d’allaitement, l’interdiction du travail des enfants, le droit à une formation professionnelle et à se syndiquer. Le XIXe siècle nous a laissé le terme de capitalisme manchestérien. Le prototype d’un capitalisme à l’état pur et d’exploitation sauvage qui avait caractérisé l’activité industrielle de cette ville britannique. En 2013, Manchester se trouve au Bangladesh.
Tandis que les firmes internationales de la mode et les grandes chaînes de distribution séduisent leur clientèle avec l’actualisation constante de leurs modèles et les bas prix de leurs produits, les ouvrières de Chine, du Maroc, du Bangladesh, du Honduras ou de Roumanie vivent entourées de vêtement qu’elles confectionnent pendant plus de 12 heures par jour en échange de salaires qui couvrent à peine leurs besoins élémentaires.
La délocalisation de la production de vêtement vers des pays économiquement appauvris s’est accélérée dans les années 1990 avec la consolidation d’un modèle de production caractérisé par la sous-traitance des fournisseurs. Les grandes marques qui, dans le passé, produisaient leurs propres vêtements, sont alors devenues des entreprises qui élaborent les modèles et qui distribuent et commercialisent des produits fabriqués dans le monde entier, dans des ateliers et des fabriques qui appartiennent à d’autres entreprises. Pour rester compétitives dans ce système qui externalise les coûts salariaux dans des pays à la main d’œuvre bon marché, les petites firmes de mode ont également appliqué le même modèle. On peut comprendre le grand succès de firmes internationales comme H&M ou Zara (du groupe Inditex) sans la réduction drastique du coût de ses produits réalisée par la délocalisation d’une bonne partie du processus de production.
Des décennies de délocalisations
La première grande vague de délocalisations du secteur de la confection s’est produite dans les années 1970 à destination de pays tels que la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hong Kong et la Tunisie. L’entrée de vêtements bon marché sur les marchés occidentaux motiva en 1974 la signature de l’Accord Multifibres (AMF) qui établissait un système de quotas et de limites. Loin d’entraîner une limitation de la globalisation de la mode, l’AMF poussa au contraire les firmes internationales à rechercher des sous-traitants dans d’autres pays qui n’étaient pas concernés par le système des quotas.
Dans les années 1980, une seconde vague de délocalisation abandonne les « tigres asiatiques » et se déplace vers des pays comme le Sri Lanka, les Philippines, le Bangladesh, la Thaïlande et l’Indonésie. Tandis que l’Amérique centrale et le Mexique devenaient des plaques tournantes pour la fournitures de vêtements bon marché pour les magasins étatsuniens, la Turquie, la Tunisie et le Maroc se sont transformés en ateliers de couture du marché européen. A la fin des années 1990, d’autres pays producteurs entrent en scène, comme le Botswana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, le Cambodge, le Laos ou la Birmanie.
Les derniers pays « élus » dans la périphérie ces dernières années ont des caractéristiques communes : ils sont fortement endettés avec les banques privées et avec le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale (BM) et on leur a imposé des plans d’ajustement orientés vers l’exportation et l’amélioration de leur compétitivité. Autrement dit, une plus forte exploitation. L’industrie de la mode, en outre, empêche le développement : on charge ces pays de la partie la plus faible de la valeur ajoutée du marché légal, on leur impose un système d’accords internationaux où ils sont en position de faiblesse et le mouvement ouvrier doit constamment affronter la menace de la délocalisation (1).
L’esclavage dans l’industrie textile
Depuis le milieu des années 1990, de nombreuses plateformes et organisations sociales dénoncent l’exploitation des travailleurs et tentent de briser le silence médiatique qui entoure le business de la confection textile globalisée. Malgré plus de 25 ans de travail réalisé par des réseaux aussi consolidés que le Campagne Vêtements Propres internationale et « d’engagements » publics des grandes firmes internationales (en réaction aux dénonciations), nous sommes aujourd’hui confrontés aux mêmes situations que dans les années 1990.
Le menace constante de fermeture et de délocalisation et la faiblesse des mouvements ouvriers dans les pays producteurs contribue toujours à ce que la réalité reste cachée derrière le « glamour » que nous vendent des sportifs d’élite, des modèles et des stylistes. Le secteur de la confection continue à se nourrir du travail de millions de personnes qui vivent dans la pauvreté malgré des journées de travail interminables. Les pratiques d’achat des marques, dérivées de ce modèle de production, de consommation et de commerce international, sont à la racine des conditions de travail et de vie de ces travailleurs.
Pour ceux qui travaillent dans l’industrie de la confection globale, gagner un salaire qui permet de couvrir leurs besoins avec un minimum de dignité est devenu leur préoccupation majeure. C’est un secteur qui, traditionnellement, se caractérise par des conditions déplorables et des rétributions salariales les plus basses du monde, avec toutes les conséquences directes qui en découlent : longues journées de travail, déstructuration familiale, accumulation de dettes impayables, malnutrition des enfants et des adultes et, en définitive, des coûts inquantifiables en termes de souffrance humaine. Tout cela viole des droits fondamentaux, comme l’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme relatif à une rémunération équitable et satisfaisante, ou les dispositions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui affirme que « le salaire minimum légal doit constituer un élément clé dans les politiques d’élimination de la pauvreté et garantir les besoins des personnes qui travaillent et de leurs familles ».
Presque tous les pays ont établis des salaires minimums légaux mais, afin d’attirer les investissements étrangers, les gouvernements fixent ces minimums très en dessous des niveaux de survie. En conséquence, dans certains pays, les salaires minimums n’atteignent guère le seuil de pauvreté absolue internationalement reconnu. Au Bangladesh, il n’atteint même pas un dollar par jour et en Inde, au Sri Lanka, au Vietnam, au Pakistan et au Cambodge, il se situe entre deux et quatre dollars par jour. Des salaires incapables de garantir les besoins de base comme l’alimentation, le logement, les vêtements et des services indispensables comme l’éducation, la santé ou le transport.
En outre, la cherté de la vie s’est aggravée dans le contexte d’une montée des prix des produits de base, affaiblissant encore plus le pouvoir d’achat, d’autant plus qu’une bonne partie des salaires est destinée à l’alimentation. Une femme en Indonésie qui travaille pour un fournisseur de Nike, Reebok et Walmart déclarait dans une interview réalisée en 2009 : « Il y a des augmentations du salaire minimum, mais le coût de la vie augmente encore plus vite. Pour empirer les choses, depuis peu l’entreprise ne nous subventionne plus le transport et la nourriture ». A Bangalore, en Inde, il existe un système triennal de révision salariale, mais le salaire réel a diminué de 10% au cours des 15 dernières années. En Thaïlande, les salaires n’ont augmenté que de 18 bath (38 centimes d’euro) entre 1997 et 2005. Au Vietnam et en Chine, les salaires ont été gelés pendant plus d’une décennie (2).
La pire des situations est celle du Bangladesh. D’après la Banque Mondiale, le Produit Intérieur Brut (PIB) de ce pays croît à un rythme de 5% depuis 1990 et il est devenu le troisième pays exportateur de vêtements. Il y existe plus de 4.000 fabriques de vêtements et de confection où travaillent plus de 3 millions de personnes, des femmes dans leur grande majorité. L’élément clé de cette croissance a été la grande disponibilité d’une main d’œuvre extrêmement bon marché du fait de la pauvreté et de l’absence de régulation des droits du travail.
Les salaires les plus bas du monde y cohabitent avec un taux d’inflation élevé qui provoque un appauvrissement rapide des ouvriers et des ouvrières. Le salaire minimum légal a été gelé de 1994 à 2006 tandis que l’inflation a enregistré des taux de l’ordre de 4 à 5% annuels. En 2006, l’augmentation du salaire minimum de 930 taka à 1.662,5 taka mensuels (quelques 18 euros), fut le résultat de manifestations massives et d’une vague de révoltes urbaines qui subirent une forte répression policière. Cependant, le triplement du prix du riz enregistré en 2008 a purement et simplement englouti l’augmentation de 2006 et provoqué une nouvelle vague de mobilisations fortement réprimées. En 2010, le gouvernement a fixé un salaire minimum de 3.000 taka (plus ou moins 32 euros) par mois (3). Les mobilisations des ouvriers et des ouvrières n’ont pas cessé, mais la répression non plus. Cette dernière a un double impact sur les femmes travailleuses, qui sont celles qui souffrent des pires conditions selon l’OIT : « des salaires bas, plus d’heures de travail, souvent temporaire et en noir, qui prolongent encore plus leurs longues journées de travail ».
Epuisement interminable
Les journées de travail dans l’industrie de la confection s’allongent jusqu’à 12 ou 14 heures. Certains fabricants vont même jusqu’à enfermer sous cadenas les équipes de travailleurs lorsque la demande est forte afin de faire face à des délais de remise très courts. Les travailleuses ne peuvent s’y opposer parce que leur salaire de base n’est pas suffisant pour couvrir leurs besoins les plus élémentaires et pour maintenir leur famille. Plongées dans la misère, les travailleuses acceptent leur surexploitation, voient leur santé se détériorer et perdent la possibilité de se former, d’éduquer les enfants et de mener une vie digne.
Après des années de travail dans des locaux exigus, mal éclairés, sans ventilation, en respirant la poussière et les particules en suspension et dans des positions corporelles inadéquates pendant de longues heures, elles souffrent de fatigue visuelle et de lésions et développent de nombreuses maladies. Et cela sans couverture sanitaire ni allocations en cas de maladie.
L’enquête réalisée par la Campagne Vêtements Propres à Tanger en 2011 montrait comment, au Maroc, où la majeure partie des firmes espagnols ont leurs fournisseurs, il est fréquent que les ouvrières travaillent plus de 55 heures par semaine, dépassant systématiquement la limite légale du pays (4). Une autre enquête réalisée au Bangladesh, en Inde, en Thaïlande et au Cambodge en 2008 (5), centrée sur les fournisseurs des grandes chaînes de distribution comme Lidl, Aldi, Tesco, Walmart et Carrefour, soulignait que les journées de travail étaient rarement inférieures à 10 heures, pour des semaines de travail de six jours.
Répression antisyndicale et difficultés de la négociation collective
Malgré le fait que la liberté d’association et de négociation collective sont deux droits fondamentaux, établis par l’OIT et définis en tant que « droits habilitants » (autrement dit que leur exercice est nécessaire afin que d’autres droits soient respectés), leur défense et leur protection semble une tâche impossible. On nie ouvertement aux travailleurs la possibilité de se syndiquer.
Dans de nombreux pays producteurs de vêtements, les gouvernements limitent, placent des obstacles, voir interdisent carrément les syndicats indépendants et la négociation collective, le tout dans un contexte de surexploitation du travail. Les patrons, à leur tour, recourent si nécessaire à l’intimidation, aux licenciements, aux listes noires et, bien souvent, à la violence physique. Les listes noires de syndicalistes partagées entre patrons est une pratique très répandue.
Nouvelles formes de lutte
Malgré tout, les travailleuses cherchent des manières de s’organiser et de lutter pour améliorer leurs conditions. La Fédération Syndicale Internationale des Travailleurs/euses du Textile, de la Confection et du Cuir (ITGLWF, pour ses sigles en anglais) comte 217 organisations affiliées dans 110 pays (6). Le contexte international d’offensive néolibérale a beaucoup limité le pouvoir de négociation des syndicats. Le patronat local dispose de marges imposées très courtes pour accepter des salaires plus élevés et est soumis à de fortes pressions par les firmes internationales. Face à la possibilité de perdre des profits, il transfère cette pression sur les travailleurs/euses. Et la menace de délocalisation et de fermeture des centres de travail est l’argument le plus utilisé pour décourager la mobilisation.
Au Bangladesh, les petites avancées obtenues dans la rémunération des travailleurs ont été arrachées dans un contexte de brutale répression gouvernementale et patronale. En janvier 2007, l’état d’urgence a été décrété afin de limiter encore plus les libertés de réunion et d’expression et a donné lieu à des persécutions, des arrestations et la torture de centaines de militants et de dirigeants syndicaux. La Campagne Vêtements Propres a impulsé diverses actions de solidarité internationale avec les détenus et, tout particulièrement, avec les membres du BCWS (sigles anglaises du Centre de Solidarité avec les Travailleurs et les Travailleuses du Bangladesh) Aminul Islam et Kalpona Arkter qui, en août 2010, furent emprisonnés et torturés pendant 30 jours à la suite des plaintes déposées par plusieurs patrons propriétaires de fabriques qui fournissent des entreprises comme Walmart, Carrefour et H&M. Tous deux furent ensuite libéré mais, le 10 avril 2012, Aminul Islam a été retrouvé mort avec des signes de torture.
Face à des marchés du travail sauvages qui transforment en esclaves des légion d’ouvrières provenant de zones rurales en crise profonde, on assiste à l’augmentation de mouvements d’ouvrières qui cherchent de nouvelles formes d’organisation et qui s’appuient sur la solidarité internationale pour ouvrir des brèches de résistance. En même temps, et sans doute en partie parce que les syndicats marginalisent systématiquement les femmes et ne parviennent pas à avoir une présence significative dans un secteur aussi féminisé comme celui de la confection, on assiste à la croissance d’organisations localisées dans les quartiers et qui rassemblent des ouvrières qui ne travaillent pas nécessairement dans la même entreprise mais qui, par contre, connaissent des situations professionnelles et personnelles similaires.
La collaboration entre ce type de mouvements et les campagnes internationales qui interpellent les consommateurs sur la réalité des centres de production est une voie permettant de faire pression sur les marques internationales. Plusieurs victoires ont ainsi pu être remportées dans des cas ponctuels de répression syndicale dans de nombreux pays producteurs de vêtements. Des victoires qui, loin de représenter un engagement réel des entreprises multinationales à impulser des changements structurels dans le secteur, sont malgré tout indispensables pour maintenir et reproduire les noyaux de lutte présents dans tous lieux où les ouvrières souffrent de leur exploitation.
Albert Sales i Campos est sociologue et politologue et membre de la Campagne Vêtements Propres et du collectif RETS. Cet article a été publié dans le n°55 de la revue « Pueblos », premier trimestre 2013. Traduction française pour Avanti4. : Ataulfo Riera