1 décembre 2021 | tiré de mediapart.fr
« Les partis ont fait leur temps. […] Je ne veux plus de filtre entre le peuple et moi et je ne me soumettrai pas à des règles fixées par les partis politiques. » Ainsi s’exprimait Xavier Bertrand dans Corse-Matin en août 2020. C’était il y a un an – et nous pourrions dire il y a un siècle, une éternité. Car depuis, le président des Hauts-de-France a remisé ses déclarations fracassantes sur l’obsolescence des organisations partisanes. Le 11 octobre dernier, en déclarant qu’il participerait au congrès des Républicains (LR), il s’est résigné à revenir dans le giron du parti qu’il avait quitté en décembre 2017.
Cette tentative avortée de prise d’autonomie illustre le paradoxe qui entoure le fait partisan. Pas un scrutin ne se produit sans que ne soient relancées les analyses sur la crise des partis, les spéculations sur leur fin, les appels à leur dépassement… Plusieurs candidats déclarés pour 2022, dont Éric Zemmour ce mardi, s’apprêtent d’ailleurs à faire campagne quasiment sur leur seul nom, sans base militante pérenne ni structures intermédiaires contraignantes.
Et pourtant, non seulement les partis persistent dans leur existence, mais il s’en crée régulièrement de nouveaux, y compris au service des figures politiques qui prétendaient s’en affranchir. De différentes manières, ils se rappellent au bon souvenir des candidates et des candidats : soit parce qu’ils concentrent des ressources propres à faire rentrer dans le rang ces derniers, soit parce que leur absence n’est pas étrangère à certaines erreurs ou difficultés. S’il est possible de comprendre pourquoi toutes ces réalités cohabitent, il n’en reste pas moins qu’elles pèsent négativement sur la qualité de notre démocratie.
Le fait est que les partis sont mal-aimés. Si la tendance est paneuropéenne (lire notre entretien avec Piero Ignazi), la France fait partie des États où elle est exacerbée. Le taux de confiance envers les partis apparaît particulièrement bas (16 % dans le dernier baromètre du Cevipof, en légère hausse par rapport à la vague précédente, mais toujours en queue de liste des organisations testées). Quant à la proportion d’électeurs et d’électrices qui adhèrent à un parti, elle est une des plus faibles du Vieux Continent (on estime que seul 1,5 % du corps électoral serait encarté).
Le phénomène est ancien et a nourri, dans les années 1990 et 2000, des réformes organisationnelles destinées à rendre à nouveau attractif le statut de membre d’un parti. Militantes et militants ont notamment été invités à se prononcer par référendum sur certains choix, à choisir directement le leader de leur formation, ou encore à désigner leur candidat à la présidentielle – ce privilège ayant ensuite été élargi aux sympathisants dans le cadre de primaires dites ouvertes.
L’effet sur les adhésions n’a cependant été qu’éphémère, et n’a pas suffi à contrecarrer la tendance de fond à la raréfaction et au vieillissement des membres. Surtout, de nouveaux acteurs sont venus bousculer le jeu.
Aventures personnelles et prétentions mouvementistes
En 2017, La France insoumise (LFI) et La République en marche (LREM) ont prospéré sur la crise des grands partis de gouvernement issus du socialisme et du gaullisme. Ils se sont autodésignés comme des « mouvements », sans s’inscrire explicitement dans une tradition idéologique les ayant précédés, et ont permis des adhésions gratuites en ligne, ne donnant guère de prise sur des organes informels et changeants. Le « moment destituant » auxquels ils ont participé ne portait pas seulement sur l’identité des organisations qui alternaient depuis les années 1980, mais aussi sur le type même de médiation qu’elles avaient assuré.
Jean-Luc Mélenchon, après de longues années au PS puis à la tête du Parti de gauche, a fait le choix assumé d’inventer une entité « gazeuse » débarrassée de caractéristiques partisanes jugées inopportunes, comme les débats sur des textes doctrinaux ou les élections internes pyramidales de la base au sommet. L’attractivité du mouvement était néanmoins censée provenir du programme en plus de sa personne, et LFI a émis des velléités d’encourager l’auto-organisation populaire.
En comparaison, Emmanuel Macron est allé encore plus loin dans la conception d’un appareil ex nihilo, lancé comme une marque et géré comme une firme, à son service exclusif. De son constat selon lequel « nos partis politiques sont morts de ne plus s’être confrontés au réel », l’actuel président de la République a tiré la conclusion qu’il lui fallait un véhicule personnel ad hoc, dont le fonctionnement managérial façon « start-up » ne mobiliserait les énergies et les affects qu’à son profit d’unique actionnaire.
Il n’est même pas assuré que la durée de vie de ces deux organisations dépasse un quinquennat. Du côté de Mélenchon, LFI n’est plus mise en avant : c’est la plateforme « Nous sommes pour » qui avait servi à récolter des signatures numériques en guise d’adoubement populaire du candidat, tandis que la campagne de 2022 est placée sous le sceau de l’Union populaire, au statut encore plus vaporeux sinon qu’un « parlement » de personnalités l’incarnera (le candidat s’en explique ici).
Du côté de Macron, la marque LREM n’est pas non plus mobilisée. Sa démonétisation précoce a conduit les soutiens du chef de l’État à désigner leur camp par des périphrases – la « majorité présidentielle » –, et à s’organiser en vue de 2022 dans le cadre d’une « maison commune » à la structure encore indéfinie et à la base idéologique tout aussi gélatineuse qu’il y a cinq ans. « Aucune procédure n’est prévue pour acter sa candidature, sans parler de l’adoption d’un programme », remarque Rémi Lefebvre, professeur de science politique à l’université de Lille.
Alors qu’il travaille sur ces deux organisations – mélenchonienne et macronienne –, le chercheur observe qu’elles ont fait des émules, tentés de « jouer la carte de l’absence de ressources collectives ».
Dans une sorte d’« ubérisation » de la politique, de plus en plus d’entrepreneurs politiques se lancent à l’assaut des suffrages en diminuant le plus possible les médiations qui les séparent des potentiels votants.
À la prochaine élection présidentielle, au moins deux personnalités ont en effet décidé de se lancer à partir d’une plateforme de soutiens, sans parti constitué qui aurait procédé à leur sélection comme candidat, en les chargeant de représenter un héritage commun. C’est le cas d’Arnaud Montebourg, qui s’appuie sur un mouvement citoyen dénommé « l’Engagement » (il a depuis été soutenu par la petite Gauche républicaine et socialiste). Et c’est bien sûr le cas d’Éric Zemmour, qui n’a parlé qu’à la première personne dans son annonce de candidature, et dispose d’une association d’Amis à son nom, chargée de récolter adresses mails et dons.
Dans une sorte d’« ubérisation » de la politique, de plus en plus d’entrepreneurs politiques se lancent donc à l’assaut des suffrages en diminuant le plus possible les médiations qui les séparent des potentiels votants. Quant à la main-d’œuvre qui s’active pour eux, elle est soit rémunérée en tant que prestataire dans une logique de donneur d’ordre, soit gratuite en raison de son engagement volontaire, mais atomisée et sans droits sur l’équipe qui centralise à la fois les décisions, l’argent et l’information.
Il ne s’agit pas nécessairement de la voie la plus sûre. Autant Éric Zemmour est parvenu – au moins pendant un temps – à saturer l’agenda médiatique et à affoler les compteurs sondagiers, autant la candidature d’Arnaud Montebourg n’a jamais vraiment décollé. Elle a même failli sombrer début novembre, à cause d’une sailliequi aurait peut-être été évitée avec davantage de procédures et de fabrique collective de la campagne.
L’absence de structuration partisane handicape aussi le polémiste d’extrême droite : certains ralliements ont pu être découragés par le manque d’expérience de son équipe, et sa lenteur à s’organiser pour les législatives qui suivront. L’absence d’implantation territoriale pose par ailleurs un obstacle à la récolte des signatures d’élus nécessaires pour se présenter à l’élection présidentielle.
Surtout, l’aventure hors parti n’est pas une voie empruntable par tous. Le retour express à LR de Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui ont repris leur carte pour avoir une chance d’être adoubés par la base du parti cette fin de semaine (voir notre émission), en témoigne.
La trajectoire d’Anne Hidalgo est tout aussi significative. Au début de l’été dernier, elle ne s’exprimait que depuis sa plateforme « Idées en commun », en se tenant à l’écart du PS. Depuis, elle a sacrifié aux rituels du parti (présence à l’université d’été, participation à la primaire interne…) et s’est même affichée avec François Hollande, le président sous lequel le parti à la rose est passé de la toute-puissance à un parti effondré et honni.
Édouard Philippe, ancien premier ministre d’Emmanuel Macron, en a si bien conscience qu’il assume la création d’un « vrai » parti, à rebours des plateformes et des mouvements citoyens peu structurés. Au Figaro, il a ainsi expliqué que sa formation, baptisée Horizons, accordera « une place particulière aux maires » et aura « vocation à travailler sur le fond, à former des équipes, à formuler des propositions et à présenter des candidats ».
« Il y a manifestement des conditions pour se passer d’un parti, commente Rémi Lefebvre. Le capital médiatique est nécessaire, même si pas suffisant, afin de sortir du rang et d’initier un phénomène d’entraînement, par lequel viendraient les financements et les réseaux manquants. » À cet égard, la force de frappe d’un Zemmour s’est révélée incomparable à celle d’un Bertrand ou d’une Hidalgo.
Ce n’est pas un hasard non plus, suggère le politiste, si les responsables issus du duopole LR/PS sont les acteurs les plus improbables de l’ubérisation : « Macron, Mélenchon ou Zemmour ont pu jouer de l’hétérogénéité des électorats et des contradictions des partis installés, en fracturant des ensembles qui étaient composites pour mieux les recomposer ». Les héritiers des anciens partis de gouvernement, lorsqu’ils continuent à se positionner au centre de gravité de ces derniers, sont mal placés pour accomplir un tel coup de force.
Si les partis concentrent parfois des ressources que certains entrepreneurs politiques se révèlent incapables d’accumuler seuls, ils finissent également par être une étape obligée pour les plus aventuriers. C’est pourquoi même les organisations auto-baptisées « mouvements » sont en fait… des partis. Ils le sont juridiquement, afin de pouvoir accéder facilement au financement public prévu pour eux. Et ils le sont aussi selon une définition minimale des partis, qui cible leur différence spécifique vis-à-vis d’autres associations politiques, dans la mesure où ils sont les seuls à placer des candidats à des charges publiques à travers des élections.
La situation est appelée à perdurer, sauf à voir émerger un jeu politique totalement déstructuré et individualisé. Tant que la démocratie représentative restera la seule manière légitime d’attribuer l’autorité politique, les partis seront incontournables, fussent-ils réduits à des fonctions logistiques et à des caisses enregistreuses.
Voilà pourquoi, dans Parti et Démocratie (Calmann-Lévy), le politiste Piero Ignazi écrit que « les partis sont seuls, telles de puissantes armées campant dans un désert. Ils ont l’équipement nécessaire pour entretenir leur quartier général et faire face à n’importe quel assaut mené par les initiatives citoyennes diverses, mais ils vivent à l’écart sans que personne leur apporte de sang frais. » Traitant dans son ouvrage de LREM, mais aussi de Podemos (Espagne) ou du Mouvement Cinq Étoiles (Italie), il estime que ces nouvelles formations n’ont pas tenu leur promesse de régénérer la forme partisane.
De fait, si l’on s’en tient à la France, les entreprises politiques lancées en 2017 ont même reconduit les travers reprochés aux partis de gouvernement absorbés dans l’appareil d’État. Comme le remarque Carole Bachelot dans une contribution à l’ouvrage collectif La fin des partis ? (PUF, 2020), « on retrouve [dans ces nouvelles forces politiques] un brouillage de la distinction entre membres et non-membres et une centralisation assumée de la direction du parti. […] L’absence de relations et la marginalisation des niveaux intermédiaires permet aux dirigeants professionnalisés d’imposer leurs décisions à la base sans craindre la structuration d’éventuels contre-pouvoirs, factionnels ou locaux ».
Le diagnostic global est donc toujours le même : les partis ne sont plus que de petites sociétés militantes isolées, et ne structurent quasiment plus les identités politiques de masse, le débat public ou la production d’idées.
Les problèmes pour la démocratie… et pour la gauche
Avec des partis inexpugnables mais désertifiés et/ou réduits à des véhicules personnels, le système politique continue certes de fonctionner. Cependant, la qualité du lien entre représentants et représentés en est forcément dégradée. Là où l’intérêt des partis consiste notamment à « agréger des intérêts sociaux sur la durée », comme le rappelait récemment la politiste Camille Bedock à Mediapart, on assiste tendanciellement à un écrasement de cette durée et à un rétrécissement des intérêts défendus.
Sauf à ce qu’un autre système se substitue au modèle libéral-représentatif dans lequel nous vivons, celles et ceux qui regrettent cet état de fait ne peuvent chercher de voie de salut que dans des formes de parti renouvelées. La question se pose d’autant plus pour la gauche de transformation écologique et sociale. Après tout, les personnes privilégiées par leurs richesses ou leurs titres de compétence ont bien d’autres canaux que les partis pour se faire entendre et voir leurs intérêts servis par la classe politique.
Les plus vulnérables, en revanche, manquent justement d’un accès à l’autorité politique. « Je continue à penser que les partis sont l’arme des faibles contre les forts, affirme Rémi Lefebvre. Sinon, comment contourner les médias de masse ? Comment politiser les milieux populaires ? » Selon lui, LFI a manqué l’occasion d’accomplir ce « travail de longue haleine » alors que le parti en avait affiché l’intention. Pour cela, il aurait été nécessaire de confier de l’argent à des groupes implantés localement.
Il reste que les conditions ont disparu du retour du parti de masse, qui avait contribué à la politisation et à la représentation des secteurs subalternes de la société. Ce modèle s’était épanoui dans un âge industriel qui n’existe plus. Les conséquences du néolibéralisme ont contribué à atomiser les citoyens et à disperser les sources du pouvoir au-delà de l’État-nation – de quoi décourager à s’investir pour « la cause ». De plus, l’individualisation des valeurs a progressé, ce qui a nourri des formes d’engagement plus exigeantes, sélectives et courtes – preuve que la crise des partis n’est pas tout à fait synonyme de celle de la politique.
Les mouvements de protestation ont beau être récurrents et massifs (parfois beaucoup plus que par le passé), ils ne sont pas soutenus dans le temps, ni ne s’adossent à un horizon d’espérance qui donne envie de pérenniser son engagement. C’est pourquoi des actrices et des acteurs du mouvement social réfléchissent de plus en plus aux dispositifs susceptibles de déjouer ce piège, comme Aurélie Trouvé avec son récent essai sur le « bloc arc-en-ciel » (lire notre recension).
« Il faut s’habituer à des grosses mobilisations, avec des effectifs importants comme jamais, mais avec des gens peu ou pas organisés, confirme Christophe Aguiton, figure de l’altermondialisme et auteur de La gauche du XXIe siècle (La Découverte, 2017). Il faut aussi accepter l’idée d’appareils plus petits, dépassés par ces mouvements. Mais même s’ils sont plus légers, cela ne doit pas empêcher les débats démocratiques en leur sein. Une des mutations à prendre en compte, c’est que les gens sont bien plus instruits qu’avant, et veulent logiquement que leur opinion compte. »
Fabien Escalona






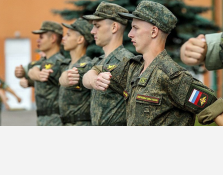





Un message, un commentaire ?