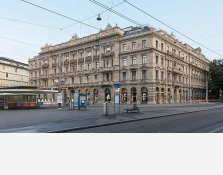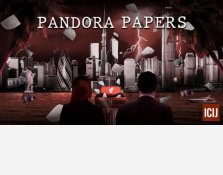1. Questions de méthode
L’effondrement financier de Septembre 2008 amorce le développement d’une crise systémique majeure.
Pour comprendre la nature de cette crise, des enjeux et à partir de là imaginer les contours possibles des différents systèmes alternatifs qui émergeront progressivement des réponses que leur donneront les forces dominantes en place, les États et les classes dirigeantes, comme les travailleurs et les peuples dominés, il est nécessaire d’aller au-delà de l’analyse du déroulement de la crise financière à proprement parler. Mais il ne suffit pas non plus de juxtaposer cette dernière analyse et celle d’autres crises en particulier : (i) la crise de l’accumulation dans l’économie productive réelle ; (ii) la crise énergétique, concernant a) l’épuisement des ressources fossiles, b) les conséquences de la croissance associée au modèle d’utilisation de cette énergie (effets possibles sur le climat inclus), c) les conséquences des politiques de substitution mises en œuvre (agro-carburants) ; (iii) la crise des sociétés paysannes soumises à une destruction accélérée et la crise de l’agro-alimentaire qui lui est associée. Il est nécessaire d’intégrer toutes les dimensions de cette crise systémique majeure dans une analyse holistique intégrée.
J’amorcerai le débat sur cette question par une série de propositions concernant les caractéristiques majeures nouvelles du capitalisme contemporain. Deux transformations majeures se sont produites progressivement au cours des dernières décennies. Bien qu’il s’agisse d’évolutions amorcées depuis longtemps, je dirai que le changement en quantité s’est transformé en saut qualitatif.
La première de ces transformations concerne le degré de centralisation du capital dans ses segments dominants. Celui-ci est sans commune mesure avec ce qu’il était il y a seulement une quarantaine d’années. Certes les monopoles et les oligopoles ne sont pas une réalité nouvelle dans l’histoire du capitalisme, depuis l’époque mercantiliste jusqu’à l’émergence des cartels et trusts de la fin du XIXe siècle (analysés par Hilferding, Hobson et Lénine). Mais aujourd’hui on doit parler pour la première fois d’un capitalisme d’oligopoles généralisé qui désormais dominent dans tous les domaines de la vie économique.
Je déduirai de cette observation deux conséquences majeures.
La première de ces conséquences est que cette transformation a donné un visage nouveau à l’impérialisme. Celui-ci se conjuguait toujours au pluriel, et se manifestait par le conflit permanent des puissances impérialistes concernées. Désormais on doit parler de l’impérialisme collectif de la triade (États-Unis, Europe, Japon), au singulier.
La seconde de ces conséquences est que la forme oligopolistique du capitalisme est à l’origine de sa « financiarisation ».
La seconde des transformations qualitatives majeures concerne les ressources naturelles de la Planète. Celles-ci ne sont plus abondantes au point de pouvoir considérer possible l’accès illimité à leur exploitation. Ces ressources sont devenues relativement considérablement plus rares (sinon en voie d’épuisement) et de ce fait l’accès à celles-ci ne peut plus être ouvert à tous.
Dans ce qui suit j’articulerai les analyses de chacune de ces évolutions nouvelles du capitalisme/impérialisme contemporain, ce qui permet de situer la crise de sa dimension financière dans l’ensemble du système. Mais aussi de comprendre la logique et la nature des réponses des pouvoirs dominants, et en contrepoint de préciser les conditions de l’émergence de réponses alternatives.
La liste de « ce qui est nouveau » dans l’organisation des sociétés modernes dépasse certainement les domaines retenus ici. La littérature met souvent l’accent par exemple sur la révolution scientifique et technologique de notre temps (informatique, espace, nucléaire, exploitation du fond des mers, fabrication de matériaux nouveaux etc.). Celle-ci est indiscutable et importante. Je refuse néanmoins d’appréhender cette dimension de la réalité à travers les « technologistes » du discours dominant sur le sujet, faisant de ces lunettes innovations le moteur premier de l’histoire, appelant donc la société à « s’ajuster » aux contraintes qu’elles commanderaient. En contrepoint, dans les analyses que je propose, les technologies sont elles-mêmes façonnées par les rapports sociaux dominants. Dans d’autres dimensions de la réalité la constatation de changements factuels importants ne s’impose pas moins. Au plan des rapports internationaux l’émergence de « puissances nouvelles » ne peut être écartée du champ du possible. Au plan des rapports sociaux la liste des « faits nouveaux » indiscutables pourrait paraître illimitée. Par exemple la fragmentation des marchés du travail et de l’organisation des systèmes productifs. Ou encore l’érosion des formes anciennes de l’expression politique au bénéfice d’affirmations nouvelles – ou renouvelées, ou renforcées – du genre, des identités (ethniques, religieuses, culturelles). Je crois néanmoins nécessaire d’articuler l’analyse de ces réalités à celle de la logique de la reproduction du système caractérisé par celles des transformations majeures que j’ai retenues.
La crise est systémique dans le sens que la poursuite du modèle de déploiement du capitalisme des dernières décennies devient impossible. La page en sera tournée nécessairement, à travers un temps de « transition » (de crise) bref ou long, ordonné ou chaotique. « Un autre monde est possible », proclamaient les « altermondistes » de Porto Allègre. Je disais « Un autre monde est en voie d’émerger », qui pourrait être encore plus barbare, mais qui peut être tout également meilleur, à des degrés divers.
Les forces sociales dominantes tenteront, dans les conflits appelés à s’aiguiser, de maintenir leurs positions privilégiées. Mais elles ne pourront y parvenir qu’en rompant avec beaucoup des principes et des pratiques associés jusqu’ici à leur domination. En particulier en renonçant à la démocratie, au droit international et au respect des droits des peuples du Sud. Si elles y parvenaient le monde de demain serait fondé sur ce que j’ai appelé « l’apartheid à l’échelle mondiale ». Phase nouvelle du « capitalisme » ou système qualitativement différent et nouveau ? La question mérite discussion.
Les travailleurs et les peuples qui seraient les victimes de cette évolution barbare peuvent mettre en déroute les forces sociales et politiques réactionnaires (et non « libérales » comme elles essaient de le faire croire par leur autoqualification) à l’œuvre. Ils sont capables de prendre la mesure entière des enjeux de cette crise systémique, de se libérer des réponses illusoires qui ont encore souvent le vent en poupe, d’inventer les formes d’organisation et d’action adéquates, de transcender la fragmentation de leurs luttes et de surmonter les contradictions qui en découlent. Auront-ils alors « inventé » - ou « réinventé » - le socialisme du XXIe siècle ? Ou seulement avancé dans cette direction, sur la longue route de la transition séculaire du capitalisme au socialisme ? Je penche pour cette seconde probabilité.
La mondialisation –phénomène inhérent au capitalisme, s’approfondissant au cours des étapes successives de son déploiement – implique que le monde de demain ne sera meilleur que si les peuples du Sud (qui rassemblent 80 % de l’humanité) l’imposent par leurs luttes. A défaut le monde ne peut être meilleur. Car l’idée que dans un mouvement de générosité humaniste les travailleurs du Nord – eux également victimes du système en place – pourraient façonner un système mondial meilleur pour les peuples du Sud reste sans fondement.
2. La domination des oligopoles, fondement de la financiarisation en déroute
Le phénomène qualifié de financiarisation du capitalisme contemporain trouve son expression dans l’expansion des placements sur les marchés monétaires et financiers. Cette expansion exponentielle sans précédent dans l’histoire, décolle il y a un quart de siècle, et a porté le volume des opérations conduites annuellement sur les marchés monétaires et financiers à plus de 2 000 tera dollars, contre à peine environ 50 tera dollars pour le PIB mondial et 15 pour le commerce international.
La financiarisation en question a été rendue nécessaire par, d’une part, la généralisation du système des changes flexibles (dont les taux sont déterminés par ce qu’on appelle le marché au jour le jour) et par, d’autre part, la dérégulation parallèle des taux d’intérêts (également abandonnés à l’offre et à la demande). Dans ces conditions les opérations sur les marchés monétaires et financiers ne constituent plus, principalement, la contrepartie des échanges de biens et services mais sont désormais motivés presqu’exclusivement par le souci des agents économiques de se protéger des fluctuations des taux de change et d’intérêt.
Il allait de soi que l’expansion vertigineuse de ces opérations de couverture du risque ne pouvait en aucune manière répondre aux attentes de ceux qui en mobilisent les moyens. Le bon sens élémentaire devrait faire comprendre que plus les moyens de réduction du risque pour une opération donnée sont démultipliés plus le risque collectif prend de l’importance. Mais les économistes conventionnels ne sont pas équipés pour le comprendre ; car ils ont besoin de croire au dogme absurde de l’autorégulation des marchés, sans l’adhésion auquel toute leur construction de la prétendue « économie de marché » s’effondre. « L’économie de marché », que j’ai qualifiée ailleurs de théorie d’un système imaginaire qui n’a aucun rapport avec le capitalisme réellement existant, est la pierre angulaire de l’idéologie (au sens vulgaire et négatif du terme) du capitalisme, son moyen de lui donner sa légitimité apparente.
On ne sera donc pas surpris que les économistes conventionnels, en dépit de leur arrogance, aient été incapables de prévoir ce qui pour d’autres était évident. Et lorsque l’effondrement a bien eu lieu, ils n’ont trouvé aucune explication autre que purement « accidentelle » - les erreurs des calculs concernant les « subprime » et autres. Il ne pouvait s’agir pour eux que d’accidents mineurs, sans conséquences dramatiques, qui pouvaient être corrigés rapidement !
L’expansion du marché monétaire et financier qui conduisait nécessairement à la catastrophe a été analysée, avant même l’effondrement de Septembre 2008, à la perfection, par les économistes politiques critiques, en particulier par François Morin, Frédéric Lordon, Elmar Altvater, Peter Gowan, moi-même et quelques autres (peu nombreux hélas). Il n’y a rien à ajouter ici à ces analyses du déroulement des évènements.
Mais il faut aller plus loin. Car en s’arrêtant à l’analyse financière de la crise financière on laisse entendre que celle-ci n’a pas d’autres causes que les causes directes qui sont à son origine. A savoir que c’est le dogme de la libéralisation des marchés monétaires et financiers, de leur « dérégulation », qui est à l’origine du désastre. Mais cela n’est vrai que dans une première lecture immédiate de la réalité. Au-delà la question concerne l’identifiant des intérêts sociaux qui se profilent derrière l’adhésion aux dogmes concernant la dérégulation des marchés en question.
Ici encore les banques et les autres institutions financières (Assurances, Fonds de pension, Hedge Funds) paraissent bien avoir été les bénéficiaires privilégiés de cette expansion, ce qui permet au discours des pouvoirs de leur faire porter la responsabilité exclusive du désastre. Mais en fait la financiarisation profitait à l’ensemble des oligopoles, et 40 % de leurs profits provenait de leurs seules opérations financières. Et ces oligopoles contrôlent à la fois les segments dominants de l’économie productive réelle et les institutions financières.
Pourquoi donc les oligopoles ont-ils délibérément choisi la voie de la financiarisation du système dans son ensemble ? La raison en est que cela leur permet tout simplement de concentrer à leur bénéfice une proportion croissante de la masse des profits réalisés dans l’économie réelle. Des taux de rapport apparemment insignifiants sur chaque opération financière produisent, compte tenu de la masse gigantesque que totalisent ces opérations, des volumes de profits considérables. Ces profits sont les produits d’une redistribution de la masse de la plus value générée dans l’économie réelle et sont des rentes de monopoles. On comprend alors que le taux de rendement élevé des placements financiers (de l’ordre de 15 %) ait pour contrepartie des taux de rendement médiocres pour les investissements dans l’économie productive (de l’ordre de 5 %). Cette ponction sur la masse globale des profits opérée par la rente financière des oligopoles interdit de dissocier la cause (le caractère oligopolistique du capitalisme contemporain) de sa conséquence (la financiarisation, c’est-à-dire la préférence pour le placement financier par comparaison à l’investissement dans l’économie réelle).
Le marché monétaire et financier occupe de ce fait une position dominante dans le système des marchés. Car il est le marché par le moyen duquel les oligopoles (et pas seulement les banques) prélèvent leur rente de monopole d’une part, et se livrent à la concurrence entre eux pour le partage de cette rente d’autre part. Les économistes conventionnels ignorent cette hiérarchisation des marchés, à laquelle ils substituent le discours abstrait de « l’économie des marchés généralisés ».
L’expansion du marché monétaire et financier conditionne celui des investissements dans l’économie réelle, dont elle limite la croissance. A son tour cette affaiblissement de la croissance générale de l’économie entraîne celui de la croissance de l’emploi, avec des effets associés bien connus (chômage, expansion de la précarité, stagnation – voire réduction – des salaires réels décrochés des progrès de la productivité). Le marché monétaire et financier domine à son tour de cette manière celui du travail. L’ensemble de ces mécanismes qui traduisent la soumission de l’économie entière (des « marchés ») au marché monétaire et financier dominant produisent l’inégalité croissante dans la répartition du revenu (que nul ne conteste dans les faits). Le marché des investissements productifs (et derrière lui celui du travail) souffre à la fois de la réduction de sa rentabilité directe apparente (contrepartie de la ponction opérée au profit de la rente des oligopoles) et de celle de l’expansion de la demande finale (affaiblie par l’inégalité dans la répartition du revenu).
La domination des oligopoles financiarisés enferme l’économie dans une crise de l’accumulation du capital, qui est à la fois une crise de la demande (« sous-consommation ») et une crise de rentabilité.
3. Les réponses des pouvoirs : restaurer la financiarisation
Nous sommes maintenant équipés pour comprendre pourquoi les pouvoirs en place (les gouvernements des pays de la triade), eux-mêmes au service des oligopoles, n’ont pas de projet autre que celui de remettre en selle ce même système financiarisé. Car les oligopoles ont besoin, de l’expansion financière en question pour affirmer leur domination sur l’économie et la société. Remettre en cause la domination du marché monétaire et financier sur l’ensemble des marchés c’est remettre en cause la rente de monopole des oligopoles.
Les politiques mises en œuvre à cette fin peuvent-elles être efficaces ?
Je crois que cette restauration du système tel qu’il était avant la crise de l’automne 2008 n’est pas impossible. Mais cela exige que deux conditions soient remplies.
La première est que l’Etat et les banques centrales injectent dans le système un volume de moyens financiers suffisant pour gommer la masse des créances pourries et restaurer la crédibilité et la rentabilité de la reprise de l’expansion financière. Il s’agit de sommes astronomiques comme quelques uns (dont moi-même) l’avaient prévu plusieurs années avant la débâcle de l’automne 2008, contre l’avis des économistes conventionnels et des « experts du FMI » (qui ne nous ont rejoint dans nos estimations que trois mois après la débâcle !). Mais désormais on peut penser que les pouvoirs finiront par porter cette injection au niveau requis.
La seconde est que les conséquences de cette injection soient acceptées par la société. Car les travailleurs en général, et les peuples du Sud en particulier, seront nécessairement les victimes de ces politiques. Celles-ci ne se donnent pas l’objectif de relancer l’économie réelle par la relance de la demande des salaires (comme le keynésianisme le proposait en son temps), mais, au contraire, de maintenir la ponction que constitue la rente des oligopoles, et a nécessairement au détriment des rémunérations réelles des travailleurs. Les plans des pouvoirs envisagent froidement l’aggravation de la crise de l’économie réelle, le chômage, la précarisation, la détérioration des retraites assurées par les Fonds de Pensions. Les travailleurs réagissent déjà, et réagiront probablement davantage dans les mois et années à venir. Mais si leurs luttes demeurent fragmentées et dénuées de perspectives comme elles le sont encore largement, ces protestations demeureront « contrôlables » par le pouvoir des oligopoles et des États à leur service.
Voilà toute la différence qui sépare la conjoncture politique et sociale de notre époque de celle qui caractérisait les années 1930. A l’époque, deux camps de forces sociales s’affrontaient : le camp d’une gauche qui se réclamait du socialisme, composé de communistes (l’Union Soviétique offrait l’image d’un succès évident à l’époque) et de sociaux démocrates authentiques, tandis que le camp de la droite pouvait s’appuyer sur des mouvements fascistes puissants. C’est pourquoi en réponse à la crise de 1930, on a eu ici le New Deal ou des Fronts populaires, là le nazisme. La conjoncture politique actuelle est radicalement différente. La faillite du soviétisme et le ralliement des socialistes au social libéralisme ont terriblement affaibli les visions politiques des travailleurs, privés de perspectives et de capacité d’expression d’une alternative socialiste authentique.
La crise actuelle du capitalisme des oligopoles n’a pas été le produit d’une montée des luttes sociales imposant le recul des ambitions des oligopoles. Elle est le produit exclusif des contradictions internes propres à son système d’accumulation. Or à mon avis, la distinction entre la crise d’un système produite par l’explosion de ses contradictions internes et celle d’une société qui subit l’assaut de forces sociales progressistes qui nourrissent l’ambition de transformer le système est une distinction centrale. Elle commande largement les issues différentes possibles. Dans la situation du premier type le chaos devient une probabilité majeure, et c’est seulement dans une situation du second type qu’une sortie progressiste devient possible. La question politique centrale aujourd’hui est donc de savoir si les victimes sociales du système en place deviendront capables de se constituer en alternative positive indépendant, radicale et cohérente.
A défaut la restauration du pouvoir des oligopoles rentiers financiarisés n’est pas impossible. Mais dans ce cas le système ne recule que pour mieux sauter et une nouvelle débâcle financière, encore plus profonde, sera inévitable, car les « aménagements » prévus pour la gestion des marchés financiers sont largement insuffisants, puisqu’ils ne remettent pas en cause le pouvoir des oligopoles.
Reste la question de savoir comment les États et les peuples du Sud répondront au défi. L’analyse du défi auquel ils sont confrontés, aggravé par la crise de la financiarisation mondialisée, s’impose ici.
4. La question des ressources naturelles et le conflit Nord/Sud
Les questions relatives à l’usage qu’un système économique et social fait des ressources naturelles de la planète, de sa conception philosophique des rapports entre l’être humain (et la société) d’une part et la nature d’autre part, sont des questions majeures. Les réponses historiques que les sociétés leur ont données définissent le mode de rationalité qui gouverne sa gestion économique et sociale.
Le capitalisme historique a largement évacué ces considérations. Il a mis en place une rationalité strictement économique, inscrite dans une vision courte du temps (« la dépréciation du futur »), et fondé sur le principe que les ressources naturelles sont le plus généralement mises à la disposition gratuite de la société et de surcroît disponibles en quantités illimitées. Il n’a fait d’exception que dans la mesure où certaines de ces ressources font l’objet d’une appropriation privée, comme le sol ou les ressources minières, mais en soumettant leur usage aux exigences exclusives de la rentabilité du capital qui en exploite le potentiel. La rationalité de ce système est donc étroite, et s’avère irrationalité sociale dès lors que les ressources en question deviennent rares, en voie d’épuisement possible, ou que leur usage, dans les formes qu’impose la rentabilité économique propre au capitalisme, produit des conséquences dangereuses à long terme (destruction de la biodiversité, voire changement climatique).
Notre propos ici n’est pas de discuter de ces aspects fondamentaux de la question du rapport société/nature, encore moins d’intervenir dans les débats philosophiques concernant la formation des modes de pensée du problème.
Notre propos ici est beaucoup plus modeste et ne concerne que l’accès à l’usage des ressources de la planète et la répartition, en droit et en fait, égale et ouverte à tous les peuples ou au contraire réservée au bénéfice exclusif de certains d’entre eux.
De ce point de vue notre système mondial moderne enregistre désormais une transformation qualitative de portée décisive. Certaines des ressources naturelles majeures sont désormais devenues considérablement plus rares – en termes relatifs – qu’elles ne l’étaient il y a encore une cinquantaine d’années, que leur épuisement constitue une menace réelle ou non (ce qui peut certes être discuté). Une conscience existe désormais que l’accès à celles-ci ne peut plus être ouvert à tous, et ce, indépendamment du fait que les formes de leur usage telles qu’elles sont selon certains mettent en danger (et selon d’autres ne le mettent pas) l’avenir de la planète. Les « pays du Nord » (j’emploie à dessein ce terme vague pour ne dire ni les États, ni les peuples) entendent se réserver l’exclusivité de l’accès à ces ressources pour leur seul usage, que celui-ci soit conçu tel qu’il est, c’est-à-dire fondé sur beaucoup de gaspillage et mettant en danger un avenir qui n’est plus lointain, ou qu’on le soumette à des régulations correctives importantes comme le proposent certains Verts.
L’égoïsme des pays du Nord trouve son expression brutale dans la phrase prononcée par le Président Bush (une phrase que ses successeurs quels qu’ils soient ne discuteront pas) : « le mode de vie américain n’est pas négociable ». Beaucoup en Europe et au Japon le pensent tout également, même s’ils s’abstiennent de le proclamer. Cet égoïsme signifie tout simplement que l’accès à ces ressources sera désormais largement interdit aux pays du Sud (80 % de l’humanité), que ceux-ci entendent faire un usage de ces ressources analogue à celui du Nord, gaspilleur et dangereux, ou qu’ils envisagent à leur tour des formes plus économes.
Il va sans dire que cette perspective est inacceptable pour les pays du Sud, en droit et en fait. Par ailleurs les moyens du marché ne sont plus nécessairement à la hauteur des exigences de la garantie de l’accès exclusif des pays opulents à ces ressources. Certains pays du Sud peuvent mobiliser des moyens importants pour se faire reconnaître sur ces marchés de l’accès aux ressources. En dernier ressort la seule garantie pour les pays du Nord réside dans leur supériorité militaire.
La militarisation de la mondialisation est l’expression de cette conscience égoïste. Elle n’est pas le produit d’une dérive passagère de l’administration de Washington. Le plan de contrôle militaire de la Planète par les forces armées des États-Unis a été mis en place par le Président Clinton, poursuivi par Bush et le sera par Obama. Certes dans la poursuite de ses objectifs Washington entend toujours utiliser cet « avantage » pour son propre bénéfice, en particulier pour compenser ses déficiences financières et maintenir sa position de leadership, sinon d’hégémonie, au sein du camp du Nord. Il n’en reste pas moins que les alliés subalternes de la triade sont bel et bien alignés sur le plan de Washington de contrôle militaire de la Planète. Ni l’atlantisme des Européens, ni la soumission de Tokyo aux concepts de Washington concernant le Pacifique et l’Asie ne sont menacés de désintégration, pour le moment tout au moins. Bien entendu les « missions » - guerres préventives, lutte contre le « terrorisme » - engagées par les forces armées des États-Unis et leurs alliés subalternes de l’OTAN sont et seront toujours enveloppées dans des discours de « défense de la démocratie », voire de son exportation, de « défense des droits à l’autodétermination des peuples » (tout au moins de certains, et pas d’autres). Mais ces emballages ne trompent que ceux qui veulent bien l’être. Pour les peuples du Sud ils rappellent simplement la permanence de la tradition coloniale ancienne de la « mission civilisatrice ». L’objectif réel exclusif du programme militaire du Nord est le contrôle des ressources de la Planète. L’aveu en a été fait lorsque Washington a décidé récemment de compléter son système de « Regional (military) Command » et de bases par la création d’un « Africa Command ». Les États-Unis, et derrière eux l’Europe, visent ici le contrôle du pétrole (Golfe de Guinée, Soudan), de l’uranium (Niger, Soudan), des métaux rares (Congo, Afrique Australe), et rien d’autre.
Le conflit Nord/Sud est devenu l’axe central des contradictions majeures de la mondialisation capitaliste/impérialiste contemporaine. Et dans ce sens ce conflit est indissociable de celui qui oppose la poursuite de la domination du capitalisme oligopolistique aux ambitions progressistes et socialistes qui pourraient faire avancer des alternatives positives ici ou là, au Sud et au Nord. Penser l’alternative, en particulier dans l’immédiat en réponse à la crise, exige que soient pris en compte le droit et la volonté des pays du Sud à accéder aux ressources de la Planète. Il n’y aura pas un « autre monde possible meilleur » si les intérêts des peuples qui constituent 80 % de l’humanité sont l’objet d’un mépris à peu près total dans l’opinion dominante des pays opulents.
L’humanitaire n’est pas un substitut acceptable à la solidarité internationale dans les luttes.
Les pays du centre du système capitaliste mondial ont toujours bénéficié de ce que j’ai qualifié de « rente impérialiste », et l’accumulation du capital dans ces centres a toujours comporté un volet important ayant la nature d’une « accumulation par dépossession » des peuples des périphéries. La prétention aujourd’hui à réserver l’accès aux ressources majeures de la Planète aux seuls nantis en constitue la forme nouvelle contemporaine.
5. Les conditions d’une réponse positive au défi
Il ne suffit pas de dire que les interventions des États peuvent modifier les règles du jeu, atténuer les dérives. Encore faut il en définir les logiques et la portée sociales. Certes on pourrait imaginer le retour à des formules d’association des secteurs publics et privés, d’économie mixte comme pendant les trente glorieuses en Europe et de l’ère de Bandoung en Asie et en Afrique lorsque le capitalisme d’Etat était largement dominant, accompagné de politiques sociales fortes. Mais ce type d’interventions de l’Etat n’est pas à l’ordre du jour. Et les forces sociales progressistes sont elles en mesure d’imposer une transformation de cette ampleur ? Pas encore à mon humble avis.
L’alternative véritable passe par le renversement du pouvoir exclusif des oligopoles, lequel est inconcevable sans finalement leur nationalisation pour une gestion s’inscrivant dans leur socialisation démocratique progressive. Fin du capitalisme ? Je ne le pense pas. Je crois en revanche que de nouvelles configurations des rapports de force sociaux imposant au capital à s’ajuster, lui, aux revendications des classes populaires et des peuples, est possible. A condition que les luttes sociales, encore fragmentées et sur la défensive dans l’ensemble, parviennent à se cristalliser dans une alternative politique cohérente. Dans cette perspective l’amorce de la longue transition du capitalisme au socialisme devient possible. Les avancées dans cette direction seront évidemment toujours inégales d’un pays à l’autre et d’une phase de leur déploiement à l’autre.
Les dimensions de l’alternative souhaitable et possible sont multiples et concernent tous les aspects de la vie économique, sociale, politique.
Dans les pays du Nord le défi implique que l’opinion générale ne se laisse pas enfermer dans un consensus de défense de leurs privilèges vis-à-vis des peuples du Sud. L’internationalisme nécessaire passe par l’anti impérialisme, non l’humanitaire.
Dans les pays du Sud la crise offre l’occasion du renouveau d’un développement national, populaire et démocratique autocentré, soumettant les rapports avec le Nord à ses exigences, autrement dit la déconnexion. Cela implique :
(i) la maîtrise nationale des marchés monétaires et financiers (ii) la maîtrise des technologies modernes désormais possible (iii) la récupération de l’usage des ressources naturelles (iv) la mise en déroute de la gestion mondialisée dominée par les oligopoles (l’OMC) et du contrôle militaire de la planète par les États-Unis et leurs associés (v) se libérer des illusions d’un capitalisme national autonome dans le système et des mythes passéistes.
La question agraire est plus que jamais au cœur des options à venir dans les pays du tiers monde. Un développement digne de ce nom ne peut être fondé sur une croissance – même forte – au bénéfice exclusif d’une minorité – fût-elle de 20 % - , abandonnant les majorités populaires à la stagnation voire à la paupérisation. Or ce modèle de développement associé à l’exclusion est le seul que le capitalisme connaisse pour les périphéries de son système mondial.
La pratique de la démocratie politique, quand elle existe (et c’est évidemment l’exception dans ces conditions), associée à la régression sociale, demeure fragile à l’extrême. En contrepoint l’alternative nationale et populaire qui associe la démocratisation de la société et le progrès social, c’est-à-dire s’inscrit dans une perspective de développement intégrant – et non excluant – les classes populaires, implique une stratégie politique de développement rural fondée sur la garantie de l’accès au sol à tous les paysans. De surcroît les formules préconisées par les pouvoirs dominants – accélérer la privatisation du sol agraire traité en marchandise – entraînent l’exode massif que l’on connaît. Le développement industriel moderne ne pouvant pas absorber cette main d’œuvre surabondante, celle-ci s’entasse dans les bidonvilles. Il y a une relation directe entre la suppression de la garantie de l’accès au sol des paysans et l’accentuation des pressions migratoires.
L’intégration régionale, en favorisant le surgissement de nouveaux pôles de développement, peut elle constituer une forme de résistance et d’alternative ?
La réponse à cette question n’est pas simple. Les oligopoles dominants ne sont pas hostiles à des intégrations régionales qui s’inscrivent dans la logique de la mondialisation capitaliste/impérialiste. L’Union européenne, les marchés communs régionaux d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique sont des exemples de formes de régionalisation qui deviennent des obstacles à l’émergence d’alternatives progressistes et socialistes. Une autre forme de régionalisation peut–elle être conçue, capable de soutenir l’option du développement national et populaire et d’ouvrir la porte sur la longue transition séculaire au socialisme aux peuples et nations de la Planète ? Si cette question ne se pose pas pour les géants comme la Chine ou l’Inde, elle ne peut être évacuée des débats concernant l’Amérique latine, le monde arabe, l’Afrique, l’Asie du Sud Est, et même l’Europe. Pour cette dernière ne faut-il pas envisager que la déconstruction des institutions de l’UE, conçues dès l’origine pour enfermer les peuples de ce continent dans le capitalisme dit libéral (c’est-à-dire réactionnaire) et l’alignement atlantiste, est le préalable à sa reconstruction éventuelle (si on la considère comme utile) dans une perspective socialiste ? Pour l’ensemble des pays du Sud un nouveau « Bandoung » politique, renforçant la capacité des pays des trois continents à contraindre l’impérialisme collectif de la triade à reculer est-il possible ? Quelles en sont les conditions ?
Des avancées dans ces directions au Nord et au Sud, bases de l’internationalisme des travailleurs et des peuples, constituent les seuls gages de la reconstruction d’un monde meilleur, multipolaire et démocratique, seule alternative à la barbarie du capitalisme vieillissant. Si le capitalisme est parvenu au point que pour lui la moitié de l’humanité soit devenue une population « superflue », ne doit on pas considérer que c’est le capitalisme qui , lui, est désormais un mode d’organisation sociale superflu ?
Il n’y a pas d’alternative autre que s’inscrivant dans la perspective socialiste.
Au-delà des accords nécessaires sur les stratégies d’étapes, fondées sur la construction de la convergence des luttes dans le respect de la diversité, et des avancées que ceux-ci doivent permettre sur la longue route au socialisme mondial, la réflexion et le débat sur l’objectif socialiste/communiste restent incontournables : imaginer l’émancipation des aliénations marchandes et autres, imaginer la démocratisation de la vie sociale dans toutes ses dimensions, imaginer des modes de gestion de la production, du local au mondial, répondant aux exigences de la démocratie sociale authentique.
Bien évidemment si le système mondial capitaliste/impérialiste réellement existant est fondé sur l’exclusion grandissante des peuples qui constituent la majorité de l’humanité, si le modèle d’usage des ressources naturelles produit par la logique de la rentabilité capitaliste est à la fois gaspilleur et dangereux, l’alternative socialiste/communiste ne peut pas ignorer les défis que ces réalités représentent. Un « autre style de consommation et de vie » que celui qui fait le bonheur apparent des peuples des pays opulents et celui de l’imaginaire de ses victimes s’impose. L’expression d’un « solar socialism » (qu’on peut traduire par socialisme plus énergie solaire), proposée par Elmar Altvater, doit être prise au sérieux. Le socialisme ne peut pas être le capitalisme, corrigé par l’égalité dans l’accès à ses bénéfices, aux échelles nationales et mondiale. Il sera qualitativement supérieur, on ne sera pas.
Source :http://alternatives-international.net/article2877.html