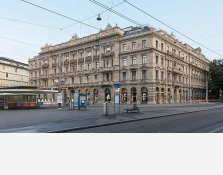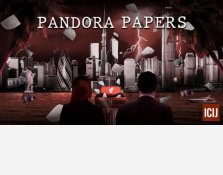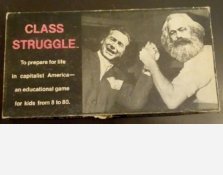Traduction du castillan : Gys Landry.
| Pour les grands spéculateurs financiers : il y a récession à l’horizon. Sur la photo, le spéculateur George Soros. |
Lorsqu’en février dernier, l’ex président de la Réserve fédérale Alan Greenspam a annoncé la possibilité que les États–Unis entrent en récession avant la fin de 2007 (son observation coïncidait avec la chute boursière entraînée par la bourse de Shangaï), les experts et les autorités monétaires des grands pays industrialisés ont fait tomber un afflux de démentis et réprobations. Mais comme la réalité ne peut être exorcisée avec des manipulations médiatiques, l’accumulation de déficits, la dégradation du dollar et surtout le dégonflement de la bulle immobilière rendaient une telle perspective inévitable.
La bulle immobilière, les immenses dépenses militaires et les réductions fiscales, pièces centrales de la stratégie économique de l’administration Bush, ont réussi à sortir l’économie états–unienne de la stagnation en gonflant la consommation, consommation non appuyée par le développement productif local (la décadence du système industriel nord américain dure depuis plusieurs années).
À la dette interne et externe ce sont ajoutés les crédits faciles, spécialement ceux destinés aux maisons qui augmentèrent démesurément, le déficit énergétique a grimpé … à la fin 2006 la dette totale états–unienne (publique, des entreprises et personnelle) atteignait 48 000 milliards de dollars : plus de trois fois le produit intérieur brute des États–Unis et supérieur au PIB mondial. Les dettes avec l’étranger atteignaient 10 milles milliards de dollars… l’élastique ne pouvait être étirée indéfiniment.
Tout a mal tourné
La stratégie du gouvernement Bush peut être synthétisée comme la combinaison de deux opérations qui, s’appuyant l’une sur l’autre, devaient relancer et consolider le pouvoir impérial des États–Unis : l’expansion rapide de la bulle consommatrice et financière pour produire un fort démarrage économique associé à une offensive militaire en Eurasie qui procurerait l’hégémonie énergétique globale et de là, la primauté financière sur les autres puissances (Chine, Union Européenne, Russie). À partir de 2001, les États–Unis misaient sur une victoire écrasante de leurs forces armées qui leur aurait permis de contrôler militairement la bande de territoire partant des Balkans dans la Méditerranée orientale jusqu’au Pakistan, passant par la Turquie, la Syrie, l’Irak, l’Iran, les anciennes républiques soviétiques de l’Asie centrale, le bassin de la mer Caspienne, l’Afghanistan, semant ici et là des bases militaires pour surveiller un éventail complexe de protectorats.
Les préparatifs de l’offensive s’étaient fait durant les années 1990 sous les gouvernements républicains et démocrates : la première Guerre du Golf, les interminables bombardements sur l’Irak durant toute la décennie, la guerre du Kosovo. Il s’agissait d’une « politique d’état » qui incluait les deux partis gouvernants et l’ensemble du régime. Ils savaient que la bulle économique lancée parallèlement à l’offensive militaire ne pouvait être soutenue longtemps, les désajustements financiers s’accumuleraient et la bulle des crédits appuyant la spéculation immobilière terminerait par désenfler : 2005–2006 apparaissait comme une barrière temporelle infranchissable. Mais à cette époque, les faucons misaient sur une victoire militaire de l’Empire qui permettrait de redéfinir les règles du jeu économique de la planète, les cow-boys du Pentagone arriveraient juste à temps pour porter secours aux magiciens de la finance. Mais tout a mal tourné : les cow–boys se sont enlisés en Irak, l’offensive fulminantes sur l’Eurasie a échoué dans la première bataille importante, et ce, pendant que le ballon spéculatif entrait en crise sans qu’aucun glaive puisse le sauver.
Signal d’alarme, ralentissement et incertitudes
Depuis 2005, des experts de tendances idéologiques très diverses ont commencée à parler du prochain dégonflement du ballon immobilier. En août de cette année, The Economist signalait les conséquences mondiales d’une inévitable contraction du ballon spéculatif [1]. Mais aux États–Unis, où la brèche entre les prêts immobiliers et le revenu personnel croît sans cesse, l’orgie financière a continué malgré les alertes, battant la mesure des autres puissances économiques ; la contagion atteignit des régions très étendue de la périphérie.
Finalement, en 2006, les prix des maisons ont commencé à descendre, la bulle états–unienne s’est contractée inexorablement. À partir de ce moment son impact négatif sur la demande puis sur l’ensemble du PIB était seulement une question de temps.
Jusqu’à fin 2006 apparurent les premiers symptômes d’un ralentissement économique qui devinrent dramatiques au premier trimestre 2007. En février s’est produite une secousse boursière internationale affectant d’abord la Chine, pays extrêmement dépendant de la capacité d’achat du marché nord américain. Actuellement, ayant traversé la moitié de l’année 2007 et indépendamment des fluctuations et éphémères récupérations, la question centrale est de savoir comment et à quel rythme se propagera le refroidissement de l’ensemble de l’économie mondiale. Par exemple, comment influenceront les prix des matières premières, spécialement ceux du pétrole, poussés vers le haut par le processus de réduction des réserves (l’approche du sommet productif global) et poussés vers le bas par le ralentissement des grands systèmes industriels. Affrontera-t-on bientôt une récession avec chute générale des prix ou bien une combinaison de récession et d’inflation telle que la stagflation des années 1970 ? Assistera-t-on à de grandes contractions des marchés financiers ou à leur combinaison avec de nouvelles poches spéculatives (par exemple, une euphorie sur les marchés de métaux précieux) ? Enfin, quelles seront les conséquences politiques, militaires et idéologiques de ces grandes perturbations du capitalisme mondial ? On peut au moins être sûr de quelque chose : cette crise ne ressemble à aucune de celles antérieurs, ce niveau d’hypertrophie financière n’avait jamais été atteint, le degré d’interdépendance entre toutes les économies est inédit. De plus, il y a une combinaison dangereuse des aspects caractéristiques d’une crise de surproduction avec d’autres propres d’une situation de sous–production de produits décisifs pour la survie du système. Ce dernier s’exprime actuellement seulement sur le plan énergétique mais il impulse lui–même d’autres pénuries, par exemple celle des aliments en raison de l’utilisation des terres cultivables dans la production de bio–combustibles.
Au delà des conspirations
Il serait naïf d’attribuer la crise à l’application d’une stratégie erronée de la part de la Maison Blanche. Il faut insérer la dite stratégie dans le contexte plus ample de la décadence de la société hégémonique états–unienne, elle–même une partie (décisive) du processus de crise globale. Si on regarde à moyen terme, depuis le commencement des années 1990 (fin de la Guerre froide), on observe comment l’économie états–unienne s’est convertie en un système basé sur la spéculation financière et le déficit commercial auquel se sont ajoutés le déficit fiscal et les dettes de tout type dans un processus général de concentration des revenus. En somme, une dynamique élitiste et parasitaire dont la première étape fut de se donner une apparence de productivité en rapport aux industries dites de « haute technologie ». Son moteur fut l’euphorie boursière et les célèbres « actions technologiques » représentées dans l’indice Nasdaq qui grimpait de manière vertigineuse. Les experts en communication de l’époque signalaient qu’on avait mis en marche une spirale sans fin qui poussait l’économie états–unienne vers une prospérité infinie. Selon eux, l’expansion de la consommation amenait de nouveaux développements technologiques qui impulsaient la productivité et par conséquent, les revenus, puis de nouveau la consommation, etc. En réalité, ce qui arrivait était une euphorie boursière qui fournissait des revenus financiers présents et futurs aux entreprises et individus qui dépensaient de plus en plus.
La fête a terminé au début de la décennie actuelle et l’économie a ralenti. La nouvelle administration républicaine n’a pas trouvé d’autres portes de sortie que celle de créer une nouvelle bulle beaucoup plus grande que l’antérieur, cette fois basée sur une avalanche de crédits immobiliers.
Avec le délire financier, d’autres phénomènes se développèrent, tels que la criminalisation étatique des classes sociales basses, spécialement celles provenant de certaines minorités (latino–américaines et afro-américaines pauvres), ou encore, la dégradation du système politique (corruption, soumission aux blocs ascendants). Il s’est spécialement formé une convergence d’intérêts qui transforma le « complexe militaro–industriel » en un vaste réseau de groupes financiers, pétroliers, industriels, politiques, militaires et paramilitaires mafieux. Au commencement de la présente décennie s’est produit un saut qualitatif représenté par l’arrivée de George W. Bush et ses faucons.
À plus long terme, depuis la fin de l’étalon–or (1971) et la crise planétaire qui a suivie, on observe une crise de surproduction globale qui fut retardée, colmatée, sur la base de l’expansion des affaires financières et de la surconsommation nord américaine inscrite dans un courrant mondial de concentration des revenus.
L’aventure militaro financière ne fut pas un glissement ou une déviation néofasciste du système de pouvoir états–unien, mais plutôt un déploiement stratégique logique (fortement imprégné de composantes fascistes) du noyau central de pouvoir des États–Unis qui, de cette manière, prolongeait et accentuait les tendances économiques, idéologiques et politiques dominantes. Ces tendances s’accentuèrent jusqu’à devenir hégémoniques à partir de la présidence de Reagan, en passant par Carter, Bush père, Clinton, jusqu’à arriver aux auto–attentats du 11 septembre 2001 et à l’invasion de l’Irak.
La fin des illusions
La prospérité fictive de l’Empire a forgé, surtout dans les années 1990, l’illusion d’un pouvoir mondial avilissant devant lequel il était seulement possible de s’adapter. Puis a surgi une droite globale triomphaliste qui a enrobé l’orgie financière d’un discours « néolibéral », mais aussi un progressisme courtisant qui, sur la base de la soumission au capitalisme, prétendait l’orner de traits humanistes. Tant pour les uns que pour les autres, la victoire de l’univers bourgeois était définitive ou, à tout le moins, de très longue durée. Mais lorsqu’ont commencé à apparaître, au commencement de la présente décennie, les premières fissures du système, ils optèrent en général pour nier frénétiquement la réalité : le déclin du dollar et le super endettement états–unien étaient présentés comme des expressions d’une recomposition positive du capitalisme global, le désordre financier et la spéculation seraient trascandés par une prochaine reconversion productiviste de l’économie de marché. Enfin, chaque démonstration d’échec était transformée en démonstration de rajeunissement, et il est possible que cela continue encore un certain temps. Le déclin des États–Unis et de d’autres puissances entraînées par le géant pourrait donner lieu à des illusions passagères sur l’ascension de capitalismes nationaux ou régionaux autonomes en périphérie ou à des reconversions miraculeuses de certaines économies centrales. L’astuce qui consiste à remplacer la réalité par des désirs illusoires semble donner de bons résultats à court terme, le problème est que les grandes tendances de l’histoire finissent par s’imposer.