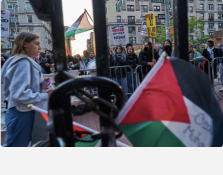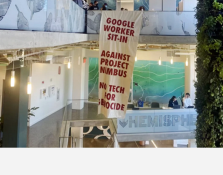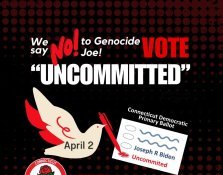Tiré de regards.fr.
En matière de discours, Obama sait y faire. Le 44e président des États-Unis l’a de nouveau prouvé mercredi lors de son allocution d’adieux à Chicago. Tout y était : l’optimisme serein pour l’avenir de la nation, l’intelligence et la rationalité réconfortantes adoucies par quelques larmes bien dosées, la touche personnelle pour Michelle mais tout en pudeur…Tout au long de ses deux mandats, le premier président noir du pays aura incarné avec cette même élégance la révolution symbolique d’une Amérique qui a voulu se croire postraciale… jusqu’à ce que le mouvement Black Lives Matter s’élève contre la persistance des violences policières racistes et vienne signaler que rien n’était réglé.
On aimait Obama comme on aime une vedette de Hollywood. Et comme toute star de cinéma, il laisse derrière lui des scènes cultes, dont les compilations font des millions de vues sur YouTube. Obama chantant Amazing Grace en hommage aux victimes de la tuerie raciste de Charleston, Obama écrasant une mouche en pleine interview, Obama jouant au basket avec l’ancien de la NBA Clark Kellog…
Ces images ont un tel pouvoir de séduction que l’on rechigne à gâcher la fête en jetant un œil derrière le décor, d’autant que la perspective cauchemardesque de la présidence de Donald Trump semble rendre dérisoires les reproches à l’encontre de son prédécesseur. Et pourtant, il faut bien dresser le bilan critique de ces huit années, précisément parce que ses échecs ont préparé le terrain à la victoire de Trump.
Aggravation des inégalités et occasions ratées
À commencer par son incapacité à améliorer les conditions de vie matérielle de la grande majorité des Américains, qui ont dès lors prêté une oreille attentive aux propositions s’affichant comme "anti-système" du candidat républicain. Si le chômage a officiellement été divisé par deux pour passer sous la barre des 5%, beaucoup d’Américains sont en fait sortis du marché du travail, de sorte que le taux réel est encore de 12%. Les inégalités ont suivi leur chemin à la hausse : depuis 2008, les 1% les plus riches ont capté près de deux tiers de la croissance du PIB, tandis que 5,5 millions d’Américains supplémentaires vivent dans la pauvreté et que le revenu médian par famille a décliné de 4,6%. Quant aux 10 millions d’emplois créés entre 2005 et 2015, 94% d’entre eux étaient précaires.
Obama n’est certes pas responsable de la crise financière aiguë dont il a hérité en 2008, ni de ses effets durables sur l’économie réelle. Il n’empêche que cette crise – et ce moment de fragilité extrême des financiers – présentaient une rare opportunité de renverser le rapport de forces et d’imposer, en contrepartie du sauvetage des banques, de vraies mesures de régulation.
Mais il suffisait de voir les noms des conseillers économiques dont il s’est entouré à l’époque pour savoir d’emblée qu’il n’en ferait rien : Lawrence Summers et Timothy Geithner étaient ceux-là mêmes qui, sous la présidence Clinton, avaient promu et conçu les politiques de libéralisation et de déréglementation responsables du désastre des subprimes. Sans surprise, la timide loi Dodd-Franck de 2010, revue et corrigée par les lobbies, ne fera rien contre les instruments de spéculation, le risque systémique des banques "too big to fail", et le pouvoir déstabilisant qu’exercent les marchés de capitaux sur les États et les entreprises.
Obama, « dernier souffle du néolibéralisme »
S’il est vrai qu’à partir de 2010, la majorité républicaine du Congrès s’est employée à bloquer systématiquement la moindre initiative gouvernementale, rien ne l’aurait empêché de mettre ses deux premières années à profit pour promouvoir des réformes radicales susceptibles de redistribuer les richesses, réduire les violences policières, rompre avec l’incarcération de masse…Or il n’en n’a jamais eu le projet. Profondément centriste et libéral, Obama, qui n’a jamais appartenu à l’aile gauche du parti, n’avait aucune intention de dévier de la ligne tracée par ses prédécesseurs.
Comme le dit le philosophe et militant afro-américain Cornel West, « Obama représente le dernier souffle du néolibéralisme qui a émergé sous Carter en réponse à la crise structurelle à laquelle était confrontée l’économie mondiale au milieu des années 1970 », et qui a tenté de « résoudre tous les problèmes profonds par la financiarisation, la privatisation et la militarisation ». Fervent partisan du libre-échange, il s’est battu bec et ongle pour faire passer le Partenariat TransPacifique, préfiguration sinistre du TAFTA qui menace l’Europe (http://www.regards.fr/web/article/le-tafta-sacrifie-pour-sauver-les-traites-de-libre-echange).
Même sa réforme phare, l’ObamaCare, qui a fourni une couverture santé à 25 millions d’Américains, reste strictement dans les clous d’une solution de marché. L’hypothèse d’une véritable sécurité sociale publique à la française, évoquée en campagne, a été vite remplacée par une mesure obligeant tous les Américains à acheter une assurance privée, si besoin avec l’aide du gouvernement. Soit l’extension du dispositif promu par le candidat républicain Richard Nixon, élaboré par le très conservateur Heritage Foundation et mis en place par l’ultralibéral Mitt Romney dans son État du Massachusetts. Sa politique en matière d’éducation suit la même logique libérale, puisqu’elle aura consisté à remplacer des centaines d’écoles publiques par des écoles à gestion privée subventionnées par l’État.
Les bombes du Nobel de la paix
Sur le plan international, enfin, on ne peut que se réjouir de l’accord nucléaire iranien et de l’ouverture des relations diplomatiques avec Cuba. Mais le lauréat du prix Nobel de la paix n’a pas rempli sa promesse de rompre avec le militarisme et l’interventionnisme de George Bush pour renouer avec une approche plus respectueuse du droit international. S’il a effectivement réduit le nombre de soldats américains se battant sur le sol irakien et afghan, ce qui a permis de sauver des vies militaires nationales, il a largement accru les bombardements, notamment par drones (dix fois plus que sous Bush), ainsi que le déploiement de forces d’opérations spéciales, présentes dans 138 pays en 2016, soit 130% plus que sous Bush.
Celui qui déclarait en 2009 au Caire vouloir « reprendre à zéro » les relations « entre les États-Unis et les musulmans du monde entier » aura approuvé des opérations militaires dans sept pays majoritairement musulmans : l’Irak, l’Afghanistan, le Pakistan, la Somalie, le Yémen, la Libye et la Syrie ont reçu 26.171 bombes américaines pour la seule année de 2016, soit trois bombes par heure.
Il faudrait encore mentionner la criminalisation des lanceurs d’alerte comme Edward Snowden et Chelsea Manning, l’expulsion record de 2,5 millions d’immigrés, l’incapacité à fermer Guantanamo, le soutien au gaz de schiste, la répression policière du mouvement Occupy… Si la conclusion de son discours de mercredi – « Oui, on peut y arriver. Oui, on y est arrivé » (« Yes we can. And yes we did. ») – paraît ainsi quelque peu présomptueuse, il faut lui accorder une chose : l’après-Obama risque d’être pire.