Si beaucoup auront en tête, à titre d’exemple paradigmatique, les discours et prises de position de Donald Trump, incarnation même du populisme de droite de ce début de 21ième siècle, il faut dire qu’en Amérique latine sévit ceux de son frère jumeau, Jair Bolsonaro, président actuel du Brésil dont les frasques, en particulier en cette époque du coronavirus, n’ont rien à envier à son collègue étatsunien et sont devenues le symbole par excellence de ce nouveau populisme de droite qui semble chaque fois plus en vogue.
Le fait est d’autant plus notoire que pour beaucoup de sociologues ou politicologues latino-américanistes, l’Amérique latine a été le berceau du populisme ou tout au moins une contrée où depuis longtemps on note sa présence, fut-il loin d’être toujours estampillé de prime abord à droite ! Pensez à Getúlio Vargas au Brésil (1930-45, puis 1951-56), ou encore à Lázaro Cárdenas au Mexique (1934-1940) et surtout Juan Domingo Perón en Argentine (1946-55), tous trois ont été à leur époque sinon considérés comme des présidents populistes, du moins ayant donné indéniablement naissance à de notables politiques populistes. Et tous trois, loin d’avoir été considérés à l’extrême droite du panorama politique, ont le plus souvent mis en œuvre des politiques nationales et populaires qui à plus d’un titre partageaient certaines valeurs propres à la gauche. Et que dire plus récemment de chefs d’État comme Hugo Chávez (1998-2012) du Venezuela, Rafael Correa (2007-2017) de l’Équateur ou Évo Morales (2005-2019) de la Bolivie, n’ont-ils pas chacun à leur manière été traités, à un moment ou à un autre, de « populistes », avec d’ailleurs toujours une nuance de mépris passablement symptomatique des peurs que cette appellation continue de soulever ?
Il y a donc de quoi y perdre son latin, tant le terme de populisme semble être à « géométrie variable », renvoyer à des réalités différenciées, en somme revêtir une polysémie de sens, brouillant ou pour le moins complétant la distinction droite/gauche qui a toujours paru depuis le 18ième siècle au centre de notre représentation occidentale du politique à la manière d’une indéfectible boussole.
Aussi peut-être vaut-il mieux d’emblée parler de « populismes » au pluriel, puisque, comme on vient de l’évoquer, il y aurait des populismes de droite mais aussi de gauche tout comme des populismes d’hier et d’aujourd’hui, et puisqu’il n’est pas sûr qu’on puisse retrouver a priori –d’un point de vue rigoureux et conceptuel— des caractéristiques qui les réuniraient tous et expliqueraient avec exactitude leur devenir contemporain.
Sans aller cependant aussi loin qu’Alain Rouquié [1], qui considère que ce terme est conceptuellement inadéquat, nous chercherons à montrer comment ce retour à notre époque de la problématique populiste –ou plutôt de certains types de populisme— est révélatrice de tensions politiques nouvelles, de phénomènes sociopolitiques qui, par leur côté passablement inquiétants— méritent qu’on s’y arrête de près [2].
1) Les spécificités du contexte latino-américain
Mais peut-être faut-il commencer par le commencement. Il faut en effet rappeler que, suite à la conquête européenne dont elle est douloureusement née à travers sa dislocation en de multiples pays, l’Amérique latine reste un sous-continent de « veines ouvertes » où suite à la violence des exactions guerrières et économiques européennes, les rapports sociaux qui se sont originairement constitués, l’ont été sur un mode extrêmement hiérarchisé et inégalitaire. Et où le développement économique qui y a pris forme n’a cessé de se caractériser par son caractère dépendant –ou périphérique— vis-à-vis des grands centre de l’économie monde, faisant en sorte que l’Amérique latine n’a pu croître pendant longtemps que dans l’ombre paralysante et atrophiante du développement capitaliste et colonial européen puis états-unien, et qu’aujourd’hui elle en porte encore 500 ans plus tard bien des stigmates.
En termes politiques, cela signifie qu’on n’y retrouve pas exactement les mêmes formes d’expression institutionnelle, ou plutôt que les volontés de démocratisation sociales et politiques qui ont pu caractériser bien des sociétés de l’époque se sont combinées à des désirs d’indépendance acharnés vis-à-vis des puissances impérialistes qui prétendaient, depuis l’étranger, régir leur développement. D’où dès le milieu du 19ième siècle, la difficulté de séparer luttes pour l’égalité sociale et luttes pour l’indépendance, tant les oligarchies locales étaient dépendantes pour leur survie de leurs liens avec les grands centres de pouvoir du nord et défendaient leurs privilèges de classes en conséquence.
C’est notamment ce qui explique qu’en Amérique latine, comme le rappelle Michaël Lowy [3] « le courant social-démocrate ne s’est guère enraciné et que la revendication nationale, dans sa dimension anti-impérialiste, a constitué un axe essentiel des luttes populaires ». Il suffit à ce propos de penser à la libération nationale de Cuba, armes à la main, à la fin du 19 ième siècle par José Martí, ou encore à la révolution mexicaine de 1910 sous l’égide guérilleriste de Emiliano Zapata et de Pancho Villa... et au combat de guérilla de Augusto Sandino au Nicaragua à la fin des années 20 et début des années 1930. Sans parler de tous leurs rejetons au 20ième siècle : révolution sandiniste au Nicaragua des années 1979, guerre de libération au Salvador des années 1980 menée par le Front Farabundo Martí de Libération Nationale, insurrection zapatiste armée au sud du Mexique en 1994, etc.
2) L’importance du courant « national et populaire »
Aussi est-ce tout à fait compréhensible qu’aux côtés de luttes politiques animées par les courants révolutionnaires, socialistes, marxistes ou anarchistes, souvent fortement réprimées, se soit développé un courant politique « national et populaire » plus réformiste –qu’on a aussi caractérisé de populiste— qui dans bien des pays est devenu une figure imposée, voire hégémonique, de la politique latino-américaine, en particulier à partir des années 30. De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un courant politique qui va associer l’affirmation de l’indépendance nationale vis-à-vis de pays impérialistes (et tout spécialement des USA), avec l’amélioration des conditions de vie des classes subalternes et populaires, mais dans le cadre d’une alliance avec certains secteurs des classes dominantes locales, donc sans ruptures radicales et sans que ne soient touchés leurs intérêts de fond [4]. Avec pour en assurer la cohésion et en diriger politiquement la marche, la présence d’un personnage politique charismatique, une sorte de « caudillo », héritier lointain de ces chefs de guerre latino-américains –officiers supérieurs ou grands propriétaires créoles— si actifs et déterminants lors des luttes pour l’indépendance.
Il s’agit donc d’un mouvement polyclassiste, réunissant sous son aile plusieurs classes aux intérêts antagoniques, mais autour d’une personnalité politique forte incarnant la figure d’une nation en butte à l’impérialisme et en mal d’affirmation nationale, à la recherche en quelque sorte d’une seconde indépendance.
Il n’est donc pas un hasard que ce phénomène se soit historiquement amplifié à partir des années 30 (connaissant même une période faste après la seconde guerre mondiale), moment où certains pays de l’Amérique latine vont en partie parvenir –en profitant des difficultés des deux grandes guerres mondiales et de la crise de 1929— à réduire leurs liens de dépendance économique avec les pays industriellement avancés du nord, en développant de solides politiques d’industrialisation par substitution des importations.
Juan Domingo Perón en Argentine est peut-être l’incarnation par excellence de cette figure politique populiste latino-américaine, lui qui a réussi en moins de 10 années –à l’encontre de l’impérialisme britannique déclinant mais encore très présent— à jeter les bases d’un État argentin plus souverain, à la fois interventionniste et providence, renforçant – y compris par le biais de nationalisations— les capacités industrielles et agraires de son pays tout en mettant en place une série de mesures visant autant à protéger les travailleurs par le biais d’une syndicalisation massive et encadrée, qu’à développer des politiques sociales de santé et d’éducation tout comme à accorder le droit de vote aux femmes (en 1947).
Partisan d’une « troisième position » entre la voie capitaliste et communiste, il n’en a pas moins toujours gardé une position de surplomb, une position « bonapartiste » diront certains [5], vis-à-vis des forces sociales qui le soutenaient, et dans les dernières années a promu à l’encontre des oppositions, notamment communistes, des politiques de plus en plus répressives et autoritaires, protégeant même d’anciens dignitaires nazis, venus se réfugier en Argentine à la fin de la seconde guerre mondiale..
C’est ce qui explique que l’on retrouve bien des travers qui peuvent faire problème dans cette forme de populisme, d’autant plus si on les juge à travers les exigences d’authentiques politiques d’émancipation : le maintien des liens de dépendance jamais véritablement rompus avec l’impérialisme (et notamment l’impérialisme étasunien montant), la subordination à moyen terme des intérêts populaires à ceux des oligarchies locales et le courcircuitage des mécanismes de représentation populaire et démocratique à travers le clientélisme, voire le culte de la personnalité et l’embrigadement partidaire obligé, devenu chaque fois plus autoritaire, en particulier lors des dernières années de sa présidence.
3) Les thèses de Laclau et Mouffe
Il reste que ce modèle si présent en Amérique latine, a su inspirer des théoriciens post-marxistes comme Ernesto Laclau (politicologue et philosophe argentin (1935-2014) [6]) et Chantal Mouffe (philosophe politique belge (1943)) qui l’ont quelque part remis à l’ordre du jour, « revampé » pourrait-on dire, particulièrement pour ce début du 21ième siècle, servant même de nouvelle boussole politique à des expériences contemporaines porteuses, comme celle de Podemos en Espagne ou de la France Insoumise en France, voire même de Québec solidaire ici au Québec [7]. Ayant noté avec raison que le populisme est le plus souvent appréhendé de manière péjorative, parce que dans les faits il représente un danger pour les tenants du statu-quo de la démocratie représentative libérale ainsi que pour les oligarchies conservatrices, ils vont –chacun à leur manière— montrer qu’il peut représenter pour les classes moyennes et populaires une forme politique particulièrement prometteuse en termes de capacité de changement collectif.
En effet, le populisme –avec son leader rassembleur, ses mots d’ordre « équivalenciels » (i-e unifiants) et ses symboles communs— peut être vu, selon eux, comme un mécanisme d’interpellation démocratique et populaire particulièrement efficace dans une situation de crise puisqu’il permet d’unir à l’encontre d’un adversaire bien ciblé (les « élites » économiques, politiques et médiatiques) des forces sociales au point de départ disparates et fragmentées en une entité –le peuple— devenant ainsi au sein du cadre national une force de changement véritable, la condition même de toute rupture avec l’ordre dominant.
Il n’en reste pas moins que si ce concept de populisme redéfini par Laclau et Mouffe, permet à une époque de grande fragmentation sociale comme la nôtre, d’expliquer l’irruption possible de larges mobilisations sociales et politiques unitaires, il ne permet pas de comprendre comment ce processus d’hégémonie populaire en marche peut s’approfondir et déboucher sur une transformation en profondeur de la société et une remise en cause de son économie capitaliste et néolibérale. Il ne permet pas non plus de comprendre comment cette contre-hégémonie de façade qui s’est créée généralement à l’occasion d’une victoire électorale pourrait se muer en une contre-hégémonie durable des classes subalternes, de toutes les classes subalternes et populaires. Il ne permet pas enfin de penser le dépassement des dynamiques et contradictions capitalistes, si présentes dans les logiques économiques néolibérales contemporaines, semant ainsi de grandes illusions sur ces capacités réelles de changement. Et encore moins, permet-il d’être à la hauteur d’une société gérée selon les principes d’une authentique démocratie populaire et participative. En somme il ne permet guère de comprendre en Amérique latine pourquoi les promesses révolutionnaires contenues dans les expériences comme celle de la révolution bolivarienne au Venezuela (1998-2012) et de la révolution citoyenne en Équateur (2007-2017)–pour ne prendre ici que ces deux exemples— se sont enferrées dans de véritables voies sans issues.
4) Les indéniables limites du populisme latino-américain de gauche du début du 21ième siècle
Car c’est bien à cette conclusion à laquelle on ne peut qu’arriver quand on s’arrête un instant à ces expériences de transformation sociale qui ont eu cours au début du 21ième siècle et qui restent –en dépit de leurs travers manifestes— si magnifiées par certains courants de la gauche. En effet si le vénézuélien Hugo Chávez et l’équatorien Rafael Correa ont été capables d’unir autour de leurs personnalités charismatiques des forces sociales au départ séparées et éparpillées, l’un dans le Mouvement pour la Cinquième République puis le Parti socialiste unifié (PSU) et l’autre dans la formation Alianza País. Si tous les deux ont pu utiliser les ressources de la rente pétrolière pour mettre en place des programmes sociaux et faire ainsi baisser pendant un temps les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté de manière significative, stimulant par ailleurs une relance de l’économie nationale à travers une intervention étatique énergique, ils n’ont pas pu, ni l’un ni l’autre, au terme de leurs présidences respectives, s’affranchir de politiques de type capitaliste ou même tout simplement réduire la part du secteur privé dans leurs économies respectives, renouant au passage, soit avec des politiques clairement extractivistes, soit avec une dépendance renforcée vis-à-vis des cours capricieux du pétrole. Enfin, tous deux se sont avérés au fil des ans de plus en plus rétifs à mettre en place des pratiques de démocratie participative et populaire dignes de ce nom. Tout au contraire, ils ont cherché par une série de subterfuges –et parfois à l’encontre du résultat de suffrages populaires— à se donner les moyens de se faire ré-élire à l’infini, tout en ne se gênant pas –particulièrement dans les dernières années de leur présidence— pour réprimer durement leurs opposants, y compris quand ils étaient des partisans de gauche. Et cela, sans même parler de leurs successeurs désignés respectifs (Nicolás Maduro au Venezuela et Lenín Moreno en Équateur) qui non seulement ont depuis leur départ des affaires, multiplié les mesures autoritaires ou manipulatoires, mais aussi ont renoué par la bande avec les pratiques mêmes du néolibéralisme extractiviste et prédateur (de la nature) avec lesquels leurs mentors avaient paru pourtant un temps vouloir rompre. Un retournement on ne peut plus dramatique et qui ne peut s’expliquer uniquement par une situation économique défavorable, ou encore par la force des oppositions de droite ou celle de l’impérialisme américain, mais aussi indéniablement par des choix et des orientations d’ordre politique lourdes de conséquence.
On le voit : le populisme de gauche, s’il prétend prendre effectivement pour acteur politique clef, le peuple, ne s’y réfère pas pour autant en privilégiant à tout coup les classes populaires et subalternes, et surtout tend, à travers le rôle décisif accordé au « leader », à trouver un substitut commode à leur propre auto-activité émancipatrice. Il ne s’agit donc pas, avec ce type de populisme, d’authentiques politiques d’émancipation populaire, mais d’un substitut à ces dernières ; un substitut qui prend la forme d’un raccourci qui n’en est pas un, puisqu’en interdisant à ces classes populaires tout contrôle effectif sur le pouvoir gouvernemental et ses orientations de fond, il s’arroge arbitrairement d’un pouvoir qui devrait leur appartenir en propre et qui finit par leur échapper chaque fois plus.
5) Le nouveau contexte contemporain et la montée d’un populisme de droite
Et peut-être n’est-ce pas un hasard qu’ait pu se développer, notamment dans le sillage des échecs des expériences populistes de gauche, un nouveau type de populisme prenant des allures de phénomène de masse, mais cette fois-ci clairement marqué à droite ? C’est que depuis les années 90 —le phénomène s’approfondissant au fil des années— nous sommes entrés dans une période où la droite semble désormais partout déterminer l’agenda politique général, et où la gauche –le dos au mur, désorientée et orpheline de ses modèles de références politiques passées— semble à la défensive, incapable ne serait-ce que de freiner minimalement les effets de la mondialisation néolibérale et de ses dérives autoritaires. Le tout néanmoins dans une période traversée par de multiples crises (économique, écologique, sanitaire, politique, culturelle, etc.) qui se combinent les unes aux autres et donnent l’impression d’une époque sans dessus dessous, sans le moindre gouvernail politique ou idéologique faisant minimalement consensus à l’échelle du monde [8].
Aussi peut-il se comprendre aisément qu’ait pris forme en Amérique latine –comme partout ailleurs— un nouveau type de populisme, mais cette fois-ci, non plus à partir d’une matrice de gauche, mais bien plutôt de droite. C’est ainsi qu’en Amérique latine on verra succéder à des présidents de centre gauche ou de gauche, comme Lula Da Silva au Brésil ou Cristina Kirchner en Argentine, ou même Michelle Bachelet au Chili, des présidents très marqués par des pratiques populistes de droite comme par exemple le brésilien Jair Bolsonaro (depuis 2019), l’argentin Mauricio Macri (2015-2019) ou même le chilien Sebastián Piñera (depuis 2018).
Ce qu’on peut dire d’emblée à leur propos c’est que la mystification y est encore plus grande : alors que le populisme de gauche, sur la base de valeurs initialement tirées de la culture de gauche, tend toujours à un moment ou à un autre à concilier des classes aux intérêts clairement antagoniques, le populisme de droite, lui va s’employer à donner l’illusion qu’il prend en charge les intérêts et sentiments populaires les plus profonds, tout en les soumettant, plus durement encore dans la réalité, aux intérêts des classes dominantes et à la néolibéralisation grandissante de l’économie. Et cela, non seulement en utilisant à son profit le monopole médiatique détenu par de grands groupes économiques qui se prêteront sans peine à ce jeu, mais aussi en se servant cyniquement –en cette période de crise et de sourde angoisse collective— de la mécanique du bouc émissaire ; manière de donner l’impression –à l’encontre d’un adversaire imaginaire qu’on aura forgé de toutes pièces et contre lequel on se mobilisera— que le peuple peut ainsi mieux se dresser et se sentir fort contre les maux qui l’assaillent.
En Amérique latine, cette mécanique du bouc-émissaire prendra souvent la forme de puissants ressentiments vis-à-vis de la classe politique traditionnelle (et des politiciens dits « corrompus » de gauche, oubliant au passage ceux de droite), ou encore vis-à-vis de l’action soit disant occulte de pays –marqués plus à gauche— comme Cuba, le Venezuela, l’Équateur ou la Bolivie, ou plus récemment vis-à-vis de ces flots de migrants économiques ou politiques venus par exemple d’Haïti ou du Venezuela à la recherche d’un avenir meilleur.
C’est ainsi par exemple que Jair Bolsonaro, en faisant campagne contre l’insécurité et la corruption et en profitant des déboires de Lula, pourra être élu à la présidence du Brésil en passant pour un candidat transgressif et anti-système, alors qu’il n’est dans la réalité qu’un vieux politicien (député fédéral depuis 1990) très lié à des courants politiques d’extrême droite marqués par le militarisme autoritaire, le catholicisme intégriste et l’anticommunisme obsessionnel. Combinant quelques mesures sociales (hausse de 4,6% du salaire mensuel minimum et 13ième mois aux familles bénéficiant du programme social Bolsa Familiar), à des politiques d’austérité (réforme des retraites) et d’ouverture tout azimut à l’industrie agro-alimentaire de son pays (multipliant ainsi au passage les prédations environnementales et les conflits avec les peuples autochtones), il se démarquera au temps de la Covid 19, en refusant au départ de porter un masque et en minimisant systématiquement le danger de contamination, alors même que le Brésil restera pendant longtemps un des pays les plus touchés par la pandémie. Il apparaît ainsi comme l’expression par excellence de ce nouveau populisme de droite qui en surfant très démagogiquement sur les ressentiments populaires nés d’une époque chaotique et traversée par des crises combinées et récurrentes, ne fait qu’accentuer cyniquement les contradictions économiques les plus fortes et les traits les plus autoritaires du système en place.
Conclusion
On le voit plus particulièrement à travers ce dernier exemple, c’est sur fond d’une véritable crise de la représentation politique –et donc sur fond de crise des traditionnelles alternatives politiques proposées par la gauche— que le populisme de droite a pu commencer à prendre pied en Amérique latine, et même à s’imposer dans certains pays auprès de larges secteurs populaires, comme solution aux multiples dangers et désarrois paraissant hanter notre époque.
Ce populisme de droite n’en reste pas moins infiniment plus problématique et inquiétant que le populisme de gauche, dans le sens où –au prix d’une véritable mystification— il consacre la soumission pleine et entière de larges secteurs populaires à des politiques de droite et d’extrême droite qui de par la caution sans faille qu’elles accordent au capitalisme mondialisé et néolibéralisé contemporain, ne font, dans les faits, que renforcer leur position de classes populaires et subalternes, en somme les conditions matérielles inégalitaires de leurs existences.
Il n’en demeure pas moins que ce n’est pas en lui opposant les seules formes d’un populisme de gauche qu’on pourra en arrêter le dramatique déploiement. Tout malheureusement, de l’histoire récente de l’Amérique latine le montre. Ne serait-ce pas plutôt en reprenant les choses à la racine et en s’employant patiemment à comprendre les limitations et échecs du populisme de gauche ? Seule manière d’en tirer lucidement leçons et de se donner par la suite les moyens de s’attaquer sérieusement aux effets grandissants et si préoccupants du populisme de droite !
C’est là, il est vrai, en ces temps si dramatiques de coronavirus, tout un défi !
Pierre Mouterde
Sociologue et essayiste
Québec, le 5 octobre 2020






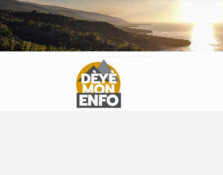






Un message, un commentaire ?