Tiré de Médiapart.
Malgré la révélation tapageuse de sa visite inédite de cinq heures en Arabie saoudite, dimanche 22 novembre, puis l’annonce de l’assassinat, vendredi, d’un acteur majeur du nucléaire iranien, l’année 2020 se termine mal pour Benjamin Netanyahou.
D’abord parce que son bref séjour dans le royaume wahhabite, abusivement qualifié d’« historique » par ses conseillers et leurs relais médiatiques, relevait davantage de la communication que de la diplomatie. Certes, il lui a permis de rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, alias MBS, en compagnie du secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, et du directeur du Mossad, Yossi Cohen, mais aucune percée n’a été obtenue. Ni dans la résolution du conflit palestinien. Ni dans la normalisation des relations entre le royaume wahhabite et l’État juif.
Officiellement, pour Riyad, les deux questions sont d’ailleurs liées depuis l’adoption en 2002 par la Ligue arabe du plan Abdallah, du nom du souverain saoudien de l’époque. Car ce texte conditionne la reconnaissance d’Israël par les pays arabes à la création d’un État palestinien avec Jérusalem pour capitale. Or rien n’a bougé sur ce point. En fait, sur la question de la Palestine, deux lignes coexistent aujourd’hui au sein du régime saoudien.
Celle que défend le vieux souverain Salmane, 85 ans (demi-frère d’Abdallah, à qui il a succédé en 2015), et qui repose sur le plan de 2002. Et celle qu’incarne son fils, MBS, indifférent aux droits et au destin des Palestiniens et obsédé par la rivalité stratégique avec l’Iran. Rivalité qui explique en partie sa proximité avec le clan Trump et son rapprochement avec Israël, ennemi mortel de la République islamique.
La coexistence, parfois conflictuelle, de ces deux lignes a d’ailleurs été illustrée le lundi 23 novembre par les versions contradictoires de l’événement livrées par les sources saoudiennes. Alors qu’un conseiller du gouvernement royal confirmait au Wall Street Journal que la rencontre MBS-Netanyahou avait bien eu lieu, qu’il y avait été question de l’Iran et de la normalisation des relations entre les deux pays, mais qu’aucun accord n’avait été conclu, le ministre saoudien des affaires étrangères, Faysal ben Farhan, tenait, quelques heures plus tard, un tout autre discours.
S’adressant manifestement surtout à l’opinion interne, largement favorable à la cause des Palestiniens, le prince-ministre a réfuté toute présence israélienne à Neom, la ville nouvelle vouée aux technologies de pointe où la rencontre a eu lieu. « J’ai vu que la presse parle d’une prétendue réunion entre Son Altesse royale le prince héritier et des dirigeants israéliens durant la visite du secrétaire d’État Mike Pompeo, a-t-il tweeté. Cette réunion n’a pas eu lieu. Les seuls responsables présents étaient américains et saoudiens. »
En d’autres termes, Benjamin Netanyahou, qui a déjà réussi, grâce au soutien de Trump et de MBS, à ouvrir en août des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis, puis en septembre avec Bahreïn, et en octobre avec le Soudan, devra sans doute attendre un peu avant de réussir le coup diplomatique majeur que serait l’ouverture d’une ambassade d’Israël dans le royaume wahhabite, qui abrite les deux villes saintes musulmanes de La Mecque et Médine. Il devra, pour l’heure, se contenter d’un simple arrangement technique : les avions civils en provenance ou à destination d’Israël pourront utiliser l’espace aérien saoudien.
Quant à l’assassinat du physicien Mohsen Fakhrizadeh, général du corps des Gardiens de la Révolution et personnage central, depuis vingt ans, du programme de production d’ogives nucléaires et des missiles capables de les projeter, il porte sans doute un coup au moral des dirigeants iraniens mais ne semble pas répondre à une urgence opérationnelle vitale. En réponse au rétablissement des sanctions économiques par Trump, la République islamique a repris prudemment ses activités d’enrichissement. L’ONU l’a constaté. Mais l’Iran paraît aujourd’hui plus préoccupé par la préparation de la transition à Washington que par la production à court terme d’une arme nucléaire.
Dans ces conditions, à quoi sert la liquidation de Mohsen Fakhrizadeh, que les services de renseignements américains attribuent clairement, selon le New York Times, à Israël – déjà accusé des assassinats de cinq scientifiques iraniens depuis 2010 ? À manifester la résolution de Netanyahou face à l’Iran ? À offrir à Trump, sur le départ, le coup d’éclat militaire dont il a été frustré ? Depuis des semaines, le président américain envisageait de bombarder des sites nucléaires iraniens, avec l’aide d’Israël, avant de quitter la Maison Blanche. Il a dû y renoncer devant les réticences des militaires. Ses multiples tweets enthousiastes postés après l’opération indiquent qu’il avait au moins donné son feu vert à son « ami » Bibi.
S’agissait-il seulement de compliquer la tâche de Biden, qui entend renouer le dialogue avec Téhéran ? Possible. La haine que le chef du gouvernement israélien et son « ami » américain portent au président élu est telle que même cette hypothèse est vraisemblable. Pour l’heure, la principale conséquence de cette opération est d’aggraver encore la tension dans la région. Au point que Netanyahou, qui devait se rendre en visite à Bahrein et aux Emirats arabes unis, a dû, in extremis, annuler son voyage.
Le premier ministre israélien le sait : il a moins deux mois – jusqu’à l’intronisation de Joe Biden, le 20 janvier – pour jouer les cartes politiques, diplomatiques et stratégiques qu’il a accumulées pendant le mandat de Trump.
Car sans être hostile à Israël, le nouveau président américain ne sera sans doute pas aussi aveuglément complaisant et dévoué à son chef de gouvernement actuel que l’ont été Trump et son administration, lesquels ont paru, pendant quatre ans, n’avoir rien à lui refuser. Depuis le déplacement de l’ambassade à Jérusalem, reconnu par Washington comme la capitale d’Israël, jusqu’à la fermeture des bureaux de l’OLP aux États-Unis. En passant par la sortie de l’accord sur le nucléaire iranien ou la publication d’un « accord du siècle » inique dépouillant les Palestiniens de leurs droits historiques.
Certes, aucun changement révolutionnaire n’est à prévoir à l’entrée de Joe Biden à la Maison Blanche. L’ambassade américaine ne retournera pas à Tel-Aviv, la reconnaissance de l’annexion du Golan sera probablement maintenue. Mais des inflexions nouvelles et un retour au statu quo instauré sous Obama sont vraisemblables. Surtout lorsqu’on découvre les noms des futurs membres de l’équipe internationale de Biden qui, contrairement aux conseillers de Trump, ont souvent une solide expérience de la diplomatie et parfois de la région. La réaction de Mahmoud Abbas à la révélation des futurs responsables du Département d’État est d’ailleurs éloquente.
Le président palestinien, qui avait rompu tout contact avec Israël et les États-Unis en décembre 2017, à l’annonce de la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale, a indiqué qu’il était déjà en relation avec l’entourage de Biden. Et ses conseillers ont déclaré qu’ils étaient satisfaits de la désignation comme secrétaire d’État d’Antony Blinken, ancien adjoint de John Kerry, chef de la diplomatie d’Obama. Et qu’ils saluaient la présence, parmi les collaborateurs de Biden, de Reema Dodin, fille d’immigrants palestiniens.
Du côté de Netanyahou, le climat est, en revanche, au dépit. Et à l’inquiétude. Après quatre ans de liens quasi fusionnels avec Trump et son clan pendant lesquels le premier ministre a « vendu » au président américain sa vision d’un Proche-Orient débarrassé de la question palestinienne et rassemblé, derrière Washington, contre l’ennemi commun iranien, il lui sera probablement difficile d’accepter une sorte de retour aux années Obama.
Surtout si le nouveau président réintègre, comme il l’a annoncé, l’accord sur le nucléaire iranien. Accord dont la sortie fut pour Netanyahou un triomphe. Et pour Biden « un désastre ». Ce retour serait pour le premier ministre israélien pire qu’un camouflet : l’effacement d’un de ses principaux acquis diplomatiques. Et un revers politique majeur.
Cette perspective cauchemardesque explique l’activisme actuel de Netanyahou et sa volonté quasi désespérée d’afficher et d’exploiter les liens scellés avec l’administration Trump. Comme si, dans les deux mois qui restent avant la prestation de serment de Biden, il était capital à ses yeux de multiplier les preuves des relations exceptionnelles établies avec les États-Unis et de leurs traductions concrètes et durables sur le terrain. Relations exceptionnelles présentées comme fondamentales pour la sécurité d’Israël. Mais aussi comme l’héritage inestimable de l’amitié entre le premier ministre israélien et le président américain.
Ainsi peut-on interpréter l’accueil spectaculaire fait à Pompeo, son dîner chez un colon-viticulteur de Psagot, en Cisjordanie occupée, son excursion sur le Golan et sa visite au musée des Amis de Sion destinée à honorer les chrétiens sionistes américains – c’est-à-dire les évangéliques, partisans à la fois de Trump et de Netanyahou.
Le secrétaire d’État américain a répondu à ces amabilités par des annonces que Netanyahou attendait depuis longtemps. Il a ainsi indiqué que le Département d’État considérera désormais le mouvement de boycott des produits israéliens BDS comme une organisation antisémite et que les produits en provenance des colonies porteront l’étiquette « Made in Israel ». Gestes de soutien à la colonisation qui ne seront peut-être pas endossés par l’administration Biden, mais sur lesquels Netanyahou s’est empressé de surenchérir en annonçant la construction de plus de 1 200 logements dans la colonie de Givat Hamatos, au sud de Jérusalem.








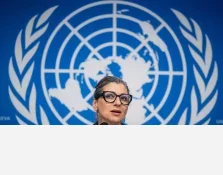



Un message, un commentaire ?