5 mai 2022 | tiré de mediapart.fr
https://www.mediapart.fr/journal/international/050522/politique-monetaire-un-moment-de-verite-pour-la-fed
Cela fait des semaines que le sujet accapare le monde financier : la Réserve fédérale va augmenter ses taux et durcir sa politique monétaire. Le 4 mai, Jerome Powell, son président, a confirmé ce que tout le monde attendait. Afin de lutter contre une inflation au plus haut depuis 1980 – 8,5 % en mars –, l’institution monétaire a décidé de relever ses taux directeurs de 0,50 %.
« C’est la plus forte hausse décidée depuis 20 ans », n’ont pas manqué de rappeler les commentateurs, afin de souligner la fermeté de la Banque centrale des États-Unis. Mais d’autres ont noté que le ton adopté par le président de la Fed se voulait d’autant plus déterminé que les mesures adoptées sont finalement plus accommodantes qu’il n’y paraît.
Alors que plusieurs membres de l’institution monétaire avaient évoqué la possibilité d’augmenter les taux jusqu’à 0,75 % en une seule fois pour contrer une inflation galopante, Jerome Powell a exclu cette possibilité. Certes, il y aura de nouvelles hausses des taux directeurs mais elles seront mesurées, a promis le président de la Fed. Les taux devraient atteindre 2 % à 2,5 % d’ici à la fin de l’année. De telle sorte que les taux réels vont rester largement négatifs, compte tenu du niveau d’inflation.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, lors de sa conférence de presse à Washington, le 4 mai 2022. © Photo Jim Watson / AFP
De même, la Réserve fédérale a annoncé mettre un terme à la politique monétaire ultra-accommodante mise en place à partir de mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid. Elle va arrêter ses rachats de titres obligataires afin de diminuer son bilan, qui a pris des allures stratosphériques : près de 9 000 milliards de dollars. Mais alors qu’elle avait laissé entendre qu’elle procéderait au rythme de 95 milliards de dollars par mois, elle n’en fera que la moitié dans un premier temps.
Même si d’autres banques centrales (Grande-Bretagne, Canada, Australie, Norvège, Suède, Islande, Inde) ont déjà lancé ce processus de resserrement monétaire – la Banque centrale européenne risque de les imiter dans un délai plus ou moins bref –, les décisions de la Fed, compte tenu de sa taille et de son influence mondiale, sont d’une autre portée : l’ensemble des marchés de capitaux est concerné et la Fed peut provoquer des ondes de choc importantes, notamment dans les pays émergents mais pas seulement. Autant dire que les mesures annoncées ce 4 mai ont été accueillies avec un certain soulagement par les financiers. Ils craignaient le pire.
C’est un choc financier mondial qui couve, de l’ordre de 410 milliards de dollars, prévenait il y a quelques jours l’agence Bloomberg, alors que l’économie mondiale, à peine remise de la pandémie, bousculée par la guerre en Ukraine, est en passe de caler. « On perçoit déjà les conséquences de ce resserrement par une diminution de la liquidité en dollars et la hausse du dollar », expliquait alors Alicia Garcia Herrero, cheffe économiste pour la région Asie-Pacifique chez Natixis.
La crainte de la fin de l’argent magique
Afin de préparer les esprits et éviter des mouvements trop brutaux, la Fed avait indiqué les grandes lignes de sa politique dès la fin mars. Depuis, la sphère financière s’est mise en mouvement. Des réallocations massives de capitaux ont alors été engagées, provoquant un tohu-bohu indescriptible. Tous les marchés ont été touchés.
Ainsi avril a-t-il été « le pire mois pour les actions sur les marchés américains depuis 2000 », pour reprendre l’expression du Wall Street Journal. Dans la précipitation, des investisseurs ont voulu se séparer pendant qu’il en était encore temps de titres surévalués, dopés grâce à l’argent de la Banque centrale. Le Nasdaq, l’indice qui regroupe toutes les valeurs technologiques, a baissé de plus de 13 % - sa pire performance depuis octobre 2008 –, le S&P 500, un des indices phares de Wall Street, de 8,8 %, le Dow Jones de 5,5 %. Et la chute a continué dans les premiers jours de mai.
Ce qui s’est passé sur les marchés obligataires, moins regardés par le grand public, est encore plus éloquent. Toutes les dettes obligataires risquées mais offrant de hauts rendements, qui ont prospéré ces dernières années car elles permettaient des effets de levier gigantesques et des enrichissements rapides, sont désormais délaissées. Les taux de ces dettes se sont envolés à plus de 8 %. Et la correction est loin d’être terminée. Des centaines de milliards de crédits liés à l’immobilier, à la consommation, sont sous la menace.
Le temps de l’argent magique, de cet argent gratuit distribué à foison par les banques centrales depuis la crise financière de 2008, est en passe de s’achever.
Même les bons du Trésor et les obligations d’État américaines, considérés normalement comme les valeurs refuges les plus sûres, surtout en temps de guerre, ne sont pas épargnés. Depuis plusieurs semaines, ils sont pilonnés, y compris par les investisseurs institutionnels et étatiques. Le Japon, qui détient l’un des portefeuilles de titres américains les plus importants au monde après la Chine, a vendu pour plus de 60 milliards de dollars de bons du Trésor durant le mois d’avril.
Face à cette fuite, les taux des obligations d’État ont remonté, celui à 10 ans est désormais à plus de 3 %. Un mouvement identique s’est produit sur les obligations européennes : les taux négatifs, qui étaient devenus la norme, ont disparu pour tous les pays y compris l’Allemagne. Et le différentiel de taux entre les titres obligataires allemands (bunds) et les obligations italiennes, jugées comme les plus fragiles, ne cesse à nouveau de croître : il est désormais de 180 points.
En soi, des taux de 2,5 % à 3 %, surtout dans un environnement d’inflation élevée, n’ont rien d’alarmant. Mais pour des financiers habitués à vivre dans un univers de taux zéro, voire négatifs depuis plus d’une décennie, ce renversement traduit une crainte : le temps de l’argent magique, de cet argent gratuit distribué à foison par les banques centrales depuis la crise financière de 2008, est en passe de s’achever. Et son tarissement risque de révéler tous les subterfuges, toutes les manipulations d’un système financier au bord de l’épuisement.
Mais c’est aussi un moment de vérité pour les banques centrales, jusqu’alors considérées comme toutes-puissantes, mais qui se trouvent confrontées au défi du désordre mondial.
Le retour de l’inflation
Cela fait des mois que des banquiers de Wall Street et des économistes réclamaient une hausse des taux de la Fed. « Cela aurait dû intervenir beaucoup plus tôt », s’est encore plaint ces derniers jours Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan.
Alors que tous ces « experts » ont approuvé des années durant les déformations provoquées par les politiques monétaires ultra-accommodantes, nourrissant des bulles d’actifs immenses dans tous les domaines (finance, immobilier, technologie, art, etc.), aggravant les inégalités à des niveaux sans précédent, dès les premiers signes de hausse de prix provoquée par la sortie chaotique de la pandémie mondiale du Covid-19, ils ont commencé à s’alarmer. L’inflation était de retour, l’inflation était là !
Dès lors, il n’y eut plus de jour sans que l’une ou l’autre des voix avisées ne demande à la Fed de changer de cap, de revenir à sa mission première de gardienne de la monnaie, de renouer avec la politique de Paul Volcker, président de la Fed au début des années 1980, et figure tutélaire du reaganisme. Bref, de retrouver les fondamentaux des années triomphantes d’un néolibéralisme mis à mal par la crise du Covid, les remises en cause de la globalisation, et maintenant par la guerre en Ukraine.
Pendant des mois, la Fed a temporisé. L’inflation, selon la fable reprise par tous les banquiers centraux, n’était que « temporaire ». Passé la période d’ajustement de l’économie mondiale, les tensions disparaîtraient et tout reviendrait à la normale. Mais rien ne s’est passé comme prévu. La pandémie continue, notamment en Chine, aggravant encore les risques de pénurie et les dysfonctionnements sur toutes les chaînes d’approvisionnement. Et la guerre en Ukraine a déclenché une crise de l’énergie, des matières premières, de l’alimentaire dont personne n’avait anticipé l’ampleur.
Alors que l’inflation atteint 8,5 %, la Réserve fédérale ne pouvait plus rester immobile. Justifiant les mesures prises, Jerome Powell reconnaît que certaines peuvent être « douloureuses » : d’une façon ou d’une autre, par le biais des crédits immobiliers, des crédits à la consommation ou autre, l’ensemble des ménages américains est concerné par la hausse du coût de l’argent. « Mais le plus grand mal est de ne pas s’attaquer à l’inflation et laisser s’installer la contraction [de l’économie] », a-t-il expliqué.
Un étrange calendrier
Une question pourtant trotte dans la tête de certains : la Fed n’est-elle pas en train d’intervenir à contretemps, avec les mauvais instruments ?
De fait, son action se déroule dans un étrange moment. À rebours de tous les préceptes historiques. D’ordinaire, les banques centrales n’augmentent pas les taux dans des périodes de ralentissement économique. Or, après la période de rebond qui a suivi naturellement l’arrêt de l’économie mondiale pendant le confinement, l’activité économique américaine ne cesse de perdre son souffle. Au premier trimestre, le PIB américain est en recul de 1,4 %.
De même, les banques centrales offrent leur appui à leurs gouvernements dans les périodes de conflit. Le gouvernement américain s’est lancé dans un effort de guerre important aux côtés de l’Ukraine : en quelques semaines, il a déjà dégagé une dizaine de milliards de dollars et prévoit d’apporter une nouvelle aide de 33 milliards de dollars à Kyiv (Kiev) dans les prochaines semaines.
En dehors d’une inflation qui ne cesse de monter mois après mois, la Fed n’a qu’un argument pour justifier ses dernières décisions : l’emploi aux États-Unis, qui est devenu l’un des indicateurs pour la politique monétaire américaine. Depuis la sortie du confinement, le marché du travail affiche des signes de tension inconnus depuis plus de trente ans : le chômage n’a jamais été aussi bas, le nombre d’emplois à pourvoir n’a jamais été aussi élevé, et le nombre de personnes démissionnant ou quittant leur emploi atteint des proportions inégalées.
Ce mouvement d’ampleur, dont les causes profondes restent encore à expliquer, traduit une rupture par rapport aux décennies de la Grande Compression. Le rapport de force entre le capital et le travail est en train de se rééquilibrer. Les mouvements pour demander des hausses de salaire se multiplient. Il n’en faut pas plus aux économistes pour convoquer la fameuse courbe de Phillips – dont la pertinence est contestée – : l’engrenage fatal hausse des prix/hausse des salaires est, selon eux, de nouveau à l’œuvre.
Alors que les ménages américains constatent chaque jour la dégradation de leur pouvoir d’achat, la grogne s’installe. Tentant de prévenir ce danger, Jerome Powell a d’emblée abordé le sujet lors de sa conférence de presse : « Je voudrais profiter de cette occasion pour m’adresser directement au peuple américain. L’inflation est beaucoup trop élevée et nous comprenons les dégâts qu’elle cause et nous agissons rapidement pour qu’elle recule. » Cela suffira-t-il pour calmer la contestation sociale ?
L’impuissance de la Banque centrale face à une inflation importée
Dans cette nouvelle partie de lutte contre l’inflation, la Fed joue, elle le sait, sa crédibilité. Mais elle n’a à sa disposition, elle le sait aussi, qu’une arme monétaire émoussée, voire inopérante : la hausse de ses taux directeurs risque d’être sans effet face à l’inflation actuelle, provoquée par des facteurs totalement extérieurs.
L’envolée des prix à laquelle le monde entier est confronté n’est pas liée à un emballement de la machine économique, mais à des pénuries, des goulots d’étranglement, des restrictions de tout ordre, apparus d’abord au moment de la crise sanitaire à laquelle vient s’ajouter désormais la guerre en Ukraine. Et face à ces facteurs extérieurs, les banques centrales sont impuissantes.
Que l’argent emprunté soit plus cher ne changera pas grand-chose à la flambée des cours du pétrole, du gaz, amplifiée par les sanctions contre la Russie. Le resserrement monétaire ne permettra pas de modifier les prix du blé, ou de parer aux pénuries d’huile sur les marchés mondiaux, alors que les champs d’Ukraine, très grand exportateur mondial de produits agricoles, sont pilonnés par l’armée russe. La politique monétaire n’a aucun effet sur les pénuries de semi-conducteurs, de composants industriels, de matières premières qui ont surgi avec la crise sanitaire.
« La politique monétaire des banques centrales n’a aucune prise sur une inflation importée. Ce n’est pas le bon instrument pour juguler une crise de l’offre de l’économie réelle », rappelle Éric Dor, professeur d’économie à l’IÉSEG School of Management de Paris et Lille. Mais il semble qu’il n’y en ait aucun autre à disposition. Parce qu’une partie du monde financier le demande, parce qu’il n’y a aucune autre instance susceptible de mettre un peu d’ordre dans le désordre actuel du monde, la Fed est intervenue.
Le spectre d’une récession
Selon les scénarios de la Fed, les hausses répétées des taux devraient permettre à terme de maîtriser l’inflation et donner lieu à un atterrissage en douceur de l’économie américaine, sans provoquer trop de casse. C’est le scénario idéal.
Mais si cela ne se passait pas comme prévu ? La décision de Jean-Claude Trichet, alors président de la BCE, d’augmenter les taux européens à la mi-2011, justement pour contrer une inflation provoquée par la hausse des prix de l’énergie (donc une inflation importée), est souvent citée en exemple ces derniers temps. Elle a laissé un souvenir épouvantable : la remontée intempestive et prématurée des taux fut un élément déclencheur de la crise de l’euro, avec son cortège de récession, de chômage et de politique d’austérité. Elle signa le début d’une décennie perdue pour l’Europe.
La Fed n’est-elle pas en train de commettre les mêmes erreurs ? Porter les taux directeurs à 2 % ou même 3 % n’est pas de nature à endiguer une inflation importée de 7 % ou 8 %. Mais elle peut accentuer le ralentissement économique en cours.
Cette crainte est de plus en plus exprimée par des observateurs. « Avec ce resserrement de la Banque centrale qui produit déjà un ralentissement, il s’agit de savoir si les banques centrales ne vont pas nous faire basculer dans la récession », dit auprès de Bloomberg Kathy Jones, stratégiste chez Charles Schwab. Une analyse que partage, avec un humour grinçant, Dany Janny, conseiller de Morgan Stanley : « La Fed ne peut pas imprimer des matières premières, mais elle peut certainement accélérer une récession », écrit-il dans une note.
Même la secrétaire d’État au Trésor, Janet Yellen, qui a précédé Jerome Powell à la tête de la Fed, a des doutes. Elle a reconnu que la Banque centrale aurait besoin « d’être habile » et aussi « chanceuse » pour parvenir à maîtriser l’inflation sans provoquer une récession.
La préoccupation d’abîmer encore plus une situation économique dégradée a naturellement pesé dans les décisions de la Fed. Mais la crainte de provoquer de nouveaux désordres dans le système financier international aussi. Les messages envoyés par les marchés financiers en avril ont été un avertissement pour la Banque centrale. Gorgée par des milliers de milliards d’argent gratuit depuis 2008, la planète financière est plus instable que jamais. Elle ne peut se passer des béquilles des banques centrales sous peine de tout voir s’effondrer.
C’est le message que semble avoir retenu le monde financier : la Banque centrale ne les abandonnera pas. « La Fed a roucoulé comme une colombe pendant une décennie, maintenant elle essaie de crier comme un faucon. Très fort. Mais je pense que c’est toujours une Fed très accommodante et je crois qu’elle reviendra à sa nature accommodante plus tard dans l’année », analyse David Kelly, chef stratégiste chez JP Morgan. Dans la foulée des annonces, tous les marchés financiers sont repartis à la hausse.
Martine Orange





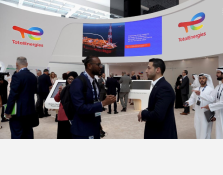

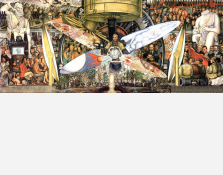


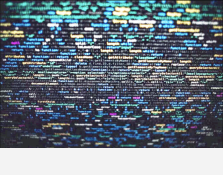

Un message, un commentaire ?