Ces derniers sont reconnus pour leur enseignement de la lutte et du maniement des armes ; ils sont également réputés experts dans l’art de se défendre au tribunal et de réduire au silence quiconque se dresse devant eux à titre d’interlocuteurs. Euthydème et Dionysodore précisent, dans le prologue du dialogue, avoir abandonné ces enseignements et se spécialiser dorénavant dans l’enseignement rémunéré d’une seule chose : la vertu (273d). Ils se déclarent capables d’exhorter quiconque à l’amour du savoir (la philosophie) et de le conduire dans le chemin de la pratique de la vertu, et ce, dans le cadre d’une très courte période de temps de formation (qui « se transmet rapidement » (304a)). Socrate les invite alors à exercer leurs nouvelles compétences en matière de vertu auprès du jeune Clinias (qui est accompagné de son amant Ctésippe). Clinias sera constamment réfuté par Euthydème et Dionysodore. Dans le présent dialogue, Socrate cherche à identifier d’une manière un peu plus précise ce que pourrait être la science du bonheur, voire la science qui rendrait nécessairement heureux celui qui la possède. Se pourrait-il qu’il s’agisse ici de l’art royal, c’est-à-dire l’art politique ? À la fin du dialogue, Socrate[3] et Criton conviennent de l’impossibilité de déterminer positivement la fameuse science susceptible de mener automatiquement au bonheur. Étonnamment ou paradoxalement, Socrate ne condamne pas les sophistes et invite même Criton à se mettre avec lui à leur école.
1. Euthydème consent à montrer sa science à Clinias
D’entrée de jeu, Euthydème demande à Clinias ce qui suit : « […] de deux choses l’une, quels sont les hommes qui apprennent ? Les savants ou ceux qui n’apprennent rien ? » (Brisson, 275 d)[4]. Question piège par excellence, car répondre que ce sont les savants permet à Euthydème d’objecter que ceux qui apprennent quelque chose, en principe, n’en savent rien et sont donc des ignorants ; tandis qu’une réponse orientée vers les ignorants amène son frère, Dionysodore, à souligner le fait que pour apprendre, par exemple, une récitation, il faut être savant. Dans cet échange, les deux frères jouent sur le sens des mots et ne cessent d’adresser à Clinias ce type de questions pièges dont les réponses se voient systématiquement infirmer en raison de la pratique d’une sophistique douteuse entre les mots « apprendre » et « connaître » (276b à 276e). Leur ruse s’inscrit donc dans un exercice habile de logomachie (soit l’amalgame des termes grecs logos, pour « discours », et makhê, signifiant « combat »), voire dans une rhétorique sur les mots qui impose de savoir les manier comme une arme en mystifiant les adversaires dans leurs sens possibles.
Cette démonstration de la part des deux sophistes relève d’un pseudo-savoir et ne correspond pas à un savoir protreptique (278c) tel que Socrate l’entend. C’est pourquoi ce dernier va s’empresser de proposer son propre discours d’incitation à la philosophie à travers le concept du bonheur et de celui qui s’enquiert du savoir.
2. Une intervention de Socrate autour de la notion de bonheur
Socrate intervient en demandant s’il est possible pour quiconque d’accéder au bonheur (« être heureux » 278e-279a) sans détenir aucun bien ? Tout homme qui aspire au bonheur se doit, selon lui, de posséder un certain nombre de biens. Mais cela ne suffit pas, encore faut-il qu’il fasse des biens acquis un usage qui est en osmose avec (ou guidé par) le savoir — lire ici un usage qui serait sage ou conforme à la sagesse. Le savoir apparaît donc aux yeux de Socrate comme une condition indispensable et décisive pour accéder au bonheur. Seul le savoir rend véritablement heureux, car il permet de réussir ce qu’une personne décide d’entreprendre. En bref, le bonheur ne dépend pas uniquement des biens détenus, mais également de leur usage.
Pour que l’usage soit jugé « bon », il doit être guidé par la science. Le savoir devient ainsi le facteur essentiel du bien, voire le seul bien réel, alors que l’ignorance est décrétée être le seul et véritable mal à combattre. Se pose une toute petite question incontournable : qu’est-ce que le savoir ou plutôt qu’est-ce que l’amour du savoir ? Réponse : l’acquisition d’une connaissance dont l’objet reste à préciser. Ce « savoir », qui mène inéluctablement une personne de l’ignorance à la sagesse et par conséquent au bonheur, peut-il être enseigné (282c) ? Aux sophistes de répondre à cette interrogation de Socrate.
3. Est-ce que changer quelqu’un c’est vouloir sa mort ?
Au lieu de répondre directement à la précédente interrogation, les deux sophistes vont faire dévier la conversation sur une piste hasardeuse. Dionysodore intervient le premier et demande s’il est vraiment désirable que Clinias devienne sage ? Selon lui, vouloir changer Clinias en savant reviendrait à vouloir sa mort, car il cesserait d’être ce qu’il est, il deviendrait un autre (283e). Ctésippe refuse de voir son aimé disparaître. Ce dernier accuse Dionysodore d’être menteur (283e) en ne disant pas les choses telles qu’elles le sont vraiment. Euthydème prend ensuite le relais en affirmant qu’il est impossible de parler d’une chose sans la décrire comme telle. Dionysodore renchérit en soutenant qu’il est par conséquent impossible de contredire cette position, car s’il n’existe qu’une seule façon de parler d’une chose (deux personnes sont réputées dire la même chose d’un même objet) ; autrement, si ces deux personnes disent des choses différentes, c’est qu’elles parlent de choses différentes. Impossible donc, selon les deux sophistes, de parler faux.
Socrate intervient en rappelant que s’il est impossible de dire des faussetés, il est impossible également d’en penser. Dans ce cas, s’il est impossible de contredire, il serait impossible de réfuter. Cette thèse ne tient pas la route selon le maître à penser de Platon (286c). Ce point de vue se contredit lui-même en raison du fait qu’il n’existerait, par conséquent et par définition, aucune opinion fausse. Nul ne serait donc ignorant. Partant de là, l’enseignement de la vertu, proposé par Euthydème et Dionysodore, deviendrait quelque chose de complètement inutile (287a). Socrate et Clinias conviennent donc que l’amour du savoir consiste en l’acquisition d’une science (288d).
4. Qu’est-ce que la vertu ?
À la suite d’un questionnement relatif au bonheur et aux biens aptes à le produire (la richesse, la santé, la beauté, le pouvoir, les honneurs, mais aussi la tempérance, la justice, le courage, le savoir et la réussite), Clinias et Socrate conviennent qu’il faut « aimer le savoir », aimer la philosophie : la vertu consiste dans la science ; l’amour du savoir, en l’acquisition d’une science ; et philosopher c’est acquérir cette science, bien qu’il soit nécessaire de statuer sur le type de science capable d’utiliser, d’une manière simultanée, ce qu’elle produit, c’est-à-dire d’être une science utile (289b). Le savoir qui conduit au bonheur n’est pas que théorique ou abstrait ou encore contemplatif. Il comporte une part essentielle de pratique, un volet technique qui conduit vers l’excellence. C’est ce savoir qui doit être associé à la vertu et à la pratique de l’action juste.
Socrate laisse clairement sous-entendre ici que le savoir qu’il recherche engage une activité déterminée, à savoir une activité qui s’introduit dans les affaires humaines et qui possède une application immédiate dans le réel. À cet égard, il aspire à trouver et à identifier une réalité spécifique du savoir. Selon lui, il doit exister une région du savoir où celui-ci, dans sa singularité de bien suprême ou d’acmé dans l’accès au bonheur, se réaliserait éminemment ou serait pleinement conforme à son essence. C’est cette science particulière qui, parmi toutes les autres, serait la plus désirable.
5. Les sciences particulières que Socrate et Clinias envisagent en vue d’aboutir à l’identification de la science du bonheur
D’abord est évoquée la science consistant à reconnaître « en quel lieu de la terre se trouve enfoui le plus d’or ? » (288d). Cette science est-elle réellement un bien qui procure le bonheur ? Est-elle réellement profitable ? Clinias reconnaît qu’elle l’est sur la base de l’opinion courante, qui rattache l’or au désirable en soi et qui associe sa possession à la félicité. Mais, il a été établi précédemment que la richesse par elle-même n’est qu’un bien relatif : elle ne permet pas par elle-même la réussite de l’action. Puisqu’il en est ainsi, elle ne saurait se constituer en bien effectif par la simple vertu de sa possession. Le savoir qui la produit n’est pas un savoir achevé. Tant que cette science ne nous indique pas « comment utiliser cet or », elle reste incomplète et sans véritable valeur. Tout d’abord, la valeur vient du fait qu’il y a un processus de valorisation et, ensuite, l’utilité dérive d’un projet d’utilisation (289d). La possession d’un bien n’est alors pas suffisante pour que celui-ci se constitue en bien effectif. Il faut encore inscrire celui-ci dans une finalité précise par laquelle il se révèle de fait.
Socrate envisage par la suite une autre science : celle qui rendrait les humains immortels, sans savoir toutefois comment utiliser cette immortalité. Une telle science s’avère ici incomplète. Elle renvoie à un bien privé d’utilité, car indéterminé dans son utilisation. L’immortalité, en tant que réalité produite, peut déboucher autant sur le bonheur que sur le malheur, n’étant pas profitable en soi. Elle deviendra un bien uniquement quand une science de l’utilisation de l’immortalité sera acquise. Par conséquent, la science recherchée doit être « telle que coïncident en elle à la fois le fait de savoir produire et le fait de savoir comment utiliser ce que cette science produit » (289b). Mais l’art de l’utilisation ne suffit pas, puisque la séparation des compétences pose problème ici. La spécialisation des uns et des autres en l’absence de toute unification des savoirs ne peut pas permettre d’accéder au bonheur. La science achevée envisagée par Socrate est une science par laquelle le bien comme objet et le bien comme finalité sont réunis. Le tout constituant un bien réel et effectif, dont on peut jouir en même temps qu’on le possède.
Sont examinés par après l’art de fabriquer des lyres (289b) ou des flûtes, « l’art de fabriquer les discours » (289c), l’art des incantations (289e), « l’art du général en chef » (apparenté à l’art de la chasse) (290a-b), la dialectique (290c), alors que la conclusion qui s’en dégage est la suivante : il n’y a rien ici qui permet d’accéder au réel bonheur ou de rendre les hommes heureux. À ce moment-ci de l’échange, l’art politique, dont Socrate avait fait allusion brièvement dans son discours, semble sortir du lot et représenter la science du bonheur, l’art royal (291c). Elle seule correspondrait à la science générale de l’utilisation, susceptible de constituer en bien les produits nécessaires à la vie.
Pour Socrate, une fois que fut avancée l’hypothèse selon laquelle c’est la politique qui est la science profitable par excellence, il était impossible de faire progresser davantage la discussion (291c). Il reconnaît par conséquent le caractère aporétique[5] de son échange avec Clinias. Dès le moment où le savoir qui permet d’accéder au bonheur ne renvoie à aucun contenu précis, la discussion ne peut faire autrement que de tourner à vide. En plus, Socrate arrive au point où il n’est même plus sûr qu’il faille « aimer le savoir », puisque ce qu’il sous-entend n’a pas été suffisamment clarifié. Socrate se devait d’exhorter le jeune Clinias à la vertu et à la philosophie, mais il admet qu’il ne sait pas lui-même en quoi consiste une telle démarche ; ironiquement, il se retrouve aussi ignorant que lui.
N’empêche que la vie heureuse pour Socrate en est une où l’âme se laisse guider par des exigences de vertu, de justice et de bonté. Dans la mesure où il est réputé être « la cause de la rectitude de l’action » et veille à ce que « de tout soit fait un bon usage », l’art politique est posé comme étant « à la poupe de la cité » (291d). Art politique = art royal, c’est-à-dire le même art. Cet art gouvernerait tout, car il est en rapport avec les idées de Justice et de Bien, ce qui le met en excellente position pour être considéré comme permettant d’accéder au Bonheur. L’art politique rendrait heureux dans la mesure où son exercice suppose la connaissance du juste et de l’injuste. Mais Socrate échoue dans sa tentative de démontrer l’effectivité identifiable et irrécusable de l’art politique, sans pour autant tout perdre, car, étant réputé correspondre à l’art « souverain sur tout », il ne saurait être dépourvu d’une certaine efficacité, et son action doit bien comporter un certain nombre d’effets.
Qu’en est-il maintenant de la médecine et de l’agriculture (291e) ? Les biens produits par ces deux arts sont des biens du corps. Mais, comme l’a déjà souligné Socrate, seul le savoir est un bien véritable. Les biens du corps sont des biens relatifs et précaires qui ne viennent pas avec les critères de leur juste utilisation. La médecine et l’agriculture ne sont donc pas des sciences du bonheur au sens strict. Ces arts doivent être subordonnés à une science plus vaste rendant possible le savoir de ceux sur lesquels elle s’applique.
Dans l’Euthydème, la bonté qui rend possible le bonheur doit être entendue dans sa relation à un art. Il ne s’agit pas simplement d’une disposition innée, mais plutôt d’une chose qui se pratique, donc qui s’acquiert. C’est ce qui explique d’ailleurs qu’un savoir incitatif (protreptique) puisse lui être associé. Nous nous retrouvons donc avec d’un côté, des sciences reconnues comme étant utiles (agriculture et médecine), mais d’une utilité toute relative, et de l’autre, une science qui devrait être la science suprêmement utile (l’art politique), mais dont l’effectivité n’est aucunement évidente (292e). À noter cette tendance à associer le bonheur individuel au bonheur collectif, car, sans véritablement le dire, un art qui procure ses bienfaits à une personne semble justifier son utilité pour l’ensemble du groupe qui en jouira tout autant, ce qui semble être une déduction simpliste ignorant la complexité du monde. En effet, quelqu’un qui se rend heureux du malheur des autres, pratiquant par exemple l’art des méfaits, que ce soit en politique, en médecine ou en extraction de l’or notamment, occasionnera des effets pervers pour la collectivité. Ainsi la difficulté à découvrir l’art parfait pour atteindre le bonheur se justifie dans la mesure d’un relativisme selon lequel chaque personne jouit du bonheur à sa façon, même si collectivement un sens commun lui a été attribué et a d’ailleurs été souligné autant par Socrate que les deux sophistes, également à leur façon. Néanmoins, la science du politique ou l’art politique défendu par Socrate vise à transformer l’homme ou la femme en citoyen ou citoyenne, dans le but d’en faire des membres à part entière de la Cité. Il s’agit d’ailleurs d’une position davantage développée par Platon dans le Criton, précisément au sujet du sens du devoir, du respect des lois et d’une intention à comprendre la justice, ce qui insinue un consentement à vivre au sein de la Cité, puisque celle-ci étant jugée apte à fournir une large part de bonheur à ses adhérent.e.s. Au fond, l’idée véhiculée ici semble justifier un réel bonheur parmi autrui, dans l’exigence du respect des règles du vivre ensemble.
La drôle d’invitation
Criton est à la recherche d’un éducateur pour son fils aîné du nom de Critobule (306d). Socrate lui propose de le mettre à l’étude de la philosophie, sans égard pour la valeur des personnes qui prétendent l’enseigner (307b). Sur ce constat, Socrate invite Criton à prendre avec lui des leçons avec les deux sophistes, ce qui ne semble pas enthousiasmer ce dernier (304c-305a). S’il s’agit certes d’une « drôle d’invitation », rappelons tout de même l’Axiocos attribué à Platon et à l’intérieur duquel on apprend que le sophiste Prodicos aurait enseigné à Socrate au sujet de la mort. Cette situation particulière suppose malgré tout une forme de reconnaissance accordée à certains sophistes qui ont su oeuvrer dans leur art jusqu’à l’émulation. En ce sens, Socrate est présenté comme un homme humble, capable de reconnaître les qualités de ses interlocuteurs, en dépit d’une position souvent sceptique et quelques préjugés à l’endroit de ceux se disant être des sophistes. Plus que cela, la morale de l’histoire suggère de ne jamais tourner le dos à quiconque pourrait nous fournir des prises de vue susceptibles d’aider à atteindre la vérité.
Conclusion
L’Euthydème se conclut sur un double échec, à savoir celui des sophistes à transmettre un savoir protreptique authentique dans un premier temps, et celui de Socrate qui est incapable d’identifier la science suprême qu’il s’agirait d’acquérir pour être heureux dans un second temps. Et devant les prétentions d’une telle science qui serait en plus porteuse de bonheur, nous serions en droit de nous demander si une telle science qui s’accompagne d’une application concrète et pratique mène l’humanité automatiquement au bonheur ? Réponse : au bonheur et au triomphe de quelques-uns peut-être, mais pas nécessairement de toutes et de tous hélas. Quoi qu’il en soit, dans le présent dialogue, Socrate a démontré qu’il était en mesure de réfuter les objections sophistiques, en précisant que leur démarche relevait de la justesse des mots. Par contre, si Socrate a échoué dans sa tentative de trouver la science qui est porteuse de bonheur, c’est en raison de son manque de clarté à définir correctement certains termes.
Nous pouvons retenir du présent dialogue, dont une partie est narrée, que Socrate a démontré qu’il avait un point en commun avec les sophistes : il était fondamentalement un éristique, c’est-à-dire un personnage qui n’hésitait pas à défendre dans une discussion son point de vue en s’objectant et en réfutant pas uniquement par goût, mais par sens du devoir. De plus, il a amplement réussi à démontrer que ses deux interlocuteurs sophistes étaient foncièrement ignorants. À la fin du dialogue, une question demeure toutefois sans réponse : sommes-nous paradoxalement en présence d’un éloge d’Euthydème et de Dionysodore ou d’une ironie de Socrate à l’endroit des sophistes ? Il est impossible de répondre ici par l’affirmative.
Sur une des limites de ce texte
Le détournement, à d’autres fins, d’un savoir réputé au départ bénéfique n’est
pas envisagé ou soulevé par Platon dans le présent texte. Nous pouvons donc
nous demander s’il n’est pas là le drame de notre civilisation. Il arrive que
l’invention créatrice soit récupérée par la suite à des fins destructrices. Hélas, la
science ne pense plus et préfère contribuer à la production de choses
bénéfiques ou maléfiques, créatrices ou destructrices pour l’humanité et la
planète. Pourquoi ?
Guylain Bernier
Yvan Perrier
21 août 2022
11h
yvan_perrier@hotmail.com
Références
Dixsaut, Monique. 1998. « Platon ». Dans Dictionnaire des philosophes. Paris :
Encyclopaedia Universalis/Albin Michel.
Platon. 1967. Protagoras, Euthydème, Gorgias, Menexène, Ménon, Cratyle.
Traduction, notices et notes par Émile Chambry. Paris : GF Flammarion, p. 107-
151.
Platon. 1994. Apologie de Socrate. Criton. Paris : Pocket, 145 p.
Platon. 2020. « Axiochos ou Sur la mort ». Dans Luc Brisson (Dir.), Platon
œuvres complètes. Paris : Flammarion, p. 94-101.
Platon. 2020. « Euthydème ou L’éristique ». Dans Luc Brisson (Dir.), Platon
oeuvres complètes. Paris : Flammarion, p. 351-394.
…

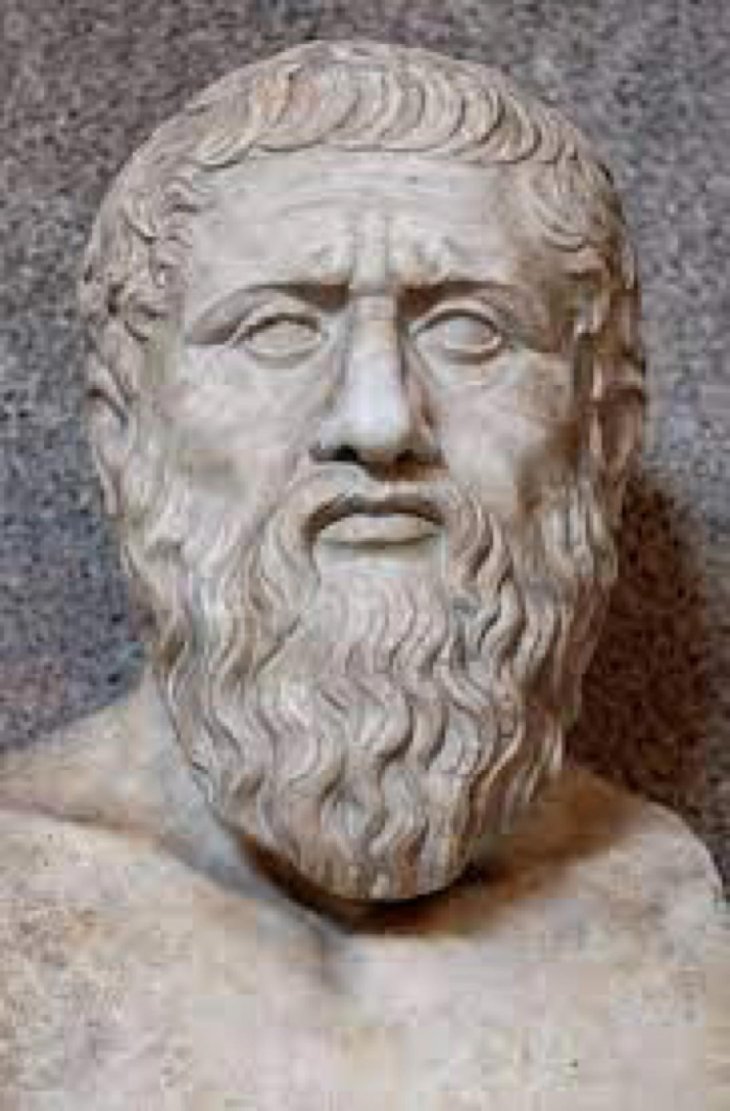








Un message, un commentaire ?