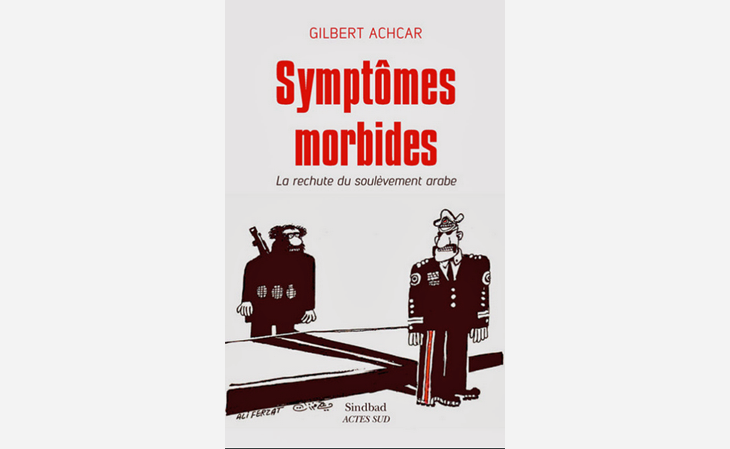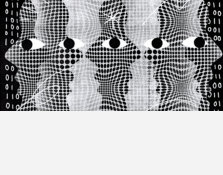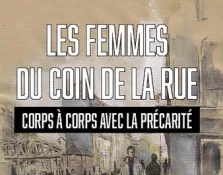10 février 2017 | tiré de mediapart.fr
Les exemples tunisiens et égyptiens étaient, selon lui, singuliers. La tentative de reproduire des processus révolutionnaires semblables au Yémen, en Libye, en Syrie ou à Bahreïn, s’est avérée vouée à l’échec. La tâche des révolutionnaires arabes s’est heurtée à la fois à des États qui n’étaient pas ceux des pays de l’Est que les « révolutions de velours » étaient parvenues à faire tomber, et à la tentation de s’allier avec des forces islamistes de nature, juge-t-il, « contre-révolutionnaire ».
S’il fallait d’emblée, estime Gilbert Achcar, « n’avoir aucune illusion quant à la possibilité que le soulèvement arabe puisse aboutir vite et paisiblement », il demeure des leçons stratégiques à tirer de cet échec d’une révolution qui s’est heurtée à deux contre-révolutions.
Comment expliquer ce que vous appelez la « rechute du soulèvement arabe » ?
Gilbert Achcar : S’il fallait ne retenir qu’une seule raison principale, ce serait l’absence d’expression politique organisée de ce que furent les aspirations de ces magnifiques révoltes. Les espoirs portés se sont souvent avérés être des illusions, parce qu’on a manqué de forces capables de mener jusqu’au bout le combat pour un changement social, économique et politique.
Qu’est-ce qui interdisait au soulèvement arabe de reproduire le modèle des « révolutions de velours », si ce facteur n’est pas à chercher du côté d’une inexistante spécificité religieuse ou culturelle des sociétés arabes ?
La raison principale est l’exception historique constituée par la nature de l’appareil étatique à l’est de l’Europe. Cet appareil était dirigé par des couches bureaucratiques non possédantes pouvant espérer se recycler dans une économie de marché : ce que beaucoup d’entre eux ont fait. Il n’existait donc pas, chez les dirigeants de l’est de l’Europe, le même acharnement à défendre l’ordre établi que chez des classes possédantes qui ont beaucoup plus à perdre.
Dans le monde arabe, la situation se trouve à l’exact opposé, avec des familles régnantes qui ont la mainmise sur des pans entiers de l’économie et du territoire et considérent l’État comme leur propriété privée. Dans le monde arabe, la concentration des richesses est exceptionnelle. Et même s’il existe parfois des parlements et des constitutions, on peut considérer qu’il s’agit de monarchies absolues, sans souveraineté démocratique et disposant de gardes prétoriennes.
N’est-il pas trop schématique de renvoyer dos à dos les partis islamistes et les tenants de l’ancien régime, comme deux forces contre-révolutionnaires symétriques ? Si l’on fait référence à l’Histoire, est-ce que les partis islamiques de type Ennahdha en Tunisie ou Frères musulmans en Égypte ne constituaient pas les représentants d’une bourgeoisie, certes conservatrice, mais prête à s’allier à des forces révolutionnaires ?
Une telle lecture serait envisageable s’il s’était agi de partis islamiques, mais non intégristes. Or les Frères musulmans ont une vision intégriste du monde et une vision théocratique de la politique. Il ne faut pas confondre les Frères musulmans, ni même Ennahdha avec, par exemple, l’AKP en Turquie, qui est issu d’une scission libérale des Frères musulmans turcs s’étant orientée vers un alliage de conservatisme social et de néolibéralisme économique.
Même si les Frères musulmans avaient, au départ, une vision intégriste et théologique, est-ce qu’ils n’ont pas évolué vers un islam politique compatible avec la république et la démocratie ?
On a pu voir, grâce à la fuite d’une vidéo, que même Rached Ghannouchi, le leader d’Ennahdha en Tunisie, ne tenait pas le même discours quand il s’adressait à des salafistes ou à un journal occidental. Qu’il tienne un double discours signifie qu’à l’intérieur même d’Ennahdha, il existe à la fois des intégristes purs et durs et des personnes ayant une conception plus libérale des choses. Mais Ennahdha n’a pas effectué le processus de décantation qui serait nécessaire pour s’émanciper de la famille intégriste. Ils continuent de placer le religieux au centre de leurs actions et de leur programme.
On peut, bien sûr, convoquer une même référence avec des organisations et des buts dissemblables. En Italie, dans les années 1970, le communisme était à la fois revendiqué par les Brigades rouges et le Parti communiste italien, très réformiste. Mais les Frères musulmans en Égypte, ou Ennahdha en Tunisie, demeurent dominés par les radicaux et les exaltés. Quand ils sont parvenus au pouvoir, ils ont arc-bouté la société contre eux, ce qui n’a pas été le cas, au départ, en Turquie, même si Erdogan est désormais parti dans un délire mégalomaniaque. En 2011, lorsqu’il s’était rendu en Égypte, il avait choqué les Frères musulmans en évoquant l’importance de la laïcité, un mot que tous les intégristes du monde arabe considèrent aujourd’hui comme une telle insulte que la gauche frileuse n’ose même plus l’employer, pour se contenter de parler d’Etat civil…
C’est peut-être aussi lié au fait que des personnes comme Saddam Hussein ou Bachar al-Assad se présentaient comme des défenseurs de la laïcité ?
Pas du tout, c’est la France qui les présentait comme tels ! Saddam Hussein a fait de la surenchère religieuse. Si, en à peine un an, les Frères musulmans et le président Morsi ont réussi à braquer contre eux la société égyptienne, c’est bien parce qu’ils se sont rapidement placés dans une logique de monopolisation du pouvoir et de « frérisation » des institutions. On s’est vite aperçu de leur volonté de dévier le processus révolutionnaire dans une direction réactionnaire que beaucoup trouvaient pire que ce dont ils venaient de sortir, comme cela avait déjà été le cas en Iran après la révolution contre le Shah. La tragédie de la gauche égyptienne a été de passer d’une alliance avec les Frères à une alliance avec l’armée, ce qui a abouti au retour de la dictature militaire.
N’existe-t-il pas davantage de contre-pouvoirs aujourd’hui en Iran qu’en Égypte ?
Selon moi, l’Iran, qui est une « mollahrchie », est un pays beaucoup plus dictatorial que l’Égypte de Sissi. L’opposition égyptienne existe encore et Sissi est encore loin du compte macabre des opposants tués par le régime iranien. Sissi n’est pas tout-puissant, et est attaqué par la presse, notamment en raison d’une situation socio-économique qui le fragilise. En Iran, le président n’a pas de pouvoir réel, donc la presse peut le critiquer, mais elle ne peut rien dire sur le Guide suprême. Et le régime iranien est beaucoup plus solide que le régime égyptien, avec une clientèle sociale large liée à la rente pétrolière et l’État parallèle que constituent les Gardiens de la révolution, comme l’a montré l’écrasement précoce de la révolte de 2009.
Prenons le cas de votre pays d’origine, le Liban. Est-ce qu’on n’a pas là, avec le Hezbollah, l’exemple d’un parti islamique conservateur, qui joue le jeu de la démocratie à l’intérieur du pays, si on met de côté l’action de ses milices armées en Syrie et à la frontière d’Israël ?
Il joue le jeu parce que c’est son intérêt et parce que cela sert aujourd’hui son seul objectif, à savoir le contrôle de la communauté chiite. Ce contrôle a été imposé par la force en assassinant tous les intellectuels chiites marxistes et en s’arrogeant le monopole de la résistance à Israël qui avait pourtant été initiée par les communistes. Le Hezbollah s’est adapté, parce qu’il savait qu’il était impossible de convertir tous les chrétiens du Liban, mais cela aurait été différent s’il avait existé une majorité démographique chiite au Liban.
Quelles leçons stratégiques peut-on tirer de la situation, critique, des révoltes arabes, six ans après leur déclenchement ?
D’abord que toute révolution dont l’enjeu est un changement radical, socio-économique et pas seulement de régime politique, doit faire une analyse précise de l’appareil d’État à combattre. Dans les États arabes dont le fonctionnement rend impossible une transition pacifique, il n’existe pas d’autre choix, même si c’est très difficile, que de trouver des stratégies pour neutraliser l’appareil d’État afin qu’il n’écrase pas les mouvements révolutionnaires. Si on veut éviter un scénario de guerre civile, la seule issue est de saper et démanteler cet appareil d’État de l’intérieur. Aucune révolution ne parviendra à démanteler l’État militaro-sécuritaire, à moins de réussir à gagner le cœur et l’esprit des troupes, au lieu de commettre l’erreur fatale de chercher à obtenir le soutien de la hiérarchie, comme ce fut le cas en Égypte en 2011 et 2013.
Le cycle des révolutions est complexe, mais la situation semble aujourd’hui tragique pour de nombreux révolutionnaires arabes, dont beaucoup sont en prison, en exil. Qu’est-ce qui pourrait leur permettre de relever la tête ?
L’espoir demeure parce que, dans aucun pays, la base révolutionnaire qui avait déclenché l’explosion de 2011 n’a été complètement écrasée. C’est vrai en Égypte et même en Syrie, où une grande partie de celles et ceux qui ont déclenché le soulèvement de 2011 sont aujourd’hui en exil, parce qu’ils ne se sentaient en sécurité ni dans les régions tenues par le régime, ni dans les régions où étaient implantés les groupes armés. Le potentiel est aussi toujours présent en Égypte, où le mécontentement à l’encontre de Sissi ne cesse de monter au fur et à mesure qu’il continue d’appliquer les vieilles recettes du FMI, alors que les conditions de vie ne cessent de se dégrader. En Tunisie aussi, une explosion sociale n’est pas forcément éloignée.
Il est donc nécessaire de distinguer l’espoir de l’optimisme. Il n’existe pas beaucoup de raisons d’être optimiste, mais il reste des raisons d’espérer. On a une idée du pire, avec ce qui se passe en Syrie, et qui peut encore s’aggraver, mais cela ne signifie pas qu’il n’existe plus de potentiel. On a eu une première phase, qui a été une phase révolutionnaire, entre 2011 et 2013, puis un basculement contre-révolutionnaire à partir de 2013, avec le choc des deux pôles contre-révolutionnaires.
Le meilleur scénario envisageable est sans doute une coalition entre les deux pôles contre-révolutionnaires – l’ancien régime et les intégristes – qui permettrait dans l’immédiat d’éviter l’effusion de sang, et ensuite de favoriser la constitution d’un scénario classique opposant le camp de la révolution à celui de la contre-révolution. Cela diminuerait la tentation des progressistes de s’allier à l’un ou l’autre camp contre-révolutionnaire, puisque cela ne mène qu’à des désastres. Cependant, avec l’élection de Trump, il est à craindre que l’option retenue soit l’écrasement de tout ce qui n’est pas l’ancien régime, que ce soit une opposition progressiste ou islamiste. Ce n’est pas un hasard si le maréchal Sissi a été le premier dirigeant arabe à rencontrer Trump… Mais la gestion du cas iranien complique la situation et la rend incertaine.
La difficulté réside-t-elle aussi dans le fait que les peuples ne tolèrent guère les situations de chaos et qu’un processus révolutionnaire est nécessairement chaotique ?
Tout dépend du degré du chaos. S’il s’agit de la guerre de tous contre tous, dans un scénario à la Hobbes, alors la réponse probable est effectivement la toute-puissance du Léviathan. Mais si vous vous placez dans un schéma à la John Locke, le peuple peut s’accorder sur autre chose qu’une autocratie totalitaire. Ce qui se passe en Syrie permet de dire à tous les ennemis de la démocratie : « Regardez : c’est ou bien nous ou bien le cauchemar syrien. » Mais le monde arabe n’est pas condamné à une telle alternative.
Quelle serait la bonne attitude à adopter pour les Occidentaux vis-à-vis des peuples arabes et de leur désir d’émancipation ? En Libye, on a dit qu’il n’aurait pas fallu intervenir ; en Syrie qu’il aurait sans doute fallu ne pas laisser franchir certaines lignes rouges…
Encore une fois, le meilleur scénario demeure une conciliation entre les deux pôles contre-révolutionnaires, que l’Union européenne et les États-Unis peuvent encourager. Un prochain test va être le fait de déclarer les Frères musulmans comme organisation terroriste, auquel pousse Sissi. Il est tout à fait envisageable que Trump fasse équipe avec Poutine en soutenant les dictateurs. Poutine a ouvert le processus d’Astana pour montrer qu’il avait les cartes en main. Mais il est trop tôt pour savoir ce qui va se passer avec ce nouveau gouvernement états-unien.
Dans les prétendues républiques qu’étaient la Syrie ou la Libye, une transmission patrimoniale et familiale du pouvoir était en place ou en préparation. Ce genre de régime ne peut céder face à une révolution de velours. Il a trop à perdre. Une illusion de 2011 a été de croire en la possibilité d’un processus relativement pacifique, non violent. Cette illusion était liée à ce qui s’était passé d’abord en Tunisie, ensuite en Égypte : deux pays où on a pu confondre la chute d’un président avec un changement de régime.
Si ce scénario a été possible dans ces deux pays, c’est parce qu’ils n’avaient pas complété le processus de transformation vécu par la Syrie ou la Libye, et que l’État conservait une autonomie par rapport à la famille régnante. L’appareil d’État a ainsi pu se séparer du président, lorsque celui-ci s’est révélé être un poids mort, comme en Égypte, où le projet de Hosni Moubarak de transmettre le pouvoir à son fils s’est heurté à l’armée, qui constitue la véritable colonne vertébrale de l’État égyptien.
Cela était impensable en Irak, en Syrie, en Libye ou à Bahreïn, à moins d’un coup d’État ou d’une guerre civile. Or, même les coups d’État sont devenus très difficiles, bien que le monde arabe en ait connu plusieurs dans les années 1960, parce que les pouvoirs en place en ont tiré les leçons et ont solidifié leur ancrage sur la société et l’État.
Cette analyse plaiderait donc, paradoxalement, pour l’option de la militarisation de l’opposition en Syrie, dont on dit pourtant qu’elle a été voulue par le régime, qui préférait affronter une insurrection armée qu’il pouvait immédiatement taxer de « djihadiste » et « terroriste » ?
Dès février 2011, il était évident que ce qui s’était passé en Égypte ou en Tunisie demeurait impensable en Syrie et qu’il y aurait un bain de sang. L’opposition syrienne a voulu croire dans la possibilité d’un changement non violent en tablant sur l’exemple libyen et en se disant qu’Assad serait dissuadé par ce qui était arrivé à Kadhafi. L’opposition syrienne n’était pas préparée à combattre un tel régime, et n’a pas été aidée par les seuls susceptibles de l’aider, à savoir les Occidentaux.
En quoi le soulèvement arabe s’est-il principalement heurté au fait de n’être pas, selon vos mots, une « confrontation bipolaire entre révolution et contre-révolution comme dans la plupart des bouleversements révolutionnaires de l’Histoire, mais un conflit triangulaire entre un pôle révolutionnaire et deux camps contre-révolutionnaires rivaux » ?
À la difficulté d’affronter un système étatique en forme d’État patrimonial possédé par des familles régnantes, s’est ajoutée une autre dimension qui a compliqué la tâche du changement révolutionnaire. Pour des raisons historiques existait dans les pays arabes une opposition réactionnaire qui s’était développée depuis les années 1970, sous la forme de courants islamistes intégristes, propulsés initialement par le royaume saoudien, en accord avec les États-Unis, comme forces susceptibles de contrer le nationalisme arabe qui se radicalisait à gauche dans les années 1960. Après la défaite du nationalisme arabe, après la guerre de 1967, de larges pans de ce courant intégriste, largement instrumentalisé par les pouvoirs en place pour combattre la gauche, ont occupé la place de l’opposition laissée vacante par la gauche.
À l’échelle régionale, ce courant intégriste, dont le mouvement des Frères musulmans constituait l’expression la plus forte et organisée, se situait dans une opposition très dure, comme en Syrie où il était violemment réprimé, ou plus modérée, comme en Égypte, où il était toléré et instrumentalisé. Quand les soulèvements arabes ont débuté, les Frères musulmans se sont engouffrés dans la brèche, parce qu’ils possédaient les moyens manquant aux révolutionnaires. Ils ont alors tenté de dévoyer les révoltes et d’imposer leurs orientations qui n’en sont pas moins opposées aux aspirations de ceux qui ont été à l’initiative de l’explosion des tenants des anciens régimes.
On s’est donc retrouvé dans cette situation particulière où, face à un potentiel révolutionnaire, ne se trouvait pas un seul camp contre-révolutionnaire, mais deux pôles contre-révolutionnaires en concurrence. En raison de leur faiblesse politique et organisationnelle, ceux et celles qui croyaient sincèrement aux aspirations progressistes des soulèvements de 2011 ont passé des alliances avec les uns ou les autres, que ce soit avec les Frères musulmans ou avec des membres de l’ancien régime, comme on l’a vu avec le mouvement Tamarod en Égypte, qui avait pris la tête de la protestation contre le président élu Mohamed Morsi.
Le potentiel révolutionnaire a donc été progressivement marginalisé au profit d’un affrontement entre les deux autres pôles, affrontement qui domine la scène depuis 2013, dans des guerres civiles comme en Syrie, ou des confrontations brutales comme en Égypte. Au lieu d’une triangulation de la lutte espérée par certains révolutionnaires, on assiste à une opposition binaire non pas entre révolution et contre-révolution, mais entre deux camps contre-révolutionnaires.