Tiré de Médiapart.
KanapeutKanapeut (Québec, Canada).– À plus de huit heures de route de Montréal, la famille Kanapé se retrouve dans son campement, tout près de l’un des nombreux barrages que compte la province. Éric et Michel Kanapé, deux frères, font partie de ces Innus qui se sentent mieux dans la forêt que dans leur réserve.
Ils y ont construit de petits chalets et érigé des tentes traditionnelles pour accueillir les visiteurs voulant, eux aussi, reconquérir leur territoire, et renouer avec la culture qui y est attachée. Les fenêtres de leurs chalets donnent sur « le plus beau lac du coin » selon eux : le lac aux perles. Et leur jardin est fait de tapis de mousse et de sapins.
Pour rejoindre ce petit havre de paix, il faut longer le fleuve Saint-Laurent durant six heures depuis Montréal. Puis monter au nord et s’enfoncer dans la forêt, par une route de terre. Ce territoire qu’ils disent « traditionnel », les Innus l’appellent le « Nitassinan ». Il s’étend sur plus de 130 000 km2 et recèle deux ressources précieuses : un réseau de lacs et de rivières, ainsi que des forêts.
Le Nitassinan compte pas moins de 13 centrales hydroélectriques et 16 barrages. Le plus grand d’entre eux, surnommé « l’œil du Québec », est Manic-5. Hydro-Québec, la société d’État chargée de la production et de la distribution d’électricité hydraulique, a construit ces barrages et inondé par la même occasion des territoires entiers de chasse et de trappe des Innus. Jamais Hydro-Québec ne leur a demandé leur avis. Elle a pris, et n’a toujours rien donné en retour. Plusieurs dossiers de réclamations sont encore devant les tribunaux.
Les compagnies forestières ont aussi saigné à blanc ces forêts, transformant le paysage pour des décennies. Là encore, les Innus n’ont pas été consultés et ce n’est que récemment que la loi a obligé les entreprises à demander l’avis des autochtones pour chaque opération qu’elles comptent entreprendre sur les territoires qu’ils revendiquent.
Contraints de quitter ce territoire, les Innus ont dû s’installer dans des réserves, ces « prisons sans murs », comme certains les appellent. Un passage forcé du nomadisme à la sédentarisation qui a laissé des séquelles profondes et brisé leur lien avec leurs traditions.
Il est temps pour les Innus de se réapproprier ce territoire et de renouer avec leur culture. En ce vendredi, une vingtaine d’Innus de Pessamit, l’une des neuf réserves innues du Québec, est venue, invitée par Éric et Michel Kanapé, qui organisent des « week-ends de ressourcement », pour les autochtones mais pas seulement. Les Blancs sont aussi les bienvenus pour découvrir ce que l’école ne leur apprend que de façon rudimentaire sur ces premiers peuples.
Les gros pick-up sont prêts à partir pour poser des collets et des pièges à castors, comme le faisaient leurs ancêtres pas si lointains. Michel s’installe au volant. Accrochées à son rétroviseur, des serres d’un pygargue à tête blanche. « Quand je l’ai trouvé, il agonisait… J’ai abrégé ses souffrances et j’ai gardé ça », dit-il en levant le menton vers ce que certains appelleraient « un trophée ». Pas lui.
À côté de lui, son fusil. Michel ne quitte jamais le camp sans lui. On ne sait jamais. Il pourrait croiser un orignal (élan) ou une perdrix. À l’arrière de son camion, quelques hommes et femmes viennent de monter pour l’accompagner.
Avoir perdu le lien avec le territoire, intimement relié à leur culture, a été dévastateur pour beaucoup d’autochtones.
Durant le trajet, tous parlent leur langue : l’innu-aimun. Statistiques Canada dénombre environ 10 000 locuteurs alors que l’on comptait 20 000 Innus au Québec en 2021. La colonisation et les pensionnats, où pendant des décennies ont été envoyés les enfants des autochtones, parfois sans leur accord, sont à l’origine du déclin de toutes les langues autochtones au pays. Malgré les efforts mis en place pour les revitaliser, leur futur est encore incertain.
Pourtant, la langue est intimement liée à la culture et révèle la manière de penser des Innus. Les traductions sont complexes. « Tshinashkumitim », utilisé par exemple pour dire « merci », signifie : « Je te donne une outarde en remerciement ». Et le mot en innu-aimun pour désigner « les Français » est en fait : « Les gens venus avec de grands bateaux en bois ».
Certains des participants, comme l’aînée, Delvina Collard, ont vécu dans la forêt avant d’être obligés de se sédentariser. Comme beaucoup d’Innus, Delvina est une femme de peu de mots. Et comme beaucoup d’Innus aussi, elle a le rire facile. Aujourd’hui, elle fabrique du pain banik, ce pain traditionnel autochtone. Les ingrédients sont simples. La technique un peu moins. C’est dans la forêt qu’elle a appris tout ce qu’elle sait aujourd’hui. Delvina fait aussi partie des chanceuses qui n’ont pas été au pensionnat.
Avoir perdu ce lien avec le territoire, intimement relié à leur culture, a été dévastateur pour beaucoup d’autochtones. Tous, au camp des Kanapé, baptisé Kanapeut, le savent.
Lorsque Éric Kanapé observe les collines désormais nues à cause des entreprises forestières, il a une pensée pour sa mère. « La dernière fois qu’elle a vu son territoire avant de décéder, il était comme ça. C’est avec cette image en tête qu’elle est partie. Moi-même, je ne reverrai jamais notre territoire comme il a été auparavant », dit-il.
Un paysage défiguré
À 49 ans, Michel, qui a vécu dans le bois jusqu’à son adolescence, se souvient des sept kilomètres qu’il devait régulièrement parcourir en tirant son traîneau sur lequel reposait de la viande, car sa famille déménageait le camp.
« Le territoire a changé, mais nous aussi. Aujourd’hui, il est plus facilement accessible en voiture. Ces changements ne nous empêchent pas de pratiquer nos activités traditionnelles », explique Michel alors qu’il revient de sa petite expédition avec quelques participants.
Diane Riverin, 65 ans, est restée au camp avec Delvina notamment. Dans la grande cuisine installée sous une immense tente, elle dépèce un lièvre au pelage gris, presque blanc, alors que plusieurs personnes filment la scène. « C’est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir retourner dans le territoire comme ça. À Pessamit, nos jeunes s’ennuient, alors qu’ici on est occupés toute la journée », dit-elle en tirant de toutes ses forces sur la douce fourrure de l’animal.
À côté d’elle, Nancy Hervieux et Daisy Bellefleur insèrent la farce dans un intestin d’orignal pendant qu’Annuk St-Onge prépare un thé. Ce soir, un grand banquet est prévu. Au menu : boudin d’orignal, pain banik, castor et lièvre. À l’extérieur, Willis, le plus jeune du groupe, ne manque pas une miette des explications de Michel qui lui apprend à découper le castor qu’ils viennent de récupérer. Le piège installé la veille a eu raison du mammifère.
Les drames ne se comptent plus dans la communauté
Tout sera mangé. Car les Innus ne gâchent rien. Au fil des siècles, ils ont gardé cette tradition de rendre honneur à l’animal et d’utiliser tout ce qu’ils peuvent utiliser. La peau, les boyaux, les os… même la queue du castor sera utilisée pour faire de la graisse. « Si les sabots de l’orignal se mangeaient, on les mangerait ! », lance Michel.
D’ailleurs, avant de commencer le festin, Michael Kanapé, un cousin des deux frères, a pris quelques minutes pour remercier les animaux qui vont remplir les ventres ce soir. La petite prière s’est faite en innu.
Quelques heures plus tôt, il a dirigé une cérémonie dans la tente à sudation installée au bord du lac. Dans cette sorte de hutte, le sol est tapissé de branches de sapin et une fosse est creusée pour recevoir des pierres chauffées. Seule une poignée d’Innus y a participé.
C’est le cas de Nathalie Hervieux. Elle revient du bord du lac en réajustant la jupe traditionnelle qu’elle a revêtue pour la cérémonie. La douceur de Nathalie cache des blessures profondes. La femme a subi de nombreuses agressions sexuelles et viols durant sa jeunesse. Son frère a tué son père. Son beau-frère a tué sa sœur. Fièrement, elle annonce que cela fait plus de vingt ans qu’elle n’a pas touché une goutte d’alcool.
Aujourd’hui, elle aide les autres femmes à ouvrir leur cœur et à leur délier la langue. « Parler fait partie de la guérison. Pour arrêter de s’en vouloir. D’être en colère. Moi maintenant je veux écrire un livre et y raconter mon histoire », dit-elle en réajustant son bonnet aux couleurs de la nation innue.
Les drames ne se comptent plus dans les communautés autochtones canadiennes. Violence, drogue, suicide, pauvreté, absence d’eau potable… Rares sont celles et ceux qui y ont échappé.
Pourtant, quiconque rencontre les Innus pour la première fois ne se doute pas de tous ces traumatismes. Jamais les rires n’auront autant résonné dans cette forêt de sapins. Ce n’est pas pour rien que les Innus sont surnommés « le peuple rieur ». Dès le réveil, aux aurores, ils rient à gorge déployée, enchaînent blagues et taquineries.
Il n’y a qu’au moment de la messe où les larmes prennent le dessus. Évangélisés par les prêtres oblats, beaucoup d’Innus sont encore très croyants, malgré les abus que certains hommes d’Église ont pu faire subir à leurs frères et sœurs.
Autour de la grande table de la cuisine, la majorité des participants sont réunis, chapelet en main. Au milieu trône une Bible traduite dans leur langue. « J’ai prié pour nos enfants… qu’ils trouvent la lumière. J’ai aussi prié pour les parents qui font face à des problèmes de boisson, de drogue. On se sent impuissant », explique Diane.
La (longue) prière terminée, les regards fixés sur les mains se relèvent. Une femme lance une blague. Tout le monde rit. Et la vie continue. Le groupe s’active pour confectionner un petit fagot de branches fines de mélèze pour en faire une tisane.
Les Innus sont avares de mots lorsqu’on leur demande ce que ça leur fait de se trouver sur ce territoire. C’est avant tout leurs visages qu’il faut lire. Mais après quelques secondes de silence, certains lâchent : « Ça me fait du bien », « Je me sens à ma place », « Ça fait des années que je rêve de venir ici », « Ici, je suis dans l’instant présent, pas comme lorsque je suis dans la réserve ».
Le dimanche, un bus arrive pour chercher les visiteurs et les ramener à Pessamit. Tous se placent en cercle pour entendre Delvina, l’aînée. Sourires, larmes, les adieux passent par de nombreuses émotions. « Il faut qu’on se batte pour protéger notre territoire, conclut Annuk Saint-Onge. Encore. Comme les Mohawks se sont battus. Mon peuple se tait encore trop. »
Delphine Jung







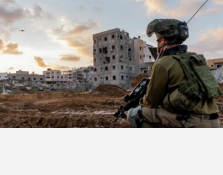
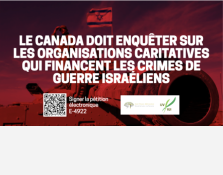





Un message, un commentaire ?