Tiré du blogue de Christine Delphy.
Autant de phénomènes qui, jusqu’à la fin des années 1970, ne portaient même pas de nom. À cet égard, nous savons que le mouvement des femmes a été fondamental pour une prise de conscience, pour la production d’un savoir et l’éveil d’une résistance. Il a remis en question les modèles naturalistes et psychologisants de la violence, a révélé au grand jour le réseau des complicités – souvent institutionnelles – qui permettent à l’homme violent de continuer à agir sans jamais être dérangé et en toute impunité ; ce sont les femmes en mouvement qui ont conçu, proposé et parfois imposé toute une série de mesures pour contrer cette violence.
Le chemin accompli au long des trente dernières années est de ce fait considérable. Bon nombre de pays industrialisés ont introduit des changements importants dans leur législation. Ainsi, en 1981, l’Italie a-t-elle vu l’abolition du « crime d’honneur », notion juridique qui réduisait de façon draconienne la peine infligée aux assassins de conjoint-e-s, de fille ou de sœur – lorsque l’on considérait que le comportement sexuel de ces dernièr-e-s avait compromis « leur honneur et celui de la famille ». En Europe, la plupart des Etats ont fini par abroger également la prétendue « exception conjugale » qui autorisait que le viol d’une femme par son mari ne soit pas considéré comme un délit (quelques dates récentes : 1980 en France, 1991 en Hollande, 1994 au Royaume-Uni, 1997 en Allemagne).
Au cours des deux dernières décennies du 20e siècle, on a vu de nombreuses organisations internationales – ONU, Unicef, OMS, Amnesty International – et bon nombre de gouvernements déclarer officiellement que la violence contre les femmes et les mineur-e-s en est une inacceptable violation des droits humains, entraînant des conséquences tragiques non seulement pour les victimes mais pour l’ensemble de la société, et donc faisant obstacle au développement. Même la Banque mondiale a souligné l’énorme coût économique engendré par cette violence (Heise et al., 1994). Dans les pays industrialisés comme dans divers pays en voie de développement, des centres anti-violence et des refuges pour femmes battues sont maintenant bien implantés. La plupart de ces lieux doivent leur existence au travail sur le terrain, théorique et pratique, des associations féministes. Forces de l’ordre, travailleurs sociaux et personnels de la santé acceptent l’idée et sont même parfois demandeurs d’une formation sur le thème de la violence ; on voit se développer de nouveaux projets, de nouvelles procédures. Toutes ces initiatives se caractérisent par plus de réceptivité au problème, de compétence et d’efficacité pour le traiter.
Toutefois les raisons d’inquiétude ne manquent pas. Comme nous allons le voir, la plupart de ces conquêtes se sont avérées fragiles et contradictoires. Les nouvelles lois et de nouvelles pratiques sociales, certes émanant toutes d’une volonté d’arrêter les violences et de protéger leurs victimes, ont révélé leur inefficacité, voire se retournent contre les victimes elles-mêmes. Des comportements qu’on avait péniblement fait évoluer régressent à leur stade antérieur, impliquant déni de la violence et dénigrement des victimes. Alors qu’on n’arrive toujours pas à savoir si la fréquence des violences a été modifiée au fil des dernières années (autrement dit si elles ont diminué ou augmenté), de « nouvelles » formes de brutalité apparaissent : ainsi en va-t-il des violences dans les couples d’adolescents, du harcèlement sexuel des étudiantes, des viols de guerre et des viols en bande appelés « tournantes », de la pornographie organisée en réseaux « pédophiles » sur Internet ou des abus sexuels à caractère rituel sur des enfants.
Tout cela a de quoi décourager. C’est comme si, femmes, nous étions prises dans la nasse d’un filet extrêmement serré. Avoir lutté et lutter encore pour nous libérer, être parvenues à force d’efforts énormes à marquer des points dans cette libération… Et puis, chaque fois qu’il s’agit de s’en sortir définitivement, et surtout de faire en sorte que toutes s’en sortent, le filet se referme, nous renferme et nous recouvre à nouveau, toutes et chacune.
Des statistiques décourageantes
Maintenant passons-la au crible, cette violence sexuelle. Si l’on confronte les données dans leur ensemble – résultats d’études sur des échantillons représentatifs de la population et statistiques des plaintes déposées, des procédures et des jugements qui ont suivi -, il ressort que les chances que l’auteur d’un viol soit identifié et mis hors d’état de nuire sont minimes. En effet, seule une infime minorité des violences font l’objet d’une plainte, dont seule une petite partie aboutira à un procès ; au bout du compte, seule une dérisoire proportion des accusés sera reconnue coupable.
Aux Etats-Unis, on estime que seules 2 à 15 % des violences sexuelles sont dénoncées à la police ; et plus les victimes sont jeunes, plus le lien est étroit entre agresseur et victime (comme dans les cas d’inceste), plus les probabilités d’un dépôt de plainte sont réduites (Koss, 1992 et 1993). En Italie, ce n’est que la moitié des plaintes pour violences sexuelles qui débouchent sur un procès avec au bout à peine plus de la moitié des accusés condamnés (Terragni, 1997). En France, une recherche auprès du Tribunal de Créteil montre que le devenir des plaintes pour viol est « plus que douteux » et que le taux de classement sans suite est très élevé (Brachet et Iff, 2000, cité par Lieber, 2005).
Ces états de fait sont loin d’être nouveaux. C’est ce qui a d’ailleurs décidé certains Etats à apporter des réformes dans leurs services sociaux et de santé publique, à améliorer les procédures de leur police et de leur système judiciaire (Lees, 1996). Quoi qu’il en soit, des recherches récentes nous prouvent qu’au cours des dernières années la situation a empiré, et ce dans bon nombre de pays ; en définitive, tandis que d’un côté les cas signalés et dénoncés sont en augmentation constante, de l’autre les enquêtes menées, les procès intentés et les condamnations prononcées voient baisser leur pourcentage.
Concernant les mineur-e-s, aux Etats-Unis par exemple, une étude menée à l’échelle de la population (National Incidence Study) rapporte qu’en 1986, 75 % des cas considérés comme très graves d’abus sexuels sur enfants (CSA, Child Sexual Abuse) faisaient l’objet d’une enquête ; en 1993, ce pourcentage avait baissé à 44 % (Bolen, Russell et Scannapieco, 2000). Les statistiques du ministère de l’Intérieur de Grande-Bretagne traduisent une tendance similaire : en 1985, sur 633 plaintes « de graves atteintes à la pudeur perpétrées sur des enfants de moins de 14 ans », on avait obtenu une condamnation dans 42 % des cas ; dix ans plus tard, en 1995, le nombre des plaintes avait doublé, mais le pourcentage des condamnations avait, lui, plus que nettement diminué : il était descendu à 12 % (Itzin, 2000). En ce qui concerne les viols, toujours en Grande-Bretagne, le nombre de plaintes déposées à la police est passé de 1 842 en 1985 à 4 589 en 1993, tandis que la proportion des condamnations traduit une baisse de plus de la moitié, passant de 24 % à 10 % (Lees, 1996). En France, la totalité des plaintes pour violence sexuelle est passée de 2 823 en 1986 à 5 068 en 1990-1991 : le pourcentage des condamnations a cependant baissé de 22 % à 14,5 % (Morbois et al.1994).
Pour autant, cette chute libre n’est imputable ni à une hypothétique atténuation de la gravité des faits ni à l’irrecevabilité des plaintes déposées : au cours de son étude, Sue Lees a vu des hommes relaxés alors qu’ils étaient accusés de violences gravissimes et répétées – parmi eux des serial rapists, violeurs en série contre lesquels les preuves à charge étaient écrasantes (Lees, 1996).
À chaque étape – révélation des faits, dépôt de plainte, enquête, instruction du procès, condamnation – toutes sortes de motifs sont invoqués pour « expliquer » qu’un tel fossé sépare la plainte de départ et l’issue finale. Une issue qui devrait être positive, donc impliquer protection, libération et dédommagement de la victime, non moins que condamnation et mise hors d’état de nuire de l’agresseur. Les dits motifs sont variables d’un pays à l’autre mais quelles qu’en soient les variantes, il est sidérant d’arriver au même constat : qu’on le veuille ou non, il s’avère que femmes et mineur-e-s victimes de violences sexuelles ne sont pas plus ni mieux protégé-e-s aujourd’hui que par le passé.
« Briser le silence » ?
« En cas de violence, brisez le silence1 ! », nous enjoint, en France, ce slogan qui date de 2001. Or, si on prenait la peine d’écouter les victimes – ou, plus exactement, les rescapées -, on découvrirait qu’elles sont fort nombreuses à avoir « brisé le silence », qu’elles ont bel et bien cherché de l’aide, et même de toutes sortes de manières, indirectes ou parfaitement explicites, au risque, d’ailleurs, de subir des violences ultérieures.
Lorsqu’on examine les affaires de viols paternels, on constate que souvent ce sont les mêmes éléments qui reviennent ; et cela, que les faits se situent au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, dans l’Afrique du Sud blanche ou en Italie. Par exemple : une petite fille raconte quelque chose – aux grands-parents, à l’école, aux copines de classe et aux parents de celles-ci. Les maîtresses remarquent qu’elle a des comportements « bizarres ». On l’envoie à l’hôpital, parce qu’elle peut avoir attrapé une maladie sexuellement transmissible ou parce qu’on constate qu’elle a été battue, et qu’elle a le nez cassé, les dents cassées, les côtes cassées, le tympan perforé. À part ça rien ne se passe. Adolescente, elle souffre de troubles du comportement, fait des cauchemars, est sujette à des accès de panique, et va jusqu’à la tentative de suicide ; mais personne, ni psychiatre, ni psychologue, ni assistante sociale ne lui demandent « pourquoi ». En revanche on lui administre des calmants. Si elle parle, on la traite de mythomane, de cabotine, d’exhibitionniste et bien sûr de menteuse ; si elle s’adresse à la police, on se moque d’elle et à nouveau elle est accusée de mensonge ; on la renvoie chez elle, non sans l’avoir menacée (Armstrong, 1993 ; Russell, 1997 ; Pearce, 2000). Bien que toutes les petites filles violées par leur père ne se retrouvent pas en face d’un tel mur d’incompréhension et ne soient pas en butte à un tel faisceau de complicités hostiles, il est effrayant de constater que cela se répète encore au jour d’aujourd’hui, dans autant de pays et de contextes différents.
Les recherches faites sur les femmes battues par leur partenaire s’accordent toutes sur ce point : seule une minorité de femmes garde le secret. Presque toutes en parlent, que ce soit à des amies, à quelqu’un de la famille et à des personnes institutionnelles tels que médecin ou gendarme. La réalité, c’est qu’elles sont rarement écoutées, crues, secourues ; de surcroît, il n’est pas rare qu’elles subissent insultes et menaces venant des personnes mêmes auxquelles elles ont demandé de l’aide (Romito, 2001 ; Creazzo, 2003).
Parce qu’il l’aimait trop…
Briser le silence : la presse s’y est mise aussi, exposant quantité de drames de la violence largement commentés, y compris par des éditorialistes de renom. Mais commentés comment ? En Italie, depuis le début des années 2000 en particulier, les journaux font leurs gros titres sur des affaires récurrentes de femmes et d’enfants assassinés par un mari et un père n’ayant pas supporté d’être quitté (il arrive que l’assassin se suicide, pour finir). Dans cette presse l’image prédominante est celle d’hommes qui « ont tué parce qu’ils aimaient trop » ou que « leur douleur était trop forte2 ». En filigrane, le « allant de soi » de la possession – « tu m’appartiens donc tu n’appartiendras à aucun autre » – et de la vengeance mise en acte par ces époux « dépossédés ». Exemples : A.M. égorge sa fille de 8 ans et dit le faire comme « punition contre son ex-femme » (janvier 2000). « Je voulais punir ma femme », dit lui aussi E.P. après avoir étranglé leur fils, également âgé de 8 ans (mai 2002). M.G. étrangle ses deux fils (septembre 2002) non sans avoir écrit à son ex-épouse : « J’espère que toute ta vie sera un cauchemar et que tu vivras assez longtemps pour souffrir de tes remords ». R.G. tue ses deux fils à coups de couteau (avril 2004) en hurlant à sa femme : « Je te les ai tués, comme ça tu sauras ce que c’est que de souffrir ».
Dans tous ces articles sont évoqués globalement des « conflits conjugaux », sans la moindre référence explicite à la violence exercée par ces hommes, violence qui fort probablement avait provoqué chez leur femme cet « abandon » – et la fuite. Si les journalistes enquêtaient ou du moins écoutaient et rendaient compte de ce que disent les épouses – quand elles vivent encore -, ainsi que leur famille et leurs voisins, leur enquête révélerait le plus souvent que ces femmes et leurs enfants ont été maltraités, et cela parfois depuis des années. En effet, la relation existant entre la violence sur la femme et celle exercée sur l’enfant est désormais avérée, de même qu’entre les violences perpétrées durant la vie commune et celles consécutives à la séparation. Aux Etats-Unis comme dans d’autres pays industrialisés, les hommes violents contre leur femme le sont également, pour une bonne moitié d’entre eux, contre leurs enfants (Edleson, 1999 ; Peled, 2000). Dans près de 80 % des cas, les femmes assassinées ont été tuées après des années de violences « conjugales » du partenaire, et généralement à la suite de la séparation ou du divorce (Campbell et al., 2003). En Italie, il a fallu attendre de véritables carnages (un homme quitté par sa femme tuant à coups de couteau toute la famille : épouse, belle-mère, jeune neveu et beau-frère ; un autre massacrant sept personnes : ex-femme, belle-mère, beau-frère et belle-sœur, voisins, puis se tuant lui-même, octobre 2002) pour que les médias finissent par évoquer timidement la violence « domestique » ou « conjugale »
Si je viens de citer de nombreux cas survenus en Italie, les lieux communs sur le « trop d’amour qui tue » ne sont pas une spécificité italienne ou méditerranéenne. Au Québec, de 1989 à 1998, plus de quatre cents femmes et une centaine de petites filles/petits garçons ont été assassinés par un homme – ex-partenaire et père -, après la séparation du couple ; or dans une émission télévisée très regardée au Québec, le reportage tourné dans la prison où certains de ces meurtriers purgent leur peine les présentait comme les « survivants d’une tragédie familial » (Dufresne, 1998). C’est de la même manière que certains médias s’emploient à accréditer la thèse selon laquelle des hommes tuent quand ils aiment ou souffrent trop – et non parce que ce sont des violents qui au bout d’années d’impunité pour les coups donnés voient d’un mauvais œil la limitation de leurs droits patriarcaux, et se vivent alors comme de pathétiques victimes, mais jamais comme agresseurs. En France, typique de ce « pathétique » relayé par de nombreux médias : Bertrand Cantat qui, au cours d’une « querelle de couple », et « poussé à bout » par un « trop plein de passion » a roué de coups sa compagne, Marie Trintignant, la laissant ensuite agoniser pendant des heures.
C’est exactement de cette manière que la presse mystifie les affaires de viol et tentatives de viol suivi de meurtre. Pour ne citer qu’un exemple, en Italie, le massacre d’une petite fille de onze ans perpétré par un homme adulte avec le concours d’une bande d’adolescents dans une bourgade du nord de l’Italie (octobre 2002) avait été commenté par les journalistes italiens non pas comme une production du système patriarcal mais comme le fruit « d’une société violente » dans laquelle « les jeunes » (terme employé au neutre, jamais au masculin) deviennent des « analphabètes de l’émotion3 ». D’une manière analogue, en France, la presse a présenté des cas de viols de groupe – dits « tournantes » – non pas comme une autre typologie de violence sexuelle et patriarcale mais comme un problème exclusif des banlieues et des jeunes hommes contraints d’y habiter – la plupart « issus de l’immigration » – et circonscrit à ce contexte (Mucchielli, 2005).
En définitive, on accepte de « briser le silence » à la seule condition que chaque épisode de violence soit présenté comme un cas isolé, et pourvu que les auteurs y apparaissent au cœur d’une situation d’exception – entre autres parce que sous l’emprise d’émotions incontrôlables, ou au contraire souffrant d’une absence pathologique desdites « émotions » ou encore parce « d’une autre culture » – entendons issus de l’immigration ou musulmans. Alors on veut bien, à la rigueur, parler de violence, mais jamais de violence masculine. Et là encore tout le monde, jusqu’à présent, s’est coulé dans cette convention. Quant aux documents officiels des organisations internationales et des gouvernements cités plus haut, ils parlent bien de violences exercées à l’encontre des femmes et des petites filles, mais ne les spécifient quasiment jamais en tant que violences masculines ; et pourtant ces textes décrivent des viols, ou traitent de la maltraitance ou encore évoquent des femmes assassinées par leur mari ou compagnon. Si par hasard on tombe sur tel document, telle publication internationale où au terme « violence »a été accolé l’épithète « masculine », l’effet produit est à peu près celui d’un coup de poing à l’estomac. Car c’est bien cet ajout qui nous oblige à voir en face une réalité brutale, réalité à laquelle d’ordinaire on prétend justement échapper en ayant recours à des euphémismes ou à des termes aussi génériques que vagues.
Beaucoup de bruit pour rien
En réalité, du silence on est passé au bruit : mais avec quelle réelle volonté d’envisager à fond la violence masculine et d’y faire obstacle ? Si l’on considère les agressions sexuelles intrafamiliales sur mineur-e-s, autrement dit l’inceste : jusqu’à la fin des années 1980 nous ne disposions d’aucune étude sérieuse sur le sujet. Ce sont les premiers travaux de chercheures féministes telles que Louise Armstrong (1978), Florence Rush (1980) et Diana Russell (1983, 1986) qui ont révélé à quel point l’inceste était une pratique répandue et, de fait, universellement tolérée – ce que confirment les recherches épidémiologiques les plus récentes. Aux Etats-Unis et en Europe, 5 à 10 % des petites filles et adolescentes ont subi des agressions sexuelles par un homme de la famille ; ces données sont d’ailleurs sous-estimées par rapport au phénomène, les recherches s’accordent toutes sur ce point (Bolen, Russell et Scannapieco, 2000).
Toutefois, Louise Armstrong signale aussi que dès la fin des années 1980 on assiste aux Etats-Unis à ce qu’elle définit – amère ironie – comme la naissance de « l’industrie de l’inceste » : une véritable cohorte de cliniciens et de conseillers et de thérapeutes et de spécialistes et de sommités et d’experts, tout à leur carrière ciblée sur tel ou tel aspect de l’inceste et de ses séquelles (Armstrong, 1996).
Il s’avère que les hommes violents étant trop nombreux et souvent trop « normaux » pour être criminalisés et punis, on a opté pour la stratégie consistant à médicaliser et professionnaliser le phénomène. À cet effet les experts ont inventé le concept de « familles incestueuses » pour couvrir ce qu’Armstrong définit – sans doute trop crûment pour ces mêmes experts comme the dreadful actuality of paternal child rape, « l’épouvantable réalité des enfants violés par leur père ». Ce qu’elle dit aussi, c’est que la question de l’inceste a basculé étrangement vite du politique à un « problème thérapeutique ». Alors elle pose la question : « Comment se fait-il qu’à peine deux décennies aient suffi pour passer du silence complet – avec secret forcé, étouffement des faits infligés aux enfants, au point qu’on ne pouvait donc même pas les entendre – à un degré de cacophonie tel que les voix de ces enfants, que les voix des femmes, une fois de plus, n’arrivent pas à se faire entendre de manière significative ? » (cité in Itzin, 2000 : 3).
À l’origine de ce vacarme, il y a, comme nous le verrons plus loin, aussi bien les professionnels concernés que des lobbies ou des individus qui a priori n’ont rien à voir entre eux. On trouvera donc des travailleurs de la santé qui vous parlent de gamines « nymphomanes », « séductrices », « comédiennes » (ou tout bonnement menteuses) et de mères « incestueuses » ou « complices » ; des psychologues et des avocats soutenant les thèses du « syndrome des fausses mémoires » et du « syndrome d’aliénation parentale », très en phase avec les lobbies de pères séparés ou divorcés qui organisent la défense des hommes accusés d’inceste ; bien sûr il y a les experts, ceux qui ont inventé le concept de failure to protect (incapacité à protéger) grâce auquel on stigmatise et condamne les mères qui n’ont pu épargner à leurs enfants la violence du père (et ce sont souvent ces mêmes experts qui les jugent « hystériques », « vindicatives » ou « paranoïaques » lorsqu’elles dénoncent les violences sexuelles paternelles) ; viennent alors ceux qui défendent la « pédophilie » à plus d’un titre, soit parce qu’ils envisagent l’inceste de manière positive au nom de « l’amour » entre adultes et enfants, soit parce qu’ils le considèrent comme une pratique « évoluée » : notion alimentée par certains artistes et critiques qui voient dans ladite pratique une chose amusante (cf. Lolita de Vladimir Nabokov4), ou alors une belle initiation à la sexualité (Le souffle au cœur, film de Louis Malle, 1970), ou encore traduisant l’avidité de gamines délurées et manipulatrices (L’Épouse libérée de Abraham Yehoshua, 2001). Enfin il y a monsieur – ou madame – Tout-le-monde, autrement dit celles et ceux qui ne peuvent tout bonnement pas « y » croire, pas admettre que ce soit si courant -ou alors « dans certains milieux peut-être ? » mais pas chez les gens bien ».
Devant un tel tableau, Armstrong tire la conclusion que tout ce bruit est bel et bien parvenu à faire taire les victimes, et surtout faire en sorte que les hommes continuent impunément à pratiquer l’inceste (Armstrong, 2000).
La faute des femmes
Un regard sur l’histoire est toujours précieux car il permet d’élargir notre champ de vision, même si en l’occurrence il multiplie nos sujets d’inquiétude. Voyons par exemple l’histoire récente de la prise de conscience par rapport aux violences sexuelles sur mineur-e-s : ce qui saute aux yeux, c’est l’alternance cyclique entre phases de révélation et phases d’occultation. Occultation parfois si brutale et phases apparemment si définitives qu’on pourrait comparer l’ensemble du processus au cours d’une rivière en terrain karstique, capable de s’y engouffrer pour y disparaître entièrement ! (Olafson, Corwin et Summit, 1993). Un cas exemplaire à ce titre : celui de Freud. Freud en effet eut bel et bien l’intuition que nombre de ses patientes avaient été abusées sexuellement par leur père ou par une figure paternelle. Il formula donc sa théorie à partir de la reconnaissance d’un traumatisme avéré, autrement dit d’une agression sexuelle. Puis il renversa complètement son schéma : aucune violence n’avait jamais eu lieu, les pères étaient innocents, les petites filles avaient désiré séduire leur père et avaient imaginé de la violence. Ainsi le « complexe d’Œdipe », soit le désir incestueux d’un enfant pour un parent de sexe opposé, est-il devenu le pilier de toute la théorie psychanalytique. Pourquoi Freud changea-t-il d’idée aussi radicalement ? Les recherches faites à ce sujet suggèrent que s’il revint sur sa première version c’est parce qu’il avait perçu l’incrédulité de ses confrères, et non pas à la suite d’un « remords » de type scientifique (Rush, 1980 ; Masson, 1984). En somme c’est sur la trahison des petites filles violées qu’a été bâtie la psychanalyse, et il aura donc fallu attendre quasiment un siècle pour que la violence paternelle redevienne visible. (Ce thème sera traité plus en détail dans le chapitre 4, 1.2, 3.1. et 3.2.)
Concernant la maltraitance masculine dans l’enceinte domestique, Linda Gordon (1988) – qui a étudié l’évolution des services sociaux de Boston dans leur approche théorique et pratique de la violence au foyer entre 1880 et 1960 – a relevé les faits suivants. À la fin du 19e siècle, les assistantes sociales étaient certes imprégnées du moralisme de l’époque mais la culture féministe exerçait son influence sur leur action : ainsi, quand les femmes des classes pauvres s’adressaient à elles parce que maltraitées par l’époux, ces femmes étaient crues et pouvaient compter recevoir de l’aide. Les personnels de l’assistance sociale identifiaient bien la source du problème chez les hommes violents, allaient chercher ceux-ci au domicile conjugal, sur leur lieu de travail ou au café, les confrontaient à leur victime, exigeaient qu’ils ramènent leur paye à la maison, et obtenaient même de les faire arrêter pour de courtes périodes.
À partir des années 1930, dans un contexte où le féminisme s’est affaibli, où le travail social s’est professionnalisé, les intervenant-e-s ne quittent pratiquement plus leurs bureaux et ne vont plus les chercher, ces hommes violents. Seules les femmes acceptent de se déplacer ; elles sont par ailleurs plus influençables, plus enclines à l’introspection. Ce sont alors les femmes battues – et non les hommes violents – qui deviennent le vrai cœur du problème. La formation des assistantes sociales va se « psychologiser » de plus en plus sous l’influence des idées freudiennes, au rang desquelles l’une de ses « sornettes » – comme les qualifie Gordon – ou fable selon laquelle « une femme dans sa maturité doit être capable de sacrifice et de renoncement ». Si par hasard la « femme mûre » en question se sacrifie plus que de mesure, de l’avis même de ces travailleurs sociaux, la voilà étiquetée « masochiste ». Moyennant quoi : la violence masculine est perçue en première instance comme le signe d’une inadéquation féminine ; quant à l’insistance des femmes battues à vouloir en attribuer la responsabilité aux maris, elle est taxée de comportement infantile, illustrant leur démission du rôle dévolu à la femme adulte (Gordon, 1988).
La réalité escamotée
Cet ouvrage a donc bien pour objectif d’analyser les mécanismes au travers desquels la société contemporaine est parvenue à occulter la violence masculine et à éviter de prendre les mesures qui pourraient l’empêcher. L’ambition est ici d’aller plus loin que le descriptif pur et simple afin d’esquisser des catégories de procédés d’occultation ; ces dernières nous serviront à décrypter de façon plus synthétique, plus efficace aussi une réalité souvent confuse, dont le poids d’atrocités accumulées a parfois de quoi nous écraser. Or, mettre à jour les procédés qui escamotent toute cette violence, c’est contribuer à y mettre un terme.
Au demeurant, vouloir que cessent les violences masculines reste un combat où de très nombreuses femmes se sont engagées, ainsi que certains hommes. Combat mené par les victimes qui ont survécu à ces violences et qui bien souvent arrivent à en tirer des leçons de vie, pour elles-mêmes et pour les autres. Combat des professionnelles qui les ont soutenues – infirmières, psychologues, assistantes sociales, enseignantes, femmes médecins, juges ou fonctionnaires de police – celles, et parfois ceux qui, dans leur travail quotidien, ont choisi de se mettre du côté de qui subit et non de qui inflige les violences. Combat des associations féministes (y compris celles qui ne se définissent pas forcément féministes) en lutte pour le respect des droits et de la dignité des femmes et des enfants.
Si j’ai voulu me concentrer sur les stratégies sociales d’occultation de la violence plutôt que sur les actions de la lutte, il va sans dire que celles-ci non seulement existent et sont souvent très courageuses, innovatrices et efficaces, mais qu’elles font partie intégrante de l’analyse développée dans ce livre ; car c’est bien parce que les femmes résistent, s’opposent et proposent des alternatives que la société fait tout pour les contrer, n’étant jamais à court pour inventer de nouvelles méthodes – plus – « modernes », mieux conçues – qui nient leurs droits et leur dignité. Nous verrons que la complexité de la plupart des stratégies d’occultation présentées dans ce livre est fonction, précisément, de l’énergie et de l’intelligence du mouvement des femmes, de la résistance de celles-ci, du combat qu’elles mènent sous toutes ses formes et à tous niveaux, individuel autant que collectif.
Une théorie « pour changer le monde »
Une fois admise l’idée que faire cesser les violences masculines relève d’un combat, il semble logique de se demander si un livre nourri de quelque ambition théorique sera l’outil idéal pour soutenir ce même combat ; il se pourrait que d’autres formes d’intervention intellectuelle – articles de vulgarisation, programmes de formation, débats – s’avèrent plus utiles. Robin Morgan, militante féministe et pacifiste, journaliste, écrivaine, poète, a bien traduit ce conflit entre désir d’écrire (en l’occurrence, pour elle, un roman) et sentiment de devoir faire « autre chose » (style : « monter sur les barricade ») ; elle n’oublie pas non plus la douloureuse question du sens que peut avoir d’écrire dans un monde où les deux tiers des analphabètes sont des femmes (Morgan, 1992)5. Elle raconte que pour finir, et avec la laïque bénédiction de Simone de Beauvoir, elle avait décidé de l’écrire, son roman, même si cela impliquait de faire passer provisoirement au second plan l’objectif de ses écrits militants. Et elle évoque alors Gerda Lerner (1986), qui revendiquait pour les femmes la nécessaire acquisition de la moins « féminine » des qualités, autrement dit cette hardiesse intellectuelle qui fonde notre droit à réorganiser le monde.
Toutefois, théoriser, ou tenter de faire de la théorie signifie aussi autre chose. La violence produit de la souffrance, et qui l’a subie en reste à jamais blessée, voire y succombe. En être témoin implique aussi bouleversement et blessure, car notre vision du monde et de la sécurité en sera définitivement ébranlée. Ecouter les femmes qui ont subi des violences, transcrire leurs témoignages, les analyser, en écrire nous fait voir le Mal en face ; alors ressurgissent certaines violences subies, douloureuses bien qu’enfouies dans la mémoire ou non identifiées comme telles ; nos certitudes sont mises à mal tout comme nos espérances pour « un monde juste » ; et, bien entendu, on se met à regarder tous les hommes avec suspicion et crainte, même ceux qui ne sont pas violents ou dont on espère qu’ils ne le soient jamais.
En bref, la confrontation avec la violence et la souffrance de ses victimes peut être dévastatrice pour les témoins aussi, et peut constituer une des motivations à produire de la théorie ; car faire de la théorie n’est-il pas le meilleur moyen de mettre une distance entre soi et le monde ? Christa Wolf (1993) ne dit pas autre chose quand elle note que l’esthétique, tout comme la philosophie et la science, n’a pas tant été inventée pour mieux approcher la réalité que dans le but de la repousser, de nous protéger d’elle.
Ecrit et théorie peuvent permettre à une victime de la violence d’objectiver les épreuves subies, et sont susceptibles de devenir un instrument de guérison, ou du moins de contrôle de la souffrance (Pennebaker, 1993). L’écrivaine bell hooks (sans majuscules, NdA), militante africaine-américaine, l’explique ainsi :
« Je me suis approchée de la théorie parce que j’étais en train de souffrir – et la douleur était si intense que je ne pouvais pas continuer à vivre. Je suis arrivée à la théorie désespérée, avec le désir de comprendre – de chercher à empoigner ce qui arrivait autour de moi et en moi. Plus crucial encore, je voulais que la douleur s’en aille. C’est alors que j’ai vu dans la théorie un espace de guérison. » (1994 : 59)
Cette voie, aussi légitime soit-elle pour les victimes de violences, comporte cependant des aspects inquiétants pour celle ou celui qui en témoigne. Se distancier de la souffrance d’autrui et l’objectiver ne revient pas seulement à porter sur le monde ce type de regard auquel nous a habitué la science traditionnelle ; cela renvoie à ce qui caractérise précisément la capacité d’infliger la douleur, par conséquent de torturer et de violer. Réfléchissant sur la prostitution, et en particulier sur le cas de Green River, dans le nord-ouest des Etats-Unis – une cinquantaine de filles massacrées, dans l’indifférence de la police -, Margaret Baldwin (1992) se demande s’il est légitime de fonctionner avec les moyens rhétoriques et intellectuels de l’écriture : autrement dit exposer brillamment hypothèses et contre hypothèses, relever de subtiles nuances, soigner son style – alors que le « matériau » sur lequel on écrit est le massacre de femmes et de petites filles.
« Le carnage : l’échelle de ce carnage, sa quotidienneté, sa soi-disant fatalité ; les tortures, les viols, les meurtres, les coups, le désespoir, l’effondrement de la personnalité, l’extinction quasi totale de l’espoir chez les femmes dans la prostitution… Considérer comme un thème à discuter à coups d’arguments analytiques ce massacre de femmes… m’est apparu parfois comme un acte de barbarie (Baldwin, 1992). »
En outre surgit un autre risque : exploiter le malheur. Aux Etats-Unis, de nombreuses militantes n’ont pas manqué d’accuser des experts et des universitaires d’avoir édifié leur carrière sur la souffrance d’autrui, volant littéralement le travail et le savoir produit par les victimes de violence et par les femmes qui les soutiennent (Armstrong, 1996 ; Garrity, 2000). La situation en Italie est, du moins pour le moment, très différente : les fonds pour ce genre de recherche sont limités, et qui les entreprend en milieu universitaire encourt l’ostracisme plutôt que la gloire. Le climat pour ce type de recherche en France est d’ailleurs plus ou moins le même qu’en Italie. Il n’empêche que ce risque d’exploitation du malheur existe et que j’en suis consciente.
Pour conclure, disons que la théorie n’est pas automatiquement salvatrice, libératrice ni révolutionnaire. Elle remplit ces fonctions lorsqu’on lui demande de le faire et que nous orientons notre pensée à cette fin. D’après une phrase attribuée à divers grands hommes, de Lénine à Che Guevara en passant par Einstein (mais d’ailleurs, comme il se doit, à aucune femme), rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie. C’est ce qu’ont exprimé bien des féministes : « Si tu veux changer le monde, ta théorie a intérêt à être juste » (Ramazanoglu, 1989 : 12).
Comme écrire est ce que je sais faire, du moins c’est ce que je veux croire, ce livre répond donc bien à mon objectif, modeste dans sa forme – un écrit théorique – mais ambitieux dans son intention : que cette théorie contribue à… changer le monde.
Patrizia Romito : Un silence de mortes
Editions Syllepse 2006, 298 pages 25 euros
Notes
1. Assises nationales contre la violence faite aux femmes, La Sorbonne, Paris, 25 janvier 2001. Slogan repris depuis par le ministère des affaires sociales dont dépend en France le secrétariat aux droits des femmes (affichettes, dépliants).
2. Autres exemples choisis en Italie : à Trieste, B.Z. est massacrée à coups de couteau par son concubin, dont elle avait eu un enfant depuis peu. Motif : elle voulait le quitter. D’après le directeur des Services psychiatriques de la ville, l’homme « n’avait pas supporté la douleur insoutenable de son détachement » (Il Piccolo,6 mars 2002). À Cosenza, M.R.S. est assassinée par son ex-fiancé parce qu’elle refusait de revenir vivre avec lui. D’après F. Piperno, homme de gauche, adjoint au maire et professeur d’université, il s’agit d’un crime « dont l’amour est la cause », avec pour déclencheur décisif « la beauté de la jeune fille », ce qui « atteste d’une très forte dimension affective du crime », dimension, ajoute-t-il, qui sera toujours « un bien précieux » (La Repubblica,17 décembre 2002). NB : La Repubblica est un quotidien italien national, orienté plutôt à gauche. Il Piccolo, un quotidien de Trieste, NdT.
3. U. Galimberti, « Gli analfabeti delle emozioni » (Les analphabètes de l’émotion), in La Repubblica, 5 octobre 2002 : un long article, où il n’est précisé à aucun moment que les auteurs de ces violences sexuelles sont de sexe masculin.
4. Dans le cas de la Lolita de Nabokov, ce sont les critiques, plus que l’auteur lui-même, qui ont présenté (et présentent toujours) le thème du livre – soit les violences sexuelles d’un homme adulte sur une enfant de douze ans, la fille de sa femme – comme quelque chose d’amusant ou comme « une vraie histoire d’amour ». En Italie, des articles sont parus encore récemment dans les journaux et paraissent s’être donné le mot avec ces titres : « Pardon si je vous choque : il faudrait faire lire Lolita à l’école » (M. Cicala, Il Venerdì della Repubblica – supplément magazine paraissant le vendredi du quotidien déjà cité, 31 octobre 2003) ; et autre titre : « Lolita fait voler en éclats les vieux tabous » (M. Pasi, Il Corriere della Sera, 10 octobre 2003).
5. En Italie où je vis et travaille, la réalité est que 61 % de mes compatriotes ne lisent même pas un livre par an ; le quotidien le plus lu est la Gazzetta dello Sport. (Cf. La Repubblica,19 mai 2003 et 19 février 2004.)




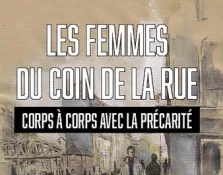

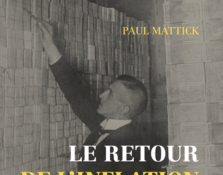





Un message, un commentaire ?