Mais pourquoi consommons-nous ? La réponse facile serait de dire que nous le faisons pour satisfaire des besoins. Avant d’en arriver toutefois à la consommation proprement dite, des préalables se révèlent nécessaires, c’est-à-dire une production ainsi qu’une acquisition de moyens pour concrétiser une consommation à partir de laquelle nos besoins seront comblés. En revanche, si nous produisons pour consommer, prétendrons-nous que nous consommons pour produire ? Dans ce dernier cas, le besoin ne serait-il pas disqualifié dans une certaine mesure ou alors habilement instrumentalisé pour devenir un « besoin de produire » qui court-circuite le cycle de production-consommation-satisfaction coutumier, d’après lequel le besoin désignerait, selon le sens commun, une nécessité à rencontrer sans quoi notre existence serait remise en cause ? Nous avancerions peut-être que ce besoin de produire s’avère essentiel en lui-même, car comment pourrions-nous consommer sans cela ?
Allons-y différemment. Dans la société primitive, la production et la consommation formaient le duo d’une économie de besoin, c’est-à-dire axée sur la subsistance et donc la suffisance. En faisant maintenant un bond qualitatif jusqu’à aujourd’hui, cette économie de besoin s’est largement modifiée pour devenir une économie de consommation, dont la suffisance fut remplacée par un souci de créer l’abondance, afin de viser l’accumulation. En lien avec cette dernière remarque, n’y a-t-il pas un problème à soulever dès le moment où nous percevons que nous consommons pour produire l’accumulation ? Nous insinuons ici que des producteurs-trices expriment leur besoin de notre consommation afin de l’encourager, la forcer, la manipuler, voire l’illusionner de manière à susciter notre intérêt envers les produits et les services vendables, au mieux – et c’est le but recherché – d’en faire de nouveaux besoins. Nul doute, parmi cette abondance il y a des besoins auxquels nous devons absolument pourvoir, parce qu’ils demeurent indispensables à notre survie et à notre bien-être. Par contre, « survie » et « bien-être » peuvent constituer des notions susceptibles d’être largement relativisées, selon le contexte, l’époque et même les gens.
Par exemple, si le téléphone intelligent possède aujourd’hui une valeur extrême pour plusieurs personnes, au point d’être élevé au statut de besoin quasi essentiel, l’histoire nous démontre que le monde pouvait fonctionner très bien sans lui, il n’y a pas si longtemps d’ailleurs. Par conséquent, pouvons-nous envisager cette technologie comme étant un faux besoin ? Oui, si nous considérons l’opinion qui réduit les besoins à des essentialités pour la subsistance. Or, selon un autre point de vue, même si un individu préférerait l’eau et la nourriture à tout autre chose pour assurer sa conservation, son voisin y ajouterait pourtant le fameux téléphone intelligent, puisque, pour lui, le « besoin de communiquer » ainsi que le « besoin d’en posséder un » s’associent à une image propagée en société selon laquelle cette possession qualifie désormais l’existence valable de l’individu de notre civilisation actuelle ; autrement dit, cet appareil sert à satisfaire à la fois un besoin « individuel » et « social » attribué à l’inclusion et au rang. Suivant cette explication, nous pourrions donc le classer dans la catégorie des « vrais » besoins.
Mais qu’est-ce qu’un vrai ou un faux besoin ? Tout dépendrait de l’individu qui s’exprime, compte tenu de l’individualisme en vogue qui participe d’ailleurs à un effet de personnalisation de la consommation. Est-ce cependant une réelle personnalisation que nous constatons, alors que les choix qui s’offrent à nous semblent suivre quelques modèles standards fournis en abondance par l’industrie ? Ce dernier aspect nous amène à nous questionner sur ce dilemme : est-ce la demande qui détermine l’offre ou plutôt l’offre qui fixe la demande ? Si les producteurs-trices-offreurs-euses nous informent de leur intérêt à connaître les goûts et les préférences des consommateurs-trices-demandeurs-euses, leur publicité s’en inspire certes et sollicite le désir dans le but d’inciter la consommation de leur offre somme toute limitée, en termes de concepts ou de modèles, mais diversifiée par ses « variantes » – couleurs, textures, grandeurs, etc. – laissant croire à une quantité de choix presque infinis pour la personnalisation.
Cet intérêt porté vers les goûts et les préférences de la clientèle sert plutôt à mieux évaluer sa sensibilité par rapport à une forme, une couleur ou un objet précis, en vue de susciter le désir, en premier lieu, puis de l’intensifier afin de le transformer en besoin par le biais d’une publicité itérative et d’une accoutumance assurée par les premiers actes d’achat, en second lieu. De là s’expose en partie l’exactitude de l’assertion voulant que nous consommons pour produire, dans le sens de « produire » toujours de nouveaux besoins de nature « sociale » et favorables à l’« esprit d’accumulation », afin de contraindre la contagion entre les individus qui devront s’adapter au nouveau standard ou à la nouvelle image projetée de la société par les offreurs-euses. Effectivement, il n’y a pas meilleure façon de créer le besoin que de spéculer sur la curiosité ou la surprise, en se rappelant David Hume et son Traité de la nature humaine, de provoquer les passions, de les aviver de manière à ce que leur apaisement surviendra uniquement lors de leur satisfaction, c’est-à-dire par la consommation. Voilà une manœuvre adaptée aux addictions, à savoir un processus qui capitalise à la fois sur le « besoin de consommer » et le « besoin d’être satisfait », synonyme de soulagement d’une vive émotion.
Le besoin de consommer tient compte d’un « besoin de posséder », précisément celui de devenir « propriétaire », d’assouvir assidûment une ambition bien connue, entre autres depuis le moment où l’esclave et le paysan ont voulu se sortir de l’esclavage ou du servage en cessant d’être les propriétés de quelqu’un pour devenir eux-mêmes propriétaires de leur milieu de vie. La possession ou la propriété excite bien sûr l’image de soi et contribue à la réalisation voulue d’un idéal de bonheur. La propriété, c’est l’expression du « pouvoir d’acquérir » qui valorise son détenteur ou sa détentrice, puisque « quelqu’un qui possède est riche ». Et cette perception associée à l’estime ou à la valorisation de soi rend l’acte d’achat ou de consommation beaucoup plus appréciable, flatte l’orgueil et la vanité, au point de continuellement vouloir recommencer.
Un monde de l’illusion se façonne grâce à la production-consommation, là où se multiplient les besoins, qu’ils soient vrais ou faux. Mais celui-ci se divise en deux : il y a le monde concret qui seul ne suffit pas, puisqu’il faut lui joindre un monde parallèle plus idyllique propice au rêve et à la folie des grandeurs. Songeons à l’idéalisme de l’autre monde proposé par la religion chrétienne, surtout au Moyen Âge et à la Renaissance, alors que les besoins de l’âme méritaient d’être satisfaits au même titre que les besoins du corps ; cette intention révélait le besoin de purifier l’âme, afin qu’elle puisse entrer au paradis ipso facto, d’où l’obligation de payer aux légats du pape des indulgences. Ainsi, par ce besoin de l’âme, le monde céleste et le monde terrestre étaient reliés. De la même façon de nos jours, la science a créé un monde virtuel, là où nous pouvons satisfaire nos rêves d’être quelqu’un d’autre, soit sur les réseaux sociaux avec des pseudonymes, soit par les jeux vidéo dans lesquels nos faiblesses s’effacent devant les pouvoirs du super héros que nous personnifions. Qui plus est, Internet nous permet en quelques clics de voyager, de magasiner, de combler nos attentes jusque-là inaccessibles, mais qui exigent, comme les indulgences ouvrant la porte du paradis, de se servir du monde réel pour entretenir notre besoin d’expression du « pouvoir d’acquérir ».
Finalement, consommer pour produire suppose l’intermédiaire d’un moyen pour réaliser les deux ; de là se découvre l’argent à la fois désiré et désirable par quiconque, soumis à une sacralisation pour devenir une fin recherchée, se transfigurant donc en un besoin capital, parce qu’il symbolise le bonheur et la satisfaction absolue. Voici ce que nous pouvons déduire : nous consommons pour satisfaire les besoins d’argent des producteurs-trices ; pour combler nos besoins générés sous l’influence des producteurs-trices ; pour vivre et survivre dans un monde de modèles fabriqués par des producteurs-trices ; pour exposer notre attitude de fidèles assidus au culte de l’accumulation du système économique prêché par les producteurs-trices ; aussi parce que nous souffrons d’une addiction à la consommation possible seulement par la production ; parce que nous voulons posséder à notre tour comme les producteurs-trices ; et parce que nous éprouvons le besoin d’être ailleurs. Nous consommons donc par obligation, par exploitation de nos passions, mais aussi parce que cela nous fait du bien, même si ce que nous achetons peut être néfaste pour notre développement, puisque se sentir bien équivaut à toucher le bonheur, et le bonheur dans la vie est un besoin essentiel.
Écrit par Guylain Bernier
Bibliographie
ARISTOTE (1881), La Politique, Paris, Garnier Frères.
BAUDRILLARD, Jean (1970), La société de consommation. Ses mythes. Ses structures, Paris, Denoël, Collection folio/essais.
HUME, David (2006), Traité de la nature humaine. Essai pour introduire une méthode expérimentale de raisonnement dans les systèmes moraux. Livre II : Des passions [1739], traduction originale de M. Philippe Folliot, édition numérique, Chicoutimi, Philippe Folliot en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l’Université du Québec à Chicoutimi, Collection « Les classiques des sciences sociales ».
LALONDE, Michel (1997), « Chapitre 9. Le travail » dans Comprendre la société. Une introduction aux sciences sociales, Sainte-Foy et Rennes, Télé-Université-Université du Québec/Presses Universitaires de Rennes, p. 311-352.
MARX, Karl (1963), Le Capital. Livre I [1867], Paris, Gallimard, Collection folio/essais.






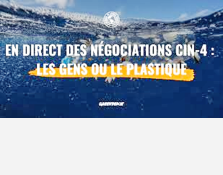


Un message, un commentaire ?