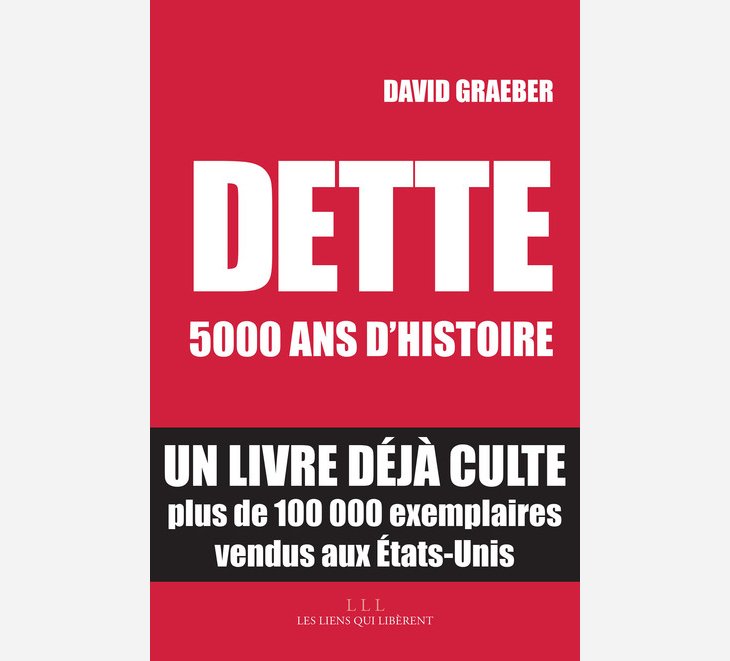Une chose est claire : des idées nouvelles ne pourront émerger que lorsque nous aurons jeté aux orties nombre de nos catégories de pensée familières – qui sont devenues un poids mort, voire des rouages du mécanisme de la désespérance – et que nous en aurons formulé d’autres. C’est pour cela que, dans ce livre, j’ai autant parlé du marché, mais aussi du faux choix entre l’État et le marché, qui a tant monopolisé l’idéologie politique au cours des derniers siècles qu’il a rendu bien difficile de raisonner sur autre chose.
L’histoire réelle des marchés ne ressemble en rien à la façon dont on nous a appris à la penser. Manifestement, les tout premiers marchés que nous pouvons observer sont plus ou moins des débordements, des effets secondaires des systèmes administratifs complexes de la Mésopotamie antique. Ils opèrent essentiellement à crédit. Puis les marchés au comptant naissent de la guerre : là encore, essentiellement à travers des politiques de l’impôt et du tribut d’abord conçues pour approvisionner les soldats, mais qui vont rendre aussi, par la suite, bien d’autres services. Ce n’est qu’au Moyen Âge, avec son retour aux systèmes de crédit, qu’émergent les premières expressions de ce qu’on pourrait appeler le « populisme de marché » : l’idée selon laquelle les marchés peuvent exister au-delà de l’État, contre lui et en dehors de lui, comme ceux de l’océan Indien musulman – idée qui réapparaît plus tard en Chine avec les grandes révoltes de l’argent métal au xve siècle. Cette émergence a lieu, en général, dans des situations où les marchands, pour diverses raisons, font cause commune avec le peuple contre l’appareil administratif d’un grand État.
Mais le populisme de marché est toujours riche en paradoxes, parce qu’il dépend encore dans une certaine mesure de l’existence de l’État [1] , et surtout parce qu’il a besoin que les relations de marché reposent en dernière analyse sur autre chose que le pur calcul : des codes de l’honneur, la confiance, et finalement la communauté et l’entraide, réalités plutôt typiques des économies humaines. Autant dire qu’il relègue la concurrence à un rôle assez mineur. Sous cet éclairage, nous voyons bien ce qu’a fait en dernière analyse Adam Smith quand il a créé son utopie du marché sans dettes : il a fusionné des éléments de cet improbable héritage avec la conception exceptionnellement militariste du comportement de marché caractéristique de l’Occident chrétien. Ce faisant, il a sûrement fait œuvre de prescience. Mais, comme tous les auteurs extraordinairement influents, il n’a fait aussi que saisir quelque chose de l’esprit émergent de son temps. Depuis, nous assistons aux retours de balancier d’une compétition politique sans fin entre deux formes de populisme – celui de l’État et celui du marché –, et nul ne se rend compte que l’on parle des flancs gauche et droit du même animal.
La grande raison qui nous rend incapables de le remarquer, à mon sens, est l’héritage de la violence, qui a tout déformé autour de nous. Guerre, conquête et esclavage n’ont pas seulement joué un rôle central dans la conversion des économies humaines en économies de marché ; toutes les institutions de notre société sans exception ont subi à quelque degré leur impact. L’histoire, relatée à la fin du chapitre 7, de la métamorphose de notre idée même de la « liberté » – passée, à travers l’institution romaine de l’esclavage, de la capacité de se faire des amis et d’établir des relations morales avec les autres à des rêves incohérents de pouvoir absolu – n’est peut-être que le cas le plus spectaculaire, et le plus insidieux, parce qu’il rend bien difficile d’imaginer à quoi peut ressembler une liberté humaine sérieuse [2].
Si ce livre a montré quelque chose, c’est combien de violence il a fallu, au fil de l’histoire de l’humanité, pour nous conduire à une situation où il est même possible d’imaginer que ce qui compte vraiment dans la vie, c’est cela. Notamment quand on pense qu’une large part de notre expérience quotidienne le contredit directement. Comme je l’ai souligné, le communisme est peut-être le socle de tous les rapports humains – ce communisme qui, dans notre vie quotidienne, se manifeste surtout dans ce que nous appelons « l’amour » –, mais il y a toujours par-dessus un certain système d’échange, et aussi, en général, un système hiérarchique. Les systèmes d’échange peuvent prendre des formes d’une infinie diversité, dont beaucoup sont parfaitement inoffensives. Mais celui dont nous parlons ici est un type d’échange bien particulier, fondé sur le calcul. Je l’ai dit dès le tout début : la différence entre la faveur que l’on doit à quelqu’un et la dette, c’est que le montant de la dette peut être calculé avec précision.
Le calcul exige l’équivalence. Et l’équivalence – notamment quand elle est établie entre des êtres humains (et elle commence apparemment toujours ainsi, parce qu’au début les humains sont toujours les valeurs ultimes) – n’apparaît que lorsqu’on a coupé des personnes de leur contexte par la force au point de pouvoir les traiter comme identiques à autre chose : « sept peaux de martre et douze grosses bagues d’argent contre la restitution de ton frère captif », « une de tes trois filles en gage pour ce prêt de cent cinquante boisseaux de grain »... Cela conduit à la grande réalité embarrassante qui hante toutes les tentatives pour présenter le marché comme la forme la plus haute de la liberté humaine : historiquement, les marchés commerciaux impersonnels sont nés du vol. L’inlassable récitation du mythe du troc, utilisée comme une incantation, est avant tout pour les économistes une façon de conjurer le risque de devoir regarder en face cette réalité.
Mais un instant de réflexion suffit pour voir que c’est une évidence. Qui pouvait bien être, au juste, le premier homme qui a regardé une maison pleine d’objets divers et les a évalués immédiatement dans les seuls termes de ce qu’il pourrait obtenir en les échangeant sur le marché ? Ce ne pouvait être qu’un voleur. Les cambrioleurs, les soldats en maraude et plus tard, peut-être, les agents de recouvrement ont été les premiers à voir le monde de cette façon. C’est seulement entre les mains de soldats qui venaient de piller des bourgs et des villes que les morceaux d’or ou d’argent – fondus pour la plupart à partir d’un précieux trésor de famille qui, comme les dieux du Cachemire, les plaques pectorales aztèques ou les anneaux de cheville des Babyloniennes, était à la fois une œuvre d’art et un petit condensé d’histoire – ont pu devenir des unités monétaires simples, uniformes, sans histoire, précieuses justement parce qu’elles n’en avaient pas, parce qu’on allait les accepter partout, sans poser de questions. Et cela reste vrai. Tout système qui réduit le monde à des chiffres ne peut être maintenu que par les armes, qu’il s’agisse d’épées et de gourdins ou de « bombes intelligentes » portées par des drones sans pilote.
De plus, il ne peut fonctionner qu’en transformant continuellement l’amour en dette. Je sais bien que, dans l’usage que je fais ici de ce mot, « amour » est encore plus provocateur, à sa façon, que « communisme ». Mais il importe de marquer les esprits. De même que les marchés, quand on les laisse dériver en toute liberté loin de leurs origines violentes, se mettent invariablement à se transformer en autre chose – en réseaux d’honneur, de confiance et de liens mutuels –, de même le maintien de systèmes de coercition effectue constamment l’opération inverse : il prend les produits de la coopération, de la créativité, du dévouement, de la confiance et de l’amour humains et en refait des chiffres. Ce faisant, il permet d’imaginer un monde qui se résume à une série de froids calculs. Plus encore, en transformant la sociabilité humaine elle-même en dettes, il métamorphose les fondements mêmes de ce que nous sommes – car que sommes-nous, en définitive, sinon la somme de nos relations avec d’autres ? – en des questions de faute, de péché et de crime, et il fait du monde un lieu d’iniquité que l’on ne pourra vaincre qu’en menant à son terme quelque grande transaction cosmique qui anéantira tout.
Essayer de tout inverser en demandant : « que devons-nous à la société ? », voire en parlant de notre « dette envers la nature » ou quelque autre manifestation du cosmos, est une fausse solution – rien d’autre qu’une tentative désespérée pour sauver quelque chose de la logique morale qui, au départ, nous a coupés du cosmos. Au fond, c’est l’apogée de ce processus, qui atteint ici un stade véritablement démentiel, puisque avancer de telles idées, c’est postuler que nous sommes dissociés du monde de façon si absolue et si radicale que nous pouvons mettre dans le même sac tous les autres humains – ou même toutes les autres créatures vivantes, ou le cosmos – et entamer une négociation avec eux. Il n’est guère surprenant que le résultat final, historiquement, soit de nous faire voir notre vie comme quelque chose que nous détenons sur de fausses bases, un emprunt depuis longtemps arrivé à échéance, et par conséquent de faire passer l’existence elle-même pour un crime. Mais si crime il y a ici, c’est le men- songe. La prémisse elle-même est mensongère. Qu’est-ce qui pourrait être plus présomptueux, ou plus ridicule, que de croire possible de négocier avec les fondements de sa propre existence ? Il est évident que c’est impossible. Dans la mesure où nous pouvons établir une relation quelconque avec l’Absolu, nous nous trouvons confrontés à un principe qui existe entièrement hors du temps, ou du temps humain ; donc, comme l’avaient bien vu les théologiens du Moyen Âge, quand on traite avec l’Absolu, il ne peut y avoir aucune dette.
Conclusion. Le monde vous doit peut-être de quoi vivre
Quand elle évoque de vastes questions historiques comme celles qui ont été traitées dans ce livre, la littérature économique existante sur le crédit et la banque n’est souvent guère plus, à mon sens, qu’un plaidoyer pour la défense d’intérêts particuliers. Certes, de grandes figures des débuts de la discipline, comme Adam Smith et David Ricardo, se méfiaient des systèmes de crédit, mais, dès le milieu du xixe siècle, les économistes qui s’intéressaient à ces questions ont cherché essentiellement à démontrer que, malgré les apparences, le système bancaire était en fait profondément démocratique. À en croire l’un des raisonnements les plus courants, il s’agissait en réalité d’un moyen de canaliser les ressources des « riches oisifs » (qui, trop peu imaginatifs pour investir eux-mêmes leur argent, le confiaient à d’autres) vers les « pauvres industrieux » (qui avaient l’énergie et l’esprit d’initiative nécessaires pour produire des richesses nouvelles). L’argument justifiait l’existence des banques, mais il renforçait aussi la position des populistes qui exigeaient des politiques monétaires souples, des mesures de protection pour les débiteurs, etc. : pourquoi, en temps d’épreuves, les pauvres industrieux – paysans, artisans et petits patrons – seraient-ils les seuls à souffrir ?
On a donc vu apparaître une deuxième argumentation : les riches, incontestablement, étaient les principaux créanciers dans le monde antique, mais aujourd’hui la situation s’est inversée. Voici ce que Ludwig von Mises écrivait dans les années 1930, à peu près au moment où Keynes préconisait l’euthanasie des rentiers : L’opinion publique a toujours eu un préjugé défavorable envers les créanciers.
Elle identifie créancier et riche oisif, tandis que les débiteurs seraient des pauvres industrieux. Elle déteste les premiers comme des exploiteurs impitoyables et s’apitoie sur les seconds comme d’innocentes victimes de l’oppression. Elle considère les mesures politiques visant à amputer les créances des prêteurs comme des actions extrêmement bénéfiques pour l’immense majorité, aux dépens d’une petite minorité d’usuriers sans entrailles. Elle n’a pas compris du tout que toutes les innovations capitalistes du xixe siècle ont complètement changé la composition des deux classes, créanciers et débiteurs. Aux jours de l’Athénien Solon, des anciennes lois agraires de Rome et du Moyen Âge, les prêteurs étaient en général les gens riches, et les emprunteurs les pauvres. Mais en cet âge de bons et d’obligations, de banques hypothécaires et de banques d’épargne, de polices d’assurance sur la vie et d’institutions de Sécurité sociale, les multitudes de gens à revenus modérés sont plutôt autant de créanciers [3] . Tandis que les riches, avec leurs compagnies qui usent et abusent du levier, sont aujourd’hui les principaux débiteurs. C’est l’argument de la « démocratisation de la finance », et il n’a rien de nouveau : chaque fois que certains appelleront à éliminer la classe qui vit de la perception d’intérêts, d’autres objecteront que cela détruirait les moyens d’existence des veuves et des retraités.
Le plus remarquable est qu’aujourd’hui les défenseurs du système financier sont souvent prêts à utiliser les deux arguments à la fois : ils recourent à l’un ou à l’autre selon la commodité rhétorique du moment.
D’un côté, nous avons des « commentateurs vedettes » comme Thomas Friedman, qui se félicite qu’aujourd’hui « tout le monde » possède un fragment d’Exxon ou du Mexique, et que les riches débiteurs soient donc responsables devant les pauvres. De l’autre, Niall Ferguson, auteur de L’Irrésistible Ascension de l’argent, publié en 2009, peut encore présenter comme l’une de ses grandes découvertes que la pauvreté ne résulte pas de l’exploitation des pauvres par des financiers rapaces, mais du manque d’institutions financières, de l’insuffisance d’établissements financiers et non de leur présence. Les emprunteurs n’échapperont aux griffes des usuriers qu’en ayant accès à des réseaux de crédit efficients, et c’est seulement quand les épargnants peuvent déposer leurs économies dans des établissements sûrs que celles-ci peuvent être redirigées des riches oisifs vers les pauvres industrieux [4].
Tel est l’état du débat dans la littérature économique orthodoxe. J’ai eu ici pour objectif moins de la prendre à partie directement que de montrer comment elle nous a constamment incités à poser les mauvaises questions. Ce dernier paragraphe en est un bel exemple. Que dit vraiment Ferguson ici ? La pauvreté est due à un manque de crédit. C’est seulement si les pauvres industrieux ont accès à des prêts consentis par des banques stables et respectables – et non des usuriers, ou, je suppose, des compagnies de cartes de crédit ou des officines de prêt sur salaire, qui aujourd’hui facturent des taux usuraires – qu’ils pourront sortir de la pauvreté. Autrement dit, Ferguson ne se préoccupe pas du tout de la « pauvreté », mais seulement de la pauvreté de certains, ceux qui sont industrieux, donc ne méritent pas d’être pauvres. Et les pauvres non industrieux ? Ils peuvent aller au diable, je présume (au sens littéral, selon de nombreuses confessions chrétiennes). Ou leurs bateaux seront peut-être soulevés par la marée montante. Mais c’est manifestement secondaire. Ils ne sont pas méritants puisqu’ils ne sont pas industrieux, donc ce qui leur arrive est hors sujet.
C’est exactement, à mon sens, ce qui est si pernicieux dans la morale de la dette : les impératifs financiers essaient constamment de nous réduire tous, malgré nous, à imiter les pillards, à regarder le monde en ne voyant que le monétisable – après quoi ils nous disent que seuls ceux qui acceptent de voir le monde comme les pillards méritent l’accès aux ressources nécessaires pour faire dans la vie autre chose que de l’argent. Ce qui introduit des perversions morales pratiquement à tous les niveaux. (« Annuler les dettes des prêts étudiants ? Mais ce serait injuste à l’égard de tous ceux qui ont sué sang et eau pendant des années pour rembourser les leurs ! » Puisque je me suis moi-même démené pendant des années pour rembourser les miens et que j’ai fini par le faire, je garantis au lecteur que ce raisonnement est aussi sensé que de dire qu’il serait « injuste » à l’égard de la victime d’un cambriolage de ne pas cambrioler aussi ses voisins.) Peut-être cette logique aurait-elle un sens si l’on admettait son postulat implicite : le travail est vertueux par définition, puisque la mesure ultime du succès de l’humanité en tant qu’espèce est son aptitude à accroître la production mondiale de biens et services d’au moins 5 % par an.
Le problème est qu’il devient toujours plus évident que nous ne pouvons pas poursuivre sur cette voie bien longtemps : si nous le faisons, il est probable que nous allons tout détruire. Cette machine géante de la dette qui, pendant les cinq derniers siècles, a réduit un pourcentage croissant de la population mondiale à être l’équivalent moral des conquistadors se heurte clairement à ses limites sociales et écologiques. La propension invétérée du capitalisme à imaginer sa propre destruction s’est métamorphosée, depuis un demi-siècle, en scénarios où il menace d’emporter le monde dans sa chute. Et rien ne porte à croire que cette propension disparaîtra un jour. La vraie question, aujourd’hui, est de trouver comment modérer un peu les choses, aller vers une société où l’on pourra vivre plus en travaillant moins. Je voudrais donc, pour finir, dire un mot en défense des pauvres non industrieux [5]. Au minimum, ils ne font de mal à personne. Dans la mesure où le temps qu’ils soustraient au travail est passé avec leurs amis et leur famille à jouir et à s’occuper de ceux qu’ils aiment, il est probable qu’ils améliorent le monde plus que nous ne le reconnaissons. Peut-être devons-nous voir en eux les pionniers d’un nouvel ordre économique, qui ne partagerait pas le penchant de l’ordre actuel pour l’autodestruction.
Dans ce livre, j’ai évité pour l’essentiel de faire des propositions concrètes, mais, pour terminer, en voici une. Il est plus que temps, je pense, de procéder à un jubilé de style biblique – un jubilé qui concernerait à la fois la dette internationale et la dette des consommateurs. Il serait salutaire parce qu’il allégerait quantité de véritables souffrances humaines, mais aussi parce qu’il serait notre façon de nous remémorer certaines réalités : l’argent n’est pas sacré, payer ses dettes n’est pas l’essence de la morale, ces choses-là sont des arrangements humains, et, si la démocratie a un sens, c’est de nous permettre de nous mettre d’accord pour réagencer les choses autrement. Il me paraît significatif que, depuis Hammourabi, les grands États impériaux aient invariablement résisté à ce type de politique. Athènes et rome ont établi le paradigme : même confrontées à d’incessantes crises de la dette, elles n’ont voulu légiférer que pour arrondir les angles, adoucir l’impact, éliminer les abus évidents comme l’esclavage pour dettes, utiliser le butin de l’empire pour distribuer toutes sortes d’à-côtés à leurs citoyens pauvres (qui, après tout, fournissaient les soldats de leurs armées) afin de les maintenir plus ou moins à flot – mais tout cela pour ne jamais autoriser aucune remise en cause du principe de la dette. La classe dirigeante des États-Unis semble avoir adopté une stratégie remarquablement similaire : éliminer les pires abus (par exemple les prisons pour dettes), utiliser les fruits de l’empire pour verser des subventions, visibles ou non, au gros de la population, ces dernières années manipuler les taux de change pour inonder le pays de produits bon marché venus de Chine, mais ne jamais permettre à quiconque de défier le principe sacré : nous devons tous payer nos dettes.
Toutefois, à ce stade, ce principe a été démasqué comme un men- songe flagrant. En fait, nous n’avons pas « tous » à payer nos dettes. Seulement certains d’entre nous. rien ne serait plus bénéfique que d’effacer entièrement l’ardoise pour tout le monde, de rompre avec notre morale coutumière et de prendre un nouveau départ.
Qu’est-ce qu’une dette, en fin de compte ? Une dette est la perversion d’une promesse. C’est une promesse doublement corrompue par les mathématiques et la violence. Si la liberté (la vraie) est l’aptitude à se faire des amis, elle est aussi, forcément, la capacité de faire de vraies promesses. Quelles sortes de promesses des hommes et des femmes authentiquement libres pourraient-ils se faire entre eux ? Au point où nous en sommes, nous n’en avons pas la moindre idée. La question est plutôt de trouver comment arriver en un lieu qui nous permettra de le découvrir. Et le premier pas de ce voyage est d’admettre que, en règle générale, comme nul n’a le droit de nous dire ce que nous valons, nul n’a le droit de nous dire ce que nous devons.
Publié par Mouvements, le 8 octobre 2013. http://www.mouvements.info/Dette-5000-ans-d-histoire.html