« Depuis très longtemps le monde possède le rêve d’une chose dont il doit maintenant posséder la conscience pour la posséder réellement. » (Karl Marx)
La catastrophe écologique ne se décline pas au futur, nous y sommes plongé·e·s et elle grandit de jour en jour. Cette réalité crève les yeux dans le cas du basculement climatique. Dès son premier rapport d’évaluation, il y a plus de trente ans, le GIEC projetait une multiplication et une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes dus au réchauffement : tempêtes et cyclones, canicules et vagues de froid, sécheresses et incendies, pluies abondantes, inondations et glissements de terrain… C’est très précisément ce qui est en train de se passer sous nos yeux : chaque année, de nouveaux records de catastrophe sont battus, chaque année les médias font les gros titres sur des événements « sans précédent » et de plus en plus « exceptionnels »… et chaque année ces événements sont chassés par d’autres, encore plus « exceptionnels » que les précédents.
La catastrophe est sociale autant qu’environnementale, surtout au Sud
La destruction écologique grandissante approfondit spectaculairement les inégalités. Cette autre réalité devrait crever les yeux également : la catastrophe est sociale autant qu’environnementale. Conformément aux avertissements des scientifiques, les pauvres – particulièrement dans les pays pauvres, mais pas uniquement – sont frappés de plein fouet. Ils et elles émettent peu de gaz à effet de serre (parfois extrêmement peu) mais ont le tort d’habiter de mauvais logements, sur des terrains inondables, ou sur des pentes exposées aux glissements de terrain, ou dans les zones les plus sèches, ou dans les quartiers les plus chauds des villes1 (où ils et elles exercent d’ailleurs, soit dit en passant, des métiers aussi essentiels que pénibles et mal payés)… Sans surprise, ces discriminations de classe face à la catastrophe écologique se combinent aux discriminations basées sur la « race », sur le genre ou sur l’orientation sexuelle. La nature est bien « un champ de bataille2 ». C’est pour embrasser toutes ces dimensions de plus en plus intriquées que nous parlons de crise « écosociale » plutôt que de crise « écologique ».
Un exemple montrera l’importance de cette sémantique. Oxfam International a mis en exergue récemment « cinq catastrophes naturelles demandant une action d’urgence3 ». L’ONG montre non seulement que la crise dite « écologique » a de terribles conséquences humaines mais aussi que ses causes sont de moins en moins « naturelles », de plus en plus sociales. Pourquoi persister alors, comme par habitude, à parler de « catastrophes naturelles » ? Il est grand temps de se défaire de cette dénomination trompeuse. L’expression « catastrophe naturelle » doit être réservée aux phénomènes indépendants de l’activité humaine – éruptions volcaniques, tremblements de terre, tsunamis… Les cinq catastrophes présentées par l’ONG sont, pour ainsi dire, d’une autre « nature » : leur extrême gravité s’explique avant tout par l’accélération du basculement climatique « anthropique » dont l’exploitation des combustibles fossiles par le capitalisme constitue la cause principale. Certes, d’autres facteurs que le réchauffement interviennent (corruption, rapports coloniaux, démantèlement du secteur public, mode d’aménagement du territoire, pratiques culturales, etc.). Mais ils renvoient tous, d’une manière ou d’une autre, au fait que la société est subordonnée à la logique du profit devenue hégémonique il y a deux siècles en Angleterre et qui, depuis, a conquis le monde
L’année dernière, un tiers du Bangladesh a été frappé par des inondations spectaculaires, les flots ont rayé de la carte des villages entiers, affecté cinq millions de personnes – 250 d’entre elles au moins ont perdu la vie – et détruit des récoltes estimées à 150 millions de dollars. Une bonne partie du sous-continent indien subit des pluies de plus en plus intenses. Cette croissance des précipitations découle d’une perturbation de la mousson par le changement climatique. En 2020, on a estimé que douze millions de personnes ont été contraintes de quitter leur maison en Inde, au Népal et au Bangladesh. Ce dernier est, de tous les pays du monde, le plus menacé par les effets du réchauffement. Même dans l’hypothèse d’une hausse de température « modérée », certains chercheurs estiment que la sévérité accrue des inondations y diminuera les récoltes de riz et de blé de 27 % et de 61 % respectivement4 au cours de ce siècle. Dès maintenant, un nombre croissant de petit·e·s paysan·ne·s ruiné·e·s migrent vers la capitale, Dacca, où iels sont contraint·e·s, pour survivre, de vendre leur force de travail contre un salaire de misère (notamment à des entreprises travaillant pour les multinationales de la confection). Au fil de leur exode, la terre se concentre entre les mains d’un nombre restreint de propriétaires, et la production pour le marché mondial tend à enfler aux dépens de la production pour la population locale.
En 2020, dans la corne de l’Afrique, le nombre de gens confrontés à une insécurité alimentaire sévère a plus que doublé. Les chiffres donnent le vertige : 2,7 millions au Kenya, 2,9 millions en Somalie, 5,6 millions en Éthiopie, près de 2 millions dans le nord de l’Ouganda, sans compter le sud du Soudan, frappé également5. Plusieurs années de précipitations extrêmement faibles (2011, 2017 et 2019) ont ruiné les cultures et décimé le bétail. Catastrophe naturelle ? Que nenni. Ici aussi, le changement climatique est montré du doigt comme cause majeure : selon les spécialistes, le réchauffement de l’océan a doublé la probabilité de sécheresse dans la région. Au total, quinze millions de personnes souffrant de la faim et de la soif ont dû quitter leurs terres. Ici aussi, comme au Bangladesh, l’accaparement de la ressource favorise son exploitation en fonction des besoins du marché mondial, pas de ceux des habitant·e·s. Quant aux dépossédé·e·s, leur survie dépend d’une aide qui n’est financée qu’à 35 %6.
Restons en Afrique. Une année plus tôt, en avril 2019, le cyclone Kenneth dévastait le nord du Mozambique. Comme on le sait, la force des cyclones est fonction de la température à la surface de l’océan. Aucun cyclone n’avait encore été observé dans cette région du monde, en tout cas depuis l’utilisation des satellites. Le changement climatique a modifié la donne. Le mois précédent, un autre cyclone, Idai, avait frappé le sud du pays, ainsi que le Zimbabwe, le Malawi et Madagascar. Avec des vents allant jusqu’à 195 km/heure, Idai était le deuxième plus violent cyclone jamais vu dans l’hémisphère Sud et le plus violent jamais vu dans le sud-ouest de l’océan Indien. Plus de trois millions de personnes ont subi la catastrophe, 1 300 d’entre elles y ont perdu la vie (sans compter le nombre considérable de disparu·e·s). Une crise humanitaire majeure a succédé pour des centaines de milliers d’hommes et de femmes, le personnel humanitaire a dû laisser mourir des gens pour en sauver d’autres et 4 000 personnes environ ont été emportées par le choléra7.
Passons à l’Amérique latine. Le « couloir de la sécheresse » désigne une partie de l’isthme centro-américain frappée de plein fouet par le phénomène El Niño. Phénomène naturel, dira-t-on… Oui, sauf que les effets d’El Niño sont décuplés par la crise climatique. En 2020, pour la sixième année consécutive, le Nicaragua, le Salvador, le Honduras et le Guatemala ont connu des précipitations anormalement faibles. De trois mois habituellement, la saison sèche a plus que doublé. Dans le sud du Honduras, les récoltes de maïs ont chuté de 72 %, celles de haricot de 75 %8. Trois millions et demi de personnes, dont la plupart ne survivent que grâce à l’agriculture pour se nourrir et subvenir à leurs besoins, dépendent de l’aide humanitaire ; 2,5 millions d’autres sont en situation d’insécurité alimentaire. Deux journalistes canadiens ont consacré un livre à ces populations martyres9, victimes non seulement du climat mais aussi du racisme anti-indigènes, de la violence, de la corruption et de l’accaparement des terres par le capital extractiviste, et même par des projets de tourisme environnemental pour les riches10. C’est leur ouvrage qui a popularisé l’expression « couloir de la sécheresse ». L’allusion aux prisons étasuniennes est délibérée. De fait, la plupart des migrant·e·s qui tentent de gagner l’Amérique du Nord par le Mexique sont originaires d’Amérique centrale et c’est contre ces pauvres gens que Donald Trump a mis en œuvre sa politique abjecte de refoulement, d’enfermement et d’appel au meurtre.
Les pays du Nord ne sont plus épargnés
Ce n’est évidemment pas par hasard que ces quatre exemples de catastrophes écosociales concernent des pays du Sud global : l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine sont les continents où les populations souffrent le plus du changement climatique (dont les nations « développées », rappelons-le, sont les principales responsables historiques). Un pays riche, développé, et super-pollueur de surcroît, se hisse pourtant dans le top cinq d’Oxfam : l’Australie. Après plusieurs années de sécheresse « exceptionnelle » (toujours le même euphémisme !), la grande île a été dévastée en 2020 par des mégafeux hallucinants, de loin les plus violents de l’histoire. Plus de dix millions d’hectares ont été réduits en cendres, vingt-huit personnes au moins ont péri dans les flammes et un grand nombre de maisons sont parties en fumée. Côté biodiversité, on estime qu’un milliard d’animaux ont été tués et que certaines espèces végétales endémiques ont disparu à jamais. Ce terrible bilan a porté un coup au climatonégationnisme du Premier ministre conservateur, Scott Morrison, qui persiste néanmoins. Plus largement, le drame a commencé à ébranler le modèle économique de l’Australie, basé sur l’exportation de charbon vers la Chine, la privatisation des ressources (l’eau, considérée comme « ressource minière », a été introduite en Bourse !), la dépossession des indigènes et le refoulement des migrant·e·s – avec pour corollaire la répression des défenseurs de la nature et des droits humains. De 2003 à 2015, cette politique ultralibérale a augmenté de 53 % la richesse des 20 % de ménages les mieux nantis, mais les 20 % de ménages les moins riches ont vu la leur chuter de 9 %11… un creusement des inégalités que les incendies – et la pandémie – n’ont fait qu’approfondir.
Les accidents climatiques majeurs restent infiniment plus graves dans le Sud global, mais le cas australien confirme que les pays dits « en développement » n’en ont plus le triste monopole. Les consciences évolueront-elles en fonction de cette réalité ? Lorsque La Nouvelle-Orléans a été dévastée par l’ouragan Katrina, en 2005, il est probable que la majorité de la population du monde « développé » n’a pas compris qu’on entrait dans une ère nouvelle, où les populations pauvres et racisées des pays du Nord, les femmes en particulier, subiraient une exposition croissante aux catastrophes écologiques et à l’approfondissement des inégalités qui en découlent12. Au-delà des cercles d’écologistes convaincu·e·s, Katrina paraissait à beaucoup comme un accident. Le bilan semblait pouvoir s’expliquer par les caractéristiques du système socio-économique étasunien à l’ère de G. W. Bush beaucoup plus que par la combinaison de ces caractéristiques avec la crise climatique. « Avec un peu plus de prudence et de prévoyance, ces choses-là n’arriveront pas chez nous » : voilà sans doute ce que beaucoup d’Européen·ne·s ont voulu croire à l’époque. Les 20 000 décès dus à la canicule de 2003 s’étaient déjà effacés des mémoires. Or, depuis, les « accidents » du genre Katrina 2005 et canicule 2003 n’ont cessé de se multiplier. Au Sud bien sûr, mais aussi au Nord.
L’accélération est spectaculaire. Les sept années de 2013 à 2020 ont été les plus chaudes jamais enregistrées13 ; en vingt ans, le nombre de catastrophes liées au climat a doublé14 ; au cours des vingt-cinq dernières années, la hausse annuelle moyenne du niveau des océans a été près de deux fois plus importante que depuis 188015 ; dorénavant, des phénomènes imputables au réchauffement forcent chaque année plus de 20 millions de gens à se déplacer. Les pays riches sont pris dans la spirale. Beaucoup plus médiatisés que les événements similaires dans les pays pauvres, les incendies très meurtriers de 2018 en Californie et en Grèce ont marqué l’opinion16. Au moment où ces lignes sont écrites, la Colombie-Britannique (Canada) pleure plus de 800 vies fauchées par un dôme de chaleur totalement hors-norme (près de 50 °C dans un pays au climat tempéré humide !) ; la Sibérie suffoque dans les fumées toxiques d’incendies dantesques, qui ont dévoré la taïga sur un million et demi d’hectares ; plusieurs pays du centre de l’Europe (Allemagne, Belgique, Autriche) font leurs comptes après des inondations terribles qui ont tué au moins 200 personnes et causé des destructions sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale…
Du coup, la question est ouverte : l’année 2021 verra-t-elle l’élargissement qualitatif du cercle des gens comprenant que ce qui ne frappait « que » le Sud global frappera de plus en plus le Nord ? Majoritaire dans les pays capitalistes développés, et pesant d’un poids décisif dans de nombreux pays du Sud « émergents », le monde du travail ouvrira-t-il les yeux sur le fait que les classes populaires de partout sont de plus en plus logées à la même enseigne ? Comprendra-t-il que la production marchande transforme le progrès en destruction, que les travailleur·euse·s n’ont rien à attendre du capitalisme, fût-il vert ? Autant d’interrogations qui débouchent sur la question stratégique majeure – posée dans plusieurs contributions à cet ouvrage : le syndicalisme rompra-t-il le compromis productiviste avec le capital pour rejoindre franchement les peuples indigènes, les petit·e·s paysan·ne·s, la jeunesse, les femmes, qui sont partout en première ligne du combat pour notre mère la Terre ?
L’avenir le dira. La réponse dépend des activistes, des luttes, de la convergence des luttes, de leur ténacité et de leur organisation démocratique à la base. C’est ce que les Gilets jaunes nous ont appris. L’engagement dans le combat est d’une importance cruciale, car le capitalisme ne résoudra rien. La raison est simplissime : ce système ne peut se maintenir qu’en produisant toujours plus pour le profit. Les propriétaires de capitaux n’ont en effet pas le choix : sous peine de mort économique, la concurrence les condamne à exploiter toujours plus le travail humain et les autres ressources naturelles. Le capitalisme vert est un oxymore, au même titre que le capitalisme social. Le respect de la vie est totalement contraire à l’ADN de ce mode de production. À supposer que celui-ci puisse n’utiliser que des sources d’énergie renouvelables, sa logique productiviste du « toujours plus, toujours plus vite » continuerait néanmoins à détruire la planète. Mais cette supposition est absurde – l’hypothèse d’une économie de marché mue uniquement par les renouvelables relève de la science-fiction pure. Le capitalisme s’est structuré historiquement autour des combustibles fossiles ; les énormes réserves de ceux-ci composent une part substantielle des actifs de multinationales puissantes qui pèsent d’un poids déterminant sur la politique énergétique des États ; les principaux secteurs de l’économie mondiale dépendent du charbon, du pétrole, du gaz naturel ; et quasiment tous les gouvernements de la planète s’activent comme des fourmis, jour et nuit, au service du Capital… Dans ces conditions, il faut croire au Père Noël pour imaginer que des politiques nécessaires au sauvetage du climat et de la biodiversité dans l’intérêt de l’humanité puissent être conçues et appliquées, même partiellement, par les décideurs. La « transition écologique » dont ceux-ci nous rebattent les oreilles n’est qu’un gigantesque miroir aux alouettes.
« Ce n’est pas une opinion, simplement une question de maths » (Greta Thunberg)
Les exemples de catastrophes évoqués plus haut sont la conséquence d’un réchauffement de 1,1 °C « à peine » par rapport à l’ère préindustrielle. De la lecture des rapports du GIEC17, n’importe quel·le lecteur·rice raisonnable conclura que tout doit être mis en œuvre pour que la Terre reste bien au-dessous des 1,5 °C, comme décidé à Paris lors de la COP21. Au-delà de ce seuil, non seulement tous les risques augmentent qualitativement (notamment le risque de disparition sous la mer des principales villes de la civilisation, telles que Hong Kong, Calcutta, Londres, Shanghai, Amsterdam, New York…, et le risque de vastes zones rendues inhabitables par la combinaison de chaleur et d’humidité), mais en plus la possibilité grandit de voir une cascade de rétroactions positives provoquer le basculement irréversible de la Terre dans un régime qu’aucun humain n’a jamais connu, avec un niveau des océans supérieur au niveau actuel de treize mètres, voire de plusieurs dizaines de mètres18.
Vu le temps perdu en manœuvres dilatoires et en fausses promesses depuis le Sommet de la Terre (Rio, 1992) – et depuis la COP21 (Paris, 2015), il n’est pas certain que la limite du 1,5 °C puisse encore être respectée. En revanche, il est certain qu’elle ne peut l’être sans rupture avec le productivisme de l’économie de marché qui creuse les inégalités sociales et détruit la nature. Comme l’a dit très justement Greta Thunberg, « la crise climatique et écologique ne peut tout simplement plus être résolue dans le cadre des systèmes politiques et économiques actuels. Ce n’est pas une opinion, simplement une question de mathématiques19 ».
Les données chiffrées de l’équation ne laissent en effet aucun doute. Résumons-les : 1o) rester au-dessous de 1,5 °C nécessite que les émissions mondiales nettes de CO2 diminuent de 59 % d’ici 2030 et de 100 % d’ici 2050, pour rester négatives ensuite jusqu’à la fin du siècle20 ; 2o) 80 % de ces émissions sont dues à la combustion des combustibles fossiles ; 3o) ces combustibles fossiles couvraient encore en 2019 84,3 % des besoins énergétiques de l’humanité ; 4o) les infrastructures fossiles (mines, pipelines, raffineries, terminaux gaziers, centrales électriques, usines automobiles, etc) – dont la construction ne faiblit pas, ou à peine ! – sont des équipements lourds, dans lesquels le capital s’investit pour une quarantaine d’années. Dès lors, sachant que trois milliards d’êtres humains manquent de l’essentiel et que les 10 % les plus riches de la population émettent plus de 50 % du CO2 global, la conclusion est imparable : changer de système énergétique pour rester sous 1,5 °C tout en consacrant plus d’énergie à satisfaire les droits légitimes des démuni·e·s est rigoureusement incompatible avec la poursuite de l’accumulation capitaliste. La catastrophe nepeut être stoppée que par un double mouvement qui consiste à réduire la production globale et à la réorienter au service des besoins humains réels, démocratiquement déterminés. Ce double mouvement passe forcément par la suppression des productions inutiles ou nuisibles et l’expropriation des monopoles capitalistes21. L’alternative est dramatiquement simple : soit l’humanité liquidera le capitalisme, soit le capitalisme liquidera des millions d’innocent·e·s pour continuer sa course barbare sur une planète mutilée, et peut-être invivable.
« Neutralité carbone », le miroir aux alouettes
Depuis que Trump a cédé la place à Biden, les principaux gouvernements de la planète affichent bruyamment leur intention de parvenir à la « neutralité carbone » (« zéro émission nette ») en 2050. Pourtant, les émissions mondiales continuent d’augmenter (sauf en 2008 pour cause de crise financière et en 2020 pour cause de pandémie) et les plans nationaux de réduction des émissions d’ici 2030 mettent la planète sur la voie d’un réchauffement de 3,5 °C avant la fin du siècle. Le fossé entre les paroles et les actes s’explique assez simplement. Premièrement, les émissions de l’aviation et du transport maritime ne sont pas comptabilisées, alors qu’elles explosent du fait de la mondialisation des échanges22. Deuxièmement, les pays riches refusent en pratique d’honorer leur promesse d’octroyer 100 milliards de dollars par an aux pays « en développement » via le Fonds climat, et les représentant·e·s des États se disputent sur la répartition des efforts, notamment à propos des émissions dites « grises » – découlant de la production des marchandises pour l’exportation : faut-il continuer à les imputer au producteur, ou à l’importateur ? Troisièmement et surtout, tous les décideurs s’inscrivent – sans le dire – dans le scénario dit de « dépassement temporaire » du 1,5 °C.
L’idée de ce scénario est de laisser le mercure filer au-dessus du 1,5 °C de réchauffement – pour ne pas nuire à « l’économie » – en pariant sur le fait que ce dépassement pourra être limité grâce au déploiement massif des « technologies bas carbone » (nom de code pour le nucléaire) et rattrapé ensuite grâce à de soi-disant « technologies à émissions négatives » (TEN)23. Or, d’une part, la dangerosité du nucléaire n’est plus à démontrer, d’autre part, les TEN n’existent pour la plupart qu’au stade du prototype ou de la démonstration. Alors que le point de bascule de la calotte groenlandaise – qui contient assez de glace pour faire monter le niveau des océans de sept mètres – se situe probablement entre 1,5 et 2 °C, alors que le seuil de 1,5 °C sera franchi avant 2040 au rythme actuel des émissions, on voudrait nous faire croire que la planète pourrait être refroidie plus tard, en retirant d’énormes quantités de CO2 de l’atmosphère et en les stockant sous terre. En vérité, ce scénario d’apprenti sorcier a pour but essentiel de sauver la vache sacrée de la croissance capitaliste pour protéger les profits des plus grands responsables du gâchis : les multinationales du pétrole, du charbon, du gaz et de l’agrobusiness, ainsi que les banques qui financent leurs investissements destructeurs. À part la guerre mondiale nucléaire, aucune folie n’éclaire aussi crûment la menace existentielle que le capitalisme fait peser sur l’humanité.
Un récent rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) balise le chemin pour la concrétisation de cette politique24. En effet, pour espérer atteindre le « zéro émission nette » en 2050 tout en relançant la croissance post-pandémie, il faudrait, selon l’AIE : deux fois plus de centrales nucléaires ; accepter qu’un cinquième de l’énergie mondiale continue à venir de la combustion d’énergie fossile (émettant 7,6 Gt CO2/an) ; capturer et stocker sous terre, chaque année, ces 7,6 Gt de CO2 dans des réservoirs géologiques (dont l’étanchéité ne peut pas être garantie) ; consacrer 410 millions d’hectares aux monocultures industrielles de biomasse énergétique (cela représente un tiers de la surface agricole en culture permanente !) ; utiliser cette biomasse à la place des fossiles dans les centrales électriques et autres installations de combustion (en capturant là aussi le CO2 émis pour le stocker sous terre) ; produire de l’hydrogène à partir du charbon (avec capture du CO2, toujours !) en espérant que l’électrolyse industrielle de l’eau prendra le relais plus tard ; doubler le nombre de grands barrages ; et… continuer à tout détruire – jusque sur la Lune – pour accaparer les « terres rares » indispensables aux éoliennes, panneaux photovoltaïques et autres « technologies vertes » à déployer massivement. Voilà le vrai visage de la « croissance verte » !
Politiques de marché, désastre assuré
Avec des variantes25, telle est l’orientation délirante adoptée – en catimini, répétons-le ! – par les gouvernements qui se ruent sur la voie du « capitalisme vert » en jurant la main sur le cœur que la « neutralité carbone » sauvera la planète… Le marché est censé coordonner la transition – par des taxes, des incitants et une généralisation du système des droits d’émission échangeables. L’Union européenne est en première ligne avec son plan « Fit for 55 », visant à matérialiser la promesse de réduire ses émissions de 55 % en 2030, par rapport à 1990 (promesse insuffisante : il faudrait 65 %). Pionnière depuis des années dans la mise en œuvre des droits de polluer au niveau de ses grands secteurs industriels, l’Union les étendra aux domaines de la construction et de la mobilité. Il en résultera pour les consommateur·rice·s des hausses de prix d’autant plus importantes que leur logement sera mal isolé ou que leur véhicule sera plus polluant. En clair : les revenus modestes seront pénalisés, une fois de plus. Les économies du Sud seront pénalisées également – et leurs populations à travers elles – par le truchement de la « compensation carbone26 » et de la taxe carbone aux frontières. Et tout ça pour un plan qui (sauf en trichant) n’atteindra même pas son objectif insuffisant, car celui-ci est inaccessible par des mécanismes de marché.
On ne résout pas un problème par les moyens qui ont causé le problème », aurait dit Albert Einstein. Le marché étant le rouage essentiel du capitalisme, qui est la cause de la crise écosociale, on ne sortira pas de la crise écosociale par des mécanismes de marché. CQFD. Le marché n’est pas neutre. Si on laisse faire le marché, les « solutions » iront spontanément (les idéologues néolibéraux diront « naturellement ») dans le sens du marché… c’est-à-dire en défaveur des classes populaires, des pays dominés et de la nature, et en faveur des possédant·e·s27. Réduire les émissions de 55 %, c’est mieux que rien, rétorqueront certains. Sans doute mais, contrairement à ce qu’affirment de nombreux spécialistes du dossier climatique28, « Fit for 55 » ne va pas « dans la bonne direction ». D’une part parce qu’il ne nous met pas sur le chemin permettant d’espérer rester sous 1,5 °C de réchauffement : en matière d’émissions, il y a un écart significatif entre le chemin vers 55 % et le chemin vers 65 % de réduction en 2030, et cet écart ne pourra pas être rattrapé par la suite. D’autre part, socialement, l’UE ne va pas dans la bonne direction non plus car son plan implique une accentuation des mécanismes coloniaux de domination, de la marchandisation de la nature et des politiques qui font payer la facture aux classes populaires.
Il n’y a rien à attendre des gouvernements néolibéraux. Cela fait plus de trente ans qu’ils prétendent avoir compris la menace écologique, mais ils n’ont quasiment rien fait. Ou plutôt si, ils ont fait beaucoup : leur politique d’austérité, de privatisations, d’aide à la maximisation des profits des multinationales fossiles et de soutien à l’agrobusiness a détruit des milliers d’espèces vivantes et défiguré les écosystèmes tout en nous poussant au bord du gouffre climatique. Aujourd’hui, ils nous promettent le « zéro émission nette », mais leur objectif n’est pas de sauver la planète : il est d’endormir les populations en atténuant la catastrophe et d’offrir aux capitalistes la plus grande part possible du marché des nouvelles technologies « propres », la plus grande part possible des profits… Inutile de dire que cela implique aussi, pour « attirer les investisseurs », de continuer les politiques néolibérales autoritaires de destruction des droits sociaux et démocratiques. Il est vain d’espérer convaincre ces gens-là de mener une autre politique : seuls des rapports de force pourront les faire reculer.
À question écosociale, luttes écosociales et projet écosocialiste
Forgée il y a deux cents ans, l’expression « question sociale » désignait bien plus qu’un ensemble de « problèmes sociaux » : elle exprimait l’inquiétude existentielle des possédants face aux bouleversements ininterrompus de la révolution industrielle. Celle-ci avait en effet deux effets contradictoires : d’une part, elle rendait la bourgeoisie plus riche qu’aucune autre classe dominante dans l’histoire ; d’autre part, elle la déstabilisait en restructurant constamment l’appareil de production, et la menaçait en renforçant les « classes dangereuses ». Constamment renouvelée, constamment amplifiée par une dynamique d’accumulation fébrile, cette contradiction n’alimentait pas seulement l’angoisse sourde des exploiteurs mais aussi l’espérance des combattant·e·s pour l’émancipation. C’est ce que le Manifeste communiste exprimait à travers cette phrase saisissante, qui résume le tournant historique par rapport à l’Ancien Régime : « Tout ce qui était sacré est profané, tout ce qui avait solidité et permanence s’en va en fumée et les hommes enfin sont forcés d’envisager leurs conditions d’existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés.
Ce n’est pas le lieu ici d’analyser les raisons pour lesquelles l’espérance de rapports humains désaliénés a été encerclée, vaincue, trahie au cours du xixe et du xxe siècle, au point de s’effondrer avec le Mur de Berlin. Le fait est que le capitalisme a survécu, s’est renforcé et qu’il nous menace même aujourd’hui d’un nouveau fascisme. En dépit de l’héroïsme de la Commune de Paris et d’innombrables combats ultérieurs, force est de le reconnaître : c’est de nos jours avec des yeux bien abusés que la majorité des exploité·e·s « envisagent leurs conditions d’existence et leurs rapports réciproques ». Pourtant, le système s’enfonce dans des contradictions de plus en plus inextricables et la destruction écologique est la clé de voûte de celles-ci. Après s’être métamorphosée au xxe siècle, la « question sociale » revient comme un boomerang sous la forme d’une « question écosociale » encore plus formidable, encore plus explosive et qui dominera le xxie siècle. Ce n’est pas en l’esquivant mais en la saisissant à pleines mains que la lutte de classe pourra se recomposer et reconstruire l’espérance.
Nous appelons « écosociales » les luttes dont les objectifs sont à la fois sociaux et écologiques. Celles et ceux qui les mènent actualisent le slogan « le pain et les roses ». Refusant de se laisser enfermer dans les choix capitalistes sordides entre la peste et le choléra, iels exigent pour le plus grand nombre le droit de jouir d’une existence digne en se réalisant dans des activités utiles et en prenant soin de la nature dont iels font partie. Enracinées dans les territoires, ces luttes politisent parce qu’elles impliquent d’articuler les efforts, les savoirs et les demandes de divers mouvements (syndicalistes, féministes, écologistes) et de divers groupes sociaux (peuples indigènes, paysan·ne·s, ouvrier·e·s, intellectuel·le·s). Ainsi commence à se construire un commun anticapitaliste, démocratique et pluraliste qui contient en germe la possibilité d’un autre pouvoir et d’une autre société : l’écosocialisme.
Nous comprenons comme écosocialisme une nouvelle conception du socialisme qui met l’écologie au centre de la réflexion et de l’action. C’est un projet révolutionnaire, qui rompt avec les fondements de la civilisation industrielle capitaliste, en soumettant la production et la consommation à une gestion collective, écosociale et démocratique. L’écosocialisme n’est pas seulement un changement des rapports sociaux de propriété et de l’appareil productif : c’est un nouveau projet de civilisation, fondé non sur les critères du profit et du marché, mais sur les besoins sociaux, démocratiquement définis, et le respect pour notre maison commune, la Nature, la planète Terre. Il est aussi une stratégie de transformation radicale, dont l’axe central est la convergence anticapitaliste entre luttes sociales et écologiques29.
Contrairement à une idée fort répandue, les luttes populaires contre les méfaits à la fois sociaux et écologiques du « progrès destructif » capitaliste sont aussi vieilles que ce progrès lui-même30. Mais elles sont restés dispersées, ont été battues ou, dans le meilleur des cas, n’ont réussi qu’à freiner la machine infernale du productivisme. L’ampleur et la globalisation de la destruction écologique par le Capital changent la donne. Elles remettent objectivement à l’ordre du jour la nécessité d’une civilisation basée sur la valeur d’usage plutôt que sur la valeur d’échange – autrement dit sur la satisfaction des besoins humains réels, démocratiquement déterminés dans le respect prudent des écosystèmes plutôt que sur la quête insensée du profit par la production sans cesse croissante de marchandises. Cette société du « buen vivir », la résistance des peuples indigènes nous invite à la réinventer en pratique à notre manière, confirmant ainsi que « depuis très longtemps le monde possède le rêve d’une chose dont il lui suffirait de prendre conscience pour la posséder réellement31 ».
Face à la barbarie montante, l’espoir réside dans la richesse et l’énergie de ces mouvements de résistance qui se développent en alliant le social, l’écologie et le féminisme. C’est à ces luttes que cet ouvrage est consacré. À leurs formes d’organisation, leurs revendications, leurs modes d’action, leurs stratégies de rassemblement des acteur·rice·s ; aux difficultés qu’iels rencontrent, à l’inventivité avec laquelle iels tentent de les surmonter. Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité : les récits rassemblés ici ne donnent qu’un échantillon très incomplet de ces combats d’un nouveau type. Mais c’est la première fois, au moins en langue française, que sont rassemblés des récits de luttes écosociales du monde entier.
Le contenu de ce livre, en bref
Nous dédions ce livre à la mémoire de Berta Cáceres, à laquelle une notice est consacrée. Michaël Löwy analyse ensuite le rôle d’avant-garde des peuples indigènes d’Amérique latine qui, en défendant la forêt, ses ressources et leur mode d’existence, font de l’écosocialisme tout en ignorant l’existence de ce mot. Mathieu Le Quang revient sur l’« initiative Yasuni-ITT », son institutionnalisation par le gouvernement équatorien et les causes de son regrettable échec. Arlindo Rodrigues montre l’articulation au Brésil, autour des peuples indigènes, des mouvements sociaux de résistance au néolibéralisme écocidaire du président Bolsonaro. Luiza Toscane brosse un panorama détaillé des luttes écosociales dans la région arabe, où « le peuple veut » – en particulier une eau propre et la maîtrise de ses ressources. Marijke Colle rapporte le combat des paysan·ne·s de Mindanao pour la souveraineté alimentaire par l’agro-écologie, le rôle clé des femmes et la conversion à l’écosocialisme d’une organisation issue de la crise du Parti communiste philippin (maoïste stalinien). Stephen E. Hunt nous entraîne au Rojava, cette terre de souffrance où les femmes en première ligne se réclament de l’écologie sociale pour panser les plaies de la Terre autant que celles des humains. Patrick Bond décortique la complexité du combat environnemental en Afrique du Sud, écartelé entre les enjeux de la justice climatique et les chants de sirène de l’industrie fossile. Marc Bonhomme s’interroge sur les raisons du rendez-vous raté, au Canada, entre le puissant mouvement pour le climat et les luttes des peuples autochtones pour leurs territoires. Phil Ward inscrit les actions d’Extinction Rebellion et du mouvement Fridays for Future dans l’histoire longue des combats écologiques d’inspiration anticapitaliste en Grande-Bretagne. Laurent Vogel retrace les étapes de la lente convergence entre ouvriers, pêcheurs et malades face aux maladies industrielles à Minamata (Japon). Dressant le bilan positif de dix années de militantisme climatique au sein de la Fédération internationale des travailleurs du transport, Asbjørn Wahl déplore cependant la difficulté de transformer des prises de position radicales en action syndicale écosociale. Denis Horman et Daniel Tanuro retracent le parcours remarquable des « révoltés belges de la Discipline » passés malgré eux de la lutte contre la fermeture de leur usine à l’exigence d’une reconversion écologique. Christine Poupin plonge dans le riche laboratoire français de la lutte écosociale victorieuse contre l’aéroport de « Notre-Dame-des-Landes et son monde ». Et Francis Lemasson, militant syndical chez Vinci, livre un témoignage de première main sur les raisons et la façon dont la CGT de cette entreprise a posé ce geste fort, qu’on espère voir se reproduire en d’autres occasions : en tant que travailleur·euse·s, choisir le camp de ce que Naomi Klein appelle la « Blockadia32 » – le camp de « la nature qui se défend » contre la folie destructrice du capital fossile.
Ces luttes écosociales prennent des formes très diverses, selon les pays et les conjonctures, mais on trouve souvent des points communs entre plusieurs expériences : le rôle très actif, généralement central, des femmes ; la forme occupation (« zones à défendre ») ou blocage ; l’ancrage local, face à une entreprise écocide ; une structuration démocratique ; des méthodes de lutte non violentes (qui n’excluent pas l’autodéfense) ; la référence à des traditions spirituelles, culturelles ou religieuses ; la méfiance envers les autorités et le refus des « compromis raisonnables » qu’elles proposent. Du côté négatif, on peut enregistrer, outre la répression des pouvoirs locaux ou nationaux – qui va jusqu’au meurtre par la police et souvent par des tueurs à gages au service des propriétaires33 – la difficulté à mobiliser le soutien des syndicats et de la gauche institutionnelle (avec d’heureuses exceptions !). Ces points communs apparaissent en particulier dans les contributions sur le Rojava, les Philippines, la région arabe, le Brésil, la France, le Canada ainsi que sur les luttes des peuples indigènes d’Amérique latine.
Plusieurs contributions à ce livre approfondissent les raisons pour lesquelles les organisations de travailleur·euse·s restent en retrait des luttes écosociales, et la façon de changer cette réalité. Le fond du problème tient à la condition salariale : contrairement aux peuples indigènes et aux communautés rurales, les salarié·e·s sont entièrement coupé·e·s des moyens de production ; iels ne peuvent subvenir à leurs besoins qu’en vendant leur force de travail aux capitalistes qui sont propriétaires de ceux-ci (notamment des réserves fossiles !) et décident seuls de ce qui est produit, comment, pourquoi et en quelle quantité, donc du type de développement de la société. C’est ce qu’illustre ici l’exemple sud-africain. Face aux directions traditionnelles des syndicats qui s’accommodent de cette situation au nom de l’emploi et du réalisme, l’expérience de la Fédération internationale du transport témoigne du fait qu’un nombre croissant de militant·e·s (y compris dans un secteur polluant) peuvent rompre le « compromis productiviste avec le capital », la grande difficulté étant alors de transformer cette conscience en action collective. Le cas de Minamata au Japon montre comment la défense de la santé peut amener le monde du travail à converger dans la lutte avec d’autres couches sociales pour poser la question de la finalité de la production. Celui des ouvrier·e·s belges du verre en lutte contre la restructuration de leur secteur par une multinationale puissante éclaire la question très actuelle de la reconversion écologique anticapitaliste, et les obstacles qu’elle doit affronter. Enfin, l’exemple du ralliement de la CGT de Vinci à la lutte contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes souligne l’importance d’un débat syndical démocratique couplé à un dialogue avec celles et ceux qui mènent un combat écosocial sur le terrain. Une conclusion majeure qui ressort de ces récits est la nécessité d’une stratégie articulant la lutte à la base et une perspective politique visant à faire sortir la société tout entière de la dictature du profit.
Notre gratitude va aux auteur·e·s ainsi qu’à la revue EcoRev’ qui a aimablement accepté que nous reproduisions certains de ses articles, sous une forme légèrement adaptée pour des raisons éditoriales. Nous sommes conscients des lacunes de notre travail, en particulier de n’avoir pas réussi à inclure ici une contribution sur les luttes écosociales en République populaire de Chine. Nous espérons néanmoins que ce recueil intéressera le public croissant qui prend au sérieux la crise actuelle, qu’il sera utile aux activistes et qu’il contribuera à l’invention du projet de société que les luttes écosociales portent en germe : l’écosocialisme.
Michael Löwy et Daniel Tanuro, le 30 juillet 2021
Notes
1. Céline Guivarch et Nicolas Taconet, « Inégalités mondiales et changement climatique », Revue de l’OFCE, 165, 2020/1, p. 35-70 : https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2020-1-page-35.htm
2 Razmig Keucheyan, « La nature est un champ de bataille. Essai d’écologie politique », Paris, Zones, 2014.
3 https://www.oxfam.org/fr/changement-climatique-cinq-catastrophes-naturelles-qui-demandent-une-action-durgence
4 Mojid M. A., « Climate change-induced challenges to sustainable development in Bangladesh », OP Conference Series : Earth and Environmental Science, Bristol, IOP Publishing, vol. 423, n° 1, 2020.
5 FAO, « Droughts in the Horn of Africa » : https://www.fao.org/emergencies/crisis/drought-hoa/intro/en/
6 Oxfam, op. cit.
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Idai. Voir aussi dans cet ouvrage la contribution de Patrick Bond.
8 Jeff Masters, « Fifth Straight Year of Central American Drought Helping Drive Migration », Scientific American, 23 décembre 2019 : https://blogs.scientificamerican.com/eye-of-the-storm/fifth-straight-year-of-central-american-drought-helping-drive-migration/
9 Valérian Mazataud et Guy Taillefer, Fuir le couloir de la sécheresse, Québec, Somme toute, 2021. Voir aussi dans cet ouvrage notre hommage à l’activiste hondurienne Berta Cáceres, assassinée par des hommes de main en raison de sa lutte contre l’appropriation des ressources hydriques du rio Gualcarque.
10 Jeff Abbott, « How Extractivism and Neoliberal Environmentalism Cause Migration and Land Conflicts in Guatemala », Land Portal, 16 juin 2017 : https://www.landportal.org/news/2017/06/how-extractivism-and-neoliberal-environmentalism-cause-migration-and-land-conflicts
11 Daniel Tanuro, « Mégafeux en Australie : un tipping point climatique, en live », 13 janvier 2020 : http://europe-solidaire.org/spip.php?article51797
12 Sur cette catastrophe, lire P. Le Tréhondat et P. Silberstein, L’Ouragan Katrina. Le désastre annoncé, Paris, Syllepse, 2005.
13 Selon la NASA. The Guardian, 14 janvier 2021 : https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/14/2020-hottest-year-on-record-nasa
14 https://www.actu-environnement.com/ae/news/inondations-coulees-boue-10827.php4
15 De 21 à 24 cm depuis 1880, dont un tiers depuis 1995. National Oceanic and Atmospheric Administration : https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level
16 Au moins 85 morts à Paradise (Californie), au moins 82 victimes à Mati (Grèce).
17 GIEC, rapport spécial 1,5 °C : https://www.ipcc.ch/sr15/
18 Will Steffen et al., « Trajectories of the Earth System in the Anthropocene », PNAS, août 2018 : https://www.pnas.org/content/115/33/8252
19 https://twitter.com/gretathunberg/status/1274618877247455233?lang=en
20 GIEC, rapport 1,5 °C. Les « émissions nettes » sont obtenues en déduisant des émissions de CO2 les augmentations des absorptions par les forêts et par les sols, pour peu qu’elles soient provoquées délibérément ; les « émissions mondiales négatives » supposent un système Terre absorbant plus de CO2 qu’il n’en émet. Cinquante-neuf pour cent est un objectif global. En tenant compte des responsabilités historiques différentes du Nord et du Sud, les pays développés devraient réduire leurs émissions de 65 % au moins d’ici 2030, et atteindre le « zéro émission nette » bien avant 2050.
21 Un raisonnement analogue peut être fait pour le sauvetage de la biodiversité, qui requiert impérativement de briser le pouvoir de l’agrobusiness et de l’industrie de la viande.
22 La plupart des États ne comptabilisent pas non plus les émissions dues aux incendies de forêt… mais comptabilisent les absorptions dues aux plantations d’arbres.
23 Les TEN retirent du CO2 de l’atmosphère, la géo-ingénierie (déconseillée jusqu’à présent par le GIEC) rejette une fraction du rayonnement solaire vers l’espace.
24 https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
25 Avec ou sans recours aux absorptions de CO2 par des plantations industrielles d’arbres, notamment : l’AIE propose de ne pays y recourir, l’UE compte planter trois milliards d’arbres d’ici à 2030.
26 La compensation carbone consiste pour un pays ou une entreprise à remplacer ses réductions d’émissions dans un pays du Nord par des investissements réduisant les émissions ou par des plantations d’arbres dans un pays du Sud.
27 En faveur par exemple du secteur de l’automobile, que l’UE veut booster en interdisant la vente de véhicules neufs à moteur thermique au-delà de 2035.
28 Par exemple, François Gemenne (professeur à l’université de Liège et à Sciences Po, interview au Soir, 18 juillet 2021) et Jean-Pascal van Ypersele (ex-vice-président du GIEC, professeur à l’Université catholique de Louvain, interview à la RTBF) : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_des-inondations-extremes-le-giec-les-annoncait-en-1990-rappelle-jean-pascal-van-ypersele?id=10804972)
29 Michaël Löwy, Qu’est-ce que l’écosocialisme ?, Montreuil, Le Temps des cerises, 2020.
30 François Jarrige, Face au monstre mécanique. Une histoire des résistances à la technique, Paris, IMHO, 2009.
31 Karl Marx, lettre à Ruge, septembre 1843.
32 Naomi Klein, This Changes Everything : Capitalism vs. the Climate, Canada, Knopf, 2014.
33 Deux cent douze activistes ont été assassinés en 2019, selon l’ONG Global Witness, plus de la moitié en Colombie et aux Philippines. Les secteurs minier et l’agrobusiness sont les principaux commanditaires. Les victimes dans les pays du Nord sont rares mais pas inexistantes : un garde-forestier a été assassiné en Roumanie par les trafiquants : https://www.globalwitness.org/fr/global-witness-records-the-highest-number-of-land-and-environmental-activists-murdered-in-one-year-with-the-link-to-accelerating-climate-change-of-increas




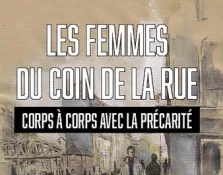

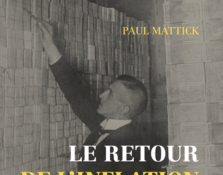





Un message, un commentaire ?