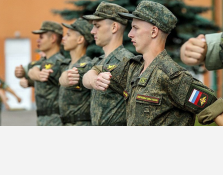Neil Davidson est un des participants du lancement en Ecosse de la nouvelle formation de gauche RISE (Respect, Independence, Socialism and Environmentalism). Il a publié cet article sur le site écossais Bella Caledonia : http://bellacaledonia.org.uk/2016/03/01/a-socialist-case-for-leaving-the-eu/
(Traduction A l’Encontre)
[...]
Le 24 juin, le Royaume-Uni, soit sera sur le chemin du Brexit, soit restera dans l’UE, mais nous ne pouvons pas éviter de prendre position à moins d’être prêts à vivre avec des conséquences auxquelles nous n’aurions en rien contribué. Si la gauche radicale ne dit rien, alors nous pouvons être sûrs que les positions très à droite continueront de dominer tant la campagne que par la suite.
[...] Le Brexit intensifierait trois crises existantes : celle de l’UE elle-même ; celle de l’Etat britannique ; celle du Parti conservateur qui, lui, fait face à sa plus grande scission depuis l’abrogation des Lois sur le blé en 1846. En fait, c’est l’absence à Westminster d’une opposition efficace aux Tories qui affaiblit la discipline intérieure du principal parti du capital britannique et y encourage une guerre interne sans freins. [...]
Le consensus de gauche favorable à Rester
Ce serait plutôt une litote de dire que la position que je viens de formuler dans le paragraphe précédent ne jouit pas exactement du soutien de la majorité dans la gauche écossaise. En fait, en termes de positions officielles de partis, il y a une remarquable unanimité pour rester dans l’UE, depuis le Parti national écossais (SNP) jusqu’au Parti socialiste écossais en passant par les Verts écossais. RISE, qui est une alliance plutôt qu’un parti, n’a pas pris de position et n’a pas besoin de le faire, bien que ses candidats aux élections au parlement écossais du mois de mai se verront demander, inévitablement et tout à fait à propos, quelle est leur position à cet égard. La Radical Independence Campaign (RIC), qui est un mouvement plutôt qu’un parti, est moins soumise à une pression pour se déterminer, et si j’en juge par le débat sur l’UE lors de sa conférence du 20 février, ses membres sont aujourd’hui aussi incertains et divisés que la plupart des gens en Ecosse.
[...] Pour commencer, on nous demande de voter pour Rester sur la base du deal de David Cameron avec l’UE qui attaque l’accès des immigrés aux bénéfices sociaux, ce qui est à son tour basé sur la thèse fausse que les immigrés sont essentiellement un drain parasite de « nos » ressources. Et, bien sûr, une fois qu’est acceptée la logique qui veut qu’on ne puisse recevoir du système des bénéfices sociaux que ce qu’on y a payé, vous pouvez être sûr que cela sera étendu des immigrés à tous les habitants du Royaume-Uni, aussi blancs de peau soient-ils et leur lignage du plus pur anglo-saxon. Ensuite, cela signifie participer à un programme de déplacement vers la droite sur toute la ligne (et pas seulement en rapport avec l’immigration) qui est promu par d’autres états membres de l’UE.[...]
A une exception très importante, les forces qui appuient la poursuite de la présence du Royaume-Uni au sein de l’UE sont les mêmes qui s’opposaient à la sécession de l’Ecosse : à l’intérieur, les institutions de l’Etat britannique, dont le Trésor, la BBC, les chefs militaires, la plupart des capitalistes de toute taille et leurs organisations représentatives comme la Confédération de l’industrie britannique (CBI) ; tous les grands partis politiques y compris (pour le moment en tout cas) le Parti travailliste, ainsi que les médias libéraux ; à l’extérieur, le Département d’Etat de Washington, le président Obama et ses deux potentiels successeurs démocrates (bien que cela soit une des rares questions sur laquelle Démocrates et Républicains sont d’accord) et, d’évidence, la Commission européenne et le Conseil européen, la Banque centrale européenne et les membres des grands courants du Parlement européen. En bref, l’opposition principale au Brexit consiste en ces représentants de la classe dominante et leurs serviteurs qui comprennent l’importance pour l’ordre international néolibéral er impérialiste de maintenir tant l’intégrité de l’Etat britannique contre la menace de l’indépendance écossaise et son statut de membre de l’UE contre la menace d’une sortie de l’UE.
[...]
Par conséquent, les arguments pour le maintien dans l’UE habituellement exprimés du côté de la gauche radicale sont essentiellement négatifs. Cette démarche part de l’observation correcte que la principale pression pour un retrait de l’UE est partie historiquement de la droite dure. On reconnaît que l’UKIP a popularisé cette position en se concentrant sur la question de la souveraineté nationale en général, particulièrement en soulignant l’incapacité du Royaume-Uni à contrôler ses frontières face à l’immigration supposée sans limite soit provenant de l’UE, soit, dans le cas des réfugiés, au travers de l’UE. A son tour, le succès de UKIP a enhardi les eurosceptiques au sein du Parti conservateur. Le référendum du 23 juin prochain n’a donc lieu qu’en réponse à leur programme raciste. L’argument, c’est donc que s’il y a un vote majoritaire pour Quitter l’UE, cela impliquera immédiatement que les citoyens non britanniques et leurs familles issus de l’UE qui ont aujourd’hui le droit de résidence dans notre pays seront confrontés au danger d’être expulsés, ou tout au moins, à une situation bien plus précaire. Vu ainsi, voter pour rester, même si cela ne conduit pas à un résultat positif, éviterait au moins un résultat négatif : c’est le « moindre mal ».
Assurément, la droite dure est notre ennemi, mais dans ce contexte au moins , ce n’est pas l’ennemi principal. Le nationalisme impérial embrassé par les Conservateurs avant 1997 en rapport à l’Europe ne l’a pas été, comme nous allons le voir, parce que l’UE aurait été d’aucune manière hostile au néolibéralisme, mais comme une diversion idéologique de l’échec du néolibéralisme à modifier le destin du capital britannique, en tout cas en dehors de la City de Londres. Ce nationalisme invoqué à cet effet devient aujourd’hui un obstacle majeur devant les politiciens britanniques et les administrateurs de l’Etat qui souhaitent poursuivre une stratégie de plus grande intégration européenne, malgré que cela soit rationnel de leur point de vue.
L’écrasante majorité des capitalistes, les patrons et leurs représentants politiques, ne veulent pas sortir de l’UE, malgré que nombreux d’entre eux aimeraient renégocier le traité en des termes qui éliminent même ces droits minimaux des salariés qu’il contient aujourd’hui, comme David Cameron, s’il gagne, essayera assurément de faire. Par-dessus tout, ils ne veulent pas barrer le flux de travail immigré entrant au Royaume-Uni, bien qu’ils le veuillent précaire et par conséquent docile.
La droite dure a, véritablement, rompu avec cette position majoritaire de la classe dominante. Il y a là un problème avec certaines analyses à gauche de la droite dure et en particulier de sa composante d’extrême droite, analyses qui considèrent qu’elle représente le vrai visage du capitalisme une fois que les masques tombent. En fait, dans le monde développé au moins, ce n’est que dans des rares situations d’extrémité aiguë – et habituellement après avoir été confronté à la sorte de menace de la part du mouvement ouvrier qui a malheureusement été absente depuis des décennies – que le capital a confié à l’extrême-droite la solution de ses problèmes. UKIP, comme le Tea Party aux Etats-Unis, est le monstre de Frankenstein du capital, la conséquence non désirée des tensions sociales insolubles provoquées par l’ordre néolibéral. UKIP a fourni un point de convergence pour toute une gamme de préoccupations sous la forme d’une institution presque imaginaire appelée « Bruxelles », d’une manière analogue à ce que fit le Tea Party sous la forme d’une autre institution quasi imaginaire appelée le « gouvernement ». La principale différence, c’est que dans le cas de l’un, l’institution est étrangère plutôt qu’intérieure, le crime des élites locales étant dans les deux cas leur soumission. Mais la base d’au moins une partie du soutien populaire à UKIP est, néanmoins, puisée dans la même sorte de couches sociales que celui du Tea Party. Sans surprise, une partie englobe des petits patrons et la petite bourgeoisie au sens strict, qui tend à commercer à l’intérieur du Royaume-Uni plutôt qu’en Europe et pour qui une régulation plus sévère et des meilleurs droits des salariés, même d’une sorte minimale, représentent une plus grande menace à leurs marges de profit que pour les grandes entreprises. Mais cette base inclut aussi une section de la classe ouvrière qui ne se sent plus représentée parce que leurs vies et leurs voisinages sont en train d’être détruits par la mondialisation néolibérale. Les anciens employés de l’industrie de la pêche dans des régions du Nord de l’Angleterre comme Grimsby peuvent reprocher à la politique européenne de la pêche avec ses règles et quotas de contribuer à leur déclin local. Ce sont là des plaintes légitimes qui n’ont rien à voir avec le racisme, même si UKIP essaye bien sûr de les formuler de cette façon.
C’est une fixation sur la droite dure et ses campagnes contre l’immigration à l’exclusion de quasiment tout autre chose qui a conduit des secteurs entiers de la gauche à adopter cette notion problématique du « moindre mal ». C’est regrettable car cela ne s’est pas révélé une tactique très heureuse dans le passé. L’histoire tend même à suggérer que cela peut aussi conduire au « plus grand mal ». Pensez à l’Allemagne en 1932 quand le Parti social-démocrate a renoncé à présenter son propre candidat aux élections présidentielles pour appeler ses électeurs à voter pour le président Hindenburg, très à droite mais pas fasciste, comme le « moindre mal », pour voir ensuite ce président une fois élu nommer quand même Hitler à la Chancellerie. C’est là manifestement un exemple extrême, bien que je m’attende à entendre bientôt le même argument à nouveau cette fois en faveur de Hillary Clinton contre Donald Trump. Il y a cependant deux raisons pour rejeter ces arguments du « moindre mal » très spécifiques à notre situation actuelle.
La première, c’est que cette approche est entièrement réactive et profondément pessimiste car elle présume que tout ce que la gauche peut faire, c’est adopter une position défensive contre UKIP et la droite conservatrice. En fait, cela revient à dire que la majorité des électeurs ouvriers sont tellement subjugués par le racisme anti-immigrés qu’ils ne voteront pour une sortie de l’UE que sur cette base. Mais les socialistes doivent argumenter pour ce qu’ils croient vraiment en postulant que nous pouvons convaincre des travailleurs de nos positions. Si nous pensons que cela est impossible, que ce soit en rapport à l’immigration ou en rapport avec n’importe quoi d’autre, alors nous avouons en fait notre impuissance politique, notre impuissance à changer l’opinion de personne. C’est penser que nous devons travailler dans les limites de ce que la députation parlementaire travailliste et les dirigeants syndicaux vont permettre à Jeremy Corbyn de dire à ce sujet.
La deuxième raison pour rejeter le « moindre mal », c’est que cela réduit la population immigrée du Royaume-Uni (ceux de l’UE et ceux du dehors) au statut de victimes passives du gouvernement Tory. Mais nombreux parmi plus de 2 millions de travailleurs ici provenant de l’UE sont intégrés dans les collectivités où ils vivent, ont rejoint les syndicats et sont membres de partis politiques de gauche, comme le RAZEM polonais. Du point de vue du capital, des secteurs entiers de l’économie et des entreprises entières (on pense tout de suite à SportsDirect) dépendent de leur travail. Les partisans de Rester évoquent une vision de cauchemar le lendemain d’un vote le 23 juin pour Quitter qui verrait des centaines de milliers de travailleurs immigrés emmenés par la police dans des fourgons noirs sans immatriculation. Mais une telle chose ne serait faisable que sous un véritable gouvernement fasciste prêt à voir s’écrouler des secteurs entiers de l’économie britannique, en particulier les services et l’agriculture. Ce qui se passera durant la période prolongée de négociations après le référendum dépendra, à nouveau, de ce que la gauche aura fait avant et fera après. De toute façon, argumenter exclusivement à propos des immigrés venant de l’UE qui vivent aujourd’hui au Royaume-Uni, c’est ignorer le sort de ces migrants et de ces migrants potentiels et réfugiés du dehors de l’UE dont la position derrière les frontières de barbelés de notre Maison européenne commune sera aggravée. Dans tous les cas, la tâche centrale, c’est de soutenir et d’aider à organiser les travailleurs immigrés tout en plaidant pour que les frontières britanniques soient ouvertes à tous, de l’UE et du dehors. Et si des camarades pensent que c’est utopiste, que devient alors la perspective de jamais réaliser le socialisme, qui est, après tout, encore plus difficile à gagner ?
Pourquoi ce fatalisme que de grands secteurs de la gauche radicale manifestent à propos de l’UE ? Une comparaison entre les référendums de 1975 et de 2016 est intéressante à cet égard. En 1975, après presque sept années de luttes de classe industrielles intensives et largement victorieuses, et l’émergence de plusieurs nouveaux mouvements sociaux, la gauche se sentait suffisamment en confiance pour faire campagne pour ce qu’elle pensait vraiment être la juste direction d’action. Si elle a perdu, cela peut être vu rétrospectivement comme le début du virage à droite et de la venue de l’ère néolibérale. Cela fait réfléchir de penser que la dernière victoire générale remportée par la classe ouvrière depuis lors fut l’abrogation de l’impôt de capitation (Poll Tax) de Madame Thatcher et sa chute il y a 25 ans. Mais même cette lutte fut basée sur les lieux d’habitation de la classe ouvrière et non leurs lieux de travail comme nous l’avons vu en Ecosse dans notre campagne pour le OUI à l’indépendance. Ces décennies de défaites ont laissé leur marque.
[...]
Enfin, il pourrait se donner une situation dans laquelle l’argument deviendrait complètement superflu. Imaginez que l’Angleterre vote pour sortir et l’Ecosse vote pour rester dans l’UE. Selon ce scénario, un deuxième référendum pour l’indépendance de l’Ecosse s’ensuit avec un résultat du OUI suffisant pour réduire au silence toute tentative de mettre en question sa légitimité. L’Ecosse alors pourrait demander à devenir membre de l’UE et, en toute probabilité, être acceptée aux conditions habituelles qui incluraient, dès lors que nous ne serions plus au bénéfice des dérogations actuelles dont bénéficie le Royaume-Uni, l’adoption des critères de convergence de Maastricht, y compris réduire à 60% du PIB la dette, l’Euro (y compris les mécanismes de sauvetage de la zone Euro), et l’accord de Schengen. On a présumé que cela se déroulerait sans aucune consultation supplémentaire de l’électorat écossais mais cela serait non démocratique à l’extrême. Un vote pour rester dans l’UE quand on fait partie du Royaume-Uni ne pourrait pas être considéré répété quand le contexte serait d’un nouvel état indépendant. Il devrait être testé à nouveau ne serait-ce que parce que l’électorat du référendum du Royaume-Uni a exclu les personnes de 16 et 17 ans et les immigrés qui votent en Ecosse et qui devraient avoir l’occasion de formuler leur vote. Cependant, arrivé là, la position du « moindre mal » ne serait plus pertinente puisque l’hystérie anti-immigrés associée à la droite dure anglaise ne biaiserait plus la nature de la question. Il serait enfin possible de juger à sa juste valeur et dans ses propres termes, sans diversion ni évasion, la question positive de savoir si adhérer à l’UE, en se basant sur ce qu’elle est et ce qu’elle fait réellement. Et quelle est cette question ?
« L’Europe sociale »
L’argument en positif pour adhérer à l’UE, indépendamment des délires contingents des Europhobes racistes, tend à être formulé par la gauche libérale et du centre. Dans leur vision, l’UE est fondamentalement une institution bégnine (« bien sûr elle n’est pas parfaite ») qui a contribué à éviter la guerre en Europe depuis 1945, a institué des droits pour les travailleurs et les citoyens, et a régulé l’impact des entreprises sur la santé et l’environnement. Associée à ces prétentions va une idée de l’« Europe » présentée généralement dans un nuage de guimauve vaguement exaltant comme incarnation des idéaux des Lumières, transcendant ce qui est invariablement décrit comme le nationalisme « étroit » et agissant comme barrière aux intérêts des Etats-Unis, présumés être différents. Dans cette perspective, l’UE d’aujourd’hui peut être temporairement dominée par les néolibéraux mais elle peut être réformée jusqu’à devenir une institution capable de répondre aux revendications de justice sociale. La dissonance entre la réalité de l’UE et les fantaisies des « valeurs européennes » tant prisées par la sorte de Polly Toynbee (journaliste du Guardian), Will Hutton (économiste et ancien rédacteur en chef de The Observer) et Martin Kettle (rédacteur en chef adjoint de The Guardian), dont le soutien à l’UE n’est égalé que par leur opposition à l’indépendance de l’Ecosse, est déguisée partiellement en brouillant ce qui appartient à l’UE et ce qui ne lui appartient pas. Ici, les libéraux sont dans les faits en collusion avec la droite dure qui a ses propres raisons de semer la confusion. Ainsi, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, par exemple, responsable du Human Rights Act, est citée fréquemment comme une raison de rester dans l’UE alors qu’elle en est tout à fait séparée, établie qu’elle a été dans les années 1950 avec l’appui de Winston Churchill, bien que ce fait dérangeant soit habituellement cachée aux lecteurs tant du Guardian que du Daily Mail.
L’attitude de la gauche socialiste à l’égard de l’UE tend à être plus hostile à l’UE que le centre et la gauche libérale, comme le suggère l’alignement lors du référendum de 1975. Tom Nairn n’exagérait que peu quand il avait intitulé son fameux article de 1972 « La gauche contre l’Europe ». Tout cela avait commencé à changer sous Margaret Thatcher quand, devant les défaites massives des syndicats et l’incapacité apparente du Parti travailliste à gagner les élections générales, l’UE apparaissait comme le seul rempart contre les attaques contre le mouvement ouvrier. Le tournant fut probablement un discours de Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, au congrès des syndicats en septembre 1988, suivi par l’adoption du Chapitre social lors du sommet de Strasbourg l’année suivante. Delors, comme ministre des finances sous Mitterrand avait bien sûr été en partie responsable de l’abandon du programme de réformes de Mitterrand en 1983-1984, et l’adoption du projet néolibéral, et cela aurait dû alerter son audience du caractère purement tactique de ses flatteries aux syndicats, mais le désespoir nous rend tous fous.
Contrairement à la théorie de la conspiration sophistiquée formulée par Naomi Klein dans sa Stratégie du choc, le néolibéralisme n’a pas été créé parce que les politiciens, les hauts fonctionnaires et les patrons des grandes entreprises, après des années d’avoir été entravés mystérieusement, ont tout à coup vu des occasions dans le « capitalisme du désastre » d’appliquer avec succès les doctrines de Friedrich von Hayek ou Milton Friedman. Au contraire, le néolibéralisme a été une stratégie improvisée en réaction au retour de la crise économique généralisée en 1973-74 dans des conditions où le mode d’accumulation qui avait prévalu depuis 1945 ne fonctionnait plus et où les options de politiques – en tout cas de politiques favorables au capitalisme – se voyaient donc fortement limitées. D’où le virage vers la privatisation, la dérégulation, les impôts indirects, et tout le reste. Mais le néolibéralisme n’est plus simplement un ensemble de politiques mais la façon comment le capitalisme est aujourd’hui organisé. Rétrospectivement, nous pouvons voir le néolibéralisme comme toute une période de l’histoire du capitalisme, dont nous ne voyons pas la fin pour le moment, qui a vu le consensus dominant démocratique social et libéral du boom de l’après-guerre être renversé et remplacé. Ces jours ne reviendront pas.
L’UE avait entrepris sa propre marche vers le néolibéralisme pas plus tard que l’Acte unique européen de 1986 et cela s’est confirmé et approfondi dans tous les pactes et traités suivants depuis Maastricht en 1991, et depuis lors. Ce n’est pas surprenant : L’UE n’est pas une institution suspendue au-dessus des transformations du système capitaliste et comme le passage au néolibéralisme fut imposé dans les Etats-nations membres, l’UE était vouée à le refléter dans ses propres règles et politiques. Ce qui a rendu cela plus facile que dans les Etats-nations individuels, c’est que l’UE a toujours manqué de la plupart des contraintes démocratiques qui ont fait que ce passage a été au moins contesté en Grande Bretagne ou en Italie, et cela même quand l’UE payait tribut à des conceptions sociales-démocrates de propriété et de contrôle. Ironiquement, à cet égard l’UE a toujours été structurée selon les préceptes d’un penseur néolibéral éminent.
[...]
Le manque de démocratie et ces règles obligatoires seraient raison suffisante pour quitter l’UE mais il y en a au moins trois autres, chacune témoignant non seulement du caractère intrinsèquement réactionnaire du projet européen mais comment il échoue même à remplir le rôle pour lequel ses thuriféraires libéraux le célèbrent le plus : surmonter l’intérêt national égoïste.
Premièrement, l’UE est conçue pour maintenir la structure des inégalités existantes entre les Etats-nations européens, bine que cela ne soit devenu entièrement visible que depuis le processus d’élargissement après 1992, quand les régions les plus pauvres de l’Europe de l’Est et méditerranéenne ont été autorisées à devenir membres. Sous tout le bavardage de « solidarité », cela est sans échappatoire : une structure financière et industrielle conçue pour satisfaire les besoins des économies les plus fortes, la France et l’Allemagne, et depuis l’introduction de l’Euro, de plus en plus seulement l’Allemagne, mais qui force les plus faibles à jouer selon les mêmes règles, sera toujours à leur détriment, particulièrement quand il n’existe aucun mécanisme de transfert de fonds ou de ressources au sein de l’UE comme cela peut se faire au sein des Etats-nations.
Deuxièmement, bien que l’UE ne soit pas une puissance impérialiste par elle-même, en tant qu’institution collective, elle agit cependant de plus en plus comme adjointe de l’OTAN et par conséquent comme un appui aux intérêts des Etats-Unis. C’est, comme ils disent, pas un hasard que les Etats-Unis aient insisté que les Etats d’Europe orientale candidats rejoignent d’abord l’OTAN avant d’adhérer à l’UE. Mais ce rôle a été inscrit dans l’ADN de l’UE depuis le début. Les Etats-Unis ont dès le début encouragé et soutenu la formation du Marché Commun, le prédécesseur de l’UE, comme partie du rempart de la Guerre froide contre son rival impérial russe et c’est là la principale raison pourquoi il n’y eut « pas de guerre en Europe (de l’Ouest) » entre 1945 et 1991 : Bien qu’engagés dans une concurrence économique entre eux tous, les états membres de l’UE étaient unis derrière les Etats-Unis dans la même alliance géopolitique. Mais si l’UE elle-même n’agit pas comme une puissance impériale, les principaux Etats-nations membres le font de plus en plus et ne se soumettent pas toujours aux désirs de Washington. Là aussi, nous voyons les plus forts placer leurs propres intérêts au dessus de la supposée unité européenne. Pour certains, c’est externalisé, comme dans la persistante, et sous estimée, présence française en Afrique centrale, mais pour d’autres, cela se manifeste au cœur même de l’Europe, le plus manifestement dans le cas de l’Allemagne, dont la reconnaissance de l’indépendance de la Croatie en 1992 a contribué au bain de sang qui a suivi en Yougoslavie.
Troisièmement, l’UE est structurellement raciste. L’idée même de « l’Europe » est nécessairement exclusive. On se rappelle peu que le Maroc a présenté sa candidature à l’adhésion à l’UE en septembre 1987, à l’hilarité des membres de la Commission, qui l’ont écartée parce qu’« il ne satisfaisait pas aux critères pour être membre ». La tant vantée « liberté de mouvement » au sein de l’UE est basée sur le blocage du mouvement de ceux qui sont au dehors comme des dizaines de milliers de réfugiés désespérés le découvrent chaque jour. Le spectacle de ces gens piégés dans les camps, derrière des barbelés et face aux chiens policiers et aux gaz lacrymogènes sur les frontières de la civilisation européenne est suffisamment obscène mais il est aggravé par l’attitude des états-membres eux-mêmes. Car là à nouveau, leurs intérêts particuliers passent devant la barbarie collective elle-même, tandis que les accords de Schengen s’écroulent en une ruée pour défendre les frontières individuelles contre les hordes étrangères. Il y a certainement là un mal, mais il ne m’apparaît pas qu’il soit « moindre ».
Il y a enfin un argument positif en faveur de l’UE, qui tend à être formulé par des secteurs de la gauche radicale. C’est que le capitalisme domine partout, depuis l’UE jusqu’à notre poste de travail. Mais selon ce récit, au moins l’UE remplit une des rares fonctions positives du capitalisme : elle rassemble des travailleurs dans un des plus grands ensembles du monde et leur pression peut transformer l’UE. Voilà un classique exemple consistant à confondre les désirs et la réalité. L’UE organise la classe dominante, elle n’organise pas les travailleurs. Comme Trotski l’a écrit dans un autre contexte, on ne peut pas utiliser un frein comme accélérateur. Il n’existe pas de partis ou de syndicats, ou de mouvements, à l’échelle de l’UE. Dans tous les cas, un des arguments que les partisans du OUI ont employé lors du référendum écossais de 2014, c’est que la solidarité par-dessus les frontières ne dépendait pas des constitutions ou des institutions mais de la volonté des travailleurs de se soutenir les uns les autres, même dans des pays séparés. Cela est vrai tant pour les Etats-nations au sein de l’UE que pour les nations du Royaume-Uni. Au lieu d’invoquer des bataillions imaginaires de travailleurs organisés au niveau européen, il serait plus utile de commencer à construire là où nous sommes.
[...]
La gauche peut-elle faire une différence ?
J’ai écrit plus haut qu’il y avait des différences entre le référendum sur l’indépendance de l’Ecosse et celui sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE. Lors du premier, la plupart des forces de la gauche radicale étaient réunies dans le RIC et nous avons eu deux ans pour déplacer la campagne large pour le OUI en l’éloignant du paquet monarchie-sterling-OTAN qu’offrait initialement le SNP. Dans le cas présent, nous sommes divisés et le temps est absurdement court pour changer les termes du débat. Néanmoins, quelles que soient les difficultés, un argument de gauche pour Quitter doit être formulé de manière urgente.
Voter Rester sur des bases tactiques (le « moindre mal »), quels que soient les avantages putatifs à court terme sera négatif à long terme, car cela va effectivement impliquer se soumettre à des chantages politiques et placer notre défense des droits des migrants à charge de l’UE, dont nous savons – pour ne pas dire plus – que nous ne pouvons pas lui faire confiance qu’elle les défendra. En d’autres termes, nous avons besoin de construire notre propre capacité indépendante d’argumenter un choix ; sinon nous nous trouverons soumis au même chantage chaque fois que cela arrivera. Et cela arrivera à nouveau, car les multiples crises de l’UE, dont la crise des frontières externes et internes n’est que la plus visible – ne vont pas disparaître prochainement. Si nous ne le faisons pas, les personnes de la classe travailleuse que nous espérons influencer vont conclure, soit que la gauche n’a pas de position positive propre, soit que sa position est tout simplement incohérente, comme l’illustre le spectacle de ces commentateurs de gauche habituellement crédibles comme Owen Jones (de The Guardian) et Georges Monbiot (du Guardian aussi) en train d’expliquer combien non démocratique et néolibérale est l’UE… juste pour appeler à voter pour Rester. Et la position Rester de gauche, quelque « tactique » soit-elle, glisse inéluctablement à une apologie de l’UE puis à un programme de sa réforme tout à fait illusoire.
Encore une remarque finale : quelques-uns pourraient dire qu’une position de gauche pour Quitter revient à retourner à la folie du Socialisme dans un seul pays, que ce pays soit la Grande Bretagne ou l’Ecosse. Mais ce n’est pas ce que nous disons ici. Il est peu probable que la lutte contre le néolibéralisme commence simultanément à travers toute l’UE ou reste confinée dans ses frontières. Il est plus probable que nous assistions à une série inégale de mouvements de différentes intensités, à l’intérieur de différents Etats-nations qui, s’ils sont victorieux, pourraient former de nouvelles alliances et finalement des Etats-Unis d’Europe. Cependant cette vision ne peut pas être réalisée au sein de l’UE mais seulement sur ses ruines.
Notes
[1] http://alencontre.org/europe/grande-bretagne/lever-de-soleil-pour-la-gauche-ecossaise.html
http://alencontre.org/europe/grande-bretagne/ecosse-oui-un-argumentaire-non-nationaliste-pour-lindependance-de-lecosse.html
http://alencontre.org/europe/ecosse-referendum-du-18-septembre-la-campagne-pour-le-non-sest-calee-sur-la-britishness-la-plus-reactionnaire.html
[2] Peter Mandelson, ancien ministre de Tony Blair et ancien membre de la Commission européenne et aujourd’hui membre de la Chambre des Lords, est le leader de la droite travailliste contre Jeremy Corbyn
Nigel Farage, ancien membre du Parti conservateur, est le dirigeant de UK Independence Party (UKIP) et député au Parlement européen.
George Galloway, ancien député travailliste et leader de la gauche travailliste, expulsé du Parti travailliste en 2003 pour son opposition à la guerre contre l’Irak, a été membre de la Chambre des Communes de 2002 à 2015 pour le Respect Party qu’il avait contribué à fonder en 2004 en alliance, alors (et jusqu’en 2008), avec le SWP. Galloway a échoué à être élu en 2011 au Parlement écossais et en 2014, lors du référendum sur l’indépendance de l’Ecosse, il s’est opposé à l’indépendance.
[3] Enoch Powell (1912-1998), professeur de grec ancien, et général durant la guerre, fut ministre conservateur en 1960-63 et leader de l’extrême-droite du Parti conservateur dès son discours fameux de 1968 contre l’immigration, jugé raciste. Il quitta le Parti conservateur en 1974 par opposition à l’Europe et fut député des Unionistes d’Irlande du Nord à la Chambre des Communes.