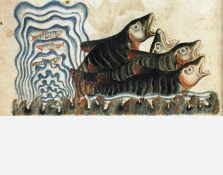La guerre culturelle des conservateurs québécois, un ouvrage paru récemment chez M éditeur et codirigé par Francis Dupuis-Déri, professeur au Département de science politique aurait pu paraître comme… une déclaration de guerre aux yeux de son collègue du Département de sociologie Jacques Beauchemin. Mais malgré des désaccords et bien que ses idées y soient critiquées, le sociologue reconnaît des qualités à l’ouvrage. « C’est un livre d’une excellente facture qui propose un argumentaire solide », affirme-t-il, beau joueur.
Cet ouvrage collectif à caractère polémique (codirigé par Marc-André Éthier, professeur de didactique à l’Université de Montréal), auquel collabore le professeur du Département d’histoire Martin Petitclerc, analyse la lutte idéologique et politique entre progressistes et conservateurs dans le champ intellectuel et universitaire au Québec. Une lutte autour de divers enjeux sociaux, politiques et culturels : la question nationale, le féminisme, l’enseignement de l’histoire, le printemps étudiant de 2012, etc.
Les auteurs dressent une cartographie de la mouvance conservatrice en distinguant différentes familles idéologiques : la droite économique néolibérale incarnée, entre autres, par l’Institut économique de Montréal ; le populisme des « radios poubelles » ; la tendance conservatrice morale et catholique ; le nationalisme conservateur – auquel sont notamment associés le sociologue Jacques Beauchemin, son collègue Joseph-Yvon Thériault du même département, le professeur Marc Chevrier, du Département de science politique, le chroniqueur Mathieu Bock-Côté (Ph.D. sociologie, 2013) et l’historien Éric Bédard –, ainsi que le conservatisme de gauche, un courant qui rejette le néolibéralisme, mais critique certaines luttes sociales (féministes, écologistes) jugées secondaires.
Selon Jacques Beauchemin, parler de « guerre culturelle » est nettement exagéré et relève d’une opération de mise en marché visant à rendre le propos de l’ouvrage plus attrayant pour les lecteurs. « Depuis la Révolution tranquille, le Québec s’est presque intégralement défini dans une perspective progressiste, observe-t-il. Cela dit, il est vrai que des voix conservatrices se font entendre depuis 10 ou 15 ans. Des intellectuels québécois défendent un point de vue, que Francis Dupuis-Déri et d’autres qualifient de conservateur, qui remet en cause les mantras du progressisme. »
« Nous n’avons pas inventé le concept de guerre culturelle, rétorque Francis Dupuis-Déri. Divers acteurs et analystes politiques l’ont déjà utilisé pour décrire la confrontation idéologique entre conservateurs et progressistes, tant au Québec qu’aux États-Unis. L’expression traduit bien à nos yeux la dynamique des débats entre les deux pôles. »
Les critiques du collectif sont principalement dirigées contre les nationalistes conservateurs, en raison de leur influence dans les médias, les universités, les revues d’idées, comme Argument et L’Action nationale, et de leurs liens avec le Parti québécois. « Les progressistes ont aussi leurs propres réseaux et revues et certains d’entre eux entretiennent des liens avec Québec solidaire », note le politologue, lui-même partisan d’une gauche de tendance anarchiste.
Souveraineté et progrès social
La légitimité du projet souveraniste et celle des mobilisations sociales dans le Québec d’aujourd’hui comptent parmi les enjeux majeurs de cette « guerre » des idées entre forces progressistes et conservatrices.
Selon Jacques Beauchemin, qui a été sous-ministre au sein du dernier gouvernement du Parti Québécois, certains progressistes nient la légitimité de la lutte nationale, alors que ceux que l’ouvrage qualifie de nationalistes conservateurs affirment sa nécessaire prééminence. « Ces derniers ne critiquent pas les progressistes parce qu’ils défendent des groupes marginalisés ou opprimés, mais ils leur reprochent d’occulter l’autre combat tout aussi fondamental, celui pour la souveraineté politique du Québec, dit-il. Il m’apparaît plus pertinent de définir d’abord le type de communauté politique que le Québec doit se donner. »
Francis Dupuis-Déri critique l’attitude paternaliste des nationalistes conservateurs à l’égard des progressistes, qui refusent de subordonner les luttes pour le progrès social à celle pour la souveraineté. « Les luttes des mouvements sociaux – groupes féministes, étudiants, syndicats, écologistes, autochtones et minorités sexuelles – constituent aux yeux des conservateurs une forme de distraction par rapport au combat prioritaire pour la souveraineté. Plusieurs enjeux sociaux et politiques – environnement, discrimination envers les autochtones, violence sexuelle à l’égard des femmes – ne sont pas solubles dans la question nationale. Cela dit, le jour où se tiendra un troisième référendum, la plupart des groupes progressistes se retrouveront probablement dans le camp du Oui, comme ce fut le cas en 1980 et 1995, au grand plaisir des nationalistes conservateurs. »
Une société des identités ?
Sans être des frères jumeaux, les conservateurs de droite comme de gauche se rejoignent dans leur attachement à l’État-nation québécois et dans la critique de la société des identités (titre d’un ouvrage de Jacques Beauchemin), qui mène à la division.
« Le développement du mouvement des femmes, du mouvement noir américain, puis du mouvement gai dans les années 1960-1970 a favorisé une recomposition de la société sur une base identitaire, affirme le sociologue. Pour plusieurs acteurs sociaux, c’était la nouvelle manière de porter un projet émancipateur. La promotion du pluralisme identitaire est même devenue le seul projet éthique et politique dans notre société fragmentée. Ce faisant, toute représentation totalisante de la société se trouve délégitimée ou secondarisée. Le projet de la souveraineté politique du Québec permet, lui, d’envisager un monde commun. »
Présenter le nationalisme comme un projet permettant de transcender le particulier ne va pas de soi, croit pour sa part Francis Dupuis-Déri. « Le nationalisme, dit-il, constitue le premier mouvement identitaire de la modernité, divisant l’humanité en communautés nationales chapeautées par des États souverains. Les féministes, que les nationalistes conservateurs de toutes tendances se plaisent à critiquer pour leurs revendications particularistes, sont quand même parvenues à formuler un projet proposant une émancipation pour toutes et tous, c’est-à-dire pour les hommes et les femmes en tant qu’êtres humains. »
La diversité, force ou faiblesse ?
Jacques Beauchemin reproche aux progressistes de concevoir la société comme une agglomération de différences, de renoncer à la penser dans son unité, en s’appuyant sur l’histoire et la mémoire. « Dans la plupart des sociétés occidentales, on observe une sacralisation de la diversité, dit le sociologue. Nos chartes des droits et libertés nous rappellent constamment que la diversité, c’est beau, c’est noble. Nous vivons, en fait, sous l’impératif moral de l’ouverture à la diversité, mais une ouverture non critique. Poser la question de la place du voile ou de la burqa dans l’espace public, par exemple, c’est faire obstacle à la diversité. De la même manière, il est devenu impossible de discuter des seuils d’immigration. Le Québec est-il capable d’accueillir 60 000 immigrants par année ? Si vous osez soulever cette question, vous êtes aussitôt accusé de xénophobie. »
Son collègue Francis Dupuis-Déri voit les choses d’un autre œil. « D’un point de vue philosophique, éthique, culturel, voire psychologique, la diversité constitue en soi une richesse parce qu’elle nous rend plus intelligent, soutient-il. Elle offre davantage de modèles et d’expériences de vie, tant sur le plan individuel que collectif. Les progressistes veulent la diversité parce qu’elle est synonyme d’inclusion, d’égalité et d’équité pour tous les groupes opprimés et oubliés dans la société. »
Les conservateurs nationalistes, eux, s’inquiètent de la cohésion sociale qui serait mise à mal par la diversité des luttes sociales. « La solidarité sociale, telle qu’elle s’exprime à travers l’État providence et les politiques publiques, nécessite un fondement unitaire, insiste Jacques Beauchemin. Or, la société s’est reformatée en tribus. Chacune défend son territoire, ses intérêts et ses droits. Ce n’est pas un hasard si le projet nationaliste est en crise parce qu’il est devenu difficile de penser la société en termes collectifs. »
La diversité n’est pas une faiblesse par effet de fragmentation, mais au contraire une force en raison des possibilités de coalitions, d’alliances et d’interconnexions, croit Francis Dupuis-Déri. « Dans les années 2000, le mouvement altermondialiste et les Forums sociaux mondiaux ont rassemblé les forces du mouvement étudiant, du mouvement des femmes, des écologistes, des syndicats. Plus près de nous, le mouvement étudiant de 2012 est devenu plus vigoureux en obtenant l’appui de divers groupes : les "mères en colère", les "profs contre la hausse", les "infirmières pour la gratuité scolaire", le mouvement des casseroles, etc. Pensons aussi au parti de gauche Québec solidaire qui réunit des gens actifs dans divers mouvements sociaux. »
Les deux professeurs, qui disent se vouer un respect mutuel, ont bien l’intention de poursuivre le débat d’idées, essentiel dans une société démocratique. Comme le rappelle Francis Dupuis-Déri, l’opposition entre conservatisme et progressisme structure la modernité occidentale depuis au moins le 18e siècle. « Ce pôle d’opposition ne fait que se recomposer selon les époques et les contextes sociaux et culturels », dit-il.