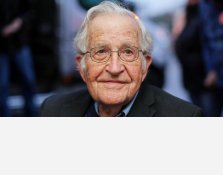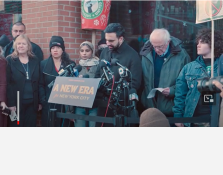Avec l’accord sur le plafond de la dette fédérale conclu avec les républicains, Obama a surpassé le bilan de Reagan en termes de réductions des dépenses sociales – à une échelle telle que les droitiers les plus récalcitrants n’auraient pu le rêver.
Si vos yeux se brouillent devant le grand chiffre et les mécanismes complexes destinés à réduire de 2 billions de dollars le budget fédéral au cours de la prochaine décennie, ceci est un bref résumé de l’accord : « Au diable les malades, les pauvres et les vieux ! Nous allons imposer une baisse permanente du niveau de vie des travailleurs pendant que les banques et les riches s’accaparent la plus grande partie des richesses nationales. » Les réductions budgétaires pourraient atteindre jusqu’à 10% du PIB du pays. Cela constitue en outre un coup sanglant contre une économie qui, plus de deux ans après la récession, récupère avec peine et maintient un taux de chômage massif.
De nombreux libéraux (dans le sens anglo-saxon du terme, de « centre-gauche », NdT) sont horrifiés par l’accord. Nonante cinq élus démocrates ont rejeté l’accord car il allait trop loin, ensemble avec 66 républicains qui s’y sont opposés car, selon eux, les réductions ne sont pas suffisantes. Mais avec le Grand capital tordant leurs poignets, l’accord a été adopté par 269 votes pour et 161 contre.
Le plafond de la dette limite la quantité de prêts que le gouvernement peut demander afin de financer ses opérations. Cette quantité – actuellement 14,3 billions – doit être, comme cela a eu lieu de manière routinière dans le passé, augmentée à la mesure de la croissance du pays et de ses obligations financières. Cette fois ci, le débat fut conflictuel car à Washington, tant les démocrates que les républicains y ont vu l’opportunité d’imposer leur agenda d’austérité.
Obama a commencé par accepter à l’avance des réductions de dépenses autrefois inimaginables, ce qui a permis aux gangsters du Tea Party de faire monter les enchères en exigeant un amendement constitutionnel obligeant de présenter un « budget équilibré » avant de permettre d’élever le plafond de l’endettement fédéral.
Mais la posture outrancière du Tea Party ne fut qu’une manœuvre de distraction. Tandis que les médias se focalisaient sur le spectacle d’une poignée d’extrémistes de droite qui menaçaient de prendre en otage l’économie étatsunienne, le véritable accord était silencieusement élaboré entre Obama et le leader de la majorité démocrate au Sénat Harry Reid d’une part, et les républicains John Boehner, leader de la majorité républicaine à la Chambre des représentants et Mitch McConnell, leader de minorité républicaine au Sénat d’autre part.
L’accord prévoit des réductions de 2,1 billions de dollars : 900 milliards maintenant, au travers d’une limitation des dépenses internes et de la Défense ; et entre 1,2 et 1,5 billions au cours des dix prochaines années, les détails devant être peaufinés pour la fin de l’année par un super comité composé par les deux partis et approuvées ou rejetées, sans amendements, par les deux chambres. Si le comité ne parvient pas à un accord, des réductions des dépenses se feront de toute façon automatiquement.
Quelle leçon de démocratie ! Les congressistes, supposément élus pour veiller sur nos intérêts, ont approuvé une loi qui empêchera de manière spécifique que l’opinion majoritaire – par exemple, en faveur d’impôts pour les riches et la protection du Medicare et de l’assurance sociale – puisse s’exprimer à l’avenir.
De fait, le « débat » sur le plafond de la dette fut délibérément manipulé dans l’intention de nier la démocratie. Les deux partis étaient d’accord depuis le début sur le fait que les dépenses sociales devaient êtres réduites. La différence résidait dans le fait que l’administration Obama a cherché à restaurer quelques menus impôts sur les riches aux niveaux, déjà forts bas, des années 1990. Mais Obama s’est allié avec enthousiasme aux républicains afin de lier la hausse du plafond de la dette à des réductions importantes des dépenses sociales, il renonça donc rapidement à toute augmentation des impôts pour les riches dans le but de parvenir à un accord.
Les politiciens étatsuniens ont fait leurs le scénario européen d’ajustement, avec des banquiers et des bureaucrates non élus qui dictent les mesures d’austérité sociale comme en Grèce, Portugal, Irlande, Espagne, Italie, etc. Mais le gouvernement d’un petit pays comme la Grèce peut tout au moins rendre responsables l’Union européenne et le Fonds Monétaire International, à cause de leurs exigences de réductions budgétaires écrasantes en échange d’un sauvetage financier. Mais quelle est l’excuse dont peut se prévaloir Barack Obama ? Il est lui, prétendument, la personne la plus puissante du monde. Mais seulement en apparence. Obama est en réalité à la merci d’une poignée d’idéologues républicains de la Chambre des représentants.
Ainsi, après que la Maison Blanche ait cédé aux républicains, l’éditorialiste du « The New York Times », Paul Krugman, a pu écrire que la décision d’Obama représentait une « capitulation totale ». Mais Obama n’a pas capitulé devant les républicains. Il les a au contraire reçus comme des libérateurs : ils lui ont permis de se libérer des espoirs élevés de « changement » placés en lui par ceux qui l’ont élu.
C’est pour cela que, lors d’une étape des négociations, Obama a y compris proposé un « grand pacte » - en mettant en avant des réductions des allocations pour les futurs pensionnés et un recul de l’âge d’accès au programme Medicare. Comme l’analyste de Salon.com Glenn Greenwald l’a souligné, Obama s’est ouvertement vanté d’être prêt à s’aliéner sa base démocrate afin de capter le vote des indépendants aux élections de 2012. « Ce n’est pas simplement qu’il n’a pas peur du mécontentement chez les libéraux, c’est – et il l’affirme – ce qu’il souhaite ».
Cela explique pourquoi Obama a écarté une série de manœuvres légales qui auraient pu éviter le blocage du relèvement du plafond d’endettement et empêché les républicains de faire passer leur programme. Il a au contraire fait le choix de négocier avec eux, en acceptant leurs termes, en les aidant à fabriquer la crise qu’il a ensuite utilisé afin de légitimer les réductions des dépenses sociales.
Les défenseurs libéraux d’Obama ont affirmé que l’offre de son « grand pacte » n’était qu’une manœuvre destinée à mettre en lumière l’intransigeance des républicains. Mais, même en jetant un coup d’œil superficiel sur les événements, l’évidence démontre le contraire. Quatre jours avant qu’Obama n’assume l’accord, l’éditorialiste du « Wall Street Journal » Gerald Seib écrivait un article intitulé « Obama s’oriente vers un « grand pacte » afin de rectifier le désarroi budgétaire ». Il y soulignait que, tout en préparant des mesures de stimulation économique qui augmenteraient le déficit budgétaire à court terme, il préparait le terrain politique afin de réduire les dépenses sociales.
« Et c’est là où le grand pacte serait utile. Tout comme Humpty Dumpty, le budget va être de toute façon brisé. En le réarmant, es-ce que les pensionnés seront disposés à accepter l’idée que les personnes âgées plus prospères payent une prime mensuelle afin de recevoir leur couverture de Medicare ? Es-ce que les libéraux accepteront les réductions dans leurs programmes favoris ? Es-ce que les conservateurs accepteront l’idée d’une taxe carbone, pour récolter des fonds pour les dépenses sociales, tout comme pour pousser le pays à abandonner plus rapidement les combustibles fossiles ? »
Mais, au final, la droite n’a pratiquement rien cédé. Pire, les républicains ont bloqué le « grand pacte » d’Obama parce qu’il aurait modestement augmenté les impôts des riches. Ainsi, le président leur a finalement donné ce qu’ils voulaient : des réductions de dépenses, et rien que des réductions de dépenses.
Mais même cela n’était pas encore suffisant pour le Tea Party, qui voulait en outre réécrire la Constitution afin de l’adapter à ses objectifs. Mais à ce moment là, agissant comme l’arbitre d’un match de catch truqué, Wall Street a sifflé la fin de la rencontre et se prépare maintenant à répartir l’argent de la prime sous forme de contributions électorales pour 2012.
L’appropriation par Obama de l’agenda budgétaire républicain n’a pas seulement constitué une posture tactique pré-électorale. C’était son objectif politique. Même sa réforme de la santé, ridiculisée par la droite comme étant « socialiste », a servi de moyen pour « économiser » 500 milliards sur le dos du programme Medicare pour les dix années à venir. (…)
Il y a eu beaucoup d’indignation chez les libéraux face à l’accord. « Ajouté aux réductions de dépenses déjà en cours dans les gouvernements d’Etats et locaux, l’accord augmente la probabilité d’une double récession », écrit ainsi l’auteur Robert Reich, qui ajoute : « En adoptant la réduction du déficit comme son objectif apparent – affirmant vouloir le faire de manière distincte que le GOP (le « Grand Old Party », surmon du Parti Républicain), les démocrates et la Maison Blanche sont maintenant d’accord avec ce même GOP sur le fait que le déficit budgétaire constitue le plus grand obstacle à la prospérité de la nation. Or, ce déficit n’est pas le plus grand obstacle à notre prospérité, contrairement au manque d’emplois et de croissance. Et la plus grande menace pour notre démocratie, c’est l’apparition d’une droite radicale capable d’obtenir victoire dans la plupart de ses chantages ».
Le président du « Caucus Noir » du Congrès, Emanuel Cleaver, a caractérisé l’accord comme un « sandwich satanique », et Raúl M. Grijalva, co-modérateur du « Caucus Progressiste » du Congrès, l’a dénoncé « parce qu’il ne tente même pas de parvenir à un équilibre entre les réductions des dépenses pour les travailleurs d’Amérique et une contribution plus juste des millionnaires et des grandes entreprises ».
Rose Ann DeMoro, directrice exécutive des Infirmières Nationales Unies, a également condamné l’accord, appelant le Congrès et la Maison Blanche à « créer des emplois et réduire la souffrance de ces millions de familles étatsuniennes qui ne peuvent payer leurs frais médicaux, perdent leur épargne de retraite et sont confrontées à la perte de leurs foyers, tandis que de plus en plus de ressources sont transférées dans les poches des grandes entreprises et des riches, qui n’en ont absolument pas besoin ».
L’accord est sans aucun doute une pilule amère pour les dirigeants syndicaux et les leaders libéraux. Mais la majorité d’entre eux s’apprête à se pincer le nez pour soutenir Obama et les démocrates aux élections de 2012. De manière révélatrice, un communiqué de presse du syndicat AFL-CIO de la fin du mois de juillet, critique les républicains pour leur volonté de chercher un accord reposant uniquement sur des réductions des dépenses sociales, mais ne mentionne pas une seule fois Obama et le Parti démocrate.
Le virage à droite décisif d’Obama va désorienter et démoraliser des millions de travailleurs, y compris des activistes essentiels pour les luttes sociales, des délégués syndicaux, ceux qui s’organisent autour du droit au logement et pour la défense des services publics, etc. Des conservateurs comme le gouverneur républicain du Wisconsin, Scott Walker, vont s’enhardir afin d’attaquer encore plus brutalement les syndicats et les pauvres. Des démocrates comme le maire de Chicago, Rahm Emanuel et les gouverneurs Andrew Cuomo de New York, Jerry Brown de Californie et Pat Quinn de l’Illinois auront encore plus d’élan politique pour leurs propres attaques contre les syndicats du secteur public et pour réduire le budget des programmes sociaux locaux.
En même temps, l’intensification de ces attaques produira de la résistance, comme celle qui a éclaté au Wisconsin en février dernier, quand des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées pendant des semaines contre la législation anti-ouvrière du gouverneur Walker. Un nombre incalculable de petites luttes locales ont continué depuis lors, par exemple celles en résistance contre les expulsions de logement à Chicago et à Boston et les protestations contre les coupes budgétaires imposées dans les écoles.
Et il existe un sentiment plus large en faveur de la justice sociale, particulièrement chez les jeunes. Les récentes marches « SlutWalk » (« Marches des garces ») aux Etats-Unis et dans d’autres pays, mettent en lumière le malaise croissant parmi les jeunes femmes, qui en ont assez de la vague croissante de sexisme. La violence raciste de la police, une question persistante dans les villes des Etats-Unis, constitue également un foyer d’activisme.
Cette résistance – et la furie généralisée déclenchée par le tournant droitier d’Obama – est en train de former de nouveaux militants qui arrivent à la conclusion qu’une alternative politique à la gauche des démocrates est nécessaire. Le défi, aujourd’hui, est de relier ce sentiment à l’effort pour reconstruire une gauche indépendante, déterminée à lutter contre les mesures d’austérité, d’où qu’elles viennent.
Article publié sur le site http://socialistworker.org/ (journal de l’International Socialist Organisation des Etats-Unis) sous le titre : « A stake in the heart of the welfare state ».