17 décembre 2023 | tiré du site du CADTM
https://www.cadtm.org/Mais-qui-depend-de-qui-in-ter-dependances-et-dette-patriarcale
Interroger la notion d’(in)dépendance n’est pas anodin car s’y dissimulent des rapports de pouvoir, comme au sein du (néo) colonialisme, du patriarcat, des relations intergénérationnelles ou encore du patronat. Un regard critique inspiré notamment des luttes anticoloniales et féministes permet de les décrypter, de se demander « qui dépend de qui ? » et de questionner la notion de dépendance même.
Cet article explore quelques éléments de réponses et s’aventure à allier questions économiques et politiques à l’ontologie, au philosophique, à l’immatériel, à l’affectif. Il propose de voir autrement ce qui compte vraiment dans ce monde désenchanté. Il aborde la question des in·ter·dépendances en proposant une lecture écoféministe de la question des dettes et des futurs désirables.
Construite politiquement par les luttes et pensées anti-impérialistes qui dénoncent l’imposture des indépendances, et celles, écoféministes, qui rendent justice - en les visibilisant - aux personnes, travaux, soins, procédés, éléments nécessaires à la vie sur terre, j’ai été inspirée par ce thème de la « dépendance » : en fait très présent dans notre société... On s’en rend compte notamment à partir de la perspective de la dette2 , formidable outil de transfert de richesses qui maintient les structures de pouvoir en place.J’en ai parlé à Sacha, qui, pour son travail de fin d’études, réfléchissait justement à un nouveau concept : la « dette patriarcale » comme élargissement des propos développés dans le livre Nos vies valent plus que leurs crédits que nous avons coécrit avec Christine Vanden Daelen 3 et d’autres formidables contributrices. On s’est dit que c’était l’occasion de se prêter à l’exercice. Au vu du sujet, il n’est pas inutile de préciser que nous sommes toutes deux des personnes blanches et valides physiquement, assignées femmes et actuellement dépendantes financièrement de revenus sociaux (et menacées de les perdre). Ceci est une exploration incomplète sur un aspect spécifique de la question, sans prétention d’être les mieux placées pour parler de dépendances, ni ambition de relativiser la violence du validisme. On se limite ici aux questions de genre mais on tient à insister sur le fait que le patriarcat est un système de domination intimement lié à d’autres oppressions : le racisme, le classisme, l’hétéronormativité, le spécisme, etc. Quand on utilise le terme « femmes », c’est comme « catégorie analytique » utile pour dresser les grandes lignes des effets genrées de la dette dans un monde organisé autour de dualismes de genre. Ce terme inclut les personnes qui se reconnaissent dans cette réalité sociale et politique, ou y ont été assignées, mais peut également inclure selon le sujet les personnes queer. Son utilisation ne se veut donc pas essentialiste, ni invisibilisante de la pluralité du genre, des sexualités et des oppressions qui en résultent.
Quand on pense à « dépendance », on pense à « indépendance », et on pense souvent à des êtres humains. Autant à des peuples entiers quand il s’agit d’indépendance politique ou économique de territoires qu’à des personnes quand il s’agit d’autonomie, d’émancipation.
Dans la sphère géopolitique comme micropolitique, la dette joue un grand rôle dans l’obtention et le maintien, ou non, de son indépendance. Les dettes dont je vais parler ici sont celles dites « illégitimes », c’est-à-dire qui n’ont pas servi les intérêts des populations4 . Elles sont désormais majoritaires, dans les Nords comme dans les Suds. Contractées soit en contrepartie d’une prétendue « indépendance » (dettes coloniales5 ) ou au nom du « développement », souvent auprès d’institutions multilatérales, comme le Fonds monétaire international (FMI) ou la Banque mondiale, mais aussi de puissances (néo)colonisatrices et de plus en plus souvent sur les marchés financiers, elles sont dans les deux premiers cas systématiquement accompagnées de conditionnalités et de juteux taux d’intérêt. Hier comme aujourd’hui, les mesures imposées au nom du remboursement des dettes permettent de maintenir le flux de matières premières, main-d’ouvre, etc., bon marché, nécessaires pour alimenter la surconsommation mondialisée et maintenir la « croissance économique » des puissances industrielles et les pays occidentaux. Pourtant, si l’on prend en compte la totalité des transferts de richesses et des intérêts, les dettes sont dans bien des cas déjà remboursées.
Outil absolument central à l’accumulation capitaliste, le remboursement des dettes s’est ainsi imposé comme primant sur toute autre préoccupation économique, sociale ou écologique6 . Cette continuité des dynamiques coloniales (néocolonialisme) facilitée par les dettes amène les luttes anticoloniales à revendiquer « qui doit à qui ? » Pour exiger l’annulation, mais aussi comme outil politique qui permet de souligner la violence passée et contemporaine des rapports NordsSuds. Pour ne pas prétendre que ce pillage appartient au passé, il convient peut-être justement de reformuler la question en termes plus actuels : « qui dépend de qui ? »
Depuis la crise financière de 2008 et le sauvetage des banques qui fait exploser la dette publique, les mêmes types de mesures d’austérité sont appliquées aux Nords au nom du remboursement. Ces logiques deviennent, partout, la nouvelle norme néolibérale. Certaines sont spécifiques selon les pays et continents, mais, de manière générale, elles suivent le même mot d’ordre de réduction des dépenses publiques (coupes budgétaires, baisse des allocations et dépenses sociales, gel des salaires, privatisations, hausse de la TVA, etc.). Cela conduit pourtant souvent à une hausse des profits du secteur privé et à un assèchement des finances publiques et des ménages.
La dette accentue les inégalités de toutes sortes. Mais surtout, elle affecte de manière spécifique et disproportionnée les personnes et groupes sociaux déjà marginalisé·es : les personnes précarisées, âgées, immigrées, non blanches, les travailleur·euses précaires, et, parmi elles, particulièrement les femmes et les personnes LGBTQIA+. Ces personnes perdent leurs revenus, s’endettent, augmentent leurs heures de travail de soin gratuit pour faire face à la fermeture des services et la hausse des prix. Les riches deviennent toujours plus riches, et les pauvres toujours plus pauvres. Ce ne sont donc clairement pas les responsables qui paient, et l’accumulation continue du capitalisme en dépend. Encore une fois, qui dépend de qui, au final ?
Par leur obligation de rentabilité, les politiques d’ajustement ne font pas qu’affecter des êtres humains ou perpétuer le pillage colonial, mais contribuent également à la destruction des écosystèmes. L’idée, au centre du dogme néolibéral, selon laquelle chacun·e a à sa disposition les moyens et informations nécessaires pour faire les choix qui vont maximiser ses ressources économiques (« homo economicus ») de manière indépendante ne tient pas compte de la réalité des rapports sociaux et des cycles de régénération des ressources naturelles, et est donc complètement illusoire. Elle n’est par ailleurs pas désirable.
En fait, ce qui est dingue, c’est que le capitalisme semble être construit sur une série de mythes, théories, et idées fausses (imbécillité ou manipulation ?), dont il est complètement dépendant, ce qui donne lieu à une série d’invisibilisations qui ont des effets néfastes : ça ne tient pas la route !! À croire que l’une des caractéristiques du capitalisme est de diminuer au lieu de valoriser, sacraliser, reconnaître, soutenir ce dont on dépend pour (sur)vivre (en gros, le travail de reproduction sociale et un environnement viable). Concrètement, cette tendance peut avoir comme conséquence de détruire les choses desquelles on dépend vitalement, pour les communautés directement concernées particulièrement, mais aussi pour la vie en général.
Ce constat accablant s’inscrit dans le mode de pensée occidental qui est fondé sur la croyance en des dualismes hiérarchisés (hommes/femmes, humain/non-humain, production/reproduction, civilisé/sauvage, blanc/non-blanc, intellectuel/manuel, etc.). Ces séparations sont au centre des rapports de domination (en justifiant ces derniers) et du rapport problématique de nos sociétés au soin et à l’interdépendance. Ce constat est notamment porté par les luttes (éco)féministes.
ÉCONOMIES FÉMINISTES ET AUTRES REGARDS SUR L’AUTONOMIE
Des impacts spécifiques
Notre contexte est également celui du patriarcat, et même de l’hétéropatriarcat : il se fonde sur une « division sexuelle du travail », des normes de genre, et des inégalités professionnelles. Les activités dites de « reproduction sociale » (ou de soin, de care), c’est-à-dire nécessaires à la reproduction de la société (soins aux personnes, éducation des enfants, nettoyage des lieux de travail, de socialisation, de vie, etc.) sont effectuées par une écrasante majorité de femmes, de manière gratuite et de manière (sous) rémunérée. Ces dernières, comme ces activités, sont dévalorisées socialement : elles ne sont clairement pas une priorité politique.
On constate par ailleurs une très grande proportion de personnes (principalement des femmes mais pas que) migrantes dans les secteurs du soin, du nettoyage et de la garde d’enfant. Plus le travail est considéré comme sale (et pourtant souvent d’autant plus important), plus il est dénigré, plutôt que reconnu et célébré. C’est ce que l’on nomme la « chaîne globale du care » : le travail des peuples, notamment des femmes, des Suds, assure le confort des métropoles à moindre coût.
Les femmes, surtout certaines, sont donc cantonnées dans certains types d’emplois (CDDs, temps partiels, échelons bas, etc.), ont des revenus inférieurs et sont pourtant en charge de la majorité des dépenses quotidiennes du ménage. Elles ont aussi de ce fait moins de patrimoine et de capital, sont moins « équipées » pour faire face aux crises et en paient le prix fort.
De fait, les mesures d’austérité mises en place pour le remboursement de la dette publique touchent en premier lieu les secteurs considérés comme « non productifs » : ceux de la santé, de l’enseignement, etc., et donc touchent les femmes spécifiquement, en tant que travailleuses majoritaires et usagères principales (également pour les personnes qu’elles ont à charge, par exemple dans les crèches). Ces secteurs sont pourtant essentiels, comme l’a bien montré la désastreuse gestion de l’épidémie de Covid-19.
La dette du care
Un dénominateur commun aux pratiques féministes est la mise en évidence du travail de soin : aux personnes, de la société, des communs, bref du monde. Dans quelles conditions ce soin est effectué et comment il est réparti en dit long sur les rapports sociaux inégalitaires qui traversent nos sociétés dites « modernes ». Les économies féministes proposent ainsi de remettre le soin au centre de nos préoccupations, de le reconnaître, le valoriser, de le rémunérer, peut-être, ou encore de le célébrer, le collectiviser. Rendre visibles ces activités permet de se rendre compte de leur ampleur, leur importance et de tout ce qu’elles impliquent (tâches, compétences, temps, ressources nécessaires, coûts, engagement affectif et émotionnel) et ainsi le reconnaître comme un « bien sociétal de valeur7 ». Cela signifie que, dans les conditions actuelles, toute une partie de la société (grossièrement, les classes dominantes et les hommes) est redevable et débitrice de ce qu’on appelle la dette du care, une énorme « dette de soin ». Plus précisément, il s’agit d’une dette due par les personnes qui non seulement pourraient prendre soin d’elles-mêmes, comme le dit Amaia Pérez Orozco8 , mais aussi prendre en charge une série de tâches de soin, mais ne le font pas et voient ainsi leur temps, confort et accumulation de capital augmenter, au détriment de celui des autres. « Quand on regarde qui donne et qui reçoit, l’imbrication des oppressions devient évidente tant à l’échelle individuelle que globale : certains groupes sociaux ne remplissant pas leurs propres besoins les délèguent à des personnes venues d’ailleurs, ce qui crée une dette du care aux dimensions non seulement genrées, mais aussi géographiques, raciales et de classe.9 » Les slogans des grèves et luttes féministes « qui doit à qui ? »et « quand les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête ! »10 sont l’incarnation du ras-le-bol de ce déséquilibre et résonne avec notre « qui dépend de qui ? »
Vulnérables, et alors ? Critique de l’individu autonome
Le fait que de nombreuses tâches qui constituent cette dette du care soient peu reconnues et souvent effectuées hors des regards11 permet également d’alimenter l’ingratitude qu’elles suscitent et le mythe de l’individu autonome, qui n’aurait besoin de personne.
Cet acharnement à renier sa dépendance envers les autres et à la considérer comme quelque chose de nécessairement péjoratif et déshonorant est typique de la domination masculine12. Cela signifie que ce ne sont pas « les hommes », mais précisément la dévalorisation du soin en tant que tel (et des personnes qui l’effectuent) qu’il faut combattre en tant que socle du patriarcat, mais aussi du capitalisme et d’autres systèmes d’exploitation qui en profitent tout autant.
L’apport d’une perspective féministe est donc « d’enlever le caractère péjoratif de la dépendance et de la vulnérabilité, et donc de s’éloigner des notions d’autonomie et d’indépendance glorifiant la liberté individuelle. Dépendance et vulnérabilité font partie intégrante de la condition humaine, certaines personnes nécessitent plus de soins à des moments donnés de leur vie, d’autres sont plus aptes à les donner. Tout le monde, personnes "autonomes" comprises, a constamment besoin de soins émotionnels13 ».
Une reconnaissance de ce besoin de soins et de nos vulnérabilités permet d’enrichir les implications de la reconnaissance d’une dette du care. Il ne s’agit pas de vouloir la « supprimer » à tout prix en étant « chacun·e pour soi » ou en exigeant compensation ou rémunération et en abolissant la gratuité. En effet, il serait peut-être pertinent, comme d’autres formes de dettes, d’en reconnaître la part illégitime et de plaider pour une société sans dette du care illégitime. Nous voulons continuer à prendre soin des gens que l’on aime, à prendre soin des gens qui en ont besoin, qu’iels puissent « rendre la pareille » ou non. On pourrait dire que c’est une dette, mais est-ce vraiment le bon mot ? Ce que nous ne voulons plus, c’est le faire dans l’invisibilisation et l’ingratitude générale, dans des conditions indignes sans contrepartie. Un monde sans dette du care signifie, au-delà de possibles compensations, de réelles réparations qui ne pourront se matérialiser que dans une nécessaire réorganisation de nos sociétés et avec de nouvelles manières de concevoir, donner et recevoir le soin, conscientes de cette responsabilité collective et de nos interdépendances.
LA DETTE PATRIARCALE : UNE PROPOSITION (SACHA)
La dette du care a été avancée comme un puissant outil politique pour revendiquer le non-paiement de la dette publique et la fin des politiques d’ajustement et d’austérité. Cette dette serait déjà largement compensée par ce travail, fut-il reconnu. Pourquoi reste-t-elle impayée ? Pourquoi est-ce que les « femmes ne s’arrêtent pas » pour « imposer leurs droits » ?
Pour exister, le capitalisme patriarcal dépend d’autres mécanismes rendant possible l’exploitation continuelle du travail du care et pour maintenir une grande partie des prestataires de soins et les femmes dans une situation de précarité économique et d’impuissance politique. Cette immense injustice engendre le sentiment qu’on nous doit encore bien plus qu’une reconnaissance de cette dette du care. C’est ce que nous proposons ici d’appeler la « dette patriarcale ».
La dette patriarcale est une violence, car elle découle de toutes les formes de violences inhérentes au patriarcat et aux rôles et normes de genre strictes : violences économiques, symboliques et institutionnelles qui sont accompagnées de violences physiques, surtout quand on dévie de la norme.
Nous avons identifié quatre dimensions qui composeraient la dette patriarcale et qui nous semblaient indispensables pour mettre encore plus en lumière les déséquilibres engendrés par le capitalisme patriarcal. La première dimension serait tout simplement la dette du care. Celle-ci augmente quand la dette financière augmente, par exemple des personnes compensent par leur travail gratuit la destruction de l’État social. La deuxième dimension, ce sont les inégalités économiques qui découlent des stéréotypes et discriminations de genre et font en sorte que les femmes dépensent plus et/ou gagnent moins. En plus d’occulter les choses dont on dépend vraiment, le capitalisme patriarcal crée des nécessités de dépenses et des illusions de besoins qui sont bien souvent genrées : pour les « hommes », ce seront des articles de sport, des voitures, etc., tandis que pour les « femmes », ce seront des produits cosmétiques ou de ménage. L’impact sur les portefeuilles et les individus est lui aussi genré. En effet, les articles destinés aux hommes sont souvent plus de l’ordre de l’investissement de capital (véhicule), tandis que ceux pour les femmes sont de l’ordre de la consommation courante ou du soin aux autres, elles n’en profitent pas forcément directement, ni à long terme. De nombreuses dépenses sont aussi directement liées à la pression de se conformer aux normes de genre, pression beaucoup moins complexe et coûteuse pour les hommes. Même quand certains besoins semblent partagés, intervient ce qui est connu comme la « taxe rose » : un même objet coûtera plus cher dans sa version destinée aux femmes (un rasoir rose, une coupe de cheveux, un short de sport.). Cette taxe est estimée à une centaine d’euros par mois14. Ces dépenses supplémentaires doivent être effectuées avec un revenu en moyenne inférieur dû aux inégalités professionnelles et patrimoniales. Cela peut être accompagné de conséquences psychologiques (estime de soi, etc.) ou d’un endettement privé. Troisièmement, on peut y inclure les inégalités économiques dues à l’augmentation de la dette publique. En plus des pertes de revenus et de l’usage de services devenus plus chers ou moins accessibles, elles paient le prix fort de l’austérité.
« En effet, via leurs contributions fiscales15, des dépenses quotidiennes sans cesse majorées mais aussi via les dettes privées qu’elles contractent pour parer aux insuffisances de l’État et assurer la (sur)vie de leursproches16, les femmes contribuent de façon disproportionnée au remboursement de la dette publique et augmentent ainsi involontairement les profits des créanciers (banques, fonds spéculatifs, institutions financières internationales) véritables responsables de la crise.17 ». Elles trouvent des solutions concrètes, adaptent leur temps de travail, restent dans un foyer violent. L’effet cumulatif résulte en une usure qui affecte très gravement les personnes déjà situées du « côté perdant » des différents rapports de domination.
La quatrième dimension est celle qui m’a donné l’envie de parler de « dette patriarcale ». C’est son autre dimension « non financière » qui se réfère à l’exploitation de nos corps féminins et marginaux, historiquement domestiqués, hypersexualisés, (dé)possédés, instrumentalisés et violentés. Alors que je me baladais dans la rue et venais de me faire harceler pour la Nième fois, je me suis dit « et si on reconnaissait tout ce harcèlement, les féminicides, les violences conjugales et toutes les violences sexistes et sexuelles comme une dette ? Comme quelque chose qu’on nous a pris (nos vies, nos énergies, nos dignités, nos joies), et qui mériterait réparation ? »
Historiquement, on peut y inclure les professions et possessions des femmes accusées de sorcellerie ou mariées de force, et, hier comme aujourd’hui, la perte de leurs terres agricoles face à l’agriculture productiviste (aujourd’hui justifiée par la pression du remboursement ou du développement). De manière générale, il s’agit de toutes ces violences qui nous gardent « à nos places », qui empêchent tellement d’adelphes de se libérer, de gagner leur vie, toutes ces violences qui sont tellement normalisées qu’on ne les nomme pas ainsi mais qui sont à la base de la domination masculine. Les « hommes », en tant que classe, ne dépendent évidemment pas du harcèlement (contrairement au travail gratuit), mais le patriarcat oui. Il permet le maintien des oppressions et privilèges, car toute oppression a besoin d’un outil pour faire taire les opprimé·es.
En plus des dommages physiques et symboliques, cette violence implique toute une série de dépenses (psychologues, gynécologues, avocats.). Les personnes préservées de la violence n’auront jamais à assumer de tels coûts. Encore une injustice économique historique et structurelle. Enfin, la dette et l’austérité augmentent encore les violences sexistes auxquelles sont confrontées les femmes (sabrage des droits sexuels et reproductifs, expulsions de territoires pour gros projets d’aménagement, fermeture de centres d’accueil, etc.). Les dettes sont liées et usent les femmes dans leurs corps, leur quotidien, leurs ressources, leur temps, leur travail et leurs possibles. Elles les maintiennent en situation de subordination et de précarité, voire de dépendance économique, alors que le monde dépend vitalement de leur travail.
Le fait que cette dette patriarcale reste non reconnue, et donc impayée, constitue un énorme défaut des classes dominantes qui permet de maintenir leurs privilèges et leurs accumulations de capital. Nous avons voulu présenter cette ébauche sur la dette patriarcale pour proposer de s’intéresser à tous les aspects d’une dette (monétaires et non monétaires). C’est utile non seulement pour la cause féministe mais aussi comme méthodologie à appliquer dans le cadre d’autres endettements et dominations systémiques. Par exemple, quand on parle d’endettement Nords/Suds, il est possible de faire rentrer les dommages symboliques, culturels, l’esclavagisme, la suprématie blanche dans l’équation.
Cet article nous a permis aussi de nous rendre compte qu’on pouvait inclure d’autres choses que du « travail » ou des « services » dans le non-monétaire, mais aussi des aspects plus immatériels comme des relations de dépendances, de redevabilité, de culpabilité. Il est donc essentiel de se demander « qui dépend de qui ? » aujourd’hui pour éviter de nouvelles dettes dans le futur, mais, surtout, pour affirmer la valeur de notre place dans le monde et donc de plaider pour des relations solidaires d’interdépendances assumées et non hiérarchiques.
FAIRE PARTIE DU MONDE (CAMILLE & SACHA)
Apports écoféministes
L’ordre dominant enlève toute valeur et invisibilise l’autre pilier de la reproduction de la vie sur terre : les capacités régénératrices de « la nature », elles aussi nécessaires à l’accumulation capitaliste. Ceci est un des postulats de base des écoféminismes, qui proposent donc de remettre en question les principaux piliers économiques et culturels de l’Occident : les dominations violentes de l’humain sur la nature et des hommes sur les femmes. Celles-ci, évidemment, s’imbriquent avec d’autres rapports inégalitaires : de race, de classe, de sexe, de genre, d’espèce.
En effet, cette pensée permet de s’attaquer aux racines de ces exploitations en identifiant les logiques communes et en s’attaquant à la domination et à la hiérarchie en tant que telles, comme mode de fonctionnement du modèle occidental fondé sur une vision pyramidale du monde. C’est-à-dire que les hommes blancs, technocrates seraient en haut, suivi des travailleurs manuels, puis les femmes, les enfants, les animaux, ensuite les plantes, et enfin les cailloux, eaux et autres entités dites « inertes ». Cette hiérarchie donnerait le droit d’exploiter ce qui est classifié comme inférieur (en tant que « ressources exploitables »). Pourtant, si on y réfléchit, plus c’est en bas, plus c’est ce de quoi on dépend. Cela permet, non pas de dire que tous les corps marginalisés vivent les mêmes oppressions, mais que ceux-ci font partie d’un même tout, qui applique des logiques analogues, logiques qui doivent ainsi être combattues conjointement.
Les écoféminismes, en proposant de s’éloigner des hiérarchies et exploitations, portent nos regards sur les procédés qui ensemble font monde et enrichissent encore la question de l’endettement. Ils invitent à se demander ce qui compte vraiment. En d’autres termes, de quoi dépend-on ? En tant qu’individu·es, mais aussi communautés, société, espèces, êtres vivants. Ariel Salleh a par exemple développé la notion de « dette incarnée18 », qui a pour objectif de visibiliser ce que nous devons toustes à tout ce qui prend soin du monde. Il s’agit de tous les procédés (avec interaction humaine ou non) qui permettent la reproduction des conditions de vie : compostage, fertilisation des sols, filtration de l’eau, soin aux enfants, entretien des communs, préservation des savoirs médicinaux et agricoles, dépollution, innovations, photosynthèse, etc. Ces activités sont effectuées par la petite paysannerie, par des peuples indigènes, par des femmes, par des êtres non humains.
Petit à petit, on commence à se dire que la dette financière dont on entend tant parler est la partie visible de l’iceberg. Tout comme, au final, les pratiques « capitalistes » : tant d’autres modes de fonctionnements et pratiques existent, que ce soit dans les écosystèmes (dont nous faisons partie) ou les sociétés inégalitaires hors/non capitalistes ou anticapitalistes, et même dans les quotidiens capitalistes (faire un cadeau, donner un coup de main)19.
Le non-monétaire comme levier politique ?
Le caractère inestimable de la vie fait que l’écologie, tout comme le soin, qui est aussi composée de dimensions émotionnelles qui ne pourront jamais être monétisées, est incompatible avec le capitalisme. Nous avons tenu dans cet article à mettre en avant la dimension non monétaire de la dette et sa portée politique. Dans les mouvements anti-dettes, on parle d’abord d’annulation, mais on parle aussi de réparations matérielles ou symboliques (on peut par exemple rendre des objets volés, restaurer des monuments, mettre en place des processus de réhabilitation, formuler des excuses publiques, ou reconnaître une oppression historique). Tenter de calculer une dette en argent peut être très utile pour calculer des réparations, certes, mais cela sous-entend aussi que, si on a de l’argent pour rembourser, on peut détruire. L’analyse non monétaire des dettes permet de faire un pas de côté en refusant ce principe et en affirmant que l’argent ne suffit pas. Elle permet donc d’envisager des réparations non seulement quantitatives mais aussi qualitatives et axées vers le futur.
La reconnaissance des dettes non monétaires expose l’ampleur de ce qui est dû à certaines populations et groupes sociaux. En effet, en se rendant compte que les personnes marginalisées, particulièrement celles à la croisée de plusieurs oppressions systémiques, sont concernées de manière cumulative par ces oppressions et processus d’extraction qui découlent des différentes dettes, on se rend compte à quel point celles-ci font système et maintiennent les rapports de pouvoir en place.
Partant de ce principe, on peut expliquer la raison d’être de la reconnaissance d’une dette patriarcale : en incarnant les dégâts multiformes de l’hétéropatriarcat capitaliste, cette reconnaissance permet de réclamer des réparations qualitatives. Elle constitue un outil d’analyse politique et encourage à reconnaître ce que le patriarcat doit au monde (aux femmes mais aussi à la société de manière générale). Comme la dette coloniale, écologique, ou du care, elle permet d’inverser les logiques, de donner une justification politique à la mise en place d’autres rapports et nous rappelle que la « dette » n’est pas juste une question économique, mais peut induire de la redevabilité, de l’échange, de la reconnaissance, de la gratitude.
Cela permet de remettre en perspective « qui doit à qui », de reconnaître « qui dépend de qui » afin d’entamer une telle justice économique (réformes fiscales, annulations de dette, identifications et condamnation des responsables.), et de réfléchir à d’autres possibles socialement et écologiquement justes, afin de les mettre en place à nos échelles.
Les humain·es dépendent les un·es des autres, et des écosystèmes, dont nous faisons partie. Ces derniers dépendent aussi de nous et du respect et du soin qu’on leur apporte. « Nous » - ce tout, qui fait monde - dépendons de la durabilité et de la qualité de ces liens.
Rêves d’interdépendances - autres possibles et imaginaires
L’ambition d’un monde centré autour du soin qui prêterait réellement attention aux interdépendances et interconnexions signifie de remettre ainsi la vie au sens large au centre de nos préoccupations, et que la notion de soin doit donc être élargie aux écosystèmes. Contrairement aux économistes mainstream, partons de la réalité : de nombreuses pratiques existent, que ce soit au sein de communautés ancestrales, de populations appauvries ou de mouvements de luttes, qui sont inspirantes et en phase avec la réalité du monde. Inspironsnous de ce qui existe déjà et osons l’imagination.
Parmi les propositions - nombreuses - à explorer, inventer, compléter, figurent la socialisation du soin20, ou encore des ébauches d’économies régénératives. Ariel Salleh fait par exemple le lien entre des « sociétés égalitaires » et le mode de fonctionnement des écosystèmes et procédés naturels qui ne créent ni « pertes » ni « dettes » mais des équilibres21 : les acteur·rices - humain·es et non humain·es - sont considéré·es pleinement, reconnu·es pour le rôle qu’iels jouent.
Yolanda Fernández Vargas22 propose quant à elle de mettre fin à l’austérité et de penser l’attribution des ressources publiques en fonction de la durabilité de la vie, en se basant sur des critères multiples non hiérarchisables, de manière adaptée au contexte et à l’écoute des marges. Il s’agit aussi de se réapproprier et de re-collectiviser les communs, qui sont des choses tangibles (une forêt, un hôpital.) mais aussi immatérielles (reproduction sociale, savoirs.).
Nous ne prétendons pas ici avoir les réponses ni les expériences et vécus suffisants pour les alimenter. Nous aspirons justement, avec d’autres copaines, à mettre en place des ateliers, moments d’échanges, de partage et d’imagination collective autour de la question des économies régénératives et de la socialisation qui pourraient, de manière participative, proposer des ébauches de ces mondes possibles. À vous, à nous, de jouer.
AUTRICES
Sacha (Lisa) Gralinger est active dans des luttes féministes et queer depuis quelques années en côtoyant manifestations, lieux de rencontres, collectifs, ZADs, et squats. Elle termine ses études en coopération internationale, avec un mémoire sur l’utilité politique des dettes non monétaires, après avoir fait son stage au CADTM (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes).
Camille Bruneau navigue entre plusieurs mondes et luttes depuis son adolescence où elle côtoie les milieux punks, voyage hors des frontières européennes, et s’inspire d’une maman féministe. Titulaire d’un diplôme en sociologie rurale et « développement international », elle continue à construire son analyse des systèmes de domination nourrie par les écoféminismes et l’anarchisme au sein de diverses occupations, luttes féministes et du CADTM (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes).
Elle y coécrit le livre Nos vies valent plus que leurs crédits : face aux dettes, des réponses féministes avec Christine Vanden Daelen et l’aide d’autres ami·es. Souvent nomade, elle se forme désormais à la mécanique poids lourd et à l’herboristerie.
Son intérêt porte de plus en plus sur les questions de soin, et son ambition dans la construction d’autres possibles pluriels et radicaux.
NOTES
1. Nous ne défendons en aucun cas les positionnements universalistes (comme assumés par certaines féministes mainstream), mais voulons dire ici que tout le monde (en tant qu’individu·e ou collectivité), sans exception, dépend de quelque chose ou de quelqu’un. Donc sans occulter les besoins et dépendances spécifiques en fonction de sa situation, son contexte, son vécu, etc.
2. On ne parle pas ici des dettes tout à fait légitimes pour financer de chouettes projets, les systèmes de protection sociale, etc.
3. Camille Bruneau, Christine Vanden Daelen, (2022). Nos vies valent plus que leurs crédits : face aux dettes, des réponses féministes. Le passager clandestin.
4. Commission pour la vérité sur la dette grecque (2015) : « Définition des dettes illégitimes, illégales, odieuses et insoutenables », https://www.cadtm.org/ Definition-des-dettesillegitimes
5. Les dettes coloniales se réfèrent en général aux dettes que les puissances colonisatrices avaient contractées pour financer l’entreprise coloniale, et qui ont été « transférées » aux pays colonisés lors de leur indépendance : ceux-ci doivent payer pour les crimes qu’on leur a infligés.
6. Voir par exemple Camille Bruneau et Christine Vanden Daelen (2022) ou Éric Toussaint (2017). Système Dette : Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation. Les liens qui libèrent.
7. Camille Bruneau et Christine Vanden Daelen (2022), p. 232.
8. Citée dans Blanca Bayas (2017). Care debt : Patriarchy and capital on the offensive, Feminist economics as a proposal. Observatori del deute en la globalitzacio.
9. Camille Bruneau et Christine Vanden Daelen (2022), p. 231.
10. Voir notamment les divers travaux de Silvia Federici, Verónica Gago et Luci Cavallero.
11. Françoise Vergès (2019), Un féminisme décolonial, La Fabrique.
12. Joël Martine (2017). Le débat sur le care dans le féminisme nord-américain et sa convergence avec l’écoféminisme. Les possibles, n°14.
13. Camille Bruneau et Christine Vanden Daelen (2022), p. 232.
14. Valérie Gillioz (2019). La taxe rose fait débourser aux femmes plus de cent francs par mois, RTS. https://urlz.fr/nYZy
15. Voir par exemple le cas évident de la TVA dans Nos vies valent plus que leurs crédits, p. 159.
16. Certains types de crédits, aux taux d’intérêt généralement indécents, ciblent spécifiquement les femmes, comme « prêts pour femmes » et les crédits à la consommation en Amérique du Sud ou les microcrédits dans de nombreux pays africains ou d’Asie du Sud.
17. Camille Bruneau et Christine Vanden Daelen (2022), p. 225.
18. Ariel Salleh (dir.) (2009). Eco-Sufficiency & Global Justice : Women write political ecology. Pluto.
19. J. K. Gibson-Graham (2008). Diverse economies : performative practices for "other worlds". Progress in human geography, 32(5).
20. Camille Bruneau et Christine Vanden Daelen (2022), p. 233.
21. Camille Bruneau et Christine Vanden Daelen (2022), p. 264.
22.Yolanda Fernandez Vargas (2019). Propositions écoféministes commes alternatives aux coupures budgétaires. https://www.cadtm.org/propositions-ecofeministe-comme-alternatives-aux-coupures-budgétaires.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d’avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d’avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

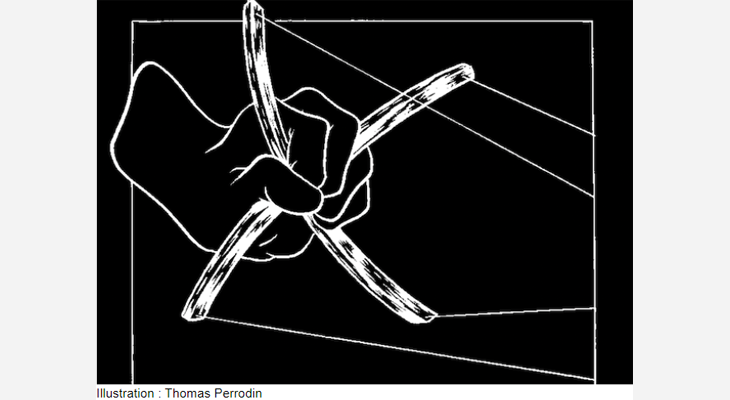










Un message, un commentaire ?