Peu de gens doutent de la nature impérialiste de l’agression russe. Cependant, certains secteurs en Ukraine continuent de croire aux prétextes officiels de l’occupant et prônent une version inversée de son scénario : traiter la langue comme un signe de loyauté envers l’Ukraine et vouloir imposer l’identité culturelle de la population. Prenons l’exemple de l’activiste Sviátoslav Litynskyi, qui estime que la barrière linguistique « correspond à la ligne de front », prétendant qu’elle maintient les défenses ukrainiennes autant que l’armée. Ou encore Serhii Prytula, un célèbre volontaire, qui a déclaré que parler russe dans la rue est « un instrument de l’expansion russe » et que ceux qui le font deviennent également cet instrument.
La question est la suivante : transformer la langue d’un instrument de communication en une question de sécurité et lorsque le russe est une épée, l’ukrainien est un bouclier. Une fois cette voie tracée, les différences quotidiennes entre les gens ordinaires apparaissent comme une menace. Pour une société déjà épuisée par la guerre, l’austérité et des décennies de négligence institutionnelle, cette conception étroite de l’appartenance est une forme d’automutilation. Au lieu de forger la solidarité et de jeter des ponts entre les divisions, le discours politique insiste de plus en plus sur le fait que la véritable unité passe par l’homogénéité culturelle.
Une histoire d’oppression
Il est un fait que la langue ukrainienne a été opprimée pendant des siècles. Sous l’empire russe des tsars, la circulaire Valuev (1863) a nié son existence en tant que langue et interdit son utilisation dans les textes religieux et éducatifs. Le décret Emsky (1876) est allé plus loin et l’a bannie de toute publication et de tout acte public. Pendant la période soviétique, après une brève période de korenizatsia (indigénisation), destinée en principe à autonomiser les nations non russes et à restaurer leur confiance), la renaissance culturelle ukrainienne a été qualifiée de « nationalisme bourgeois » et la langue a été confinée dans une niche étroite. La langue russe, quant à elle, a été promue comme langue de communication interethnique dans toute l’Union soviétique, dominante dans la production de connaissances, la politique et la vie culturelle.
Après l’indépendance en 1991, la situation de la langue ukrainienne ne s’est guère améliorée en dehors de ses bastions dans l’ouest du pays. Les fonctionnaires avaient souvent des difficultés à l’utiliser, et une blague circulait selon laquelle le meilleur moyen d’éviter une amende était de parler ukrainien, car le policier ne saurait pas comment répondre. L’ukrainien a survécu comme symbole distinctif dans les cercles culturels et civils alternatifs, tandis que dans la vie quotidienne, il pouvait être ridiculisé comme la langue des « paysans incultes ».
Curieusement, mon premier emploi après l’obtention de mon diplôme m’a conduit à la compagnie aérienne Lufthansa en République tchèque. Après l’Euromaïdan, ils ont soudainement décidé d’embaucher des téléphonistes parlant ukrainien ; auparavant, les passagers ukrainiens ne pouvaient choisir qu’entre le russe et l’anglais. Cela en dit long sur la visibilité de l’ukrainien jusqu’à très récemment.
L’histoire explique la colère et la sensibilité. Elle explique également pourquoi la politique linguistique est un signe distinctif important de souveraineté. Mais elle ne peut justifier la reproduction de la logique d’exclusion en contrepartie.
Changements dramatiques
Il est ironique que la protection du russe brandie par le Kremlin ait eu l’effet inverse. Entre 2015 et 2024, la proportion de la population ukrainienne favorable à la suppression du russe dans la communication officielle a triplé, atteignant les deux tiers. Cette dynamique s’est accélérée après 2022 : aujourd’hui, près des deux tiers déclarent également que l’ukrainien est leur principale langue familiale ; le russe est tombé à 13 %. Le pourcentage de personnes pensant que le russe doit être banni de l’école est passé de 8 % à 58 %. Si Moscou parvenait un jour à imposer la reconnaissance officielle du russe, le recul pourrait être encore plus important. Cependant, le discours alarmiste selon lequel l’ukrainien serait en danger d’extinction reste d’actualité.
Cette considération de la langue comme une question de sécurité n’est plus une simple préoccupation culturelle. C’est désormais une loi. Alors que la Constitution garantit le libre développement du russe et d’autres langues associées aux minorités nationales et interdit toute discrimination linguistique, en 2021, la Cour constitutionnelle a déclaré que l’ukrainien était « le code de la nation », jugeant que les russophones, puisqu’ils comprennent l’ukrainien et peuvent le parler, ne constituent pas un groupe sociodémographique distinct. Au lieu de cela, ils ont défini ce groupe comme une construction politique, issue de décennies de russification, et donc dépourvu de fondement pour bénéficier de protections collectives telles que celles qui pourraient
s’appliquer à d’autres minorités, comme celles de langue hongroise.
La législation a renforcé ce cadre. La loi sur la langue officielle limite l’enseignement des langues minoritaires aux langues de l’Union européenne. La loi sur les minorités nationales exclut le droit d’utiliser une langue minoritaire si celle-ci est la langue officielle d’un État agresseur ou occupant. Le président de la Verkhovna Rada (parlement), Ruslan Stefanchuk, a expliqué que « si un peuple commet une agression, ses droits doivent être restreints ». Le ministre de l’Éducation l’a appuyé : les opportunités de développement égalitaire ne s’appliquent « catégoriquement » pas à la langue « utilisée comme une arme ».
Les hauts responsables de l’État rivalisent pour aller plus loin. Un ancien médiateur linguistique a rappelé que les soldats au front « tirent lorsqu’ils entendent parler russe » et a qualifié la langue ukrainienne d’« identifiant ami ou ennemi ». Son successeur a réclamé l’interdiction des chansons russes car, en temps de guerre, les scènes et les rues sont des « espaces de sens » réservés à « la langue et à la force spirituelle du peuple ukrainien ». Une médiatrice dans le secteur de l’éducation a directement proposé que les enseignants refusent de comprendre les élèves qui parlent russe.
Des personnalités du monde culturel amplifient le message. Un acteur célèbre a proposé de fouetter les enfants qui parlent russe. Un écrivain renommé a préconisé de surveiller les aires de jeux et de réprimander les parents d’enfants russifiés. Une blogueuse populaire s’est vantée d’avoir inculqué à ses enfants une attitude si négative envers le russe qu’ils pourraient en venir aux mains avec leurs camarades qui le parlent.
Une étude du réseau civique OPORA montre à quel point cette rhétorique envahit les écosystèmes médiatiques. Sur les principales chaînes Telegram, les Ukrainiens russophones sont souvent qualifiés de responsables de l’invasion, de porteurs d’une culture étrangère, de collaborateurs potentiels et de vestiges du passé soviétique. Le dénigrement est devenu la norme. Ce n’est plus un phénomène marginal. C’est la nouvelle orthodoxie.
Qui en paie le prix ?
Le coût est principalement supporté par ceux qui sont déjà devenus vulnérables à cause de la guerre. C’est dans le sud et l’est de l’Ukraine, c’est-à-dire dans les régions les plus dévastées par l’invasion et l’occupation, que le russe était le plus parlé. Des millions de personnes déplacées de ces régions sont confrontées à d’énormes difficultés économiques et sociales. Selon des études de l’Organisation internationale pour les migrations, ces foyers déplacés sont composés de manière disproportionnée de personnes âgées et de femmes qui s’occupent de parents atteints de maladies chroniques ou de handicaps.
Cependant, au lieu de solidarité, ces personnes russophones sont accueillies avec méfiance. Les familles déplacées à l’intérieur du pays sont accusées d’« apporter la langue de l’occupant » ; les appels à la création d’« inspections linguistiques » se multiplient. Traiter la langue comme un signe de loyauté brouille la menace réelle. Cela n’aide guère à mobiliser les citoyens autour d’un vaste projet national lorsque leurs croyances et leurs pratiques quotidiennes sont exclues du « corps de la nation ». Cela favorise la désolidarisation et le sabotage silencieux, et offre en outre à Moscou un cadeau propagandiste.
Il existe déjà des chaînes Telegram en langue russe qui diffusent des récits de harcèlement et de trahison, qualifiant les Ukrainiens russophones de groupe persécuté, contraint de sacrifier son identité, et accumulant la haine envers les activistes linguistiques « perturbés ». On peut souvent lire sur les réseaux sociaux un appel à exempter les russophones du service militaire : « Si nous ne sommes pas ukrainiens, pourquoi devrions-nous combattre ou rester ici sous les bombes ? » Cependant, le devoir semble être plus universel que le respect.
Il dresse également des obstacles à toute réconciliation future. Comme l’a souligné le groupe ukrainien de gauche Sotsialnyi Ruj en 2022, le russe reste la langue de millions d’Ukrainiens, y compris ceux qui luttent contre l’impérialisme russe, et refuser aux gens le droit à leur langue maternelle ne fait qu’aliéner une partie importante de la société. Et si n’existe aucun moyen légitime pour eux de s’exprimer, pourquoi ne voteraient-ils pas pour un politicien qui promet de le faire à leur place, aggravant ainsi la polarisation ? Toute minorité insatisfaite et exclue est un fardeau non seulement pendant la guerre, mais aussi lors de la reconstruction.
Je me souviens de cela à Sloviansk, où je travaillais avant de partir étudier à l’étranger, la ville dont la prise par les milices pro-russes a marqué le début du conflit armé en 2014. Des guerriers locaux de la « décolonisation » – souvent dotés d’un capital culturel plus important, certains fanatiques avides de drapeaux sang et terre – n’ont pas manqué l’occasion de prêcher que tout le monde devait parler ukrainien en leur présence et qu’il fallait « décommuniser » le plus rapidement possible tous les noms de rues. Dans une ville où l’industrie est en ruine, la population vieillissante et le taux de chômage élevé, ils n’ont pas réussi à obtenir de soutien, mais ont plutôt accentué le ressentiment. La majorité silencieuse a haussé les épaules et a continué à voter pour la fraction de l’ancien Parti des régions – la force dominante dans l’est russophone de l’Ukraine avant l’Euromaïdan – qui s’était présentée. Ce qui se voulait une libération a été perçu comme une imposition moralisatrice.
La logique de cette pensée ne se limite pas à la langue, mais est expansive. L’une des Églises orthodoxes est dénoncée comme étant « subordonnée à Moscou » malgré ses statuts. La politique mémorielle suit le même schéma : en juillet, les autorités de Lviv ont démantelé un mémorial soviétique de la Seconde Guerre mondiale, exhumant les restes de 355 soldats et proposant de les échanger contre des prisonniers de guerre ukrainiens. Le purisme passe facilement des mots aux tombes.
Le pire, c’est que cela ne servira probablement à rien. Si Vladimir Poutine décidait demain de se couronner tsar orthodoxe et protecteur, même une conversion massive et rapide au catholicisme ne l’arrêterait pas. Il pourrait simplement qualifier cela de nouveau complot des marionnettes occidentales visant à endoctriner ceux qu’il continue d’appeler la « nation sœur ».
Décolonisation ou essentialisme ?
Cet état de fait est justifié au nom de la décolonisation. Corriger les inégalités, garantir le développement de la langue ukrainienne et autonomiser ses locuteurs : ce sont là des objectifs légitimes, mais est-ce bien ce qui se passe ? La culture n’est pas une essence enfouie sous terre en attendant d’être déterrée. Elle est plurielle, vivante, chaotique. Au contraire, la décolonisation contemporaine la traite différemment : comme quelque chose à nettoyer, à purifier des vestiges impériaux, à compresser dans un moule unique, une excuse pour enseigner la vérité aux gens ignorants, exiger le repentir, la confession et la rééducation. Dans la pratique, cette rhétorique ne fait que reformuler les revendications ethno-nationalistes dans un langage progressiste destiné au public occidental.
Le souci des récits historiques au détriment des expériences réelles vécues par les gens fait que ces décolonisateurs ressemblent à la logique impérialiste à laquelle ils s’opposent. Le fait que les ukrainophones se soient sentis marginalisés ne les autorise pas – ni ceux qui agissent en leur nom – à harceler d’autres personnes aujourd’hui. Aucun Ukrainien n’a intérêt à remplacer une exclusion par une autre.
Survivre pour quoi faire ?
Voilà donc où nous en sommes : la population ukrainienne russophone bombardée par la Russie, victime de méfiance et de marginalisation dans son propre pays, écrasée entre le marteau et l’enclume. L’un envahit, l’autre exclut. Mais un projet qui purge son peuple pour survivre ne peut le libérer ; il ne fait que redistribuer la peur. Nous devons donc nous demander : si la survie exige cela, pourquoi voulons-nous survivre ?
L’alternative n’est ni l’assimilation impérialiste ni l’essentialisme nationaliste. C’est un projet politique fondé sur la démocratie et le pluralisme, non pas à des fins décoratives, mais comme seul moyen de rendre la solidarité réelle. Sinon, plus nous nous purifierons, moins il restera de personnes à défendre.
Oleksandr Kyselov, originaire de Donetsk, est un militant de gauche ukrainien qui travaille comme assistant de recherche à l’université d’Uppsala, en Suède.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d’avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d’avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre




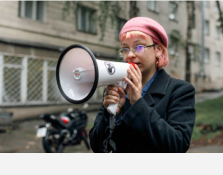
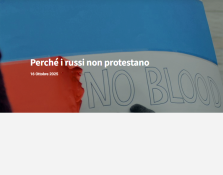






Un message, un commentaire ?