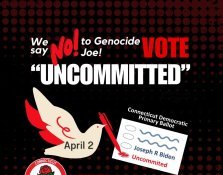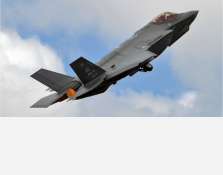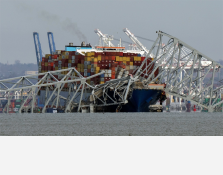Max Bohnel : (…) Les Démocrates ont tenu leur convention et, merci aux impers dans la campagne de Mitt Romney, Barack Obama est maintenant en tête dans les sondages. (Ce qui n’est plus exactement le cas en ce moment. N.d.t.) Pouvons-nous faire le tableau des déceptions qui ont éloignées certainEs électeurs-trices du président mais qui l’appuieront encore ?
Ingar Solty : Pendant une longue période, un fort vent venu de larges secteurs du capital, très bien organisés autour de la Chambre de Commerce ont fait une lutte ouverte à M. Obama. Je parle de l’industrie des énergies fossiles, de celle des soins médicaux et de Wall Street. Dans le mouvement ouvrier, certains petits ou moyens syndicats n’ont pas donné leur appui au président. Le National Nurses United, le United Electrical et le Radio and Machine Workers of America, poursuivent une politique stratégique de type « lutte de classe » indépendante. Mais dès le printemps 2012, les membres de l’AFL-CIO ont, avec plus ou moins d’enthousiasme, déclaré leur appui à B. Obama. Ceci malgré qu’il n’ait pas tenu sa promesse électorale de faire adopter le Employee Free Choice Act, (loi facilitant la syndicalisation, n.d.t.) et sa trahison des syndicats du Wisconsin durant la lutte pour le retrait de Scott Walker du poste de gouverneur, en ne les soutenant qu’avec un message Twitter.
La défaite, en juin dernier, du candidat de gauche, Danny Donohue, à la tête de l’American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) a tué l’espoir qu’entretenait la gauche d’un virage dans les syndicats du secteur public, après la défaite au Wiskonsin. Il s’agit de la plus grande organisation syndicale du secteur public juste après la National Education Association (NEA). Il faudra voir ce qu’apportera de vivifiant la grève des professeurEs de Chicago aux d’autres syndicats du secteur public. Cette grève a coalisé de larges secteurs de la classe ouvrière de la ville contre les mesures d’austérité dans l’éducation. En plus, il faut voir tout ce qui entoure le Mouvement Occupy même si ses résultats ne sont pas clairs.
MB : Est-ce qu’Occupy n’est pas en train d’aider à la réélection de B. Obama ? N’est-ce pas une des raisons pour lequel il est en crise en ce moment ?
IS : En effet, on peut dire que cette année électorale, avec la menace d’une présidence républicaine et d’une vice-présidence libertaire de droite, est largement responsable de la véritable démobilisation que le mouvement Occupy connait en ce moment. C’est difficile, pour une large partie de la gauche, de contrer le populisme de droite sans tomber dans une très contradictoire apologie de M. Obama. Il semble plausible qu’il s’agisse d’une décision bien consciente de lutter pour le « moins pire » des Démocrates. Le président a évidemment tenté de se donner un peu plus de capital politique en cooptant Occupy. Son expérience politique lui a probablement enseigné, (sans qu’il ne s’inspire de l’école française de la régulation), que l’introduction des réformes à long terme pour le renouvellement et la stabilisation du capitalisme depuis « en haut » est paradoxalement liée à la résistance venant « d’en bas ». Le premier exemple de ce phénomène est le second New Deal de FD Rosevelt. Il l’a mis de l’avant dans les meilleurs intérêts à long terme du capital, mais contre la résistance de larges segments de la classe capitaliste et avec l’appui du puissant mouvement ouvrier de l’époque.
On peut observer comment M. Obama a tenté de coopter le mouvement Occupy dans ses discours populistes de gauche comme celui de Osawatiomie au Kansas à la fin de 2011. Il se peut qu’il ait été sincère, mais il n’a pas réussi. L’enthousiasme à son égard est retombé et ce peut être une des raisons qui pousse le capital vers Mitt Romney. Cela veut aussi dire que le New Deal vert que proposait Mme C. Romer avant sa démission, est mort lui aussi. Déjà, dans son adresse sur l’état de l’Union en 2001, la perspective des trains à grande vitesse et d’autres projets du genre, étaient abordée platement. Il ne s’agissait plus d’éléments d’un programme politique. En 2012, la référence à une conversion de l’économie vers les industries vertes, une « économie post-bulle financière » comme il se plaisait à la nommer, n’était même plus invoquée. Il se peut bien qu’en privé, il veuille encore aller dans ce sens, politiquement toutefois, il a abandonné cet axe. Il sait que son introduction, avec l’opposition qu’elle soulève chez les puissantEs, nécessite une conjoncture tout-à-fait nouvelle comme une intensification spectaculaire de la crise avec une résistance massive de la base.
Même si M. Obama, le premier président de l’après lutte pour les droits civiques comme le nomme Rariq Ali, s’est rendu compte, à un moment donné que son approche centriste pour le programme de stimulation de l’économie, l’assurance maladie etc., n’était pas la bonne, il ne peut plus faire marche arrière maintenant. Pour ce qui est de sa nouvelle politique de croissance basée sur les exportations, il n’a pas besoin de la gauche ou des syndicats, au contraire pour la mettre en place. La plupart des militantEs de gauche commencent à s’en rendre compte.
MB : Donc vous dites que le virage du président vers l’austérité et la stratégie du développement par les exportations rend impossible la cooptation d’Occupy et de ses partisans ?
IS : Oui, exactement. Mais il y a un élément crucial à venir. Je trouve qu’Occupy et le Tea Party partagent une même caractéristique : ils sont les deux faces d’un même élément. Quand on élimine les circonstances particulières qui sont aux origines de leur création, l’un et l’autre, de droite et de gauche sont des réponses à la crise de l’hégémonie du néolibéralisme.
L’incapacité des institutions libérales démocrates à venir à bout des contradictions du capitalisme actuel est la manifestation concrète de cette crise hégémonique. Toute une série de crises défilent devant nous : la dérégulation des marchés financiers, le chômage de masses, l’augmentation du nombre de travailleurs-euses pauvres à cause des bas salaires, le travail précaire, l’augmentation des inégalités et son impact sur la démocratie libérale, l’immigration et les politiques d’intégration (spécialement en Europe), la sécurité des installations nucléaires et les changements climatiques. Aux yeux du public, l’État et les législateurs-trices ont manqué à leurs devoirs. Que ce soit à Washington, Berlin, Londres ça ne marche plus, la machine est brisée.
C’est cette situation qui a provoqué l’étonnante culture de pessimisme qui prévaut chez les intellectuelLEs liéEs à la bourgeoisie, qui écrivent dans le Wall Street Journal et le Financial Times venant du Washington Post et du New York Times. Souvent leurs opinions reflètent une juxtaposition de virages et de vigoureux changements dont le gouvernement chinois est capable et la « paralysie » du système politique américain. Il était assez étonnant de lire sous la plume du libéral triomphant qu’était Francis Fukuyama, qu’à cause de leur paralysie politique, les États-Unis avaient « peu à enseigner à la Chine » et sous celle de l’idéologue du marché libre et du « poing dissimulé de l’Empire américain », Thomas L. Friedman, dans son livre sur le capitalisme vert, le souhait que les États-Unis « puissent être la Chine pendant une seule journée », donc qu’ils puissent agir avec la même autorité que la Chine pour qu’ils réussissent à exécuter ce qui est nécessaire, selon lui, pour renouveler le capitalisme.
À leur manière, les mouvements de gauche et de droite, sont l’expression de leur conscience de cette crise depuis leur base. Je suis étonné que le mouvement Occupy se soit développé sans se rendre jusqu’à Occupy la Maison Blanche. Pourtant les militantEs ont souvent dit qu’une de leur motivation venait de leur déception du président Obama.
Il est intéressant de faire la comparaison avec ce qui s’est passé en Allemagne, où pour diverses raisons, le mouvement Occupy n’a jamais décollé. La clientèle d’Occupy correspond étroitement à celle du parti Pirate allemand. Il a recueilli un fulgurant 15% d’appuis dans les sondages au début 2012. Ce sont des jeunes souvent très qualifiéEs, salariéEs précaires qui, malgré leur hétérogénéité, ont des positions claires d’opposition aux discours d’exclusion raciste des populistes de droite. Ils voient le monde d’un œil égalitariste, inclusif qui va du libéralisme social à la sociale démocratie jusqu’aux critiques socialistes du néolibéralisme.
En Allemagne, l’émergence du Parti Pirate est due essentiellement à la conviction politique, que la crise de la démocratie bourgeoise en période de néolibéralisme peut être résolue par l’élection de meilleurEs nouveaux et nouvelles députéEs plus transparantEs à qui ont a donné un mandat contraignant et par l’ajout d’un élément de démocratie directe sous la forme de référendums populaires. Ils n’ont pas tiré la leçon de l’expérience américaine : les référendums sur une seule question, avec l’argent nécessaire pour faire campagne, peuvent aboutir aux pires décisions même dans le domaine économique. Pensons à la démarche de divers États à majorité républicaine qui veulent, par référendum déclarer le Employee Free Choice Act, (loi qui faciliterait la syndicalisation. N.d.t.), inconstitutionnel.
Il semble qu’aux Etats-Unis, Occupy aille dans une toute autre direction. En exagérant un peu, on peu dire que les partisanEs du Parti Pirate en Allemagne sont politiquement là où étaient ceux et celles d’Obama en 2008. Ils et elles ont voté pour un sauveur libéral-messianique, convaicuEs que cela, et non l’organisation extra-parlementaire, dans les milieux de travail, dans des organisations politiques indépendantes, allait résoudre tous leurs problèmes. Autrement dit, nous sommes ici et maintenant devant une considérable avancée de la conscience politique. Face aux politiques anti-gauche du président Obama, cette position rend difficile la politique du moins pire mais rend très probable la naissance d’un mouvement Occupy 2.0 de résistance aux programmes d’austérité locaux, régionaux et nationaux quelque soit le prochain président.
MB : Alors, quel est selon vous, les raisons de la crise qui traverse Occupy ?
IS : Je pense que cette crise serait survenue même en dehors d’une année électorale. Tous les mouvements spontanés, qu’elle que soit leur dynamisme, et Occupy était éminemment dynamique, à un moment donné, rentrent en crise. Seule la capacité de se transformer en mouvement politiques avec des perspectives à long terme peut empêcher cela. Évidemment, c’est plus facile à dire qu’à faire. Nulle part ailleurs la création d’organisations politiques est-elle plus difficile qu’aux États-Unis. C’est le pays capitaliste le plus avancé qui garde un système politique issu de la période du libéralisme classique.
MB : Pouvez-vous élaborer ?
IS : Le livre de Charlie Post, The American Road to Capitalism, décrit merveilleusement cela. Son analyse marxiste démontre que la « révolution bourgeoise » américaine n’a pas eu lieu lors de la guerre d’indépendance mais bien lors de la guerre civile de 1861-1865 : les capitalistes primitifs du nord y ont affronté les précapitalistes du sud. C’est dans ce contexte qu’est né le duopole des partis républicain et démocrate. En Europe, de 1870 à 1880, de vigoureux partis socialistes, liés à la classe ouvrière, naissaient et combattaient les conservateurs-trices féodaux-ales, et les partis de la bourgeoisie libérale. Aux États-Unis, durant cette période, toutes les tentatives historiques de créer ce genre de partis de masse avec des programmes dominés par la classe ouvrière, capables d’affronter le duopole, ont échouées le dernier étant la mort du parti Socialiste de Eugène Debs dans la foulée de la première guerre mondiale.
Cette faillite a eu des conséquences dévastatrices pour la gauche jusque dans son vocabulaire. Celui qui a cours en ce moment dans l’univers politique américain, des conservateurs aux libéraux, (dans le passé on a utilisé les adjectifs « radicalE » aujourd’hui on entend plus souvent « modéréE » ou « indépendantE ») remonte à l’époque du libéralisme classique.
On peut observer des différences importantes dans l’usage du préfixe « social ». En Europe, la reconnaissance de « la question sociale » durant la première moitié du 19ième siècle, a mené à l’émergence d’organisations de masse qui se sont qualifiées elles-mêmes de « socialistes » ou de « sociales démocrates ». Dans cette orientation, encore aujourd’hui, le mot « social » désigne la nécessité d’améliorer ou de surmonter les contradictions du capitalisme par des réformes minimales jusqu’au passage par la révolution. Donc, l’opinion générale a intégré que le capitalisme est intrinsèquement antisocial, c’est-à-dire qu’il produit des résultats qui sont la plupart du temps inégalitaires et/ou injustes. On peut observer les succès des socialistes dans leur lutte contre le capitalisme en ce que le préfixe « social » a été adopté par la droite, qui apeurée par la possibilité d’une révolution sociale, l’a intégré dans son discours donnant ainsi l’impression qu’elle se préoccupait des pauvres et de la classe ouvrière.Donc, en Europe, surtout en Allemagne, en Autriche et en France, historiquement le terme « social conservatisme » désigne les critiques conservatrices du capitalisme. On fait généralement la différence entre les critiques conservatrices des marchés et les « sociaux conservateurs-trices ». Aux États-Unis, le « social conservatisme » désigne ce qu’en Europe on appelle le conservatisme des valeurs ou culturel. Le préfixe « social », au sens de la reconnaissance d’une tendance inhérente du capitalisme aux crises et de la réponse bourgeoise des classes salariées à s’organiser sur des bases autonomes pour tenter de se libérer, n’existe même pas aux Etats-Unis.
Au lieu de cela, y être de gauche est largement associé à être « libéral [2] ». Il s’agit d’une manière de désigner la conception bourgeoise de l’organisation sociale qui doit se faire du haut vers le bas, soit parce qu’il faudrait être gentilLEs avec les pauvres ou, qu’il faut faire face au danger de révoltes et de désintégration sociale par les crimes, la culture ou les conflits ethniques etc. ou encore simplement parce que de plus hauts salaires vont soutenir la demande pour les biens produits. C’est donc une méthode pour stabiliser le système capitaliste et favoriser sa reproduction. En Europe, au cours des dures trente années qui ont suivi le tournant conservateur insuflé par les révolutions bourgeoises de 1848, le projet socialiste a réussi son mouvement historique d’émancipation. Aux États-Unis, cela reste à (re)faire.
Comment voulez-vous qu’un mouvement anticapitaliste réussisse s’il n’a pas de vocable propre pour se désigner lui-même ? Dans la conception américaine la plus répandue, les socialistes sont des partisans de l’instabilité et des guerres qui prévalaient en Europe, pas une réponse légitime d’un acteur de gauche dans son univers politique. Une telle compréhension confine le mouvement dans une position de subordonné à la fraction bourgeoise orientée vers les compromis. C’est le libéralisme historiquement incarné par le parti Démocrate. Il ne faut pas penser que la gauche européenne n’a pas à s’émanciper de tous les partis socialistes de nom seulement. Ils ont largement adhéré aux divers Partis Démocratiques au cours de cette période néolibérale en qualifiant de Troisième Voie celle qui s’est construite sur le modèle développé par les « nouveaux démocrates » de Bill Clinton. Ils sont ainsi devenus des partis (sociaux) libéraux caractérisés par des programmes de moindre envergure, avec moins d’adhérantEs des couches populaires et moins de démocratie dans leurs rangs et leur fonctionnement.
Donc, linguistiquement, la distinction entre socialisme et capitalisme est bien vivante en Europe. Les vieux partis de tradition sociale démocrate aussi bien que les nouveaux à gauche peuvent facilement s’en réclamer que ce soit le Parti de la gauche allemand, le Front de gauche en France, le Parti socialiste hollandais ou les Partis de la gauche postcommuniste scandinaves.
MB : Donc, nous devons voir la crise d’Occupy comme un résultat de la faiblesse de la gauche américaine qui est elle-même héritière de structures historiques et du manque d’organisations politiques de masse à la gauche du parti démocrate ?
IS : Exactement. Quelque mouvement spontané que ce soit doit pouvoir s’appuyer sur un large mouvement politique de masse qui aide à l’organisation interne de la classe ouvrière et l’aide aussi à devenir active dans le processus politique en recherchant son autonomie mais en développant des alliances avec les classes qui ne lui sont pas antagoniques.
Les Démocrates ont joué le rôle de sociaux-démocrates des années trente jusqu’aux années soixante, tant qu’a duré la coalition pour le New Deal. Toutefois, ils n’ont jamais été un parti de masse ni celui de la classe ouvrière comme cela est le cas en Europe. Ils ont opéré dans un système où l’État fédéral était et est toujours puissant pour ce qui est de la politique étrangère et faible pour ce qui concerne les politiques intérieures de l’État providence. Donc, jusqu’à maintenant, le parti Démocrate fonctionne selon un modèle libéral classique, celui des dignitaires et des notables avec tous les problèmes que cela génère dans une société de classe inégalitaire. Le Congrès est de fait le quasi domaine exclusif de millionnaires ou de gens qui dépendent financièrement de millionnaires ou multi millionnaires comme Sheldon Adelson, le guichet automatique de Newt Gingrich.
Toutes les tentatives du mouvement ouvrier pour créer un parti national, de classe, démocratique, contrôlé par ses membres, ont échoué. Conséquemment, et au-delà de l’opposition anarchisme/socialisme, rien n’a autant divisé la gauche américaine que les questions d’organisation. Est-ce qu’il faut travailler à une stratégie pour obtenir un système de vote proportionnel et/ou le système préférentiel (où le vote consiste à ranger les candidats par préférence N.d.t.). Est-ce que vous tentez d’infiltrer le parti Démocrate en passant par ses formations internes comme le Working Families’ Party. Ou, est-ce que vous vous lancez dans la tentative de créer un nouveau parti de classe comme le Labor Party USA qui s’est malheureusement évanoui en 1990 ? C’est une question incroyablement difficile. Ce sont toutes ces raisons qui me font dire qu’Occupy, dont la crise a commencé bien avant 2012, n’est pas victime de l’année électorale. Il est plutôt victime de la position difficile dans laquelle se trouve la gauche américaine pour des raisons historiques.
Le fait que ces conditions rendent si difficile les décisions stratégiques me semble être la raison fondamentale pour laquelle toute les tentatives de créer un nouveau troisième parti ont échoué. Malgré toutes les déceptions que B. Obama a suscitées, les espoirs de lui opposer un candidat de gauche lors de la Primaire démocrate et tous les efforts déployés par des intellectuels de gauche comme Stanley Aronowitz et Rick Wolff pour créer un nouveau parti ont aussi échoué. N’oublions pas que le sénateur socialiste Bernie Sanders, un des politiciens les plus populaires au pays, était un candidat acceptable pour la gauche. Sa possible candidature aurait au moins ouvert un espace de débat pour une alternative de gauche au président Obama.
Chris Hedges, un des intellectuels publics les plus influents, continue de soutenir que si la gauche américaine ne développe pas un projet politique radical crédible, indépendant de B. Obama et de la classe libérale, le désir d’une alternative programmatique à l’intolérable statut quo actuel va venir de la droite. Sans propositions d’humanisme ni de solidarité, les libertaires de droite comme Paul Ryan et Ron Paul, alliés aux chrétiens fondamentalistes comme James Dobson et Tim LaHaye, vont répondre aux désirs d’une vision globale de l’avenir du monde. Ils représentent le courant idéologique du parti Républicain qui s’est considérablement déplacé encore plus à droite et qui fait peur à raison aux travailleurs-trices organiséEs dans le pays mais aussi aux cibles géopolitiques et géoéconomiques de l’empire américain.