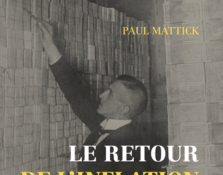Naomi Klein est une icône de longue date des mouvements sociaux et des médias, forte en synthèse et vulgarisatrice douée, elle est, depuis deux décennies, l’une des principales chroniqueuses des mouvements d’opposition aux grandes sociétés, à la mondialisation et au capitalisme (une série de mouvements « antisystémique » qui exigent sans doute certaines explications).
Qui d’autre de gauche pourrait avoir une entrevue sympathique aux informations du soir de la télévision publique du Canada avant même la parution de son dernier livre ? Et à qui d’autre, afin d’avoir un aperçu du livre, demande-t-on à expliquer à un public national pourquoi, du point de vue de l’environnement, le capitalisme est « l’ennemi principal » ?
Les écrits et les entretiens de Klein ont fourni au « mouvement » une contextualisation et la cohérence dont il avait besoin. Ils ont servi de catalyseur à la discussion, contribuant ainsi à la croissance du mouvement. Son nouveau livre, This Changes Everything : le capitalisme contre ce climat est le point culminant de sa très influente trilogie. Il nous montre aussi combien son analyse a évolué au cours des quinze dernières années.
Cette évolution touche à la fois son évaluation du mouvement — plus que jamais, Klein exprime des frustrations avec le mouvement dont elle fait partie et qu’elle continue à considérer comme fondamental pour le changement social — et sa plus profonde analyse du capitalisme comme « ennemi principal. » Sa critique antérieure de certains aspects particuliers du capitalisme a maintenant été élargie pour suggérer — ou au moins elle s’en approche — que le capitalisme est devenu la menace principale à la survie humaine et au progrès social.
La trilogie de Klein a commencé avec No Logo, paru en 1999, qui expose le dessous manipulateur et exploiteur de la culture de consommation. Publié heureusement au milieu de la Bataille de Seattle contre l’Organisation mondiale du commerce et devenu éventuellement la « bible du mouvement antimondialisation, » No Logo a contribué à la croisade morale dans les campus universitaires contre l’utilisation des ateliers de misère pour alimenter cette culture. Mais ce livre a fait l’erreur de distinguer entre les sociétés qui sont prétendument « bonnes » et les « mauvaises », laissant ainsi dans l’ombre le système social qui a formé ces sociétés et le cadre dans lequel elles agissent. .
Le deuxième livre majeur de Klein, La stratégie du choc : la montée du capitalisme du désastre, est également paru à un moment propice — en 2007, juste avant l’implosion financière et la crise économique la plus spectaculaire depuis la Grande Dépression. Cette fois Klein chronique comment les entreprises et les États capitalistes exploitent les possibilités offertes par les crises naturelles ou générées par le système pour imposer des politiques qui enrichissent une petite élite. Dans ce cas, cependant, l’accent mis sur les crises a laissé dans l’ombre ce que le capitalisme fait entre les crises.
Avec son penchant pour les lancements au moment propice, This Changes Everything de Klein est arrivé dans les librairies deux jours avant la marche massive en octobre à New York pour protester le changement climatique. Cette fois ce n’est plus les brebis galeuses du capitalisme qui sont le sujet, ni la capacité du capitalisme à exploiter les crises, mais les principes mêmes de l’organisation du système — et les conséquences environnementales qui en découlent. « Notre système économique et notre système planétaire sont maintenant en guerre, » écrit Klein, « et ce n’est pas les lois de la nature qui peuvent être modifiées."
Dans un langage typiquement accessible, Klein résume le consensus scientifique alarmant concernant le changement climatique. Mais l’importance de Cela change tout ne réside pas dans la description détaillée et passionnée de l’urgence de combattre la crise environnementale. Son importance réside plutôt dans l’effort de Klein pour démontrer que la modification de notre rapport à la nature est inséparable de la modification de nos rapports entre nous – de « la transformation de notre système économique. » (Je reviendrai plus tard aux ambiguïtés dans la façon dont cela est interprété).
La menace immédiate à la terre « change tout, » en ce sens que le simple ajout de « l’environnement » à notre liste de préoccupations ne suffit pas.
L’ampleur du problème nécessite une politique de combat contre le capitalisme. Nous devons en finir avec l’idée, affirme Klein, que la crise de l’environnement peut être contenue et finalement annulée par une politique de bricolage (même s’il faut évidemment traiter les symptômes aussi) ; par des corrections techniques (bien que des avancées technologiques raisonnables doivent être vigoureusement poursuivies) ; ou par des solutions basées sur le marché (aucun commentaire n’est nécessaire – c’est ridicule de penser que le marché va résoudre les problèmes qu’il a contribué à créer). Quelque chose beaucoup plus global est nécessaire.
Souligner cela, cependant, ne signifie pas simplement démonter les solutions douloureusement inadéquates proposées par la droite. Il faut aussi poser des questions difficiles au mouvement écologiste lui-même. Aussi important que ce mouvement ait été pour mettre la question à l’ordre du jour et pour mobiliser en particulier les jeunes pour cette lutte, ses formes d’organisation ne sont simplement pas à la hauteur du défi. Après des décennies de lutte, le mouvement environnemental demeure relativement marginal. Il est capable de ralentir telle ou telle tendance, mais non pas d’inverser et de corriger la trajectoire irresponsable du capitalisme.
Klein se montre particulièrement critique envers les secteurs du mouvement qui ont sauté dans le train du « capitalisme vert » durant les années 1970. Suivant une trajectoire qui nous rappelle étrangement la bureaucratisation du mouvement syndical, que les écologistes ont autrefois critiquée, la citant comme antithèse de leur propre politique, leur environnementalisme a cessé de se concentrer sur l’organisation de manifestations et de teach-ins pour se concentrer sur l’adoption de lois, puis sur les poursuites judiciaires de sociétés qui les violent, et la critique des gouvernements qui ne les appliquent pas. Très rapidement, ce qui avait été un mouvement de hippies est devenu un mouvement d’avocats, de lobbyistes, et de participants à des sommets organisés par l’ONU. En conséquence, beaucoup d’écologistes nouvellement professionnalisés se vantent d’être les ultimes initiés, capables de traiter avec tout le spectre politique.
Klein poursuit en soulignant que « tant que les victoires s’accumulaient, leur stratégie d’initiés semblait fonctionner... Puis arrivent les années 1980. » Là encore, en parallèle avec le mouvement syndical, le tournant néolibéral du capitalisme a révélé dans quelle mesure le mouvement écologiste était devenu un tigre de papier, capable de manœuvrer un peu au sein du système, mais sans capacité de mobilisation de masse indépendante et soutenue.
Mais au-delà de la critique de cette orientation, nous devons demander ce qui, à part de l’opportunisme visant à gagner accès à des ressources et aux cercles internes, explique les trahisons de ces anciens idéalistes.
Dans cette recherche de solutions faciles, quel rôle a joué la combinaison de sentiment sincère d’urgence extrême et la compréhension de l’impact limité que pourraient avoir des manifestations sporadiques ? Dans quelle mesure la vulnérabilité du mouvement à la cooptation, d’une part, et son épuisement et sa retraite, de l’autre, étaient-ils tributaires d’un manque de vision qui dépasse la question de l’environnement et de l’absence de planification stratégique en vue de faire vraiment reculer le pouvoir ?
Ce ne sont pas que des questions d’historiens. Elles ont une pertinence immédiate. Elles se posent à cette partie du mouvement qui ne s’est pas vendue mais qui est restée fidèle à ses principes originaux. Quoique Klein place son espoir dans ce dernier groupe, à son crédit elle avoue sa frustration avec des aspects centraux de son orientation stratégique. Ici elle dit deux choses importantes qui sont liées : l’une qui concerne l’organisation ; l’autre – la stratégie.
Premièrement, il y a la tendance assez répandue au sein du mouvement à considérer les structures elles-mêmes comme faisant partie du problème. Pourtant, il ne peut y avoir du progrès sans le développement sérieux d’institutions qui peuvent assurer la gestion à grande échelle de ressources, la coordination, la continuité entre les générations, le développement de qualités de direction, le recrutement, la formation populaire. Il faut, en particulier, des structures capables de prendre des décisions complexes et difficiles et d’assurer le contrôle démocratique des dirigeantEs.
Comme Klein l’écrit, « le fétichisme face à l’absence de structure, la révolte contre toute forme d’institutionnalisation, n’est pas un luxe que les mouvements de transformation contemporains peuvent se permettre ... Le ronchonnement sans fin, le tweeting, les « flash mobs » et les occupations ne remplacement pas les outils collectifs qui ont construit et soutenu les mouvements de transformation dans le passé. »
Ce refus d’organiser sérieusement et de construire des institutions – un refus qui s’observait également dans le mouvement syndical – a contribué à une série de défaites depuis le début des années 1980. Et ces défaites ont généré un manque d’imagination qui est inséparable de la disparition de visions d’un monde alternatif et de structures qui donnent confiance et qui soutiennent le travail collectif.
Deuxièmement, Klein souligne que la lutte contre le changement climatique ne peut être remportée uniquement en faisant appel à la peur. « La peur est une réaction de survie. Elle nous fait courir ; elle nous fait sauter ; elle peut stimuler des actions surhumaines. Mais il faut encore savoir où courir. Sans cela, la peur ne fait que paralyser. » (On pourrait ajouter que la peur peut susciter le soutien aux panacées immédiates offertes par le capitalisme vert).
De même, s’il est vrai qu’il faut affronter le problème du consumérisme, le seul appel à un mode de vie plus austère ne fait que renforcer l’austérité promue par les États capitalistes. La question n’est pas seulement de vivre avec « moins », mais de vivre autrement – ce qui peut aussi signifier vivre mieux.
Il est question d’une société alternative. Et puisque des sacrifices seront vraiment nécessaires, ceux-ci doivent être caractérisés par une égalité radicale de sacrifice. En plus, ces sacrifices doivent être perçus comme des « investissements » dans la transformation de la société, plutôt que des concessions pour sauver le capitalisme.
À la question inconfortable à savoir « comment nous pouvons convaincre le genre humain de placer l’avenir devant le présent, » Klein emprunte une réponse à Miya Yoshitama : « On ne le fait pas. » Au lieu de cela, on agit selon la proposition : « S’il n’y avait jamais un moment pour proposer un plan pour guérir la planète tout en guérissant nos économies dysfonctionnelles et nos communautés brisées, c’est le moment maintenant. »
Et on énumère une longue série de problèmes liés directement à l’environnement : logement, transport, infrastructure, emplois valorisants, services publics, espaces publics, plus grande égalité et démocratie authentique — et on essaie de convaincre les gens que « l’action climatique est leur meilleur espoir pour un meilleur présent et un avenir beaucoup plus intéressant que tout ce qu’on leur offre présentement. »
Au lieu de cela, le courant principal du mouvement environnemental, se plaint Klein, "se tient généralement à l’écart de ces expressions de frustration, choisissant de définir l’activisme de manière étroite, revendiquant, par exemple, une taxe carbone ou l’organisation du blocage de la construction d’un pipeline. »
La construction d’un mouvement de masse large contre le changement climatique ne veut pas dire minimiser l’importance de la crise écologique, mais plutôt penser politiquement et dans le cadre de valeurs plus englobantes. Un tel mouvement de masse doit forger son propre sens commun, créer des structures indépendantes du capital, et générer l’énergie et l’endurance que donne une vision réalisable, même si lointaine.
Une fois que nous nous rendons compte que l’ampleur de la question du changement climatique demande non seulement d’agir pour la protection de l’environnement, mais pour la transformation de la société, nous arrivons à une nouvelle étape, encore plus intimidante. Nous avons ajouté la nécessité d’ajouter la bataille contre le capitalisme et nous devons bien comprendre ce que cela signifie.
C’est le grand mérite de Klein d’avoir mis le capitalisme sur le banc des accusés. Mais elle lui laisse trop de marge de manœuvre lui permettant d’échapper à une condamnation définitive. Il y a déjà beaucoup de confusion et de divisions au sein des mouvements sociaux quant à la signification de l’« anticapitalisme ». Pour beaucoup, sinon la plupart, ce n’est pas le système capitaliste qui est en cause, mais certaines sous-catégories de méchants particuliers : grandes entreprises, banques, sociétés étrangères, multinationales.
Klein est ambivalente sur cette question. Dans l’analyse qui traverse son livre, elle semble soutenir assez clairement que c’est le capitalisme qui est le coupable. Mais elle jette un doute sur cette position lorsqu’elle insère des mots comme « le type de capitalisme que nous avons », « le capitalisme néolibéral » ou « le capitalisme dérégulé », « le capitalisme déchaîné, » « prédateur » « extractif », et ainsi de suite. Ce genre de qualificatifs mine la logique puissante de son argumentation, selon laquelle le défi n’est pas de créer un meilleur capitalisme, mais d’affronter le capitalisme comme système social.
Cette ambivalence est aggravée par l’accent excessif que Klein met sur l’idéologie comme moteur de changement social. Loin de moi l’idée de minimiser l’importance de l’idéologie. Mais il faut l’ancrer dans un contexte.
Que Friedrich Hayek et Milton Friedman aient été largement ignorés après la Seconde Guerre mondiale pour ensuite être idolâtrés dans les années 1980 ne s’explique pas par la force de leurs arguments qui auraient fait des convertis, mais par le fait que les contradictions du capitalisme et la modification du rapport de forces entre les classes ont mis à l’ordre de jour un capitalisme plus agressif. C’est cela qui a ouvert la porte à ces idéologies, qui attendaient leur moment. .
C’est une chose de mettre l’accent sur l’éducation populaire et sur la nécessité d’avoir notre propre idéologie et notre sens commun comme, éléments de la lutte contre le pouvoir structurel de nos sociétés. Mais c’en est une toute autre de penser que l’idéologie est tout et de sous-estimer ce qui doit être fait (ou à l’extrême, de remplacer naïvement la lutte populaire par un effort qui vise à convertir les élites à notre idéologie).
Le capitalisme varie évidemment d’une époque à l’autre et d’un pays à l’autre. Certaines de ces différences sont loin d’être négligeables. Mais si nous cherchons des changements significatifs, nous ne devons pas exagérer l’importance de cette diversité. En outre, ces différences ne sont pas en train de s’accentuer avec le temps, mais de s’effacer, nous laissant un capitalisme plus ou moins monolithique à travers la planète.
Ce n’est pas seulement que toute forme de capitalisme exige une croissance aveugle. Mais la marchandisation du travail et de la nature, que le capitalisme entraîne, nourrit un consumérisme individualiste qui est hostile aux valeurs collectives. (La consommation sert de compensation pour ce que nous perdons en étant transformés en marchandise et soumis à l’incitation au travail qui y est liée.) Ce capitalisme est insensible à l’environnement (la nature est un entrant, et le coût lié à la manière dont elle est exploitée par une entreprise n’est pas son souci).
Un système social fondé sur la propriété privée des moyens de production ne peut supporter le type de planification nécessaire pour éviter une catastrophe environnementale. Les propriétaires du capital sont fragmentés et contraints par leur concurrence à se soucier d’abord de leurs propres intérêts. Toute planification sérieuse doit passer outre les droits de propriété — une action qui rencontrera une résistance féroce.
Comme l’observe Klein, même les pays qui se sont prononcés contre l’extractivisme — en réponse à la pression des écologistes indigènes — se sont vus contraints par les options que capitalisme leur impose d’extraire et de vendre ce que la terre leur offre.
Quant à l’idée selon laquelle les pays du Nord pourraient utiliser leur technologie et leurs richesses pour élargir les options du Sud, ce genre de solidarité demanderait une transformation culturelle au Nord et un contrôle direct de la technologie et de la richesse sociale qui rendraient possible cette redistribution mondiale. Mais ces conditions ne sont envisageables que dans une société postcapitaliste.
Certains, ayant compris les limites du capitalisme de notre époque, se tournent vers un après-guerre romancé. Mais c’est justement pendant cette période de l’État providence keynésien que la libéralisation du commerce a fait son grand bond en avant, que les multinationales ont commencé leur expansion mondiale, et que la finance – profitant de l’expansion des prêts hypothécaires et des fonds de pension, et suivant les multinationales à l’étranger - ont connu leur première vague d’expansion explosive. C’est à cette époque que la gauche radicale et ses idées ont été marginalisées, que le consumérisme s’est étendu à la classe ouvrière.
Qui plus est, on peut difficilement ignorer le fait que les capitalistes et les États capitalistes ont depuis longtemps perdu tout intérêt à cette époque passée, qui, malgré son caractère limité, a imposé trop d’obstacles à la course aux profits. C’est le capitalisme - non pas un capitalisme particulier, mais le capitalisme réellement existant et le seul disponible - qui est « l’ennemi principal ».
Il est critique que nous soyons clairs là-dessus, parce que si nous concluons que l’environnement ne peut être régénéré sous le capitalisme, alors cela change complètement la nature du jeu. Car c’est une chose de se demander comment nous pouvons nous organiser pour mieux manifester notre mécontentement, pour faire pression et du lobbying auprès des sociétés et des États en faveur de la modification de certaines pratiques dans le cadre du capitalisme. Mais c’est une toute autre chose de conclure qu’il faut nous organiser pour réaliser la tâche beaucoup plus ambitieuse de remplacer ce puissant système.
Nous devons nous battre avec la plus grande force possible pour des réformes qui limitent les dégâts environnementaux. Mais cette lutte pour des réformes doit servir à la construction d’un mouvement qui nous permettra éventuellement d’aller au-delà du capitalisme.
Face au défi redoutable de transformer le capitalisme et face à une crise environnementale si urgente, certains peuvent décider qu’il faut repenser nos arguments et battre en retraite afin de permettre une alliance plus large qui inclurait des élites sympathiques, même si pour cela il fallait sacrifier d’autres buts comme l’égalité et même la démocratie. Mais il devrait déjà être clair que cela n’est pas du tout une option. Cela signifierait le retour au capitalisme vert discrédité.
Une telle stratégie de concessions saperait notre base, tout en contribuant peu à freiner le changement climatique. Des élites mêmes "éclairées " ne verraient pas d’un bon œil la subversion des institutions du capitalisme. Les gagner est donc un but téméraire. Le désarmement préalable ne ferait que garantir que les élites vont tenter de se sauver à nos frais. Nous n’avons pas de choix que d’aller de l’avant, malgré l’énormité du défi.
Klein ne fournit pas une stratégie de rechange. Mais nous pouvons difficilement le lui reprocher. Des « recettes » visionnaires pour « les marmites de l’avenir » font défaut depuis longtemps à gauche. Cela change tout est quand même le meilleur et le plus important livre de Klein. Il contribue à nous mettre sur la bonne voie. Il n’a pas peur d’analyser sobrement l’état du mouvement. Il offre des idées cruciales pour le progrès du mouvement et nous invite - même si parfois de manière ambiguë – à engager un débat sérieux sur ce qui doit se faire et sur la nécessité de repenser la façon de le faire.
À la fin du livre, Klein s’apprête à interviewer le jeune chef de Syriza, le parti grec radical qui s’apprête maintenant à former un gouvernement. Elle demande à un ami grec ce qu’elle devrait lui demander. Et ce Grec lui répond : "Demandez-lui : Lorsque l’histoire a frappé à la porte, lui avez-vous répondu ?" Klein conclut : « C’est une bonne question à nous poser à nous toutes et tous. »