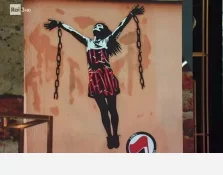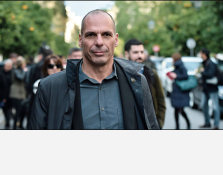(...)
Programme et « gouvernement de gauche », de quoi parle-t-on ?
Dans cette situation, la coalition SYRIZA se trouve confrontée à la question suivante : comment la gauche radicale peut-elle réclamer et conquérir le pouvoir sans perdre son âme ? En termes concrets, la question posée est celle des alliances sociales et politiques, du programme, de la manière de conquérir le pouvoir gouvernemental et de ce que l’on entend, en termes de tâches et de devoirs, lorsque sont affirmés la perspective et le mot d’ordre de « gouvernement de gauche ».
Par programme, nous n’entendons pas une liste de revendications. Tout d’abord, un programme doit être une façon de rendre compréhensible au plus grand nombre possible la dynamique de la situation du pays comme de la société ; plus précisément celle des rapports entre les classes dominantes et leurs représentants politiques, d’un côté, et le prolétariat, au sens large, ainsi que ses alliés réels ou potentiels (petits paysans), de l’autre. Une compréhension qui s’éclaire grâce à une mise en relief des actions précises et concrètes du gouvernement Samaras et du patronat, en insistant sur leur responsabilité et en ne transférant pas l’ensemble du sort du pays et de sa population sur les décisions de la Troïka, qui sont, certes, importantes. En faisant de la Troïka la seule responsable de la situation, le piège d’une politique « d’unité nationale », de vraie collaboration de classes, d’endormissement des salarié·e·s, est mis en place. De manière complémentaire est stimulé un sentiment d’impuissance parmi les salarié·e·s, car les Führer troïkiens sont « trop loin, trop distants, trop intouchables ». Cette façon de rendre compréhensible la situation concrète pour les masses laborieuses est certes liée à un travail analytique. Mais il ne s’agit pas de déverser des tonnes d’analyses sans en tirer des conclusions pratiques sur : que faire demain ?
Simultanément, il faut rendre cette situation, dans ses déclinaisons sectorielles (écoles, santé, emplois, privatisations, etc.), sensible pour les salarié·e·s. Autrement dit, permettre aux plus larges secteurs possible des dites masses laborieuses, au travers de leurs pratiques de lutte et des revendications qui les accompagnent, d’envisager avec plus d’acuité les voies d’une résistance afin de passer à une contre-attaque. Une mobilisation-grève des enseignants doit trouver les modalités, y compris pédagogiques, pour que les travailleurs et travailleuses du secteur de la santé, de l’administration communale – et pourquoi pas de la police municipale ? – puissent s’identifier comme menant ou devant mener un même combat. Ce qui implique de poser non seulement un acte de défense des salaires, du statut de l’enseignant – ce qui est prioritaire – mais de développer une idée supplémentaire, étroitement liée à la première : quel service public, quel enseignement, quelle éducation pour qui, pour quoi, avec quels moyens ? Quels liens entre cela et la défense de l’emploi ? Selon une telle orientation peut s’établir, plus aisément, une jonction avec les parents, les usagers. L’analogie avec une lutte dans le secteur de la santé est alors possible à être appréhendée.
Dans cette logique dynamique s’affirment les conditions d’un « gouvernement de gauche » fondé sur l’action massive, coordonnée, construisant une compréhension et une conscience communes. Cela à l’opposé d’un « gouvernement de gauche » prenant appui sur une majorité parlementaire construite à partir d’alliances douteuses et suscitant le maximum de délégation de la part de la population, avec des secteurs combatifs mis en stand-by, pour ne pas gêner l’activité dudit gouvernement de gauche, dont la lettre d’intention comportera, à coup sûr, des revendications « intelligentes » et « techniquement irréprochables ».
Au cours des derniers mois, la direction Tsipras de SYRIZA a envoyé de nombreux signaux sur le fait que la coalition, dans ses diverses composantes, était en train d’adopter une approche modérée, de « centre gauche » concernant ces questions stratégiques. Beaucoup de membres dirigeants argumentent que dans un tel désastre social et devant les dangers de l’autoritarisme, il faut, en priorité, « sauver le pays ». Ils en concluent que des politiques de gauche allant à la racine de la crise socio-économique et du régime politique en place doivent être, au mieux, reportées dans un futur hypothétique. Dans l’action de SYRIZA doit être effacée la ligne rouge indiquant la liaison entre l’affrontement immédiat, les besoins les plus ressentis les véritables obstacles à leur satisfaction, soit le complexe s’articulant autour de la propriété privée, des institutions régaliennes de l’Etat et de la politique gouvernementale en tant que conseil d’administration placé sous la surveillance des contrôleurs et réviseurs de comptes mandatés par les sommets de la Troïka. Ceux qui doivent montrer aux classes laborieuses européennes la punition méritée lorsqu’elles n’acceptent pas que les conquêtes sociales, issues de rapports de force et d’une période de « croissance économique » passée, sont à considérer comme ne correspondant plus aux exigences de la compétitivité mondialisée, le train à grande vitesse censé permettre à l’ensemble du prolétariat mondial de s’engager, demain, sur une courbe à plus de 250 km/h, sans danger pour les passagers. Et non pas pour les concepteurs du réseau productif interconnecté à l’échelle mondiale, ainsi que son support « naturel », son environnement.
En termes sociaux, une perspective de « gouvernement de gauche » de ce type abouti à un compromis, pour ne pas utiliser un autre terme, avec des secteurs des classes dirigeantes nationales ou internationales, pour mettre en place une « restructuration de l’économie grecque sur une base socialement juste ». Cela a conduit Alexis Tsipras, dans son discours télévisé du 10 juillet devant un congrès de délégués encore parsemés – et avec plus de netteté dans des interventions suivantes – à laisser entendre que le « gouvernement de gauche » devrait avoir comme centre de gravité des ministres de SYRIZA, mais qu’il ne fallait exclure personne d’autre à l’exception d’Aube Dorée (les néonazis) et de la droite de la Nouvelle Démocratie.
Pour rappel, Antonis Samaras a quitté, en 1992, la Nouvelle Démocratie à cause de sa ligne ultranationaliste sur la Macédoine. Il créa alors son propre parti : le Printemps Grec, très à droite. Il eut des contacts avec le Front national de Jean-Marie Le Pen. Suite à des résultats électoraux médiocres et une non-participation aux élections de 2000, il rejoignit à nouveau la Nouvelle Démocratie, en 2004. Il sera alors le ministre de la Culture sous le gouvernement Karamenlis II. Il conduira une bataille clanique et idéologique pour prendre la tête de la Nouvelle Démocratie. Il obtiendra son poste, avec une majorité relative, en juin 2012. Ce point d’histoire indique le sens de la formule de Tsipras sur la composition et les alliances envisagées pour la formation de son hypothétique « gouvernement de gauche ». En fait, DIMAR, des éléments du PASOK et d’autres « techniciens » convertis de la dernière heure seraient des candidats acceptables pour un tel gouvernement, un gouvernement de « salut national ».
Or, Tsipras peut faire toutes les concessions qu’il veut, il est plus que probable que les secteurs dominants du capitalisme grec et leurs mentors internationaux ne vont pas acheter des propositions « d’ouverture » de ce type. Ce d’autant plus que son contrôle sur SYRIZA n’est pas hégémonique et solide et que SYRIZA ne contrôle pas la dynamique socio-politique – au contraire de ce que le PCI (Parti communiste italien) et la CGIL étaient aptes à faire en Italie, dans les années 1970-1980. En outre, SYRIZA ne détermine pas (encore ?) la direction du gros des appareils du mouvement syndical, avec ses deux confédérations : ADEDY pour le public et GSEE pour le privé, secteur où son implantation est très faible, entre autres dans les moyennes et petites entreprises.
Sous les feux de la rampe, chauffer pour dissoudre
Dès le jeudi 10 juillet au soir, les enjeux du Congrès dit de fondation du nouveau parti SYRIZA étaient clairs. La soirée d’ouverture était mise en scène pour deux acteurs, Alexis Tsipras et Pierre Laurent du PCF. A la tribune sont montés, entre autres, des anciens militants communistes incarnant toute une histoire. Ils étaient précédés par les dirigeants des organisations fondatrices de SYRIZA en 2003, dont Antonis Ntavanellos de DEA (Gauche internationaliste ouvrière). Les anciens ont été plus applaudis que Tsipras lorsqu’il arriva sous les feux des projecteurs et des applaudissements concertés, saluant théâtralement ses « alliés internationaux ». Le genre de signe que les conseillers expérimentés du dirigeant de 39 ans ont décelé de suite. Manolis Glezos, né en 1922 et héros de la résistance anti-nazie, n’était pas présent. N’ayant pas eu droit à une discussion avec la direction Tsipras sur la question de la dissolution des organisations (entre autres la sienne), il boycotta cette ouverture « lumineuse ».
Le discours de Tsipras était articulé autour de trois thèmes : 1° le danger du régime autoritaire qui se renforce ; 2° l’importance, dès lors, de défendre la démocratie sans qualificatif (pas les droits sociaux et démocratiques conquis dans les luttes, ce qui constitue une donnée du passé proche et du présent en Grèce) ; 3° la lutte pour la « justice sociale ». Pas une allusion aux luttes qui se déroulaient ce jour-là, afin d’en tirer des enseignements sur la stratégie à venir. Des phrases indiquant une ouverture à des alliances politiques et sociales larges.
Comme toujours dans ce genre de discours – qu’il lisait car « on » le lui avait écrit – le venin est dans la queue. Au nom de la fondation, enfin, d’un « parti unifié et démocratique », il était nécessaire de mettre fin à la coalition des 14 partis qui formait SYRIZA. La proposition était emballée dans un papier de fête dont ont le secret des élèves de l’eurocommunisme : « il faut que chacun et chacune puisse s’emparer du parti, que le peuple puisse disposer de cet instrument en mettant tout le monde sur le même pied, donc en dissolvant les partis et organisations qui composent SYRIZA ». Pour preuve, le jeudi matin du 10 juillet, Synaspismos (Coalition de la Gauche, des Mouvements et de l’Ecologie), principale composante numérique de SYRIZA, s’était dissoute. Ce fait accompli devait servir d’indication exemplaire pour les autres groupes, mouvements ou organisations. Ainsi, seuls le président de SYRIZA devant être élu par le Congrès (et non par le Comité central) et la direction majoritaire autour de lui resteraient organisés et s’empareraient, sans débats futurs, du « grand parti démocratique que tous les Grecs attendaient ». L’essentiel du Congrès va tourner autour de cet objectif décisif pour la direction Tsipras afin de renforcer sa crédibilité auprès de ce qu’elle considère ses interlocuteurs importants, des secteurs du PSOK et des fractions bourgeoises censées accueillir ses avances. Ce qui est illusoire, par ailleurs, dans le contexte national et international présent. Les questions politiques les plus urgentes ont donc été abordées, pour l’essentiel, par des intervenants de divers courants autres que celui de la majorité, en particulier des délégué·e·s de la Plateforme de gauche.
En vedette américaine – celle qui passe avant Johnny Halliday pour entretenir la salle dans un spectable normal, mais qui en l’occurrence a passé après le chanteur vedette, Tsipras – les congressistes ont eu droit à Pierre Laurent, du Parti communiste français (PCF). Il est intervenu après avoir quitté, pour un instant, ses camarades de la Gauche unie européenne (GUE), assis au premier rang. Il concluait la soirée spectacle. Son discours traduit en grec sur les haut-parleurs n’était audible que sur le canal zéro de la traduction. Un nombre emblématique.
Laurent, au nom du Parti de la gauche européenne (PGE), révèle d’abord la situation politique européenne favorable au PGE et à ses perspectives : « Ils n’ont aucun soutien populaire. C’est pour cela qu’ils bafouent la démocratie, nient les souverainetés populaires, les droits politiques et sociaux des citoyens. Ils n’ont aucun avenir politique. Ils sont en sursis. Ce sont des “gouvernements zombies” ! » Puis il souligne les avancées de cette gauche : « En 2012, vous [SYRIZA] êtes passés à l’offensive en revendiquant le pouvoir, en rassemblant autour d’un projet de progrès pour la société grecque. Votre force est devenue la première force de gauche du pays. Elle a rendu crédible la perspective d’une politique alternative. Elle est aux portes du pouvoir aujourd’hui. Les défis sont très grands. Il faut reconstruire la société, ses structures de solidarité, ses outils productifs, sa démocratie. Il faudra trouver les voies pour le respect de sa souveraineté face à une UE dominée par les marchés et les néolibéraux. La solidarité européenne et les luttes pour la refondation de l’UE seront déterminantes. Vous pourrez compter sur les forces du PGE pour ouvrir les espaces de convergence nécessaires, au niveau européen, entre les forces politiques de gauche, avec les forces sociales et syndicales. Les conditions de cette union sont plus favorables aujourd’hui comme le démontrent l’Altersummit [qualifié par beaucoup de militant·e·s de rencontre estivale pour la bureaucratie syndicale européenne qui se donne à ces occasions des airs de combattant européaniste et pour des représentants, pour l’essentiel salariés, d’ONG diverses, tout cela à l’ombre du PGE et de la droite de SYRIZA, ce qui n’altère pas grand-chose] qui s’est réuni à Athènes le mois dernier [en juin], les évolutions de la Confédération européenne des syndicats [la CES financée par l’UE !] et la première grève générale coordonnée du 14 novembre dernier. » Verbatim. Vous ne rêvez pas.
Pierre Laurent, magnifique (pas le Florentin du XVe siècle italien), conclut par un coup de gong : « En 2004, nous étions ensemble, Synaspismos et mon Parti, le Parti communiste français, pour fonder le PGE. Nous avons beaucoup avancé en suivant chacun notre route, mais en ayant la même trajectoire. Les progrès des uns ont renforcé les autres et ensemble nous avons fait grandir le PGE. » L’horizon, pour Pierre Laurent et le PGE, ne s’éloigne pas trop lorsqu’ils s’en rapprochent. Il est normal car Laurent le définit ainsi : « Nous allons préparer les élections européennes de 2014 qui seront un moment crucial pour changer le rapport des forces en Europe, pour renforcer le groupe GUE-NGL au Parlement européen. » Le travailleurs et travailleuses européens attendent impatiemment mai 2014. Ses « amis » du Parti de gauche et du Front de gauche français, du moins les composantes présentes, ne faisaient pas une mine trop réjouie. Mais ils ont fait leur choix. A eux de l’assumer. Pour ce qui est d’IU (Izquierda Unida, Espagne), du Bloco de Esquerda du Portugal, de Die Linke d’Allemagne, de Rifondazione communista d’Italie, du PC Finlandais, du PC d’Autriche… et même afghan, tout « baignait dans l’huile ». La confiance dans Tsipras, qui « a même réfléchi aux nouveaux billets à imprimer », en cas de sortie de l’eurozone, comme le soulignait un économiste réputé portugais, est là pour concrétiser les espoirs (vains) de ceux qui pensent que la classe dominante européenne est prête à faire des cadeaux à une majorité parlementaire « vraiment de gauche », sans même mentionner le groupe du GUE qui fait vibrer les travées à Bruxelles et Strasbourg.
A ce sujet, un des arguments avancés par la direction Tsipras à propos de la mise à mort de la coalition était le suivant : si nous ne sommes pas un parti unifié, nous risquons de ne pas obtenir les 50 sièges supplémentaires attribubés au parti arrivant en tête des futures élections en Grèce. Or, cette question avait été réglée formellement (au plan juridico-constitutionnel) avant les dernières élections. Cette anecdote à propos d’une rumeur permet de saisir la façon dont le débat avait été choisi d’être conduit par la direction Tsipras lors du Congrès de fondation. La seconde partie de cet article établira le lien entre les débats et résultats du congrès et la situation en Grèce début août.
Charles-André Udry