5 juillet 2022 | tiré d’Analyse Option Critique
https://aoc.media/analyse/2022/07/04/nous-sommes-dans-la-guerre/
Nous voici au 5ème mois de la guerre déclenchée par l’invasion russe. Dans ce texte[1], j’essayerai de mettre en ordre quelques-unes des réflexions que m’inspirent la situation en Ukraine et ses prolongements planétaires. Je formulerai des hypothèses et poserai des questions, mais je n’ai pas de certitude absolue quant à la réponse qu’il faut leur apporter. Sur plusieurs points je me demande même si ces réponses existent – sauf à vouloir projeter sur la réalité qui nous assiège des catégories idéologiques toutes faites. Mais ce n’est pas une raison, bien au contraire, pour ne pas tenter d’articuler ce que nous savions déjà et ce que nous apprenons au jour le jour, de façon à éclairer les enjeux et les éventualités d’un conflit qui nous concerne tous directement. Devant la guerre d’Ukraine en effet, devant la bataille qui fait rage autour des villes du Donbass, devant les menaces qui s’accumulent aux alentours, nous ne pouvons pas nous comporter comme de simples « observateurs engagés » qu’affectent plus ou moins les événements.
• C’est notre avenir, c’est notre « monde commun » qui sont en jeu, et dont la physionomie va dépendre aussi de nos interprétations et de nos choix. En ce sens, toutes proportions gardées car – ne l’oublions jamais – nous ne sommes pas les combattants ou les victimes directes du conflit, je dirai pourtant que nous sommes dans la guerre, car elle a lieu « chez nous » et « pour nous ». Nous n’avons pas le choix, hélas, comme le propose dans une belle leçon de pacifisme révolutionnaire mon ami le philosophe Sandro Mezzadra, de « déserter la guerre ».[2] Je n’en conclus pas pour autant que nous devions nous laisser « mobiliser » et emporter par elle d’une façon irréfléchie. La marge laissée au choix est très faible, mais faut-il décider d’avance qu’elle est inexistante ?
De quelle guerre, cependant, sommes-nous ici en train de parler ? Sur ce point déjà l’incertitude règne. Car au-delà du fait que le territoire ukrainien (en partie occupé ou annexé depuis 2014) a été pris d’assaut au matin du 24 février dernier sur l’injonction de Vladimir Poutine, et que l’armée russe y perpétue jour après jour des exactions qui ont entraîné de gigantesques déplacements de populations, mais aussi des actions de résistance exceptionnellement courageuses et intelligentes du peuple ukrainien, il faudrait une vue plus complète des ramifications et des contrecoups de la guerre dans une série d’autres lieux, peut-être dans le monde entier.
D’une perception complète des espaces qui forment le « théâtre » de la guerre, et de la façon dont ils se modifient à mesure qu’elle dure et change de rythme, dépendent en effet non seulement le jugement que nous porterons sur son « caractère » historique, mais l’idée que nous nous ferons de la politique qu’elle appelle ou qu’inversement elle interdit. On ne se lasse pas de répéter la « formule » du Vom Krieg de Clausewitz : « la guerre est la simple continuation de la politique par d’autres moyens ».[3] Ne serait-il pas tout aussi pertinent de nous demander, ici et maintenant, quelle politique « continue la guerre », ou surgira dans son après-coup (s’il doit y en avoir un), en tant qu’institution et en tant que praxis, sur la base des conditions qu’elle aura créées et des problèmes qu’elle aura révélés ?
Ces questions pour l’instant sans réponses, je voudrais commencer à les instruire en choisissant trois points d’entrée : de quoi cette guerre « est-elle le nom », ou comment la définissons-nous pour pouvoir la nommer ? que nous dit-elle des fonctions du nationalisme, de ses fluctuations, de son rapport à la « forme nation » elle-même ? quels sont les espaces politiques dont elle recoupe et, le cas échéant, déplace les frontières ?
Noms et définitions
Pour saisir le caractère de la guerre en cours, je pense qu’il faut appliquer plusieurs grilles, opérant à différents niveaux et faisant ressortir différentes modalités du conflit. La guerre se développe sur de multiples « théâtres » avec des intensités et des rythmes différents. Il est crucial de bien décrire cette surdétermination intrinsèque, dont vont dépendre son évolution et ses conséquences, même si nos incertitudes en sont d’abord accrues.
Cela n’empêchera pas qu’il nous faille décider quel en est l’aspect principal, d’une décision fondée sur l’analyse aussi rationnelle que possible des multiples dimensions de la guerre, mais qui n’en sera jamais simplement déductible et restera par conséquent subjective. Cette décision « commande » notre jugement politique sur les enjeux de la guerre et nos tentatives d’intervention depuis le lieu où nous sommes situés par l’histoire et par la géographie, c’est-à-dire en Europe et comme « citoyens d’Europe » (dont font partie beaucoup d’étrangers venus du monde entier, car l’Europe est de facto une entité cosmopolitique).
Je proposerai de considérer au moins quatre niveaux superposés, mais cette énumération appelle quelques préliminaires sur lesquels je passe aussi vite que possible. D’abord le caractère d’une guerre dépend certes des objectifs que poursuivent les belligérants, mais il ne peut se définir simplement à partir de leurs intentions ou de leurs déclarations : il faut les rapporter à la constitution des institutions et des forces (en général des nations) qui leur confèrent une effectivité, ce qui dépend toujours de conditions historiques déterminées. C’est pourquoi il y a, sans doute, de grands types de guerres, au-delà même des distinctions juridiques (guerres civiles ou étrangères, compatibles ou non avec le droit international…) et des catégories polémologiques (guerres de conquête ou de défense – voire de défense « préventive », de « haute » ou de « basse intensité », symétriques ou asymétriques…), que nous cherchons à identifier en ayant recours aux comparaisons.
Plusieurs seraient ici pertinentes, dont certaines ont été régulièrement invoquées depuis le début de la Guerre d’Ukraine, et d’autres soigneusement évitées : guerres d’Algérie et du Vietnam, occupation de la Palestine, guerres de Yougoslavie, guerre de Tchétchénie, invasion de l’Irak par les États-Unis… Mais en dernière analyse toute nouvelle guerre est une guerre nouvelle, et les comparaisons, bien qu’elles puissent servir à éviter les évaluations biaisées, fournissent avant tout des contre-exemples. Enfin toute guerre qui dure et engendre ce que Clausewitz appelait des effets de « friction » connaît plusieurs phases de mouvement ou de position, souvent associées à des tracés de fronts et de frontières, qui font évoluer son caractère et dans lesquelles changent les rapports de forces.
En l’occurrence, après la phase d’invasion proprement dite, dans laquelle l’armée et les unités territoriales ukrainiennes ont réussi à repousser les chars russes et à reprendre l’initiative, la guerre s’est figée dans une confrontation incertaine et dévastatrice, dévoreuse d’hommes et de munitions, concentrée dans les régions orientale et méridionale du pays que la Russie cherche à annexer. On retourne ainsi, en apparence, mais avec plus d’intensité, à ce qui avait été son théâtre initial, ce qui veut dire aussi que son vrai commencement date de 2014 et que nous n’en sommes pas au centième jour mais à la huitième année déjà… Cependant ce n’est qu’avec les développements actuels que toutes les implications du conflit commencent à se faire voir.
Tentons alors une première définition. La guerre des Ukrainiens est proprement ce qu’il faut appeler une guerre d’indépendance nationale, ce qui en ukrainien se dit maïdan et appelle la comparaison avec d’autres moments historiques où la constitution d’une nation souveraine se « libérant » de la sujétion d’un empire, est passée par la confrontation armée avec celui-ci : la sécession d’une partie de l’Irlande anglaise au début du siècle dernier, les guerres de libération nationale des colonies (ou semi-colonies) européennes en Afrique et en Asie, mais aussi, plus lointainement bien que symboliquement significatives, les « insurrections » qui donnèrent naissance aux nations modernes détachées des empires anglais, espagnol ou ottoman… Et sans doute ici on observera que l’Ukraine (qui avait joui au sein de l’URSS d’un statut de « république fédérative » et, à ce titre, disposé d’un siège aux Nations unies) était déjà devenue un État souverain, internationalement reconnu, à la suite de la dissolution de l’URSS en 1991.
Ce point est fondamental parce qu’il fait de l’invasion russe une transgression ouverte du droit international, ce qui qualifie l’un des belligérants comme agresseur et l’autre comme agressé, fondé pour se défendre à faire appel à l’aide étrangère.
Mais sur le plan politique, tel que le traduisent les discours de Poutine et l’ensemble de la propagande justifiant l’occupation et la « russification » des territoires conquis, on voit que la puissance impériale – continuée sur ce point par le régime communiste en dépit des principes démocratiques et fédératifs proclamés par la révolution d’Octobre 1917 – n’avait jamais considéré comme légitime l’indépendance des territoires ayant appartenu à l’Empire. Elle prétend exercer quelque chose comme un droit de « retour ».[4] C’est pourquoi on peut dire à bon droit que les Ukrainiens sont engagés dans une guerre d’indépendance qui avait été seulement différée. S’ils remportent la victoire, la souveraineté et l’existence même de leur nation deviendront un fait accompli et ne seront plus contestables. Évidemment, elles auront coûté très cher en termes de destructions et de souffrances.
Nous ne pouvons, cependant, en rester là. La référence à la continuité impériale dans l’espace qui va de l’Océan Pacifique jusqu’à la frontière polonaise (et parfois au-delà), mais surtout la référence à la façon dont la révolution russe a remis en question cette forme impériale pour finalement la restaurer et la « moderniser », imposent de considérer les choses sous un autre angle et sur une autre scène.[5] La comparaison qui s’impose ici, trop souvent censurée dans les commentaires, est avec les guerres de Yougoslavie des années 1990, même si l’ampleur des destructions et la masse des troupes et des équipements engagés est disproportionnée (mais la nature des crimes de guerre en train d’être commis est, elle, du même ordre).[6]
De ce point de vue, ce que nous avons caractérisé comme une guerre d’indépendance doit aussi nous apparaître comme l’exemple d’une guerre post-socialiste, ayant sa source dans l’effondrement des régimes communistes en Europe, et plus profondément dans l’incapacité de ces régimes à trouver une solution pour la « question des nationalités » héritée des empires : ce qui a entraîné à terme une intensification des nationalismes et de leur hostilité mutuelle, encore aggravée par le désastre social des politiques de « libéralisation à outrance » qui leur ont été appliquées après 1989 par le néolibéralisme triomphant.
Mais la profondeur historique dont nous avons besoin est plus grande encore, car l’histoire du communisme européen fait intégralement partie d’un cycle plus vaste et plus complexe : celui de la « guerre civile européenne » qui commence en 1914, enchaîne la guerre impérialiste et la révolution, puis débouche sur le triomphe du nazisme dans l’Allemagne vaincue, entouré d’une constellation de régimes et de mouvements fascistes d’un bout à l’autre de l’Europe, d’où la Seconde Guerre mondiale, suivie de la guerre froide entre les deux « camps » et de la division du continent, à laquelle mettront fin les révolutions démocratiques de 1989 et la chute du rideau de fer (si toutefois il s’agit vraiment d’une « fin »).
Envisagée dans ce cadre – celui d’une histoire continentale tragique, faite de révolutions et de contre-révolutions, de nations anéanties ou restaurées (comme la Pologne), scindées ou réunifiées (comme l’Allemagne), de destructions et de reconstructions, de massacres et de génocides, de déplacements de populations et de frontières, d’allers et retours entre le totalitarisme et la démocratie, dont les traces sont omniprésentes partout dans notre continent – la guerre actuelle n’est pas seulement une guerre européenne, comme je l’ai dit ailleurs avec d’autres, mais c’est un nouvel épisode de la guerre civile européenne[7].
Démontrant du même coup que celle-ci n’était pas achevée, ou que les problèmes dont elle surgissait et qu’elle avait reproduits n’étaient pas non plus résolus par l’ordre post-communiste ayant un moment fait croire à une « fin de l’histoire ». De ce fait même la répétition des destructions, des stratégies de la terreur, des exodes massifs, constituant à eux tous une manifestation de la guerre totale, devient moins énigmatique, sans se voir pour autant justifiée le moins du monde. Peut-être avions-nous, Européens, oublié l’histoire que, tous ensemble, nous « faisons » par nos guerres chaudes et froides entrecoupées de trêves et de refondations étatiques ou diplomatiques…
À nouveau, cependant, parvenus à ce point, nous devons changer de perspective et considérer de plus vastes espaces. Les guerres européennes au 20ème siècle ont été, de façon intrinsèque, des guerres mondiales, et inversement les guerres mondiales ont conféré à l’Europe une place non exclusive, mais toujours centrale comme théâtre des batailles, comme siège historique des « puissances » qui s’y affrontaient et des peuples qui en subissaient les plus lourds effets. La guerre actuelle en Ukraine – susceptible de déborder ce « théâtre » initial – intervient alors que l’Europe est irréversiblement provincialisée (ce qui ne veut pas dire, on le voit bien, qu’elle ait perdu toute fonction stratégique et géopolitique) : ce serait plutôt, me semble-t-il, une guerre mondialisée, ou « en cours de mondialisation ».[8]
Ceci n’a de sens cependant que si nous commençons à la penser comme une guerre « hybride », à la fois « chaude » et « froide », conduite sur le terrain de la technologie et de l’économie dont aucune politique ne peut plus se dissocier en même temps que sur celui des combats et des bombardements, et dans laquelle sont progressivement attirées, de façon essentiellement dissymétrique, plusieurs régions du monde avec leurs populations et leurs États. En effet les belligérants font partie d’alliances mondiales qui leur fournissent un appui direct ou indirect et dont certaines peuvent être dites mener « par procuration » (war by proxy). Étant donné la position de « réserve » adoptée par la Chine sur le plan militaire (ce qui s’explique par l’autosuffisance apparente des armements russes, mais aussi sans doute par le fait que, dans une perspective géopolitique, sa stratégie consiste à la fois à soutenir la Russie en face de « l’Occident » et à s’en dissocier pour faire avancer d’autres objectifs), cette dernière caractéristique vaut surtout, évidemment, pour le camp « occidental ».
Il est clair que sans un flot permanent, toujours grossissant, d’armements avec leurs instructeurs et de renseignements électroniques, l’armée ukrainienne malgré toute sa valeur et son esprit de sacrifice ne soutiendrait pas l’assaut de l’armée russe. Et surtout, n’en déplaise à la terminologie, la coalition occidentale venue au secours de l’Ukraine mène bel et bien une « guerre économique » pour essayer de faire plier la Russie. Il est hautement significatif de ce point de vue que, des deux côtés, le nom de « guerre » fasse l’objet d’une dénégation : les Russes parlent d’une « opération militaire spéciale » et les Occidentaux disent qu’ils appliquent des « sanctions ».
Par dessus tout il faut prendre la mesure des effets combinés qu’engendrent, à l’échelle mondiale, les destructions matérielles, le blocus interdisant l’exportation (et conduisant à la perte) de millions de tonnes de céréales, et la crise économique rampante induite par les sanctions portant sur l’énergie : le monde entre dans une spirale inflationniste lourde de conflits sociaux et voit se profiler des menaces de disette ou même de famine. Ce sont naturellement les pays du « Sud Global » qui sont ici menacés avant tout ou subissent déjà les contrecoups de la guerre totale et de la guerre hybride. En réalité, eux aussi sont maintenant « dans la guerre » avec nous, sans pour autant être officiellement « en guerre ».
Pour finir, je pense qu’il faut insérer dans nos définitions une caractéristique « virtuelle », nullement imaginaire pour autant, qui concerne l’intensité de la guerre plutôt que son extension. Il y a deux mois, dans un article venant à l’appui de son gouvernement qui a immédiatement fait polémique en Allemagne, Jürgen Habermas a soulevé la possibilité que l’escalade conduise au déclenchement d’une guerre nucléaire entre la Russie et l’OTAN (donc fondamentalement les États-Unis) dans laquelle toute l’Europe serait menacée d’anéantissement.[9] Beaucoup de commentateurs avaient déjà fait remarquer que le pouvoir russe brandit l’utilisation éventuelle d’armes nucléaires (en se servant aussi de l’occupation des centrales nucléaires) comme un instrument de chantage ou d’intimidation, et l’idée d’une « guerre coloniale sous parapluie nucléaire », ayant pour but de contraindre l’adversaire (c’est-à-dire l’OTAN, les États-Unis) à limiter le niveau et la portée de son intervention, avait été proposée par d’autres.
Mais ce que suggère Habermas, c’est une question plus générale : dès lors qu’on entre dans une guerre totale, qui porte en elle le risque d’une « montée aux extrêmes », l’évolution du rapport des forces et notamment l’incapacité de l’un des belligérants d’atteindre ses objectifs, considérés comme « vitaux », par des moyens conventionnels, ou la nécessité pour l’autre d’élever le niveau de son engagement à des armes de plus longue portée, peuvent conduire à l’utilisation des armements nucléaires (tactiques ou stratégiques) dont ils disposent.
Ainsi que l’avaient soutenu en leur temps (critiquant l’idée d’un « équilibre de la terreur » qui garantirait paradoxalement la paix par dissuasion mutuelle) des analystes de la nouvelle configuration des guerres comme Günther Anders ou Edward P. Thompson, c’est l’existence même des armes nucléaires qui entraîne la possibilité d’une catastrophe, ou d’un suicide collectif de l’humanité, devant lequel on ne peut garantir que les États auront « l’intelligence » (Clausewitz) de se retenir. Ce que Thompson avait appelé l’exterminisme à l’époque de la crise des « euromissiles » (au début des années 1980) ne peut être considéré comme « l’impensable ».[10] Et dès lors qu’il n’est pas impensable il faut le penser, ou faire entrer sa possibilité dans la définition de la guerre en cours.
Nous voilà donc ramenés à la nécessité d’une décision subjective, si possible éclairée, mais aussi par définition incertaine et risquée, quant à l’articulation et à la hiérarchie des dimensions de la guerre en cours, et au jugement que nous leur appliquons. Il me semble que la priorité immédiate est de soutenir le combat du peuple ukrainien, qui exprime son exigence d’indépendance nationale : non pas parce que celle-ci serait en soi une valeur absolue, mais parce que le droit à l’autodétermination des Ukrainiens est foulé aux pieds, et que la guerre « totale » qui leur est faite s’accompagne de violations massives des droits de l’homme dont la qualification juridique fait débat, mais ne peut être inférieure à celle de crimes de guerre. Leur défaite serait moralement inacceptable et désastreuse pour la légalité internationale (comme l’ont été d’autres auparavant, dont certaines récentes). Ce soutien est entier mais il n’est pas pour autant aveugle à ses conditions et à ses implications. Je passe donc aux deux autres points que j’ai annoncés.
Nations et nationalismes
« Nationalisme » : le mot fatal est de nouveau au centre de l’espace politique européen, avec son cortège de tueries, d’intolérance et d’exclusions. Force est de reconsidérer ce qui semble conférer à la « forme nation », parmi d’autres formations sociales, une singularité et un privilège : qu’est-ce qui la légitime ? dans quelle mesure et pourquoi serait-elle le cadre indépassable de la conscience collective et de l’action historique ? Il est clair que les Ukrainiens qui se battent pour leur indépendance et résistent héroïquement à des forces plusieurs fois supérieures sont animés d’un sentiment d’unité nationale et d’une volonté d’autonomie correspondante. En ce sens ils sont tous des nationalistes, il n’y a pas d’autre mot. Cela n’implique pas qu’ils le soient tous de la même façon ou pour les mêmes raisons. Surtout cela n’implique aucune équivalence avec le nationalisme officiel de l’État russe, bien qu’à un niveau très abstrait il s’agisse de deux espèces d’un même genre et qui se renforcent de leur antagonisme.
Non seulement parce qu’on ne peut assimiler des forces aussi inégales et des positions aussi dissymétriques par rapport au droit international (lequel fait de l’autodétermination des peuples une valeur inconditionnelle, sous condition cependant de reconnaissance par la communauté des autres nations, ce qui donne lieu à bien des fluctuations). Mais parce que la substance objective, éthique et politique, de ces nationalismes adverses n’est pas la même des deux côtés.
La propagande du régime russe exploite sans mesure les composantes « extrémistes » (voire fascisantes) de la vie politique ukrainienne au cours des dernières années (qui sont réelles, mais très minoritaires), ainsi que l’imaginaire de la Grande Guerre patriotique contre le nazisme tel que l’a « russifié » l’État déjà au temps du communisme, pour décrire le nationalisme ukrainien comme une résurgence de l’hitlérisme. Mais on voit bien qu’en réalité c’est le régime russe actuel qui développe des caractéristiques totalitaires, allant de la répression violente des opposants par une police politique et de la suppression de la liberté d’expression à la construction idéologique d’un néo-impérialisme officiel, attribuant au « peuple russe », dépeint comme un véritable peuple de Maîtres, une valeur et une mission historique supérieures.
Deux axiomes politiques, me semble-t-il, en découlent. Le premier, c’est qu’il n’existe pas de formation nationale sans « nationalisme ». Rejeter totalement celui-ci en le considérant dans l’absolu comme une idéologie réactionnaire est dénué de sens, sauf si nous croyons devoir (et pouvoir) nous débarrasser de la forme nation elle-même (ce qui, bien entendu, a été la position d’une partie de la tradition socialiste et anarchiste). Mais le second, c’est que les fluctuations du nationalisme et les métamorphoses de la nation dans l’histoire sont corrélatives. L’histoire des nations (en grande partie déterminée par les guerres qu’elles ont menées ou dans lesquelles elles sont été prises : telles guerres, telles nations, ai-je proposé ailleurs[11]) engendre des changements spectaculaires dans la signification et la fonction du discours nationaliste qui peuvent aller jusqu’à de véritables retournements (pensons au nationalisme français dans les années 1940-1945, puis dans les guerres coloniales).
Mais celui-ci en retour est susceptible de pousser la nation ou la « défense nationale » dans les directions les plus opposées (même cas de figure à l’appui). Ce qui est politiquement décisif, ce sont donc les proportions, les « équilibres instables » qui s’instaurent entre des formes antithétiques du nationalisme, et sous le même nom. C’est pourquoi il n’est pas vraiment pertinent, à mon avis, de demander ce qu’est « en soi » le nationalisme ukrainien, car la question n’admet pas de réponse univoque. Il faut plutôt se demander : que devient-il au cours de la guerre et sous son influence ?
De nouveau j’éprouve ici la fragilité des hypothèses que je vais formuler. Je sais qu’elles pourraient se trouver réfutées du jour au lendemain, et pourtant je crois utile de les prendre en considération. La question névralgique, me semble-t-il, c’est celle du statut de la différence culturelle, et particulièrement du multilinguisme dans les institutions de l’État-nation. Le sens et les effets politiques du nationalisme ukrainien en dépendent et en dépendront. Faisant ici recours à des catégories devenues courantes en sociologie politique et proposant un scénario « optimiste » inspiré par la résistance ukrainienne elle-même et le genre de patriotisme qui s’y exprime, je dirai que l’identité de la nation ukrainienne se déplace idéalement de l’ethnos au demos, d’un « nationalisme ethnique » à un nationalisme « civique », ou mieux à une prévalence tendancielle du second sur le premier.
C’est la leçon de ce qui s’est passé lorsque, déjouant les plans de l’envahisseur, les deux « communautés linguistiques » coexistant en Ukraine et qui, ne l’oublions jamais, ne sont pas séparées l’une de l’autre, mais se recouvrent en grande partie généalogiquement, sociologiquement et géographiquement (de sorte que la majorité des citoyens sont en fait bilingues en fonction de toute sorte de variables), se sont unies dans la même résistance patriotique et identiquement reconnues dans l’objectif d’un État-nation indépendant ukrainien. [12] Beaucoup de forces sans doute tirent en sens contraire, mais elles ne sont pas majoritaires : ce fait est décisif.
Effectuons ici un rapide détour pour comparer les idéologies « nationalistes » en présence. Du côté russe, néo-impérial, c’est la possibilité même d’un État-nation séparé qui est récusée d’avance. Il y a des contradictions internes, sans doute, entre plusieurs discours. Une variante est centrée sur l’idée du « monde russe » (Russkyi Mir), entité substantielle unique à laquelle sont censés appartenir indissolublement les trois « peuples frères » grand-russe, russe-blanc et petit-russe (Ukrainien) sous l’autorité éminente de l’un d’entre eux. Cette généalogie se caractérise par l’étroite combinaison du religieux et du linguistique, et le sens en est donné symboliquement par le « transfert » du siège métropolitain de Kiev à Moscou au 15ème siècle. Une autre variante, beaucoup plus semblable au discours des colonialismes occidentaux, présente l’Ukrainien comme un « dialecte » provincial, et ceux qui le parlent comme les représentants d’une race inférieure (de moujiks), à laquelle seule son incorporation à l’Empire (grand) russe aurait enfin permis d’ « entrer dans l’histoire ».
Mais ces contradictions n’empêchent en rien les porte-paroles de ces idéologies respectives (comme le patriarche de Moscou, Cyrille, ou le théoricien « eurasiatique » Alexandre Douguine, l’un et l’autre proches de Poutine) de se retrouver au service du même impérialisme et de la même dénégation du droit à l’existence des Ukrainiens. Et l’on comprend, par contrecoup, comment le nationalisme ukrainien a construit son propre discours, en affirmant la continuité du peuple-nation en Ukraine à travers les siècles, et en identifiant son existence avec sa résistance permanente à l’entreprise d’élimination conduite par les Empires qui l’ont dominé. Ce récit projette une continuité mythique entre des formations sociales complètement hétérogènes (le royaume de Kiev ou la Rus’ du haut Moyen Âge et la constitution contemporaine de la nation ukrainienne), séparées l’une de l’autre par de longues périodes d’aliénation et d’acculturation (malgré les événements symboliques qui attesteraient d’un même « projet » de refondation et de retour aux origines, par exemple la principauté ou « hetmanat » des Cosaques au 17ème siècle, ou la « Rada centrale » contemporaine de la révolution russe et partie prenante de ses luttes internes entre 1917 et 1920).
Évidemment l’idée de la continuité souterraine fondée sur la langue, conformément aux théories romantiques de la constitution des peuples, va de pair avec celle d’une identité collective que le pouvoir impérial (essentiellement celui de l’Empire russe car l’Autriche « multiculturelle » avait d’autres priorités) aurait en vain cherché à éradiquer, dans ce qu’on appellerait aujourd’hui un ethnocide. Qu’on m’entende bien cependant : ce récit historiquement problématique est l’analogue d’un très grand nombre d’autres mythes nationaux d’origine et de descendance qu’on peut trouver dans le monde, avec ses spécificités et ses fonctions institutionnelles. Je ne cherche pas à lui en opposer un autre terme à terme, mais – avec ce que je crois savoir – je veux indiquer pourquoi l’héritage du passé en Ukraine est probablement un peu plus complexe.
Comme l’indique déjà son nom (qui signifie « marche », et donc « région frontalière » en slave, et qui a commencé à être revendiqué au 19ème siècle avant d’être officialisé par l’URSS), l’Ukraine est un Borderland ou un « pays-frontière » dont les limites ont toujours été flottantes au nord, au sud, à l’est et à l’ouest, et dont la culture populaire est marquée au cours des siècles du sceau de la multiplicité et de l’hybridité. Les conflits de classe autant que de pouvoir et de forme étatique qui s’y sont déroulés ne cessent de configurer les « appartenances », cependant que le pays a été partagé et repartagé entre les empires (ou les royaumes, comme le grand État polono-lituanien de la Renaissance), dont chacun avait sa propre classe privilégiée, sa propre façon de construire l’hégémonie.
L’histoire de l’Ukraine, de ce fait, c’est donc celle des changements d’identité, mais aussi celle des révolutions démographiques qui passent par des colonisations, des déportations, des migrations de peuplement.
C’est aussi l’histoire des génocides qui laissent une trace indélébile : le Holodomor ou l’extermination des paysans par la famine qu’organisèrent les Bolcheviks au moment de la collectivisation, et la Shoah ou extermination des Juifs par les massacres et les camps de la mort, perpétrée par les Nazis avec l’aide de supplétifs ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui « survit » à cette histoire dans les strates de mémoire de la nation d’aujourd’hui, ce n’est pas tant une identité unique (même si elle fait l’objet d’une promotion officielle) que le bilinguisme et le biculturalisme de la majorité de la population, probablement renforcé par les effets à long terme de la scolarisation soviétique, dans laquelle se sont formées les générations majoritaires de la classe moyenne et de la classe ouvrière.
•
Telles sont quelques-unes des raisons qui peuvent donner à penser que le facteur principal dans la constitution du patriotisme tel qu’il s’illustre dans la guerre actuelle n’est pas à rechercher dans le récit ethnique (du moins pas dans ce récit seul) mais plutôt dans l’invention démocratique (comme aurait dit Claude Lefort) qu’incarne la révolution de l’Euromaïdan en 2013 et 2014 : c’est elle qui engendre et sous-tend une notion de citoyenneté comme participation à la chose publique, distincte de l’appartenance à la communauté ethnique, ou susceptible d’en opérer le dépassement.
•
Il se peut que cette invention ne soit pas pure, qu’elle soit traversée de conflits sectaires, qu’elle fasse l’objet de manipulations de la part des « oligarques » et de politiciens corrompus (alors même qu’elle a été principalement dirigée contre leur influence), et qu’elle se soit achevée par des affrontements entre des milices « nationalistes » (au sens étroit, exclusif) : ce qui est pourtant incontestable, c’est qu’il s’agissait d’une insurrection populaire et démocratique de masse, d’autant plus significative si on la compare aux évolutions vers des idéologies autoritaires et des régimes « post-démocratiques » qui se produisent dans toute la région (y compris au sein de l’Union européenne).[13]
Telle est manifestement l’une des raisons qui ont poussé la dictature mise en place en Russie sous l’autorité et au bénéfice de Vladimir Poutine à en vouloir la disparition immédiate, et à chercher à l’obtenir au prix d’une guerre : car cette invention fondée sur une révolte contre la corruption et attirée par la forme démocratique des systèmes politiques libéraux de l’Occident (qui garantissent le pluralisme politique, même s’ils comportent leur propre dimension « oligarchique »), voire par des formes plus radicales de « démocratie d’assemblée », risquait d’apparaître aux citoyens de la Fédération de Russie comme le modèle à suivre pour faire face aux même maux que leurs voisins et leurs « frères ».
Il faut ici le redire : des forces poussent en direction diamétralement opposée, et j’en suis tout-à-fait conscient. La plus puissante et la plus dangereuse est la guerre elle-même, car elle ne peut pas ne pas semer dans la population ukrainienne brutalisée les germes d’une russophobie tenace qui ne visera pas seulement la Russie comme État ou son régime, mais atteindra son peuple et sa culture, voire sa langue telle qu’ont l’habitude de l’utiliser de nombreux citoyens ukrainiens eux-mêmes (et qui donc est aussi « la leur »). Comment évoluera cette antithèse chargée de potentialités contradictoires ? C’est la grande inconnue à laquelle est suspendue, dans la guerre et par-delà la guerre, le destin de la formation nationale qu’elle traverse.
Espaces géopolitiques
J’en reviens alors à l’idée des multiples « guerres » qui se superposent à la guerre russo-ukrainienne et de leurs espaces politiques, chacun avec ses « frontières » propres. Ce qui frappe d’emblée, c’est le paradoxe inhérent à la situation contemporaine et de plus en plus accentué par la guerre elle-même : des nations en lutte pour leur indépendance, surtout si elles ont affaire à un empire ou à un système politique cherchant à ressusciter la forme d’un ancien empire, ont pour objectif principal la reconnaissance et le respect de leur souveraineté. D’où l’insistance sur l’intégrité territoriale, la liberté de choix diplomatique, etc. Mais toute souveraineté en réalité est limitée, même pour des nations puissantes et a fortiori pour de « petites » nations, parce que dans le monde actuel elle repose sur l’existence de « garanties » et donc d’alliances, qui sont corrélatives de contraintes. Les choses n’ont cessé d’évoluer, évidemment, à cet égard, en Europe comme ailleurs.
À l’époque de la guerre froide, dont on comprend maintenant qu’elle opposait deux systèmes « impérialistes » de nature différente, l’autonomie des nations « souveraines » au sein de chaque camp est devenue de plus en plus formelle, en dehors des puissances hégémoniques, bien que suivant des modalités diplomatiques, militaires, économiques très hétérogènes (l’Union européenne dans ses formats successifs a joué un rôle ambigu d’assujettissement de ses membres aux objectifs du « camp occidental » en même temps que de renforcement des capacités de négociation du bloc européen, cependant que l’OTAN servait à le domestiquer autant qu’à équilibrer la puissance du camp socialiste adverse, où ne régnait que la « souveraineté limitée » – à l’exception notable et décisive à long terme de la dissidence chinoise). Cette situation a-t-elle aujourd’hui disparu ? La guerre montre, me semble-t-il, que ce n’est pas totalement le cas, même si les rapports de forces et les modalités institutionnelles ont profondément évolué.
Il s’agit plutôt d’une reconduction du mécanisme de contrainte dans de nouvelles conditions géopolitiques. Il apparaît très clairement que l’Ukraine n’a de chances de se défendre et de se construire comme un État-nation stable, assuré de son avenir, que si elle est incorporée à un double système supranational. D’une part il faut qu’elle soit intégrée à l’alliance militaire occidentale, c’est-à-dire à l’OTAN, une structure qui n’est pas impériale mais « impérialiste », au service des intérêts des États-Unis (en tout cas placé sous la condition de ne pas les contredire). D’autre part elle consolidera ses institutions et les développera dans le sens d’un libéralisme démocratique si elle devient au plus vite un État-membre de l’Union Européenne, donc d’une structure « quasi-fédérale ».[14]
Ces deux processus font de la dépendance le contenu réel de la souveraineté (d’où le paradoxe, et à l’occasion la gêne) : ils sont étroitement articulés et pourraient sembler matériellement indiscernables l’un de l’autre, dans la situation actuelle qui, malgré quelques proclamations d’indépendance, pousse à une plus grande intégration militaire des États-membres de l’UE, inévitablement chapeautée par l’OTAN et dépendante stratégiquement et technologiquement des États-Unis. Et surtout, alors que dans un passé récent les évolutions du politique et du militaire semblaient se dissocier progressivement l’une de l’autre, ce qui conférait une autonomie relative au politique et ouvrait la possibilité d’évolutions démocratiques plus radicales, les deux instances se présentent de nouveau comme l’endroit et l’envers d’un même processus. Les conséquences n’en sont pas heureuses, c’est le moins qu’on puisse dire : retour à une logique de « camps » sur la scène internationale et remise à un avenir indéterminé d’en finir avec ce que j’ai appelé la « guerre civile européenne », verticalisation de l’autorité politique au sein de la fédération, et distorsion des économies dans le sens de la production d’armements.
•
Est-ce que toutes ces considérations viennent à l’appui de la propagande russe, pour qui la guerre (bien que jamais dénommée ainsi) serait la réponse à une menace, voire une agression de l’OTAN, engagée dans une politique de refoulement (« push back ») de son ancien adversaire communiste ? Tel est en effet le plan qu’avaient dessiné les idéologues néo-conservateurs américains (comme Zbigniew Brzeziński) et qui s’est matérialisé dans la mesure où le permettaient les reculs de la puissance américaine, notamment au travers de l’incorporation dans l’OTAN des pays du « voisinage proche » de la Russie ou de son soutien aux révolutions « de couleur », et même de l’installation de bases en Asie liées à l’intervention en Afghanistan. Mais même s’il est vrai que l’OTAN a développé une politique d’ « encerclement » de l’espace eurasiatique traditionnellement considéré par la Russie comme sa sphère d’influence géopolitique (un Grossraum au sens de Schmitt), il reste – et c’est le point décisif – que l’OTAN n’a pas attaqué militairement la Russie.
Nous pouvons penser (et je le pense personnellement) que la politique de l’OTAN a contribué à créer dans toute la région les conditions de la guerre, mais à aucun moment, nous ne pouvons faire comme si ce n’étaient pas les armées russes qui ont envahi le territoire ukrainien et sont en train de le détruire faute d’arriver à le contrôler. J’ajoute que, même s’il s’avérait nécessaire pour obtenir un cessez-le-feu dans l’intérêt des populations de négocier avec le régime de Poutine ou de chercher des « médiations », aucune concession à ses exigences ne nous fera sortir (et ne fera sortir les Ukrainiens) du « paradoxe de la souveraineté limitée » que j’évoquais à l’instant, c’est-à-dire du fait que la seule forme aujourd’hui concevable de l’indépendance réside dans l’assujettissement à un ensemble plus vaste que la nation.
Or ces ensembles sont aujourd’hui commandés par des machines de guerre antagoniques. Mais du point de vue de la politique démocratique il y a une dissymétrie manifeste entre les deux perspectives : celle d’être absorbé à nouveau, de façon violente et revancharde, dans un empire autocratique et passéiste, et celle d’adhérer à une fédération qui perpétue, certes, toutes sortes d’inégalités nationales, sociales et culturelles, mais comporte des règles de participation et de sortie négociables. On voit se profiler ici la nécessité d’un grand débat sur les formes contemporaines de l’impérialisme, une notion qui n’a rien perdu de son actualité mais dont le contenu ne peut rester figé aux géographies et aux rapports de forces du 20ème siècle, et dont un des aspects concerne précisément les modalités de la « dépendance » politique, militaire, économique des nations.[15]
Au-delà de cette question, essayant d’imaginer l’avenir, il faudrait évaluer les chances qui restent pour l’Ukraine et pour l’Europe elle-même d’une intégration politique et d’un élargissement de son territoire qui ne coïncide pas purement et simplement avec l’inscription dans un système de camps et ne soit pas synonyme de militarisation de la vie sociale. Tout dépendra évidemment de la durée de la guerre et de la façon dont elle se « terminera », ainsi que de l’attitude des opinions publiques (y compris celle du peuple russe) à l’égard des solutions qui s’imposeront par la force ou par la négociation.
Mais peut-être le plus important en matière de géopolitique et de « cosmopolitique » n’a-t-il pas encore été dit ? Faut-il tenir pour allant de soi que le niveau des conflits entre alliances militaires et la cartographie évolutive des impérialismes mondiaux (où la Chine apparaîtra sans doute, au bout du compte, comme l’arbitre de la situation) constituent la dernière instance de notre réflexion ? En esquissant le concept d’une « guerre hybride » qui ne serait pas tant une guerre mondiale qu’une guerre mondialisée, j’ai voulu indiquer une autre possibilité. Les guerres ont toujours pour lieu et pour enjeu le tracé de fronts et de frontières, mais il en existe de plusieurs sortes.
Un premier niveau est constitué par le réseau des frontières nationales (doublé de leurs « frontières intérieures » qui fixent des règles d’inclusion et d’exclusion dans la communauté des citoyens et déterminent les sentiments d’appartenance) : ce sont les États qui, normalement, sont chargés de les mettre en vigueur, avec ou sans l’assentiment des peuples. Mais à un autre niveau la population se distribue entre des « régions » planétaires, séparées par des lignes ou des zones de transition qui résultent de phénomènes historiques de longue durée comme la conversion religieuse, les migrations, la colonisation et la décolonisation, le développement inégal et l’hégémonie de formes de capitalisme complémentaires, avec les « visions du monde » qui leur correspondent. Je pense ici en particulier à la grande division du « Nord » et du « Sud global », qui ne se reflète pas identiquement dans toutes les régions du monde actuel, mais n’en laisse aucune à l’écart.
On voit bien que cette division est déterminante dans la façon dont la guerre européenne est perçue par les citoyens d’autres régions de la planète, en particulier ceux du Sud global qui ont tendance à y voir un conflit entre « impérialismes du Nord », ou même une « guerre par procuration » (proxy war) que l’impérialisme le plus puissant (à supposer qu’il le soit toujours), à savoir les États-Unis, conduirait contre ses adversaires.[16] Mais je veux surtout suggérer que cette division, si réelle et si déterminante qu’elle soit politiquement, est de plus en plus exposée aux effets d’un autre phénomène « planétaire » qui est en train à la fois de la souligner et de la déplacer : le réchauffement climatique, avec le « grand dérangement » qu’il entraîne dans les équilibres environnementaux.[17] Toutes les frontières du monde en sont affectées et remises en question, en tant qu’elles séparent des zones (plus ou moins) habitables et d’autres devenant inhabitables, ou qu’elles déplacent le « front » des territoires ouverts à l’extraction de matières premières, au prix de catastrophiques atteintes à la stabilité des milieux naturels.
Ce processus est en cours, il semble inexorable, mais on n’avait pas anticipé le « supplément » que lui apporte aujourd’hui la guerre, en augmentant la probabilité de pénuries et même de famines dans diverses régions du monde (pour la plupart localisées dans les pays du Sud qui manquent à la fois de ressources agricoles et de réserves financières pour acheter sur le marché mondial ce qu’ils ne produisent plus eux-mêmes en raison de la destruction des économies traditionnelles). Sans oublier les effets directement climaticides de la production accrue et de l’usage des armements. Or la Russie est au cœur de ces processus. Bruno Latour, dans plusieurs interventions récentes, a proposé de juxtaposer dans le tableau de l’actualité deux guerres qui y seraient menées simultanément : celle qui est faite à la liberté du peuple ukrainien au nom du « monde russe », et celle qui est faite à la Terre au nom de la « modernité » postindustrielle.[18] Ne faudrait-il pas convenir qu’en réalité ces deux guerres n’en font plus qu’une si nous nous élevons à la considération de la scène planétaire et des phénomènes de violence « hybride » qui s’y superposent ? L’avenir immédiat n’offre pas, il faut le dire, de perspectives bien encourageantes pour sortir de cette « guerre généralisée ».
Je me garderai donc de conclure. Mais j’essayerai de prendre parti, avec et contre mon propre « camp ». Je suis très attaché à la position pacifiste de principe qui fait partie de la tradition de la gauche mondiale, et corrélativement à l’internationalisme hérité du communisme révolutionnaire et renouvelé par l’anti-impérialisme du 20ème siècle. Mais le pacifisme se trouve aujourd’hui pris entre des exigences contradictoires, tout particulièrement sur le continent européen, comme ce fut déjà le cas à l’occasion d’autres conflits où les droits humains fondamentaux étaient en cause. Et l’internationalisme, plus nécessaire que jamais dans sa « méthodologie » politique, apparait tragiquement désarmé lorsque la logique de guerre ne s’accompagne pas d’une mobilisation transnationale au moins virtuelle, ayant son propre « mythe » ou sa propre « utopie » comme ciment. La cage d’acier s’est refermée. Je ne vois d’autre perspective immédiate qu’une « unité de contraires », en espérant qu’elle se développe dialectiquement.
Il faut soutenir effectivement, efficacement, un peuple envahi, torturé, massacré, dont les maisons, les infrastructures économiques et les lieux de culture sont journellement écrasés sous les bombes. Il a le droit de se défendre par tous les moyens à sa disposition et de vaincre son envahisseur. Ceci désigne un ennemi qui est aussi le nôtre, mais qui n’est pas un étranger au sens exclusif du terme. Nous ne devons donc rien céder à l’idée que le régime dictatorial du président Poutine est l’émanation d’une « essence impériale » du peuple russe, pas plus que le Nazisme n’incarnait l’essence de l’Allemagne, ou Bush et Trump n’expriment celle de l’Amérique.
Il faut donc combattre la russophobie imbécile et chercher toutes les possibilités de solidarité active avec les dissidents russes, qui combattent le régime et s’opposent à la guerre de l’intérieur au péril de leur liberté. Car ils portent l’espoir. Enfin et surtout il faut relancer de toute urgence les campagnes pour le désarmement nucléaire et contre la militarisation de nos sociétés, pour la construction d’un ordre international fondé sur l’indépendance des nations en même temps que l’interdépendance des peuples, sur la sécurité collective au lieu de l’équilibre de la terreur, de l’intervention militaire au-delà des frontières et des sanctions qui frappent les populations civiles autant et plus que les États agresseurs et les classes dominantes, pour la priorité donnée aux intérêts qui réunissent l’espèce humaine toute entière et posent des questions de vie et de mort, non seulement à long terme, mais de façon urgente et immédiate.
Étienne Balibar
PHILOSOPHE
Entre impérialisme et dénégation du droit à l’existence des Ukrainiens, l’invasion russe du 24 février a marqué le début d’une guerre « totale » s’accompagnant de violations massives des droits de l’homme, et un nouvel épisode de la guerre civile européenne. Face à cette « guerre hybride », mondialisée sans être mondiale, la priorité immédiate est de soutenir le combat du peuple ukrainien qui exprime son exigence d’indépendance nationale.
favoris
agrandir
partager
twitter
faceboook
linkedin
copier le lien
mail
Nous voici au 5ème mois de la guerre déclenchée par l’invasion russe. Dans ce texte[1], j’essayerai de mettre en ordre quelques-unes des réflexions que m’inspirent la situation en Ukraine et ses prolongements planétaires. Je formulerai des hypothèses et poserai des questions, mais je n’ai pas de certitude absolue quant à la réponse qu’il faut leur apporter. Sur plusieurs points je me demande même si ces réponses existent – sauf à vouloir projeter sur la réalité qui nous assiège des catégories idéologiques toutes faites. Mais ce n’est pas une raison, bien au contraire, pour ne pas tenter d’articuler ce que nous savions déjà et ce que nous apprenons au jour le jour, de façon à éclairer les enjeux et les éventualités d’un conflit qui nous concerne tous directement. Devant la guerre d’Ukraine en effet, devant la bataille qui fait rage autour des villes du Donbass, devant les menaces qui s’accumulent aux alentours, nous ne pouvons pas nous comporter comme de simples « observateurs engagés » qu’affectent plus ou moins les événements.
publicité
C’est notre avenir, c’est notre « monde commun » qui sont en jeu, et dont la physionomie va dépendre aussi de nos interprétations et de nos choix. En ce sens, toutes proportions gardées car – ne l’oublions jamais – nous ne sommes pas les combattants ou les victimes directes du conflit, je dirai pourtant que nous sommes dans la guerre, car elle a lieu « chez nous » et « pour nous ». Nous n’avons pas le choix, hélas, comme le propose dans une belle leçon de pacifisme révolutionnaire mon ami le philosophe Sandro Mezzadra, de « déserter la guerre ».[2] Je n’en conclus pas pour autant que nous devions nous laisser « mobiliser » et emporter par elle d’une façon irréfléchie. La marge laissée au choix est très faible, mais faut-il décider d’avance qu’elle est inexistante ?
De quelle guerre, cependant, sommes-nous ici en train de parler ? Sur ce point déjà l’incertitude règne. Car au-delà du fait que le territoire ukrainien (en partie occupé ou annexé depuis 2014) a été pris d’assaut au matin du 24 février dernier sur l’injonction de Vladimir Poutine, et que l’armée russe y perpétue jour après jour des exactions qui ont entraîné de gigantesques déplacements de populations, mais aussi des actions de résistance exceptionnellement courageuses et intelligentes du peuple ukrainien, il faudrait une vue plus complète des ramifications et des contrecoups de la guerre dans une série d’autres lieux, peut-être dans le monde entier.
D’une perception complète des espaces qui forment le « théâtre » de la guerre, et de la façon dont ils se modifient à mesure qu’elle dure et change de rythme, dépendent en effet non seulement le jugement que nous porterons sur son « caractère » historique, mais l’idée que nous nous ferons de la politique qu’elle appelle ou qu’inversement elle interdit. On ne se lasse pas de répéter la « formule » du Vom Krieg de Clausewitz : « la guerre est la simple continuation de la politique par d’autres moyens ».[3] Ne serait-il pas tout aussi pertinent de nous demander, ici et maintenant, quelle politique « continue la guerre », ou surgira dans son après-coup (s’il doit y en avoir un), en tant qu’institution et en tant que praxis, sur la base des conditions qu’elle aura créées et des problèmes qu’elle aura révélés ?
Ces questions pour l’instant sans réponses, je voudrais commencer à les instruire en choisissant trois points d’entrée : de quoi cette guerre « est-elle le nom », ou comment la définissons-nous pour pouvoir la nommer ? que nous dit-elle des fonctions du nationalisme, de ses fluctuations, de son rapport à la « forme nation » elle-même ? quels sont les espaces politiques dont elle recoupe et, le cas échéant, déplace les frontières ?
Noms et définitions
Pour saisir le caractère de la guerre en cours, je pense qu’il faut appliquer plusieurs grilles, opérant à différents niveaux et faisant ressortir différentes modalités du conflit. La guerre se développe sur de multiples « théâtres » avec des intensités et des rythmes différents. Il est crucial de bien décrire cette surdétermination intrinsèque, dont vont dépendre son évolution et ses conséquences, même si nos incertitudes en sont d’abord accrues.
Cela n’empêchera pas qu’il nous faille décider quel en est l’aspect principal, d’une décision fondée sur l’analyse aussi rationnelle que possible des multiples dimensions de la guerre, mais qui n’en sera jamais simplement déductible et restera par conséquent subjective. Cette décision « commande » notre jugement politique sur les enjeux de la guerre et nos tentatives d’intervention depuis le lieu où nous sommes situés par l’histoire et par la géographie, c’est-à-dire en Europe et comme « citoyens d’Europe » (dont font partie beaucoup d’étrangers venus du monde entier, car l’Europe est de facto une entité cosmopolitique).
Je proposerai de considérer au moins quatre niveaux superposés, mais cette énumération appelle quelques préliminaires sur lesquels je passe aussi vite que possible. D’abord le caractère d’une guerre dépend certes des objectifs que poursuivent les belligérants, mais il ne peut se définir simplement à partir de leurs intentions ou de leurs déclarations : il faut les rapporter à la constitution des institutions et des forces (en général des nations) qui leur confèrent une effectivité, ce qui dépend toujours de conditions historiques déterminées. C’est pourquoi il y a, sans doute, de grands types de guerres, au-delà même des distinctions juridiques (guerres civiles ou étrangères, compatibles ou non avec le droit international…) et des catégories polémologiques (guerres de conquête ou de défense – voire de défense « préventive », de « haute » ou de « basse intensité », symétriques ou asymétriques…), que nous cherchons à identifier en ayant recours aux comparaisons.
Plusieurs seraient ici pertinentes, dont certaines ont été régulièrement invoquées depuis le début de la Guerre d’Ukraine, et d’autres soigneusement évitées : guerres d’Algérie et du Vietnam, occupation de la Palestine, guerres de Yougoslavie, guerre de Tchétchénie, invasion de l’Irak par les États-Unis… Mais en dernière analyse toute nouvelle guerre est une guerre nouvelle, et les comparaisons, bien qu’elles puissent servir à éviter les évaluations biaisées, fournissent avant tout des contre-exemples. Enfin toute guerre qui dure et engendre ce que Clausewitz appelait des effets de « friction » connaît plusieurs phases de mouvement ou de position, souvent associées à des tracés de fronts et de frontières, qui font évoluer son caractère et dans lesquelles changent les rapports de forces.
En l’occurrence, après la phase d’invasion proprement dite, dans laquelle l’armée et les unités territoriales ukrainiennes ont réussi à repousser les chars russes et à reprendre l’initiative, la guerre s’est figée dans une confrontation incertaine et dévastatrice, dévoreuse d’hommes et de munitions, concentrée dans les régions orientale et méridionale du pays que la Russie cherche à annexer. On retourne ainsi, en apparence, mais avec plus d’intensité, à ce qui avait été son théâtre initial, ce qui veut dire aussi que son vrai commencement date de 2014 et que nous n’en sommes pas au centième jour mais à la huitième année déjà… Cependant ce n’est qu’avec les développements actuels que toutes les implications du conflit commencent à se faire voir.
Tentons alors une première définition. La guerre des Ukrainiens est proprement ce qu’il faut appeler une guerre d’indépendance nationale, ce qui en ukrainien se dit maïdan et appelle la comparaison avec d’autres moments historiques où la constitution d’une nation souveraine se « libérant » de la sujétion d’un empire, est passée par la confrontation armée avec celui-ci : la sécession d’une partie de l’Irlande anglaise au début du siècle dernier, les guerres de libération nationale des colonies (ou semi-colonies) européennes en Afrique et en Asie, mais aussi, plus lointainement bien que symboliquement significatives, les « insurrections » qui donnèrent naissance aux nations modernes détachées des empires anglais, espagnol ou ottoman… Et sans doute ici on observera que l’Ukraine (qui avait joui au sein de l’URSS d’un statut de « république fédérative » et, à ce titre, disposé d’un siège aux Nations unies) était déjà devenue un État souverain, internationalement reconnu, à la suite de la dissolution de l’URSS en 1991.
Ce point est fondamental parce qu’il fait de l’invasion russe une transgression ouverte du droit international, ce qui qualifie l’un des belligérants comme agresseur et l’autre comme agressé, fondé pour se défendre à faire appel à l’aide étrangère. Mais sur le plan politique, tel que le traduisent les discours de Poutine et l’ensemble de la propagande justifiant l’occupation et la « russification » des territoires conquis, on voit que la puissance impériale – continuée sur ce point par le régime communiste en dépit des principes démocratiques et fédératifs proclamés par la révolution d’Octobre 1917 – n’avait jamais considéré comme légitime l’indépendance des territoires ayant appartenu à l’Empire. Elle prétend exercer quelque chose comme un droit de « retour ».[4] C’est pourquoi on peut dire à bon droit que les Ukrainiens sont engagés dans une guerre d’indépendance qui avait été seulement différée. S’ils remportent la victoire, la souveraineté et l’existence même de leur nation deviendront un fait accompli et ne seront plus contestables. Évidemment, elles auront coûté très cher en termes de destructions et de souffrances.
Nous ne pouvons, cependant, en rester là. La référence à la continuité impériale dans l’espace qui va de l’Océan Pacifique jusqu’à la frontière polonaise (et parfois au-delà), mais surtout la référence à la façon dont la révolution russe a remis en question cette forme impériale pour finalement la restaurer et la « moderniser », imposent de considérer les choses sous un autre angle et sur une autre scène.[5] La comparaison qui s’impose ici, trop souvent censurée dans les commentaires, est avec les guerres de Yougoslavie des années 1990, même si l’ampleur des destructions et la masse des troupes et des équipements engagés est disproportionnée (mais la nature des crimes de guerre en train d’être commis est, elle, du même ordre).[6]
De ce point de vue, ce que nous avons caractérisé comme une guerre d’indépendance doit aussi nous apparaître comme l’exemple d’une guerre post-socialiste, ayant sa source dans l’effondrement des régimes communistes en Europe, et plus profondément dans l’incapacité de ces régimes à trouver une solution pour la « question des nationalités » héritée des empires : ce qui a entraîné à terme une intensification des nationalismes et de leur hostilité mutuelle, encore aggravée par le désastre social des politiques de « libéralisation à outrance » qui leur ont été appliquées après 1989 par le néolibéralisme triomphant.
Mais la profondeur historique dont nous avons besoin est plus grande encore, car l’histoire du communisme européen fait intégralement partie d’un cycle plus vaste et plus complexe : celui de la « guerre civile européenne » qui commence en 1914, enchaîne la guerre impérialiste et la révolution, puis débouche sur le triomphe du nazisme dans l’Allemagne vaincue, entouré d’une constellation de régimes et de mouvements fascistes d’un bout à l’autre de l’Europe, d’où la Seconde Guerre mondiale, suivie de la guerre froide entre les deux « camps » et de la division du continent, à laquelle mettront fin les révolutions démocratiques de 1989 et la chute du rideau de fer (si toutefois il s’agit vraiment d’une « fin »).
Envisagée dans ce cadre – celui d’une histoire continentale tragique, faite de révolutions et de contre-révolutions, de nations anéanties ou restaurées (comme la Pologne), scindées ou réunifiées (comme l’Allemagne), de destructions et de reconstructions, de massacres et de génocides, de déplacements de populations et de frontières, d’allers et retours entre le totalitarisme et la démocratie, dont les traces sont omniprésentes partout dans notre continent – la guerre actuelle n’est pas seulement une guerre européenne, comme je l’ai dit ailleurs avec d’autres, mais c’est un nouvel épisode de la guerre civile européenne[7].
Démontrant du même coup que celle-ci n’était pas achevée, ou que les problèmes dont elle surgissait et qu’elle avait reproduits n’étaient pas non plus résolus par l’ordre post-communiste ayant un moment fait croire à une « fin de l’histoire ». De ce fait même la répétition des destructions, des stratégies de la terreur, des exodes massifs, constituant à eux tous une manifestation de la guerre totale, devient moins énigmatique, sans se voir pour autant justifiée le moins du monde. Peut-être avions-nous, Européens, oublié l’histoire que, tous ensemble, nous « faisons » par nos guerres chaudes et froides entrecoupées de trêves et de refondations étatiques ou diplomatiques…
À nouveau, cependant, parvenus à ce point, nous devons changer de perspective et considérer de plus vastes espaces. Les guerres européennes au 20ème siècle ont été, de façon intrinsèque, des guerres mondiales, et inversement les guerres mondiales ont conféré à l’Europe une place non exclusive, mais toujours centrale comme théâtre des batailles, comme siège historique des « puissances » qui s’y affrontaient et des peuples qui en subissaient les plus lourds effets. La guerre actuelle en Ukraine – susceptible de déborder ce « théâtre » initial – intervient alors que l’Europe est irréversiblement provincialisée (ce qui ne veut pas dire, on le voit bien, qu’elle ait perdu toute fonction stratégique et géopolitique) : ce serait plutôt, me semble-t-il, une guerre mondialisée, ou « en cours de mondialisation ».[8]
Ceci n’a de sens cependant que si nous commençons à la penser comme une guerre « hybride », à la fois « chaude » et « froide », conduite sur le terrain de la technologie et de l’économie dont aucune politique ne peut plus se dissocier en même temps que sur celui des combats et des bombardements, et dans laquelle sont progressivement attirées, de façon essentiellement dissymétrique, plusieurs régions du monde avec leurs populations et leurs États. En effet les belligérants font partie d’alliances mondiales qui leur fournissent un appui direct ou indirect et dont certaines peuvent être dites mener « par procuration » (war by proxy). Étant donné la position de « réserve » adoptée par la Chine sur le plan militaire (ce qui s’explique par l’autosuffisance apparente des armements russes, mais aussi sans doute par le fait que, dans une perspective géopolitique, sa stratégie consiste à la fois à soutenir la Russie en face de « l’Occident » et à s’en dissocier pour faire avancer d’autres objectifs), cette dernière caractéristique vaut surtout, évidemment, pour le camp « occidental ».
Il est clair que sans un flot permanent, toujours grossissant, d’armements avec leurs instructeurs et de renseignements électroniques, l’armée ukrainienne malgré toute sa valeur et son esprit de sacrifice ne soutiendrait pas l’assaut de l’armée russe. Et surtout, n’en déplaise à la terminologie, la coalition occidentale venue au secours de l’Ukraine mène bel et bien une « guerre économique » pour essayer de faire plier la Russie. Il est hautement significatif de ce point de vue que, des deux côtés, le nom de « guerre » fasse l’objet d’une dénégation : les Russes parlent d’une « opération militaire spéciale » et les Occidentaux disent qu’ils appliquent des « sanctions ».
Par dessus tout il faut prendre la mesure des effets combinés qu’engendrent, à l’échelle mondiale, les destructions matérielles, le blocus interdisant l’exportation (et conduisant à la perte) de millions de tonnes de céréales, et la crise économique rampante induite par les sanctions portant sur l’énergie : le monde entre dans une spirale inflationniste lourde de conflits sociaux et voit se profiler des menaces de disette ou même de famine. Ce sont naturellement les pays du « Sud Global » qui sont ici menacés avant tout ou subissent déjà les contrecoups de la guerre totale et de la guerre hybride. En réalité, eux aussi sont maintenant « dans la guerre » avec nous, sans pour autant être officiellement « en guerre ».
Pour finir, je pense qu’il faut insérer dans nos définitions une caractéristique « virtuelle », nullement imaginaire pour autant, qui concerne l’intensité de la guerre plutôt que son extension. Il y a deux mois, dans un article venant à l’appui de son gouvernement qui a immédiatement fait polémique en Allemagne, Jürgen Habermas a soulevé la possibilité que l’escalade conduise au déclenchement d’une guerre nucléaire entre la Russie et l’OTAN (donc fondamentalement les États-Unis) dans laquelle toute l’Europe serait menacée d’anéantissement.[9] Beaucoup de commentateurs avaient déjà fait remarquer que le pouvoir russe brandit l’utilisation éventuelle d’armes nucléaires (en se servant aussi de l’occupation des centrales nucléaires) comme un instrument de chantage ou d’intimidation, et l’idée d’une « guerre coloniale sous parapluie nucléaire », ayant pour but de contraindre l’adversaire (c’est-à-dire l’OTAN, les États-Unis) à limiter le niveau et la portée de son intervention, avait été proposée par d’autres.
Mais ce que suggère Habermas, c’est une question plus générale : dès lors qu’on entre dans une guerre totale, qui porte en elle le risque d’une « montée aux extrêmes », l’évolution du rapport des forces et notamment l’incapacité de l’un des belligérants d’atteindre ses objectifs, considérés comme « vitaux », par des moyens conventionnels, ou la nécessité pour l’autre d’élever le niveau de son engagement à des armes de plus longue portée, peuvent conduire à l’utilisation des armements nucléaires (tactiques ou stratégiques) dont ils disposent.
Ainsi que l’avaient soutenu en leur temps (critiquant l’idée d’un « équilibre de la terreur » qui garantirait paradoxalement la paix par dissuasion mutuelle) des analystes de la nouvelle configuration des guerres comme Günther Anders ou Edward P. Thompson, c’est l’existence même des armes nucléaires qui entraîne la possibilité d’une catastrophe, ou d’un suicide collectif de l’humanité, devant lequel on ne peut garantir que les États auront « l’intelligence » (Clausewitz) de se retenir. Ce que Thompson avait appelé l’exterminisme à l’époque de la crise des « euromissiles » (au début des années 1980) ne peut être considéré comme « l’impensable ».[10] Et dès lors qu’il n’est pas impensable il faut le penser, ou faire entrer sa possibilité dans la définition de la guerre en cours.
Nous voilà donc ramenés à la nécessité d’une décision subjective, si possible éclairée, mais aussi par définition incertaine et risquée, quant à l’articulation et à la hiérarchie des dimensions de la guerre en cours, et au jugement que nous leur appliquons. Il me semble que la priorité immédiate est de soutenir le combat du peuple ukrainien, qui exprime son exigence d’indépendance nationale : non pas parce que celle-ci serait en soi une valeur absolue, mais parce que le droit à l’autodétermination des Ukrainiens est foulé aux pieds, et que la guerre « totale » qui leur est faite s’accompagne de violations massives des droits de l’homme dont la qualification juridique fait débat, mais ne peut être inférieure à celle de crimes de guerre. Leur défaite serait moralement inacceptable et désastreuse pour la légalité internationale (comme l’ont été d’autres auparavant, dont certaines récentes). Ce soutien est entier mais il n’est pas pour autant aveugle à ses conditions et à ses implications. Je passe donc aux deux autres points que j’ai annoncés.
Nations et nationalismes
« Nationalisme » : le mot fatal est de nouveau au centre de l’espace politique européen, avec son cortège de tueries, d’intolérance et d’exclusions. Force est de reconsidérer ce qui semble conférer à la « forme nation », parmi d’autres formations sociales, une singularité et un privilège : qu’est-ce qui la légitime ? dans quelle mesure et pourquoi serait-elle le cadre indépassable de la conscience collective et de l’action historique ? Il est clair que les Ukrainiens qui se battent pour leur indépendance et résistent héroïquement à des forces plusieurs fois supérieures sont animés d’un sentiment d’unité nationale et d’une volonté d’autonomie correspondante. En ce sens ils sont tous des nationalistes, il n’y a pas d’autre mot. Cela n’implique pas qu’ils le soient tous de la même façon ou pour les mêmes raisons. Surtout cela n’implique aucune équivalence avec le nationalisme officiel de l’État russe, bien qu’à un niveau très abstrait il s’agisse de deux espèces d’un même genre et qui se renforcent de leur antagonisme.
Non seulement parce qu’on ne peut assimiler des forces aussi inégales et des positions aussi dissymétriques par rapport au droit international (lequel fait de l’autodétermination des peuples une valeur inconditionnelle, sous condition cependant de reconnaissance par la communauté des autres nations, ce qui donne lieu à bien des fluctuations). Mais parce que la substance objective, éthique et politique, de ces nationalismes adverses n’est pas la même des deux côtés.
La propagande du régime russe exploite sans mesure les composantes « extrémistes » (voire fascisantes) de la vie politique ukrainienne au cours des dernières années (qui sont réelles, mais très minoritaires), ainsi que l’imaginaire de la Grande Guerre patriotique contre le nazisme tel que l’a « russifié » l’État déjà au temps du communisme, pour décrire le nationalisme ukrainien comme une résurgence de l’hitlérisme. Mais on voit bien qu’en réalité c’est le régime russe actuel qui développe des caractéristiques totalitaires, allant de la répression violente des opposants par une police politique et de la suppression de la liberté d’expression à la construction idéologique d’un néo-impérialisme officiel, attribuant au « peuple russe », dépeint comme un véritable peuple de Maîtres, une valeur et une mission historique supérieures.
Deux axiomes politiques, me semble-t-il, en découlent. Le premier, c’est qu’il n’existe pas de formation nationale sans « nationalisme ». Rejeter totalement celui-ci en le considérant dans l’absolu comme une idéologie réactionnaire est dénué de sens, sauf si nous croyons devoir (et pouvoir) nous débarrasser de la forme nation elle-même (ce qui, bien entendu, a été la position d’une partie de la tradition socialiste et anarchiste). Mais le second, c’est que les fluctuations du nationalisme et les métamorphoses de la nation dans l’histoire sont corrélatives. L’histoire des nations (en grande partie déterminée par les guerres qu’elles ont menées ou dans lesquelles elles sont été prises : telles guerres, telles nations, ai-je proposé ailleurs[11]) engendre des changements spectaculaires dans la signification et la fonction du discours nationaliste qui peuvent aller jusqu’à de véritables retournements (pensons au nationalisme français dans les années 1940-1945, puis dans les guerres coloniales).
Mais celui-ci en retour est susceptible de pousser la nation ou la « défense nationale » dans les directions les plus opposées (même cas de figure à l’appui). Ce qui est politiquement décisif, ce sont donc les proportions, les « équilibres instables » qui s’instaurent entre des formes antithétiques du nationalisme, et sous le même nom. C’est pourquoi il n’est pas vraiment pertinent, à mon avis, de demander ce qu’est « en soi » le nationalisme ukrainien, car la question n’admet pas de réponse univoque. Il faut plutôt se demander : que devient-il au cours de la guerre et sous son influence ?
De nouveau j’éprouve ici la fragilité des hypothèses que je vais formuler. Je sais qu’elles pourraient se trouver réfutées du jour au lendemain, et pourtant je crois utile de les prendre en considération. La question névralgique, me semble-t-il, c’est celle du statut de la différence culturelle, et particulièrement du multilinguisme dans les institutions de l’État-nation. Le sens et les effets politiques du nationalisme ukrainien en dépendent et en dépendront. Faisant ici recours à des catégories devenues courantes en sociologie politique et proposant un scénario « optimiste » inspiré par la résistance ukrainienne elle-même et le genre de patriotisme qui s’y exprime, je dirai que l’identité de la nation ukrainienne se déplace idéalement de l’ethnos au demos, d’un « nationalisme ethnique » à un nationalisme « civique », ou mieux à une prévalence tendancielle du second sur le premier.
C’est la leçon de ce qui s’est passé lorsque, déjouant les plans de l’envahisseur, les deux « communautés linguistiques » coexistant en Ukraine et qui, ne l’oublions jamais, ne sont pas séparées l’une de l’autre, mais se recouvrent en grande partie généalogiquement, sociologiquement et géographiquement (de sorte que la majorité des citoyens sont en fait bilingues en fonction de toute sorte de variables), se sont unies dans la même résistance patriotique et identiquement reconnues dans l’objectif d’un État-nation indépendant ukrainien. [12] Beaucoup de forces sans doute tirent en sens contraire, mais elles ne sont pas majoritaires : ce fait est décisif.
Effectuons ici un rapide détour pour comparer les idéologies « nationalistes » en présence. Du côté russe, néo-impérial, c’est la possibilité même d’un État-nation séparé qui est récusée d’avance. Il y a des contradictions internes, sans doute, entre plusieurs discours. Une variante est centrée sur l’idée du « monde russe » (Russkyi Mir), entité substantielle unique à laquelle sont censés appartenir indissolublement les trois « peuples frères » grand-russe, russe-blanc et petit-russe (Ukrainien) sous l’autorité éminente de l’un d’entre eux. Cette généalogie se caractérise par l’étroite combinaison du religieux et du linguistique, et le sens en est donné symboliquement par le « transfert » du siège métropolitain de Kiev à Moscou au 15ème siècle. Une autre variante, beaucoup plus semblable au discours des colonialismes occidentaux, présente l’Ukrainien comme un « dialecte » provincial, et ceux qui le parlent comme les représentants d’une race inférieure (de moujiks), à laquelle seule son incorporation à l’Empire (grand) russe aurait enfin permis d’ « entrer dans l’histoire ».
Mais ces contradictions n’empêchent en rien les porte-paroles de ces idéologies respectives (comme le patriarche de Moscou, Cyrille, ou le théoricien « eurasiatique » Alexandre Douguine, l’un et l’autre proches de Poutine) de se retrouver au service du même impérialisme et de la même dénégation du droit à l’existence des Ukrainiens. Et l’on comprend, par contrecoup, comment le nationalisme ukrainien a construit son propre discours, en affirmant la continuité du peuple-nation en Ukraine à travers les siècles, et en identifiant son existence avec sa résistance permanente à l’entreprise d’élimination conduite par les Empires qui l’ont dominé. Ce récit projette une continuité mythique entre des formations sociales complètement hétérogènes (le royaume de Kiev ou la Rus’ du haut Moyen Âge et la constitution contemporaine de la nation ukrainienne), séparées l’une de l’autre par de longues périodes d’aliénation et d’acculturation (malgré les événements symboliques qui attesteraient d’un même « projet » de refondation et de retour aux origines, par exemple la principauté ou « hetmanat » des Cosaques au 17ème siècle, ou la « Rada centrale » contemporaine de la révolution russe et partie prenante de ses luttes internes entre 1917 et 1920).
Évidemment l’idée de la continuité souterraine fondée sur la langue, conformément aux théories romantiques de la constitution des peuples, va de pair avec celle d’une identité collective que le pouvoir impérial (essentiellement celui de l’Empire russe car l’Autriche « multiculturelle » avait d’autres priorités) aurait en vain cherché à éradiquer, dans ce qu’on appellerait aujourd’hui un ethnocide. Qu’on m’entende bien cependant : ce récit historiquement problématique est l’analogue d’un très grand nombre d’autres mythes nationaux d’origine et de descendance qu’on peut trouver dans le monde, avec ses spécificités et ses fonctions institutionnelles. Je ne cherche pas à lui en opposer un autre terme à terme, mais – avec ce que je crois savoir – je veux indiquer pourquoi l’héritage du passé en Ukraine est probablement un peu plus complexe.
Comme l’indique déjà son nom (qui signifie « marche », et donc « région frontalière » en slave, et qui a commencé à être revendiqué au 19ème siècle avant d’être officialisé par l’URSS), l’Ukraine est un Borderland ou un « pays-frontière » dont les limites ont toujours été flottantes au nord, au sud, à l’est et à l’ouest, et dont la culture populaire est marquée au cours des siècles du sceau de la multiplicité et de l’hybridité. Les conflits de classe autant que de pouvoir et de forme étatique qui s’y sont déroulés ne cessent de configurer les « appartenances », cependant que le pays a été partagé et repartagé entre les empires (ou les royaumes, comme le grand État polono-lituanien de la Renaissance), dont chacun avait sa propre classe privilégiée, sa propre façon de construire l’hégémonie. L’histoire de l’Ukraine, de ce fait, c’est donc celle des changements d’identité, mais aussi celle des révolutions démographiques qui passent par des colonisations, des déportations, des migrations de peuplement.
C’est aussi l’histoire des génocides qui laissent une trace indélébile : le Holodomor ou l’extermination des paysans par la famine qu’organisèrent les Bolcheviks au moment de la collectivisation, et la Shoah ou extermination des Juifs par les massacres et les camps de la mort, perpétrée par les Nazis avec l’aide de supplétifs ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui « survit » à cette histoire dans les strates de mémoire de la nation d’aujourd’hui, ce n’est pas tant une identité unique (même si elle fait l’objet d’une promotion officielle) que le bilinguisme et le biculturalisme de la majorité de la population, probablement renforcé par les effets à long terme de la scolarisation soviétique, dans laquelle se sont formées les générations majoritaires de la classe moyenne et de la classe ouvrière.
Telles sont quelques-unes des raisons qui peuvent donner à penser que le facteur principal dans la constitution du patriotisme tel qu’il s’illustre dans la guerre actuelle n’est pas à rechercher dans le récit ethnique (du moins pas dans ce récit seul) mais plutôt dans l’invention démocratique (comme aurait dit Claude Lefort) qu’incarne la révolution de l’Euromaïdan en 2013 et 2014 : c’est elle qui engendre et sous-tend une notion de citoyenneté comme participation à la chose publique, distincte de l’appartenance à la communauté ethnique, ou susceptible d’en opérer le dépassement.
Il se peut que cette invention ne soit pas pure, qu’elle soit traversée de conflits sectaires, qu’elle fasse l’objet de manipulations de la part des « oligarques » et de politiciens corrompus (alors même qu’elle a été principalement dirigée contre leur influence), et qu’elle se soit achevée par des affrontements entre des milices « nationalistes » (au sens étroit, exclusif) : ce qui est pourtant incontestable, c’est qu’il s’agissait d’une insurrection populaire et démocratique de masse, d’autant plus significative si on la compare aux évolutions vers des idéologies autoritaires et des régimes « post-démocratiques » qui se produisent dans toute la région (y compris au sein de l’Union européenne).[13]
Telle est manifestement l’une des raisons qui ont poussé la dictature mise en place en Russie sous l’autorité et au bénéfice de Vladimir Poutine à en vouloir la disparition immédiate, et à chercher à l’obtenir au prix d’une guerre : car cette invention fondée sur une révolte contre la corruption et attirée par la forme démocratique des systèmes politiques libéraux de l’Occident (qui garantissent le pluralisme politique, même s’ils comportent leur propre dimension « oligarchique »), voire par des formes plus radicales de « démocratie d’assemblée », risquait d’apparaître aux citoyens de la Fédération de Russie comme le modèle à suivre pour faire face aux même maux que leurs voisins et leurs « frères ».
Il faut ici le redire : des forces poussent en direction diamétralement opposée, et j’en suis tout-à-fait conscient. La plus puissante et la plus dangereuse est la guerre elle-même, car elle ne peut pas ne pas semer dans la population ukrainienne brutalisée les germes d’une russophobie tenace qui ne visera pas seulement la Russie comme État ou son régime, mais atteindra son peuple et sa culture, voire sa langue telle qu’ont l’habitude de l’utiliser de nombreux citoyens ukrainiens eux-mêmes (et qui donc est aussi « la leur »). Comment évoluera cette antithèse chargée de potentialités contradictoires ? C’est la grande inconnue à laquelle est suspendue, dans la guerre et par-delà la guerre, le destin de la formation nationale qu’elle traverse.
Espaces géopolitiques
J’en reviens alors à l’idée des multiples « guerres » qui se superposent à la guerre russo-ukrainienne et de leurs espaces politiques, chacun avec ses « frontières » propres. Ce qui frappe d’emblée, c’est le paradoxe inhérent à la situation contemporaine et de plus en plus accentué par la guerre elle-même : des nations en lutte pour leur indépendance, surtout si elles ont affaire à un empire ou à un système politique cherchant à ressusciter la forme d’un ancien empire, ont pour objectif principal la reconnaissance et le respect de leur souveraineté. D’où l’insistance sur l’intégrité territoriale, la liberté de choix diplomatique, etc. Mais toute souveraineté en réalité est limitée, même pour des nations puissantes et a fortiori pour de « petites » nations, parce que dans le monde actuel elle repose sur l’existence de « garanties » et donc d’alliances, qui sont corrélatives de contraintes. Les choses n’ont cessé d’évoluer, évidemment, à cet égard, en Europe comme ailleurs.
À l’époque de la guerre froide, dont on comprend maintenant qu’elle opposait deux systèmes « impérialistes » de nature différente, l’autonomie des nations « souveraines » au sein de chaque camp est devenue de plus en plus formelle, en dehors des puissances hégémoniques, bien que suivant des modalités diplomatiques, militaires, économiques très hétérogènes (l’Union européenne dans ses formats successifs a joué un rôle ambigu d’assujettissement de ses membres aux objectifs du « camp occidental » en même temps que de renforcement des capacités de négociation du bloc européen, cependant que l’OTAN servait à le domestiquer autant qu’à équilibrer la puissance du camp socialiste adverse, où ne régnait que la « souveraineté limitée » – à l’exception notable et décisive à long terme de la dissidence chinoise). Cette situation a-t-elle aujourd’hui disparu ? La guerre montre, me semble-t-il, que ce n’est pas totalement le cas, même si les rapports de forces et les modalités institutionnelles ont profondément évolué.
Il s’agit plutôt d’une reconduction du mécanisme de contrainte dans de nouvelles conditions géopolitiques. Il apparaît très clairement que l’Ukraine n’a de chances de se défendre et de se construire comme un État-nation stable, assuré de son avenir, que si elle est incorporée à un double système supranational. D’une part il faut qu’elle soit intégrée à l’alliance militaire occidentale, c’est-à-dire à l’OTAN, une structure qui n’est pas impériale mais « impérialiste », au service des intérêts des États-Unis (en tout cas placé sous la condition de ne pas les contredire). D’autre part elle consolidera ses institutions et les développera dans le sens d’un libéralisme démocratique si elle devient au plus vite un État-membre de l’Union Européenne, donc d’une structure « quasi-fédérale ».[14]
Ces deux processus font de la dépendance le contenu réel de la souveraineté (d’où le paradoxe, et à l’occasion la gêne) : ils sont étroitement articulés et pourraient sembler matériellement indiscernables l’un de l’autre, dans la situation actuelle qui, malgré quelques proclamations d’indépendance, pousse à une plus grande intégration militaire des États-membres de l’UE, inévitablement chapeautée par l’OTAN et dépendante stratégiquement et technologiquement des États-Unis. Et surtout, alors que dans un passé récent les évolutions du politique et du militaire semblaient se dissocier progressivement l’une de l’autre, ce qui conférait une autonomie relative au politique et ouvrait la possibilité d’évolutions démocratiques plus radicales, les deux instances se présentent de nouveau comme l’endroit et l’envers d’un même processus. Les conséquences n’en sont pas heureuses, c’est le moins qu’on puisse dire : retour à une logique de « camps » sur la scène internationale et remise à un avenir indéterminé d’en finir avec ce que j’ai appelé la « guerre civile européenne », verticalisation de l’autorité politique au sein de la fédération, et distorsion des économies dans le sens de la production d’armements.
Est-ce que toutes ces considérations viennent à l’appui de la propagande russe, pour qui la guerre (bien que jamais dénommée ainsi) serait la réponse à une menace, voire une agression de l’OTAN, engagée dans une politique de refoulement (« push back ») de son ancien adversaire communiste ? Tel est en effet le plan qu’avaient dessiné les idéologues néo-conservateurs américains (comme Zbigniew Brzeziński) et qui s’est matérialisé dans la mesure où le permettaient les reculs de la puissance américaine, notamment au travers de l’incorporation dans l’OTAN des pays du « voisinage proche » de la Russie ou de son soutien aux révolutions « de couleur », et même de l’installation de bases en Asie liées à l’intervention en Afghanistan. Mais même s’il est vrai que l’OTAN a développé une politique d’ « encerclement » de l’espace eurasiatique traditionnellement considéré par la Russie comme sa sphère d’influence géopolitique (un Grossraum au sens de Schmitt), il reste – et c’est le point décisif – que l’OTAN n’a pas attaqué militairement la Russie.
Nous pouvons penser (et je le pense personnellement) que la politique de l’OTAN a contribué à créer dans toute la région les conditions de la guerre, mais à aucun moment, nous ne pouvons faire comme si ce n’étaient pas les armées russes qui ont envahi le territoire ukrainien et sont en train de le détruire faute d’arriver à le contrôler. J’ajoute que, même s’il s’avérait nécessaire pour obtenir un cessez-le-feu dans l’intérêt des populations de négocier avec le régime de Poutine ou de chercher des « médiations », aucune concession à ses exigences ne nous fera sortir (et ne fera sortir les Ukrainiens) du « paradoxe de la souveraineté limitée » que j’évoquais à l’instant, c’est-à-dire du fait que la seule forme aujourd’hui concevable de l’indépendance réside dans l’assujettissement à un ensemble plus vaste que la nation.
Or ces ensembles sont aujourd’hui commandés par des machines de guerre antagoniques. Mais du point de vue de la politique démocratique il y a une dissymétrie manifeste entre les deux perspectives : celle d’être absorbé à nouveau, de façon violente et revancharde, dans un empire autocratique et passéiste, et celle d’adhérer à une fédération qui perpétue, certes, toutes sortes d’inégalités nationales, sociales et culturelles, mais comporte des règles de participation et de sortie négociables. On voit se profiler ici la nécessité d’un grand débat sur les formes contemporaines de l’impérialisme, une notion qui n’a rien perdu de son actualité mais dont le contenu ne peut rester figé aux géographies et aux rapports de forces du 20ème siècle, et dont un des aspects concerne précisément les modalités de la « dépendance » politique, militaire, économique des nations.[15]
Au-delà de cette question, essayant d’imaginer l’avenir, il faudrait évaluer les chances qui restent pour l’Ukraine et pour l’Europe elle-même d’une intégration politique et d’un élargissement de son territoire qui ne coïncide pas purement et simplement avec l’inscription dans un système de camps et ne soit pas synonyme de militarisation de la vie sociale. Tout dépendra évidemment de la durée de la guerre et de la façon dont elle se « terminera », ainsi que de l’attitude des opinions publiques (y compris celle du peuple russe) à l’égard des solutions qui s’imposeront par la force ou par la négociation.
Mais peut-être le plus important en matière de géopolitique et de « cosmopolitique » n’a-t-il pas encore été dit ? Faut-il tenir pour allant de soi que le niveau des conflits entre alliances militaires et la cartographie évolutive des impérialismes mondiaux (où la Chine apparaîtra sans doute, au bout du compte, comme l’arbitre de la situation) constituent la dernière instance de notre réflexion ? En esquissant le concept d’une « guerre hybride » qui ne serait pas tant une guerre mondiale qu’une guerre mondialisée, j’ai voulu indiquer une autre possibilité. Les guerres ont toujours pour lieu et pour enjeu le tracé de fronts et de frontières, mais il en existe de plusieurs sortes.
Un premier niveau est constitué par le réseau des frontières nationales (doublé de leurs « frontières intérieures » qui fixent des règles d’inclusion et d’exclusion dans la communauté des citoyens et déterminent les sentiments d’appartenance) : ce sont les États qui, normalement, sont chargés de les mettre en vigueur, avec ou sans l’assentiment des peuples. Mais à un autre niveau la population se distribue entre des « régions » planétaires, séparées par des lignes ou des zones de transition qui résultent de phénomènes historiques de longue durée comme la conversion religieuse, les migrations, la colonisation et la décolonisation, le développement inégal et l’hégémonie de formes de capitalisme complémentaires, avec les « visions du monde » qui leur correspondent. Je pense ici en particulier à la grande division du « Nord » et du « Sud global », qui ne se reflète pas identiquement dans toutes les régions du monde actuel, mais n’en laisse aucune à l’écart.
On voit bien que cette division est déterminante dans la façon dont la guerre européenne est perçue par les citoyens d’autres régions de la planète, en particulier ceux du Sud global qui ont tendance à y voir un conflit entre « impérialismes du Nord », ou même une « guerre par procuration » (proxy war) que l’impérialisme le plus puissant (à supposer qu’il le soit toujours), à savoir les États-Unis, conduirait contre ses adversaires.[16] Mais je veux surtout suggérer que cette division, si réelle et si déterminante qu’elle soit politiquement, est de plus en plus exposée aux effets d’un autre phénomène « planétaire » qui est en train à la fois de la souligner et de la déplacer : le réchauffement climatique, avec le « grand dérangement » qu’il entraîne dans les équilibres environnementaux.[17] Toutes les frontières du monde en sont affectées et remises en question, en tant qu’elles séparent des zones (plus ou moins) habitables et d’autres devenant inhabitables, ou qu’elles déplacent le « front » des territoires ouverts à l’extraction de matières premières, au prix de catastrophiques atteintes à la stabilité des milieux naturels.
Ce processus est en cours, il semble inexorable, mais on n’avait pas anticipé le « supplément » que lui apporte aujourd’hui la guerre, en augmentant la probabilité de pénuries et même de famines dans diverses régions du monde (pour la plupart localisées dans les pays du Sud qui manquent à la fois de ressources agricoles et de réserves financières pour acheter sur le marché mondial ce qu’ils ne produisent plus eux-mêmes en raison de la destruction des économies traditionnelles). Sans oublier les effets directement climaticides de la production accrue et de l’usage des armements. Or la Russie est au cœur de ces processus. Bruno Latour, dans plusieurs interventions récentes, a proposé de juxtaposer dans le tableau de l’actualité deux guerres qui y seraient menées simultanément : celle qui est faite à la liberté du peuple ukrainien au nom du « monde russe », et celle qui est faite à la Terre au nom de la « modernité » postindustrielle.[18] Ne faudrait-il pas convenir qu’en réalité ces deux guerres n’en font plus qu’une si nous nous élevons à la considération de la scène planétaire et des phénomènes de violence « hybride » qui s’y superposent ? L’avenir immédiat n’offre pas, il faut le dire, de perspectives bien encourageantes pour sortir de cette « guerre généralisée ».
Je me garderai donc de conclure. Mais j’essayerai de prendre parti, avec et contre mon propre « camp ». Je suis très attaché à la position pacifiste de principe qui fait partie de la tradition de la gauche mondiale, et corrélativement à l’internationalisme hérité du communisme révolutionnaire et renouvelé par l’anti-impérialisme du 20ème siècle. Mais le pacifisme se trouve aujourd’hui pris entre des exigences contradictoires, tout particulièrement sur le continent européen, comme ce fut déjà le cas à l’occasion d’autres conflits où les droits humains fondamentaux étaient en cause. Et l’internationalisme, plus nécessaire que jamais dans sa « méthodologie » politique, apparait tragiquement désarmé lorsque la logique de guerre ne s’accompagne pas d’une mobilisation transnationale au moins virtuelle, ayant son propre « mythe » ou sa propre « utopie » comme ciment. La cage d’acier s’est refermée. Je ne vois d’autre perspective immédiate qu’une « unité de contraires », en espérant qu’elle se développe dialectiquement.
Il faut soutenir effectivement, efficacement, un peuple envahi, torturé, massacré, dont les maisons, les infrastructures économiques et les lieux de culture sont journellement écrasés sous les bombes. Il a le droit de se défendre par tous les moyens à sa disposition et de vaincre son envahisseur. Ceci désigne un ennemi qui est aussi le nôtre, mais qui n’est pas un étranger au sens exclusif du terme. Nous ne devons donc rien céder à l’idée que le régime dictatorial du président Poutine est l’émanation d’une « essence impériale » du peuple russe, pas plus que le Nazisme n’incarnait l’essence de l’Allemagne, ou Bush et Trump n’expriment celle de l’Amérique.
Il faut donc combattre la russophobie imbécile et chercher toutes les possibilités de solidarité active avec les dissidents russes, qui combattent le régime et s’opposent à la guerre de l’intérieur au péril de leur liberté. Car ils portent l’espoir. Enfin et surtout il faut relancer de toute urgence les campagnes pour le désarmement nucléaire et contre la militarisation de nos sociétés, pour la construction d’un ordre international fondé sur l’indépendance des nations en même temps que l’interdépendance des peuples, sur la sécurité collective au lieu de l’équilibre de la terreur, de l’intervention militaire au-delà des frontières et des sanctions qui frappent les populations civiles autant et plus que les États agresseurs et les classes dominantes, pour la priorité donnée aux intérêts qui réunissent l’espèce humaine toute entière et posent des questions de vie et de mort, non seulement à long terme, mais de façon urgente et immédiate.
Étienne Balibar
PHILOSOPHE
Notes
[1] Adaptation française de ma conférence « In the War : nationalism, imperialism, cosmopolitics », London Critical Theory Summer School, Birkbeck College, 27 juin 2022.
[2] Voir Sandro Mezzadra, « Disertare la guerra », Euronomade, 11 mars 2022.
[3] Carl von Clausewitz, De la guerre, traduction de Denise Naville, Les Éditions de Minuit, 1955, Livre I, chapitre Ier, §24, p. 69. Les commentateurs s’épargnent en général la discussion du « simple ».
[4] Ceci vaut d’une façon générale pour l’ensemble des territoires ayant appartenu à l’Empire Russe ou à l’URSS après 1945 et constituant ce que le discours officiel russe, de façon quasi-constitutionnelle, désigne comme « l’étranger proche ». Mais à l’intérieur de cet ensemble, qui inclut notamment les pays baltes, il est clair que l’Ukraine, pour des raisons économiques, démographiques, historiques et idéologiques sur lesquelles je reviens plus bas, occupe une place tout à fait singulière, perçue non seulement comme « non négociable » mais comme « existentielle ».
[5] La reprise de la forme empire par l’URSS est un objet de discussion en soi. Elle ne peut évidemment pas se concevoir comme l’effet du seul pouvoir de Staline et de son idéologie. Peut-être même faut-il voir les choses en sens inverse : c’est le retour du refoulé impérial au sein de la révolution qui explique l’ascension de Staline et les modalités de son exercice du pouvoir.
[6] Un aspect particulièrement important de la comparaison concerne les violences exercées contre les femmes, et plus généralement le caractère « viriliste » de la guerre. D’où l’importance de tenir compte des analyses et des propositions des féministes, parmi les rares à mettre en œuvre effectivement une méthode internationaliste. Voir le texte récent de Rada Ivekovic : Postsocialist Wars and the Masculinist Backlash, Alienocene, 30 mars 2022.
[7] Le concept de guerre civile européenne n’est pas la propriété exclusive de Ernst Nolte, dont l’ouvrage de 1997 (Der Europäische Bürgerkrieg 1917-1945) a lancé en Allemagne la « querelle des historiens ». Au contraire il a été employé (avec des « périodisations » et des interprétations diverses) par des historiens conservateurs, libéraux, socialistes. Voir mon commentaire dans E. Balibar, Histoire interminable. D’un siècle l’autre, Éditions La Découverte 2020, p. 40-41.
[8] J’emprunte cette formulation à l’excellent éditorial de Denis Sieffert dans Politis, 16 mars 2022 : « Ukraine : Un conflit qui se mondialise ».
[9] Jürgen Habermas zur Ukraine : Krieg und Empörung, Süddeutsche Zeitung, 28 avril 2022.
[10] Voir Edward P. Thompson et al., L’exterminisme. Armement nucléaire et pacifisme, tr. fr. Presses Universitaires de France 1983.
[11] E. Balibar, Cosmopolitique. Des frontières à l’espèce humaine, Éditions La Découverte, 2022, p. 17.
[12] Voir l’article très éclairant paru dans la revue ukrainienne Commons : Journal of Social Criticism, 15 juin 2022 : Denys Gorbach : « : Ukrainian identity map in wartime : Thesis-antithesis-synthesis ? ». Un symbole frappant de cette situation est constitué par le fait que le Vocabulaire Européen des Philosophies (Paris, 2014) a fait l’objet d’une double traduction en russe et en ukrainien publiée à Kiev/Kyiv sous la direction de Konstantin Sigov, aujourd’hui un des porte-paroles de la résistance parmi les intellectuels.
[13] Voir le volume très intéressant paru chez Suhrkamp en 2014 : Euromaidan. Was in der Ukraine auf dem Spiel steht, Herausgegeben von Juri Andruchowytsch (5ème édition révisée 2022) .
[14] Dans le passé, j’ai caractérisé la structure de l’Union Européenne comme « pseudo-fédérale », et plus récemment comme « étatisme de marché », à la suite de Carlos Herrera (voir Ninon Grangé et Carlos M. Herrera (dir.), Une Europe politique ? Obstacles et possibles, Kimé, 2021). Il s’agissait de faire voir ce qui manque à l’Union Européenne pour accéder vraiment à un fonctionnement de type fédéral. Mais dans le cadre de la grande antithèse entre les deux formes de « supranationalité », c’est évidemment la promesse de cette structure antithétique de l’empire qu’il faut évoquer pour comprendre l’attraction exercée sur les nations de l’ancien bloc soviétique.
[15] Ce débat a été puissamment relancé parmi les marxistes (ou les postmarxistes) depuis le début de la guerre en Ukraine par les divergences mêmes qui les ont opposés entre eux. Je signale l’intérêt de l’échange entre Gilbert Achcar et Alex Callinicos.
[16] Voir l’article de Boaventura de Sousa Santos dans le Wall Street International Magazine du 10 mars 2022 : « Ukraine : complexity and war. Is it still possible to think ? »
[17] Amitav Ghosh, Le Grand Dérangement. D’autres récits à l’ère de la crise climatique, Éditions Wildproject, Marseille, 2021.
[18] Bruno Latour, « Quelles entre-deux-guerres ? », AOC media, 3 mars 2022.









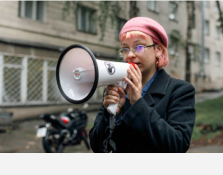
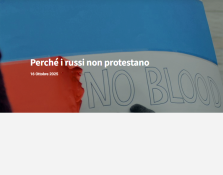

Un message, un commentaire ?