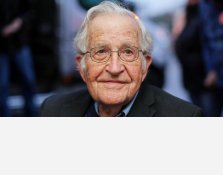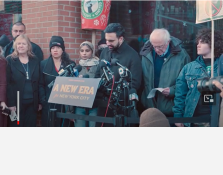Les profits constituent un indicateur crucial sur l’état d’une économie capitaliste parce que l’on considère généralement que ce sont eux qui actionnent l’investissement. L’investissement, à son tour, possède un effet déterminant en matière d’emplois, de salaires (dans la mesure où une augmentation du nombre d’emplois aboutit à un accroissement de la capacité de négociation des travailleurs), ainsi qu’une plus vaste assiette fiscale permettant de soutenir des programmes sociaux.
Actuellement, cependant, ce lien entre les profits et l’investissement semble être brisé : alors que les profits explosent, l’investissement reste obstinément à la traîne. Comment pouvons-nous comprendre ce phénomène ?
Certains prétendent qu’il y a une réponse simple. Ils bouclent la quadrature du cercle en affirmant qu’en réalité les profits ne se comportent pas aussi bien que cela. Les contorsions statistiques nécessaires pour que les hauts profits disparaissent sont toutefois difficiles à vendre alors que sont nombreuses les informations sur les entreprises établissant une croissance rapide de l’accumulation de cash. Mark Carney, président de la Banque d’Angleterre (qui est aussi ancien président de la Banque du Canada), a baptisé cela du terme « d’argent mort », se lamentant devant le refus des entreprises à « remettre au travail » (réinvestir) leurs profits dans le circuit économique.
Une autre explication a reçu beaucoup d’attention. Elle a été résumée récemment par Mike Whitney dans la revue Counterpunch. Il souligne le fait que les entreprises se sont réorientées vers une « compulsion écervelée de rachats » de leurs actions, d’une manière si « folle que le rachat de leurs propres actions a, en fait, excédé les profits de trois quarts en 2014 ».
La ruée des entreprises vers le rachat de leurs propres actions, en parallèle avec la croissance rapide des dividendes alloués aux actionnaires, comporte deux implications significatives. Il semble, tout d’abord, qu’elle laisse un volume moins important de fonds pour l’investissement et l’innovation. Ensuite, la demande plus importante d’actions augmente artificiellement leur cotation en bourse et, alors que les circonstances changent, il en découle que le marché des actions est vulnérable à un nouveau krach dévastateur.
L’augmentation de la « valeur » boursière des actions, pour Whitney, n’est manifestement pas un reflet de la force réelle de l’économie américaine car il considère comme étant évident que l’économie américaine est « paralysée ». La Réservée fédérale américaine (Fed) est le premier responsable pour avoir rendu possible le boom du marché des actions alors que sa politique « d’argent facile » (qualifiée de quantitative easing – assouplissement quantitatif) encourage des emprunts supplémentaires – en plus des fonds rendus disponibles par les profits des firmes – pour financer le rachat d’actions. Cela a « conduit le pays une nouvelle fois au bord du précipice, où la moindre hausse des taux d’intérêt fera chuter brutalement l’économie ».
Pourquoi, alors, la Fed « pilote le pays d’une catastrophe financière à l’autre » ? Parce que, Whitney l’affirme, cela fait partie de l’engagement de la Fed de garantir le fait – ainsi qu’il a titré son article – que « les riches deviennent plus riches ». Dans la mesure où la richesse aux Etats-Unis, et en particulier les actions, est notoirement distribuée de manière inégale (le 10% le plus riche possède le 90% des actions), des prix d’actions plus élevés soutiennent et augmentent cette inégalité.
La séduction de ce type de récits ne correspond pas seulement à cette attraction étrange de la gauche pour les prédictions qu’une apocalypse économique se trouve juste au coin de la rue. L’argumentation de Whitney fournit également de forts points de discussion, bien qu’ils soient simples.
Si cette histoire simplifie de manière exagérée le rôle de la Fed, elle met dans le mille lorsqu’elle attaque une justification clé des inégalités causées par les bénéfices élevés des entreprises ainsi que les salaires scandaleux de leurs dirigeants et gestionnaires. Il est prétendu que ces inégalités sont une condition pour la création d’emplois et du bien-être social général. Mais, alors que les entreprises ne réinvestissent pas ces bénéfices d’une manière un tant soit peu proportionnelle à leurs profits, nous nous retrouvons sans emplois ni programmes sociaux et même face à une inégalité sociale accrue ainsi qu’à une plus grande insécurité économique.
En conséquence, la question posée, d’un point de vue radical, est la suivante : si les entreprises échouent à investir de manière adéquate leurs surplus, pourquoi ne pas taxer – pour le moins – leurs bénéfices socialement improductifs et faire en sorte que l’Etat utilise ces revenus pour réaliser des investissements ? Il est remarquable, et il s’agit d’une indication de la faiblesse de la gauche, que le sentiment populaire n’ait pas été mobilisé en ce sens de manière significative. C’est ce qui rend l’analyse de Whitney particulièrement bienvenue. Son argumentation, pourtant, glisse également sur certaines présomptions qui doivent être interrogées et « mises au jour ».
De manière implicite Whitney suppose qu’un effondrement imminent du marché des actions serait économiquement catastrophique. Est-ce vrai ? Les rachats d’actions et les fonds destinés à l’investissement constituent-ils en fait un jeu à somme nulle dans lequel une augmentation des uns sape les seconds ? L’investissement est-il aussi plat qu’il le suggère ? Est-il correct de décrire l’économie américaine comme étant « paralysée » ou la situation est-elle plus ambiguë ? Pouvons-nous réduire le rôle de la Fed à celui de servante des banques et des riches ? Et pouvons-nous supposer que s’il y a une nouvelle profonde crise économique la gauche se trouverait renforcée ?
Pour commencer, l’éclatement des bulles du marché des actions est, en première instance, un événement financier. Il peut soit aboutir à des conséquences économiques plus amples, soit n’être que l’occasion d’une panique financière temporaire qui est attendue. A la différence d’un effondrement du marché immobilier – qui a des conséquences directes sur l’emploi dans divers secteurs et touche la source principale de richesse de la classe laborieuse – un krach du marché des actions ne signifierait pas nécessairement un effondrement abrupt de l’économie. Cela dépendrait de sa profondeur, de sa durée et de ce qui se déroule dans le reste de l’économie ainsi que de la réponse de l’Etat.
Pour ce qui touche aux rachats, le fait que les entreprises utilisent leurs fonds pour acheter leurs propres actions et augmentent les dividendes n’enlève rien à leur possibilité d’investir également dans les biens d’équipement et dans les infrastructures. Il ne s’agit pas de choix à somme nulle. Apple, par exemple, est l’actuel meneur parmi les entreprises dans le retour des fonds aux actionnaires ; cela n’affecte qu’environ 10% de la thésaurisation des liquidités de l’entreprise. Et, pourtant, Apple figure parmi les premiers rangs en termes de dépenses consacrées à la recherche et au développement, aux équipements et aux infrastructures.
D’une manière plus générale, si les profits sont suffisamment élevés et si les entreprises peuvent emprunter à de faibles taux d’intérêt, il est tout à fait possible de remettre des fonds aux actionnaires et de réinvestir dans les infrastructures et l’équipement. Cela devrait être évident à partir du fait que même après tout ces rachats et ces distributions de dividendes, les entreprises états-uniennes non financières disposent toujours de quelque 1,7 trillion de dollars en cash (Financial Times, 10 mai 2015).
Il n’est, en outre, pas nécessairement vrai que distribuer des fonds aux actionnaires ne soit pas fonctionnel à l’accumulation capitaliste. Les entreprises ne pratiquent pas des rachats d’actions uniquement pour augmenter les bonus des dirigeants en lien avec les valeurs actionnariales. Les rachats d’actions sont aussi un outil financier que les entreprises utilisent pour entretenir les augmentations régulières des prix de leurs actions parce que cela contribue à leur accès à des crédits bon marché.
Et, dans la mesure où les entreprises distribuent une part de leurs profits aux actionnaires et que ces derniers, à leur tour, réinvestissent les fonds dans d’autres compagnies desquelles ils attendent des gains plus élevés (y compris dans de nouvelles entreprises), la réallocation de capital finit par renforcer le capital dans son ensemble et, ainsi, plus largement l’économie.
Bien entendu, la question centrale est de savoir si de tels réinvestissements s’effectuent effectivement. Les actionnaires ne réinvestissent-ils pas leurs richesses augmentées et, ainsi, n’agissent-ils plus comme des capitalistes mais plutôt comme des rentiers (c’est-à-dire consommant du capital plutôt que de le régénérer) ? Si les actionnaires ne réinvestissent pas leurs nouveaux fonds dans d’autres compagnies mais ne font qu’acheter d’autres produits financiers, une question demeure : où finissent ces fonds ?
Participent-ils indirectement à l’investissement de capital à travers les services qui sont fournis (comme c’est le cas avec les produits dérivés garantissant les risques de changes ou les fonds qui sont déployés pour les fusions et les restructurations) ? Et jusqu’à quel point ces fonds retrouvent finalement la voie vers les investissements dans des moyens de production ?
Il s’agit là, dans une large mesure, de questions empiriques. Afin de les aborder, nous devons d’abord réexaminer si la stagnation présumée de l’investissement états-unien est fondée dans la réalité. Il est indéniable que l’investissement est bas en comparaison avec le niveau des profits. Mais avec des profits si élevés, l’investissement peut être en décalage avec les profits tout en restant significatif – même si de tels investissements n’ont pas retrouvé des niveaux suffisants pour consolider une reprise robuste.
Considérons les données de l’investissement réel (après inflation). Si l’on compare la part de l’investissement privé brut au cours du premier trimestre de 2015 avec ce qu’elle était en 2007, l’année qui précédait la crise, elle n’a crû que de 5,5%, ce qui est même significativement plus bas que la modeste augmentation du PIB réel de 9,6%.
Cependant, ces chiffres de l’investissement comprennent la diminution spectaculaire de l’investissement résidentiel (23%). Si l’on ne considère que l’investissement non résidentiel, les données semblent significativement meilleures. Se situant à 10,4%, il est au-dessus de la croissance du PIB. En outre, si nous allons au-delà des années les plus turbulentes de la crise financière et que nous observons seulement les cinq dernières années, l’investissement non résidentiel réel a crû à un taux annuel moyen respectable supérieur à 6% (bien que cette croissance soit partie d’un niveau bas, au point le plus profond de la crise).
Cette croissance de l’investissement privé peut difficilement être considérée comme étant spectaculaire, mais elle tient la comparaison avec l’investissement public. Les dépenses étatiques réelles en matière d’investissement se situent 12% plus bas qu’elles ne l’étaient en 2007 et restent en deçà de 2003.
En revanche, l’investissement non résidentiel est actuellement presque 40% plus élevé en termes réels qu’il n’était alors. Malgré les mesures de relance prises par l’Etat fédéral à partir de 2009-2011, au plus fort de la crise économique, pour empêcher que l’économie états-unienne ne sombre dans une autre Grande Dépression, les fortes réductions [des budgets] au niveau des Etats ont eu pour effet que les dépenses actuelles d’ensemble de l’Etat, comprenant aussi bien l’investissement que la consommation, demeurent en dessous de ce qu’elles n’étaient en 2007.
L’économie américaine est-elle donc « paralysée » ? La déclaration sans ambiguïté de Whitney, renforcée par le constat de l’atonie du PIB au cours des deux derniers trimestres, va dans ce sens. Bien qu’obligeant à la prudence, la période est bien trop brève pour aboutir à une conclusion définitive de ce type. Les problèmes à brève échéance ne doivent pas être méprisés – ils peuvent délimiter des possibilités à long terme – mais d’autres tendances aux Etats-Unis augmentent les chances de la poursuite d’une reprise.
Par exemple, les niveaux de l’emploi constituent un facteur clé pour la capacité d’emprunt des ménages et les dépenses en matière de biens de consommation durables, tels que le logement et les automobiles. Le taux de chômage a diminué pour avoisiner le 5%. Les exportations sont plus élevées de 27% par rapport à 2007 et de 75% par rapport à 2003 alors que les importations ont augmenté à un niveau proche de la moitié de ces dernières, à 11% et 35% respectivement. Les bilans des banques se sont suffisamment rétablis pour pouvoir soutenir de nouveaux cycles d’investissement (bien que le rôle de la finance sous sa forme actuelle d’accumulation implique nécessairement une grande volatilité ainsi que de nouvelles vulnérabilités).
L’investissement des Etats-Unis s’est, en effet, étendu à l’étranger mais les transnationales étrangères ont également fortement investi aux Etats-Unis. De manière décisive, l’Etat américain a maintenu, contrairement aux années 1930, le capitalisme sur les rails d’échanges commerciaux mondialisés et d’investissements libéralisés et confirmé ses capacités stratégiques à contenir – si ce n’est prévenir – les crises. Et l’accumulation de liquidités sert également de fonds potentiel disponible pour nourrir un boom si la confiance en une croissance durable fait sa réapparition.
Ce « si » est, bien sûr, la grande question. L’élément que l’on veut souligner ici est uniquement le suivant : la possibilité d’une reprise économique durable ne peut être écartée de manière aussi définitive que le fait Whitney et d’autres. Cela est particulièrement le cas lorsque le mouvement ouvrier et social aux Etats-Unis (ou ailleurs en ce domaine) ne représente qu’un obstacle minimal à toute restructuration de capital nécessaire.
A cet égard, si les pessimistes ont raison sur le fait qu’une croissance renouvelée est improbable au moins dans le proche et moyen terme, l’expérience de la crise récente – accompagnée des coûts importants imposés à la classe laborieuse ainsi que du déplacement du rapport de forces plus loin encore vers la droite – suggère que l’optimisme d’une secousse positive en faveur de la gauche provenant d’une plus longue stagnation économique ou même d’une nouvelle crise ouverte a peu de fondement.
Des liberals proéminents comme Joseph Stiglitz et Paul Krugman, ainsi que l’ancien Secrétaire au Trésor [ministre des Finances] Larry Summer en particulier, ont ajouté du poids à l’argument selon lequel les Etats-Unis étaient « paralysés » en soulevant le spectre d’une stagnation séculaire. Il est important de remarquer, néanmoins, qu’ils ne présentent pas la thèse de la stagnation structurelle comme inévitable, mais plutôt comme d’un avertissement selon lequel des contre-mesures sont nécessaires et peuvent être réalisées. Leurs recommandations stratégiques découlent également de préoccupations par rapport à l’accumulation de liquidités à côté des faibles niveaux d’investissements privés et publics.
Ils soutiennent que des entreprises individuelles se placent en « attente » d’une reprise économique cohérente avant de se lancer dans une hausse des investissements. Les investisseurs sont pris dans une toile d’incertitudes au sujet du comportement des ménages, des autres entreprises ainsi que des développements de l’économie mondiale.
Pour ces liberals, une responsabilité spéciale échoit à l’Etat américain pour que ce dernier intervienne de manière productive. L’écart énorme entre les besoins états-uniens en termes d’infrastructures (physiques, éducatives et en rapport à l’environnement), la disponibilité pour les Etats-Unis de capital bon marché (taux d’intérêt presque nuls) ainsi que la croissance effroyable et imparable des inégalités, tout cela penche en faveur de développements étatiques massifs dans le domaine des infrastructures en parallèle à une réforme fiscale et à de mesures en faveur de l’augmentation des salaires pour les secteurs se situant au bas de l’échelle salariale.
Une telle renaissance liberal de la formule keynésienne de dépenses et de redistribution modérée peut difficilement être qualifiée de radicale. Pourquoi, alors, ne se trouve-t-on pas face à un enthousiasme généralisé pour cette manière de procéder, relevant apparemment du sens commun ?
La réponse facile qui cible l’emprise de l’idéologie néolibérale n’y parviendra pas. Les idéologies comptent, formulent un cadre et renforcent les pratiques des décideurs économiques. Mais elles peuvent aussi se heurter frontalement avec des intérêts concrets ainsi que des contradictions qui atténuent leur importance face à un pragmatisme politique nécessaire.
Il existait, par exemple, des prédilections idéologiques au sein du Congrès pour que soit rejetée l’aide financière au Mexique lors de sa crise du début des années 1990, pour refuser l’adoption de budgets déficitaires ainsi que pour s’opposer au TARP (le Troubled Asset Relief Program ou, en français, Plan Paulson d’injection de liquidités pour sauver les institutions financières) et au « sauvetage » des banques lors de la crise financière. Mais, sous la pression des circonstances, le Congrès s’y est finalement rallié.
Une explication différente de la résistance à une politique de relance (tel que mentionnée ci-dessus) se fonde sur la vision d’un l’Etat américain (ou de la Fed dans l’argumentation de Whitney) comme étant simplement captif de la finance. Il est exact de dire que la prépondérance croissante de la finance sur l’économie met sous pression la Fed et l’Etat pour qu’ils soient sensibles aux structures financières ainsi qu’à la « confiance » des banquiers.
Ces banquiers ont tendance à être conservateurs en matière d’impôts et préoccupés du fait que des dépenses excessives pourraient causer une hausse de l’inflation qui entamerait leurs capitaux ou, dans des cas extrêmes, provoquerait un défaut sur leurs obligations. Bien que le risque d’un défaut puisse sembler éloigné au niveau fédéral, ce n’est pas le cas à celui des Etats et au niveau local (comme en témoigne la faillite de la ville de Detroit).
Pourtant, ici aussi, il semble que l’enjeu soit plus grand. Après tout, une économie en croissance est aussi favorable – et plus sûre – pour les banques. Un facteur supplémentaire qui vaut la peine d’être considéré est que l’Etat, soutenu par le capital plus en général et non uniquement le secteur financier, a œuvré durement pour entamer la portée relative de la politique fiscale en termes de gestion de l’économie et il est réticent à laisser tomber cette victoire.
Le problème est que l’intervention fiscale porte en elle le danger d’être intrinsèquement politisée dans la mesure où elle soumet au débat public les questions fiscales et de distribution des impôts, de priorités sociales et des dépenses en dehors de leur portée directe sur l’économie privée. La gestion monétaire, en revanche, a l’avantage reconnu par les élites de pouvoir d’être menée derrières des portes closes, avec des mandats strictement orientés en direction du marché et de pouvoir se mener au moyen de marchés financiers qui disciplinent chaque entreprise, les travailleurs et les Etats envers les priorités « apolitiques » de l’accumulation.
A cet égard, la faiblesse du travail comme force faisant contrepoids renforce la tolérance du conservatisme fiscal. En outre, la persistance de l’austérité et de la croissance restreinte donne à l’Etat l’occasion d’affaiblir encore plus le travail [labor].
Tant que la croissance ralentie ne menace pas la survie des banques – ce qui a fait l’objet de soins méticuleux – l’austérité peut être utilisée pour entreprendre l’objectif à plus long terme favorisé par des fractions des élites : consolider la défaite institutionnelle des syndicats du secteur privé et faire en sorte que cette réalisation se prolonge dans le secteur public.
Dans cette perspective, la ferveur conservatrice de l’Etat allemand en faveur de l’austérité, alors même que l’Etat américain fait pression pour qu’il limite un peu cette orientation, n’est pas seulement le problème d’un héritage historique qui serait paranoïaque vis-à-vis de l’inflation, mais elle et aussi une dimension de l’Etat allemand jouant un rôle dominant dans la consolidation du néolibéralisme européen et se dirigeant (sans retour) vers « l’Etat social » plus faible et la plus grande flexibilité du travail que l’on trouve déjà aux Etats-Unis.
Le capitalisme américain est actuellement caractérisé autant par le plus grand rôle des marchés financiers que par la faiblesse de la classe laborieuse. Les rachats d’action sur lesquels insiste Whitney ajoutent de la volatilité financière ainsi que la possibilité d’une bulle de capitaux aboutissant à un effondrement significatif du marché des actions. Et l’insistance politique sur le lien entre faire monter les prix des actions et l’inégalité sociale ainsi que l’échec des entreprises (et des riches) à investir à des niveaux justifiant leur part radicalement disproportionnelle des richesses de la société est probablement correcte.
Mais nous ne devrions pas sous-estimer la capacité de résilience du capitalisme ainsi que l’endurance de l’économie américaine. La classe laborieuse et les mouvements sociaux sont toujours sur la retraite et des mobilisations récentes comme Fight for $15 [bataille pour un salaire horaire minimum de 15 dollars] ainsi que celles du Black Lives Matter restent limitées si elles n’ont pas de perspectives plus amples.
Nous devons nous préparer non pas à nous trouver face à un capitalisme à bout de souffle mais à un qui est capable de trébucher et de générer des profits malgré toute la volatilité et l’incertitude. Les tâches que doit se fixer la gauche portent sur le long terme, celui de convaincre des personnes de rejeter le capitalisme même lorsqu’il fonctionne, selon ses propres termes, « bien ».
C’est notre incapacité à nous organiser pour faire face à ce défi plutôt que de se centrer sur la manière de « réparer » qui définit les échecs de la gauche. C’est de cette crise que nous devrions particulièrement discuter. (Traduction A l’Encontre)
Article publié le 28 mai 2015 sur les sites www.jacobinmag.com. Sam Gindin a été, entre 1974 et 2000, directeur de recherche pour le syndicat canadien de l’automobile. Il est actuellement professeur adjoint à l’Université York de Toronto. Il a récemment publié, avec Leo Panitch, The Making of Global Capitalism : The Political Economy of American Empire (Verso, 2013).