Tiré de Entre les lignes et les mots
FS : Les masculinistes et les personnes peu informées établissent une symétrie entre les hommes qui tuent leur compagne et les femmes qui tuent leur compagnon. Y-a-t-il vraiment symétrie (motivations, nombre de victimes etc.) entre les auteurs et autrices de ces crimes ?
PM : Avant tout, je précise que notre recherche a porté sur les crimes commis dans le contexte d’une relation conjugale, amoureuse ou sexuelle. Nous avons donc étudié des crimes commis par des hommes ou par des femmes, qui pouvaient tuer leur conjoint·e ou d’autres personnes, leur rival par exemple, leurs enfants, leur belle-famille… C’est plus large que l’homicide conjugal au sens strict, et encore plus large que le féminicide qui se définit spécifiquement comme le meurtre d’une femme parce qu’elle est une femme, et peut inclure bien sûr le meurtre d’une conjointe, mais aussi la dowry death indienne, le crime dit d’honneur, le viol de guerre meurtrier, et d’autres types de circonstances.
Ceci posé, il n’y a aucune symétrie entre les crimes commis dans ce cadre (conjugal, amoureux ou sexuel) par les hommes et ceux commis par les femmes, à aucun point de vue. D’abord, c’est un crime d’homme essentiellement, les chiffres ne sont pas du tout symétriques : environ 80% des crimes prétendument passionnels sont commis par des hommes, et 20% par des femmes… Inversement, les victimes de ce type de crime sont essentiellement des femmes et des enfants. Dans notre recherche, nous avons étudié les crimes de 72 femmes qui ont tué leur conjoint, 1 femme qui a tué deux personnes, et 263 hommes qui ont tué au total 382 personnes parmi lesquelles leur conjointe, leurs enfants, leur rival, la famille de leurs partenaires ou rivaux ou encore des inconnu·e·s.
FS : En effet, d’après les chiffres dont je dispose, les homicides conjugaux sont à 85% commis par des hommes. Et encore faut-il rappeler que sur les 15% commis par des femmes, environ 50 à 60% de ces femmes étaient elles-mêmes victimes de violences, donc leur recours à la violence relève d’une forme de légitime défense.
PM : Une forme de défense c’est certain, justifiée par la violence, la menace, la terreur même parfois ; néanmoins, la qualification « légitime défense » est juridique et soulève d’autres questions.
En tout cas, dans notre recherche, le contexte de violences conjugales est prévalent aussi bien dans les cas de féminicides (plus de la moitié de ces hommes étaient violents) que quand une femme tue son conjoint (la presque totalité de ces femmes étaient victimes de violences).
Les mobiles surtout sont complètement différents – et ça, c’est super-important : nous avons relevé, listé les mobiles invoqués par ces criminels, hommes et femmes. Sachant que c’est le mobile invoqué, ce qu’ils savent d’eux-mêmes, ce qu’ils peuvent dire, qui n’est pas forcément ce qui est vrai au fond. Du côté homme, plus de la moitié tuent parce qu’ils sont jaloux, que ce soit justifié ou pas, et plus de la moitié aussi parce qu’une femme les abandonne, veut les abandonner ou qu’ils craignent qu’elle les abandonne. Et comme on peut avoir plusieurs mobiles à la fois, quand on réunit ces deux mobiles, ça fait 75%. Donc 75% des hommes tuent une femme qu’ils voudraient garder. Alors que du côté des femmes, les mobiles sont un peu plus variés, et surtout elles tuent nettement des hommes dont elles veulent se débarrasser. Ce n’est pas du tout la même chose, c’est une asymétrie profonde.
On peut trouver d’autres asymétries intéressantes : les femmes tuent surtout dans une situation de mariage, alors que le couple est en cours, alors que les hommes tuent plus fréquemment des femmes qui les ont déjà quittés, dont ils ont déjà divorcé, comme si la rupture ne comptait pas, comme s’ils voulaient les récupérer, donc les situations sont très différentes, la dynamique qui va conduire au crime est très différente.
FS : Les auteurs de féminicides disent souvent « je ne sais pas ce qui m’a pris », plaident le « coup de folie » devant les enquêteurs et les juges, déclarent souvent avoir été mal aimés dans leur enfance, ou victimes de violences. Que pensez-vous de ces discours psychologisants auto-justificateurs ?
PM : Cette formulation m’a un peu mise mal à l’aise parce que, ce que vous citez là, c’est le discours des meurtriers eux-mêmes.
FS : Tout à fait.
PM : Donc évidemment ils se justifient, ils disent quelque chose de leur vécu – quand ils sont de bonne foi évidemment, parce que l’on peut penser aussi que certains mentent. Mais quand ils sont de bonne foi, ils disent quelque chose de leurs sentiments intimes. Quand ils disent : « je ne sais pas ce qui m’a pris » ou « j’ai eu un coup de folie », c’est une façon d’exprimer qu’ils ne se reconnaissent pas entièrement dans leur acte, ils ont été pris par surprise par leur propre recours à l’acte. Et d’autre part, vous dites que ces discours sont psychologisants mais, si ce sont les meurtriers qui les tiennent, on ne peut pas dire qu’ils psychologisent, ils vivent les choses psychologiquement, c’est dans leur psyché qu’ils les vivent.
Ce qui serait psychologisant, c’est d’utiliser une analyse psychologique pour camoufler la dimension politique. Ce qui est psychologisant, c’est le discours qu’on trouve beaucoup en ce moment, et qui ne vient pas des meurtriers eux-mêmes : « ce sont des pervers narcissiques ». Car quand on dit : « ce sont des pervers narcissiques », on dit d’abord que ce serait un homme exceptionnel, différent, pas comme les autres, un grand malade, dont la violence serait liée à la structure de sa personnalité, qui serait unique. Ça c’est une explication psychologisante, qui camoufle la dimension politique de ces meurtres. Et je pense en particulier à des témoignages de femmes sur ces meurtres… Je ne sais pas si vous avez lu le très bon ouvrage de Florence Torrollion, « Ma mort dans ses yeux » [1]. L’autrice a survécu à une tentative de féminicide, et tout le monde, elle y compris, a considéré que son mari était un pervers narcissique ; c’est possible, mais en lisant ce témoignage, j’ai personnellement conclu que c’était avant tout un homme convaincu de la légitimité du fait que sa femme devait lui appartenir.
FS : En utilisant le terme « psychologisant », je faisais allusion au fait que ces arguments sont souvent acceptés socialement et proposés comme explication des violences masculines. Ça peut être vrai, mais ces hommes savent très bien quelles excuses invoquer, sur quel registre jouer pour attendrir leur entourage, la société et les juges. Je pense que la plupart sont très conscients du discours qu’il faut tenir pour avoir le bénéfice de circonstances atténuantes.
PM : Vous avez raison, ils savent très bien sous quel angle se présenter, et de toute manière ils se vivent eux-mêmes comme des victimes. « Regarde ce que tu m’as obligé à faire », c’est une phrase typique d’homme violent. Comme s’il était lui-même victime, dans une inversion complète. Pourtant je ne pense pas qu’on puisse réduire leur discours à du pur mensonge. Ça ne les excuse pas mais c’est vrai que ces hommes – et ces femmes – viennent de familles fondamentalement dysfonctionnelles. Évidemment on pourrait argumenter que dans la société, il y a une prévalence énorme du dysfonctionnement familial. Parce que ce n’est pas rare du tout : quand on sait qu’il y a 5% d’enfants qui sont victimes d’inceste, 5% c’est colossal, c’est minoritaire mais pas du tout insignifiant ou même exceptionnel. Et oui, c’est un argument dont ils savent jouer, mais d’un autre côté, j’ai bien peur qu’ils n’y croient, en fait.
FS : Vous dites que pour ces meurtriers, « avoir une femme (et la contrôler totalement) est le seul accès à une identité virile » et de ce fait « une question de vie ou de mort ». Vos commentaires ?
PM : J’étais en train de vous parler de familles dysfonctionnelles. D’après notre recherche, d’après les dossiers que nous avons étudiés, ces hommes ont quand même des points communs entre eux : ils ont grandi dans des familles avec un modèle de la virilité extraordinairement contraignant.
La virilité, il faut la définir. Pascale Molinier [2], à la suite de Christophe Dejours, une très intéressante distinction entre « virilité » et « masculinité ». La virilité, c’est la posture par laquelle un homme doit à toute force se distinguer des femmes pour être bien sûr qu’il est un homme. Et pour se distinguer des femmes, pour ne surtout pas être comme une femme, il faut faire deux choses fondamentalement : premièrement lutter contre la peur, nier sa propre peur, nier le danger et l’affronter jusqu’à la bêtise – c’est pour ça que, dans les métiers hautement virils comme le bâtiment ou le maniement des barres de métal en feu, les ouvriers n’utilisent pas les équipements de sécurité, parce qu’ils seraient moins mecs, ils passeraient pour des femmelettes. Et la deuxième façon de s’assurer qu’on n’est pas comme une femme, c’est de lutter à toute force contre l’empathie. C’est comme ça qu’on peut faire faire des horreurs à des hommes pendant les guerres – parce qu’ils ne vont pas reculer devant la violence.
Au contraire, la masculinité, c’est la posture de quelqu’un qui peut être un homme sans avoir perpétuellement besoin de prouver qu’il n’y a rien en lui de féminin.
FS : Mais pourquoi la possession d’une femme est-elle si essentielle à l’affirmation de l’identité virile ?
PM : Ces hommes qui en viennent au crime n’ont pas pu construire autre chose que cette preuve-là pour confirmer leur identité virile. Ce sont des hommes qui ont vécu, qui ont été élevés, dans un autoritarisme profond – il faudrait définir aussi, l’autoritarisme, ce n’est pas la même chose que l’autorité – c’est-à-dire qu’ils ont été exposés à une véritable tyrannie, ils ont vécu dans des familles où les femmes étaient souvent reléguées à la sphère domestique, ou considérées comme objet sexuel, en tout cas reléguées. Ils ont eu un accès à la culture empêché… Sur l’accès à la culture empêché, il faut nuancer un peu parce que, malgré tout, on a aussi des bourgeois.
FS : Bien sûr, la violence conjugale n’est pas spécifique à une classe sociale.
PM : En tout cas, l’autoritarisme paternel a été énorme, ces hommes-là n’ont rien d’autre pour se construire une identité, et leur identité, elle repose sur le fait de posséder une femme. Et qu’est-ce qu’on appelle identité ? Pour ces hommes, être un homme, c’est une posture identitaire, c’est-à-dire une carapace inamovible dont on ne peut pas sortir. On ne peut pas s’en dégager sans risquer de se perdre complètement. Ce n’est pas la seule façon d’avoir une identité, les gens qui vont bien ont une identité complètement différente, beaucoup plus souple, ils ne sont pas collés à l’étiquette « je suis un mec, un vrai ».
FS : « La virilité se jauge à l’importance de la violence qu’on est capable d’exercer sur autrui, les dominés et les femmes en particulier ». Cette citation (de Chr. Dejours) rappelle que la violence masculine n’est pas pulsionnelle, ou purement éducationnelle, mais d’abord stratégique : elle est pour un homme, le moyen d’obtenir la soumission féminine. Peut-on postuler la possibilité d’une réduction des violences masculines significative sans recul de la domination masculine ?
PM : Je ne pense pas.
FS : Je partage votre avis.
PM : Là, ce n’est pas de la recherche, c’est une question d’opinion. Il faut définir ce qu’on appelle la violence : la violence, c’est d’abord une pulsion. Nous avons tous et toutes des pulsions de violence, des potentialités de violence, des mouvements internes de violence. Combien de fois est-ce qu’on formule intérieurement des vœux de mort ? Mais côté homme, la violence manifeste, agie, est bien sûr interdite par la loi, mais d’un autre côté, on voit bien qu’elle est valorisée, hyper-valorisée même : environ 90% des films qui sortent actuellement portent sur la violence du modèle viril… Au cinéma, des films qui parlent d’empathie, qui parlent de familles qui vont bien, il n’y en a pratiquement pas, et on les considère trop souvent comme des films « de bonne femme » ; les films d’action, les thrillers, les policiers dominent presque toute la production, et tout ça valorise la violence masculine. Je ne vois pas comment on pourrait imaginer que la violence masculine décroisse sans recul de la domination masculine.
FS : Tout à fait. Pour moi, la violence est essentielle au maintien de la domination masculine, c’est le moyen de premier et de dernier recours, quand rien d’autre ne marche, de pair avec le conditionnement, l’idéologie, qui prend sans doute une place plus importante dans les sociétés modernes.
PM : Même avant que rien d’autre ne marche. Par exemple, la menace de viol, c’est de la violence, c’est une manière extrêmement efficace de réguler le comportement des filles et des femmes, avant toute autre chose. Combien de filles, de jeunes filles, de gamines, se sont vu expliquer qu’il fallait faire attention, qu’il ne fallait pas sortir trop tard… C’est la menace de viol, et ça marche très bien.
FS : Bien sûr. On dit que les violeurs sont les troupes de choc, les milices du patriarcat…
PM : Cela dit, dans une famille qui va suffisamment bien, où il y a suffisamment de souplesse dans les modèles, où il y a une possibilité d’accéder à l’altérité, c’est-à-dire à la reconnaissance de l’autre, avec qui partager mon humanité, où même les femmes sont des sujets avec qui les hommes partagent leur humanité. Si l’on est dans une famille qui socialise ses enfants de cette manière-là, c’est vrai que les hommes seront moins violents. Ces familles-là, elles ne sont pas si nombreuses que ça.
FS : Vous parlez de la « terreur sans nom », d’une « expérience de mort psychique » des hommes quittés : ils ne mangent plus, ils ne dorment plus, on a parlé de la « clochardisation » des hommes suite à une séparation. Comment expliquer cette vulnérabilité psychique masculine à l’abandon de leur compagne ? Vous en avez déjà un peu parlé mais on peut creuser un peu : c’est beaucoup plus catastrophique, psychiquement, pour un homme d’être quitté par une femme que l’inverse.
PM : Absolument, et c’est parce qu’ils ont été socialisés à penser que leur identité en dépend. C’est plus que de la dépendance ; la dépendance c’est que, quand on est quitté, on fait une dépression. Là, c’est plus que de la dépendance car c’est une remise en cause de ce qui est au centre de l’identité, de ce qu’est la virilité : si ma femme me quitte, je ne suis plus un vrai homme, je ne suis plus personne.
FS : On a dit que le crime passionnel était en fait un crime possessionnel, et vous évoquez la façon dont, socialement, les femmes sont frappées d’un « interdit de s’appartenir ». Vos commentaires ?
PM : Dans le courant de notre recherche, ça a été vraiment la découverte que l’on a faite. Il faut replacer cette recherche dans son époque : maintenant, ces idées sont devenues plus courantes, presque évidentes, toutes les féministes le disent, mais quand on a fait cette recherche à la fin des années 90, le terme de féminicide n’était pas du tout utilisé. Nous, on a trouvé femicide en Anglais, et on ne l’a pas traduit, on a écrit femicide. Notre éditeur nous a obligées à mettre « crime passionnel » en titre mais dès la première ligne, on a écrit « crime dit “passionnel“ », avec dit en italiques et passionnel entre guillemets. Ça a l’air un peu prétentieux de dire ça mais on était vraiment en avance par rapport à ce qui aujourd’hui est évident dans la pensée féministe.
Ce que nous avons découvert à ce moment-là, nous ne l’attendions pas… Comme on était en avance, on s’imaginait vraiment qu’on allait trouver des histoires de passion. En fait pas du tout. Et on avait pas mal travaillé sur les différents concepts proposés notamment par les féministes radicales, et quelques autres, pour qualifier la hiérarchie entre hommes et femmes. Parmi ces concepts, il y a « patriarcat », il y a « domination masculine », qui est venu 20 ans plus tard par Bourdieu, il y a « valence différentielle des sexes » » qui est venu plus tard aussi, par Françoise Héritier, et il y avait le concept d’« appropriation des femmes » de Colette Guillaumin, qu’elle met en évidence en 1978 [3], donc exactement 20 ans avant La domination masculine. Et quand on avait lu le travail de Guillaumin sur l’appropriation des femmes, on s’était dit : « bon, elle exagère peut-être ». Sur l’appropriation, sur l’appropriation privée, l’appropriation publique, ses analyses étaient très intéressantes mais on s’est dit quand même qu’elle poussait le bouchon.
Et de fait, ce que nous avons trouvé dans ces familles, c’est l’évidence de l’appropriation, c’est-à-dire que les hommes considèrent comme absolument évident que leur femme leur appartient, que les femmes appartiennent aux hommes. Les femmes, elles, nous avons découvert qu’elles ont rencontré un interdit de s’appartenir. Quand on regarde un peu en détail l’histoire de ces femmes, toute leur vie, depuis l’enfance, elles ont été empêchées d’accéder à l’indépendance et à la culture. Ce sont des filles qu’on pouvait enlever de l’école pour remplacer leur maman à la maison, pour qui faire ses devoirs n’était pas une priorité parce qu’il fallait d’abord faire le ménage. Elles ont rencontré une emprise extrêmement rigide, un autoritarisme très fort des parents, ce sont des filles – il y en a plusieurs dans notre corpus – qui ont été emmenées chez le gynéco pour vérifier leur virginité, parce qu’elles étaient soupçonnées de l’avoir perdue. Donc une emprise et un autoritarisme rigide, qui inclut le corps : quand on va jusqu’à vérifier votre virginité, il y a vraiment un interdit de s’appartenir.
Et en même temps, une extrême négligence, un extrême abandon : il y a une très forte surveillance sur la sexualité mais en même temps une extrême négligence sur la santé, sur l’expression des désirs, des sentiments. C’est ce que nous avons appelé « interdit de s’appartenir » : certaines de ces femmes ont développé une position que nous avons appelée dépendance à la soumission, parce que c’était, au fond, la seule façon de trouver de la valeur dans leur famille.
Sur le plan psychique, il se trouve dans ces familles-là qu’être une femme qui ne s’appartient pas, qui appartient à son homme, à sa famille, est la seule valeur proposée aux jeunes filles ou femmes. Il n’y a rien d’autre, il n’y pas d’échappée : quand c’est la seule valeur que vous pouvez avoir, vous essayez de l’obtenir.
FS : Une amie originaire du Liban m’avait donné l’exemple de sa mère qui avait eu cinq enfants parce que, d’après ce que celle-ci disait, elle ne sentait avoir de la valeur aux yeux de son entourage, elle ne se sentait respectée et prise en considération que lorsqu’elle était enceinte : elle disait « je suis traitée comme une reine quand je suis enceinte » – mais évidemment pas le reste du temps. D’où le genre de comportement que vous décrivez.
PM : Bien sûr, il y a encore des cultures qui fonctionnent comme ça : où la seule valeur d’une femme, c’est d’avoir un fils. Après, elles tyrannisent leur belle-fille et organisent pour elle des avortements préférentiels de fœtus féminins.
FS : Vous rappelez cette situation paradoxale « les relations entre hommes et femmes ont ceci de particulier …qu’elles sont les seules relations de domination sociale où le dominant et le dominé sont supposés s’aimer ». Vous notez que, parmi les femmes qui subissent les plus graves violences, près de la moitié se disent « amoureuses de leur conjoint ». Comment l’obligation d’amour, auquel les femmes sont socialisées dès l’enfance comme étant la vocation féminine par excellence, est-elle partie prenante dans l’acceptation par les femmes de la violence et du contrôle de leur compagnon ? L’amour, c’est quand même un problème pour l’émancipation des femmes…
PM : Bien sûr que c’est un problème. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. La première, c’est effectivement qu’il y a socialisation à l’amour, à l’amour hétérosexuel. Une de mes amies sociologue féministe disait : « c’est un goût, comme tous les autres, ça s’acquiert dans le milieu ». C’est la seule personne que j’ai entendue définir ça comme ça et ça m’a frappée comme une évidence. Ça s’acquiert par la socialisation et de fait, on voit bien que les femmes hétérosexuelles tendent à préférer les hommes dominants [4].
FS : Tout à fait. La domination est une grande part de ce qui attire les femmes vers les hommes – le pouvoir masculin.
PM : Oui, c’est ce qui est excitant, on est socialisées très jeunes à trouver ça excitant. Mais d’un autre côté, il y a ce fait que le couple se stabilise psychiquement au niveau de celui qui va le plus mal, c’est une loi. Quand on est amoureux, on espère qu’on va tirer l’autre vers le mieux, mais ça ne marche jamais.
FS : Ce sont plutôt les femmes qui essaient de « sauver » les hommes, non ? Parce que généralement, les hommes ne s’occupent pas beaucoup de sauver les femmes.
PM : Moins, c’est vrai. Mais il se passe quelque chose dans ces couples-là, tout se passe comme s’il absorbait la violence interne de la femme, alors que de son côté elle absorbe les sentiments d’inadéquation, d’impuissance et de mépris de soi de l’homme. Ainsi, toute la violence est déléguée à l’homme, et toute la dépendance déléguée à la femme. Et ces femmes disent : « sans moi, il ne pourrait pas survivre ». C’est parce qu’elles sont en contact direct avec la dépendance que lui ne peut pas éprouver parce qu’elle est camouflée derrière le masque viril. Lui au contraire voit en elle la violence, le pouvoir qu’il lui dénie : « elle m’a obligé, elle me tyrannise ». Vous dites qu’ils sont de mauvaise foi, mais pas seulement, c’est leur fantasme aussi.
La socialisation des femmes à l’amour comme dévouement joue un rôle extrêmement important dans l’acceptation par les femmes de la violence et du contrôle des hommes. Ce n’est pas une socialisation à n’importe quel amour : si elles sont bien dévouées, bien bonnes, bien soumises, bien appropriées, elles espèrent en retour recevoir de la reconnaissance, être reconnues – mais ça ne marche jamais [5]. C’est une socialisation à cette forme-là de l’amour. Parce que les hommes aussi, ils aiment…
FS : Mais l’amour n’a pas du tout le même sens pour eux que pour les femmes…
PM : Ce n’est pas le même amour. Et c’est cette forme-là de l’amour qui est tellement préjudiciable aux femmes.
FS : Que pensez-vous de l’efficacité des stages de rééducation des hommes violents tels qu’ils ont été largement développés au Québec par exemple ?
PM : Malheureusement, je n’ai pas de données, j’ai essayé de chercher mais je n’ai pas trouvé. Dans mon souvenir, les psys québécois qui animaient de tels groupes de parole étaient extrêmement déçus par les résultats qu’ils obtenaient. Les hommes qui font ça n’adhèrent pas vraiment, ils font ça par obligation, ils ont du mal à se représenter les femmes autrement. Ils arrivent à faire des choses comme la gestion de la colère, à reconnaître une émotion de colère et à différer le passage à l’acte. C’est de la rééducation, et on arrive à leur apprendre ça. Mais quant à transformer leur représentation des femmes, ça ne marche pas. Et du coup, je suis hyper-sceptique pour ces groupes où il s’agit de gérer ses émotions, gérer sa colère, de rééducation… Ça n’a qu’un temps. Et ils ne changent pas au fond.
FS : J’ai trouvé de la documentation sur d’autres pays que le Québec où ces stages de rééducation avaient été largement développés, en particulier auprès des criminels emprisonnés pour violences, en Suède, pays où l’éducation est « non-sexiste ». Pourtant la Suède – et c’est ce qu’on appelle le « paradoxe nordique » – est un pays dont le taux de féminicides, proportionnellement au nombre d’habitants, est près du double de celui de la France. Ça permet de relativiser un peu l’efficacité de ces stages de rééducation des hommes violents à la non-violence.
PM : J’ai quelque chose là-dessus, c’est une vieille recherche, de Karen Stout [6] qui date de 1992 : elle examine les chiffres des homicides conjugaux dans différents états des États-Unis et note qu’ils ont tendance à se faire plus rares dans certaines conditions. Premièrement, quand la situation économique des femmes est moyenne, ni trop favorable, ni trop défavorable. Deuxièmement, dans les États qui promeuvent l’égalité des sexes et la justice sociale à l’égard des femmes. Troisièmement, dans les États où il y a des refuges pour les femmes victimes de violences.
FS : Vous parlez de « l’extraordinaire tolérance dont bénéficient les violences conjugales en France » qui « frise la non-assistance à personne en danger » par la police, l’appareil judiciaire et l’opinion commune. On l’a vu récemment quand des hommes politiques se sont vus accusés de violences conjugales : de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux étaient que c’était là une affaire privée qui ne concernait que les intéressé·es. Comment expliquez-vous cette résistance à considérer des crimes comme des crimes – dès le moment où ils se produisent dans la sphère privée ?
PM : C’est la définition même de la sphère privée : la sphère privée est essentiellement une sphère privée de droits. Enfin, privée de droits : certains sujets sont privés de droits, en l’occurrence les femmes et les enfants. Les enfants, c’est la définition même du statut de mineur : ils sont privés de citoyenneté, sous le prétexte de les protéger [7]. Et en ce qui concerne les femmes, on voit bien que les violences conjugales restent « plus ou moins légitimes », au sens où elles ne sont pratiquement pas sanctionnées. On a beau faire des efforts, on a beau former les policiers, créer des cellules d’accueil… Il y a eu un débat intéressant il y a quelques jours, sur la création de juridictions spécifiques pour les violences conjugales. Vous savez comment on a tranché à ce sujet ?
FS : Je sais seulement qu’il y a eu une proposition de loi faite à l’Assemblée nationale sur la création de telles structures et je crois que Dupont-Moretti s’y est opposé [8].
PM : On voit très bien que ça reste non-sanctionnable. Les femmes sont par définition suspectes de mentir, et c’est congruent avec la définition même du consentement sexuel. Le consentement sexuel, dans notre pays, c’est ne pas dire non. Ne pas dire non assez fort, ne pas dire non assez fermement, ne pas dire assez non. Alors que l’Espagne vient de passer une loi « solo si es si » – seul un oui est un oui – pour redéfinir le consentement comme nécessairement explicite. Donc on voit bien qu’en France, les femmes ne sont pas crues, elles ne disent jamais assez non dans les affaires de viol. Un autre exemple, ce sont les affaires de divorce et de garde d’enfants : les femmes ne sont pas crues quand elles dénoncent des violences intrafamiliales de la part de leur conjoint sur leurs enfants.
FS : Absolument, dénoncer un inceste, c’est même la meilleure façon de perdre la garde de son enfant.
PM : Le meilleur moyen de se faire enlever son enfant, c’est de dire qu’il est victime de son père. À cause de cette thèse masculiniste de l’aliénation parentale qui est vraiment une horreur [9]. On voit très bien comment les femmes sont toujours suspectes, et comment la violence des hommes sur les femmes, au fond, ce n’est pas si grave. Aux yeux de notre justice, de notre police et de nos politiques. C’est vrai que tout le monde parle du mouvement #metoo, et ça m’exaspère parce que c’est une manière de prétendre qu’il n’y a rien eu avant, alors que ce mouvement arrive après 50 ans de féminisme où la question du viol, des abus sexuels et de la justice, on en a parlé et reparlé. On voit très bien qu’il y a maintenant un discours très complaisant : « maintenant toutes les femmes veulent se faire passer pour des victimes ». Dénoncer son agresseur, ça serait du victimaire. Dénoncer son agresseur, ce n’est pas être une victime, c’est sortir de la position de victime.
[1] Torrollion Florence (2021). Ma mort dans ses yeux. Paris : Horsain.
[2] Molinier Pascale (2000). Virilité défensive, masculinité créatrice. Travail, genre et société, 1(3), pp. 25-44. https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2000-1-page-25.htm?contenu=article
[3] Guillaumin, C. (1978). Pratique du pouvoir et idée de nature : 1/ L’appropriation des femmes, 2/ Le discours de la nature. Réed. (1992). Sexe, race et pratique du pouvoir, l’idée de nature. Paris : Côté-femmes.
[4] Bozon Michel (2006). La formation du couple. Textes essentiels pour la sociologie de la famille. Paris : La Découverte.
[5] Benjamin Jessica (1988). The Bonds of Love : Psychoanalysis, Feminism and the Problem of Domination. Trad. (1992). Les liens de l’amour. Paris : Métailié
[6] Stout Karen (1992). Intimate femicide, an ecological analysis. Journal of Sociology and Social Welfare, 19 (3) 29-50.
[7] Delphy Christine. Minorité légale ou incapacité réelle ? Le statut des enfants. In : Cahiers du GEDISST (Groupe d’étude sur la division sociale et sexuelle du travail), N°11, 1994. Division du travail. Rapports sociaux de sexe et de pouvoir. Séminaire 1993-1994. pp. 9-22.
[8] https://www.publicsenat.fr/article/politique/juridiction-specialisee-sur-les-violences-intrafamiliales-pourquoi-l-executif-n-en
[9] https://blogs.mediapart.fr/revue-deliberee/blog/010720/qui-profite-la-pseudo-theorie-de-l-alienation-parentale
https://revolutionfeministe.wordpress.com/2023/01/08/feminicide-crime-passionnel-ou-crime-possessionnel/








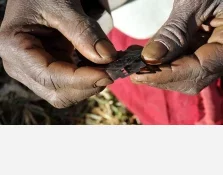

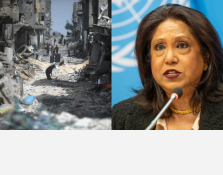

Un message, un commentaire ?