Conclusion du livre « La société ingouvernable » de Grégoire Chamayou
La séduction que le néolibéralisme a malgré tout pu exercer tient à sa double promesse d’autonomie individuelle et d’autorégulation sociale. Contre les anciennes tutelles, contre les corsets de la discipline, il fait miroiter l’image de sujets émancipés, jouissant de « l’autonomie d’un entrepreneur de sa vie » et que l’on peut « responsabiliser à ce titre ».Contre les rigidités verticales du commandement et du contrôle, contre l’interventionnisme d’un État bureaucratique, il offre l’utopie d’une « régulation cybernétique de l’économie de marché », où le profit servirait d’instrument transcendant d’une régulation globale dont tout le monde est bénéficiaires, même si momentanément, quelques-uns sont plus bénéficiaires que d’autres »…
Si vous êtes à la recherche d’un « art de ne pas être gouvernés », en somme, tournez-vous vers Hayek et consorts. Là vous trouverez une « forme de rationalité gouvernementale qui laisse déployer le désir des individus, qui prend acte du fait qu’il est plus efficace de laisser faire, au moins partiellement, plutôt que de vouloir tout contrôler, fixer, réprimer ».
Cette vision enchantée, quasi libertaire de la gouvernementalité néolibérale est trompeuse.
Les stratégies élaborées pour conjurer la « crise de gouvernementalité de la démocratie » convergent bien plutôt vers le libéralisme autoritaire dont il est temps de préciser la définition.
L’autorité, a-t-on coutume de dire en sciences politiques, ne suffit pas par elle-même à caractériser l’autoritarisme. Certes, mais qu’est-ce qui le définit alors ? L’abus d’autorité ? Les empiétements plus ou moins poussés de « l’autorité » sur les « libertés » ? Sans doute. Mais aussi plus fondamentalement autre chose, qui forme la cœur du concept : est autoritaire un pouvoir qui s’affirme comme le seul véritable auteur de la volonté politique. Les partisans de l’État autoritaire vantent ainsi les vertus d’une volonté souveraine « autonomisée et responsable envers elle-même », « neutre » car indépendant du Parlement et des partis.
En pratique cependant, l’érection d’une volonté souveraine autonomisée, détachée du demos, implique que soient restreints les moyens de pression subalternes sur la prise de décision politique. L’affaiblissement des pouvoirs parlementaires, la répression des mouvements sociaux, l’amoindrissement des droits syndicaux, de la liberté de presse, des garanties judiciaires, etc., participent d’un même processus d’insularisation et de verticalisation de la décision souveraine.
Si les défenseurs d’un « État fort » ne se font pas tous la même idée de ce que cette force recouvre, jusqu’où concrètement elle peut aller, de la simple démonstration de fermeté jusqu’à la répression systématique des opposants, ils s’accordent cependant pour considérer que l’autorité de l’État doit, pour se rehausser, se délester des pressions de la « volonté populaire ».
Mais à ce dernier aspect de la notion, le versant libéral ajoute une seconde dimension qui implique paradoxalement de restreindre cette même autorité qu’il s’agissait de renforcer en premier lieu. Quand bien même l’État libéral autoritaire serait tout-puissant dans sa sphère, cette sphère aura été sévèrement limitée. Sous un refus affichée de « l’interventionnisme », ce bornage économique du champ de la décision politique recouvre réalité – Hayek n’en faisait pas mystère – l’interdit fondamental de toucher à l’ordre des inégalités sociales, la répudiation de toute politique de redistribution. Comme nous en avertissait Heller, un libéralisme autoritaire est un autoritarisme socialement asymétrique. Tout dépend à qui il a affaire : fort avec les faibles, faible avec les forts.
Loin de se réduire au cas extrême de la dictature libérale, la notion de libéralisme autoritaire ainsi définie s’applique à toutes les situations où, à une limitation du périmètre de la décision politique par l’interdit économie (son versant libéral), s’associe une restriction des moyens de pression subalternes sur la prise de décision politique, (son versant proprement autoritaire).
Il n’y a pas simple conjonction accidentelle entre certain type de programme économique et un certain style de gouvernement, mais, plus profondément, articulation fonctionnelle et stratégique entre la réduction du champ d’intervention de l’État et le renforcement de son autorité dans ce champ limité – ceci selon un rapport réciproque. Car si, comme l’écrivait l’un des pères fondateurs de l’ordolibéralisme, Alexsander Rüstow, l’auto-limitation de l’État est « la condition de l’expression de son indépendance et de sa force » en ce qu’elle lui permet d’échapper aux « groupes d’intérêts » dont il est sinon la « proie » ; si, donc, c’est pour mieux se renforcer que l’État doit se limiter, il n’en reste pas moins, comme l’a remarqué Schmitt, il ne peut procéder à cette ablation sans un être au préalable renforcé, politiquement et policièrement, car cette opération implique la confrontation avec les intérêts sociaux subalternes qui y ont partie liée.
Or autant il peut exister des régimes autoritaires qui ne soient pas économiquement libéraux autant il est difficile de concevoir une politique néolibérale qui ne procède pas, par principe, à la première limitation (bornage économique de la politique), et, par nécessité stratégique – à moins d’imaginer un peuple composé de patrons et de rentiers – à la seconde (étouffement plus ou moins appuyé de la manifestation politique des intérêts subalternes). On a beaucoup dit que le libéralisme autoritaire était un oxymore, ce serait plutôt un pléonasme.
Mais la dimension autoritaire du néolibéralisme excède la sphère du pouvoir d’État. Ce que défend bec et ongles mondent des affaires – tel est le sens de sa mobilisation politique – c’est l’autonomie de son gouvernement privé. S’il y a bien un acteur social qui ne veut pas être gouverné, c’est lui : se rendre soi-même ingouvernable, mais ceci pour mieux gouverner les autres.
Organisant l’ingouvernabilité des marchés, le néolibéralisme les élève au rang de dispositif de gouvernance. On a indiqué par quels moyens la conduite des managers fut alignée sur la valeur actionnariale. Tandis que cependant que les dirigeants ont vu leurs marges de manœuvre décisionnelle restreintes par leur subordination accrue aux marchés boursiers, leur autorité, celle qu’ils exercent sur leurs subordonnés, n’a pas dépéri. L’intensification des de disciplines de marché va de pair avec le renforcement du pouvoir des grands et des petits chefs dans les organisations.
La politique néolibérale en ce qu’elle pratique la dérégulation, notamment du droit du travail, renforçant le pouvoir de l’employeur dans une relation contractuelle, en ce qu’elle précarise et insécurise les travailleurs, affaiblissant leur rapport de force, réduisant leur capacité de refus, leur liberté, en ce qu’elle favorise l’accumulation des richesses, creusant des inégalités, exacerbant par là plus encore les opportunités de subjugation de tous ordres, implique un raffermissement des autoritarismes privés. C’est en ce sens-là que le libéralisme économique est autoritaire au sens social et, pas seulement étatique.
On a pu présenter le néolibéralisme comme l’État l’expression d’une « phobie d’État ». En réalité, il s’accommode très bien du pouvoir d’État, y compris sous des formes autoritaires, tant que cet État demeure libéral au plan économique.
De quoi leur est-il « phobique » ? On l’a vu sur l’exemple de la question écologique : crainte de la régulation, de ses coûts pour le capital, de ses empiétements sur les prérogatives managériales, et, derrière, horreur des mouvements sociaux, de la « démocratie- mouvement » et de ses exigences, à juste titre perçues comme tendanciellement antinomique avec l’organisation capitalise de la production et le primat de la valeur qui la fonde.
Pour les économistes qui s’efforçaient dans les années 70 de rebâtir de nouvelles théories de la firme, tout comme pour les spécialistes du management qui s’interrogeaient à la même période sur les limites du pouvoir disciplinaire de l’entreprise, il y avait un objet plus précis, si ce n’est de phobie, du moins de préoccupation. Non pas l’État, mais l’autogestion.
C’était le grand thème de la gauche radicale de l’époque. Nourrissant ses réflexions d’une multitude d’expériences alternatives, dans les coopératives, les occupations d’usines avec contrôle ouvrier ou encore les entreprises autogérées, et ils y voyaient une nouvelle voie prometteuse, une alternative possible aussi bien à la firme capitaliste qu’à la bureaucratie étatique.
On l’a oublié, mais les défenseurs de la « libre-entreprise » dans une situation – du moins au début de la période – proche de la banqueroute intellectuelle, s’intéressaient aussi de très près aux théories autogestionnaires. L’idée selon laquelle « l’individualité dans la coopération » puisse se révéler socialement et historiquement supérieure à « la compétition dans l’individualisme » ainsi que le chantait dans ces mêmes des années Colette Magny, apparaissait aux néolibéraux comme une hypothèse suffisamment crédible pour qu’ils dépensent beaucoup d’encre et de papier à tenter de la réfuter. Et pour cause.
L’anti-étatisme des courants autogestionnaires, leur pensée de l’immanence, de l’autonomie de l’auto-organisation exerçait sur eux un attrait indéniable. L’autogestion en ce qu’elle était une tentative de rupture avec l’étatisme économique et un projet de dépassement à la fois du gouvernement managérial et de la pseudo-régulation par le marché, leur apparaissait comme un véritable défi. Tel était l’ennemi principal, sur le terrain théorique. De là pouvait venir le danger pour l’avenir, bien plus au fond que d’un keynésianisme moribond.
La grande réaction s’est préparée dans les années 70 ne fut pas tant conçue comme une alternative à l’État-providence que comme une alternative à la contestation de celui-ci. Ce fut une alternative à l’alternative. Sans doute aurait-on là une bonne indication pour savoir d’où repartir aujourd’hui : contre le libéralisme autoritaire rouvrir le chantier de l’autogestion.
Tiré de Reporterre.
Partout, ça se rebiffait. Les années 1970, a-t-on dit à droite et à gauche, du côté de Samuel Huntington comme de Michel Foucault, ont été ébranlées par une gigantesque « crise de gouvernabilité ».
Aux États-Unis, le phénomène inquiétait au plus haut point un monde des affaires confronté simultanément à des indisciplines ouvrières massives, à une prétendue « révolution managériale », à des mobilisations écologistes inédites, à l’essor de nouvelles régulations sociales et environnementales, et – racine de tous les maux – à une « crise de la démocratie » qui, rendant l’État ingouvernable, menaçait de tout emporter.
C’est à cette occasion que furent élaborés, amorçant un contre-mouvement dont nous ne sommes pas sortis, de nouveaux arts de gouverner dont ce livre retrace, par le récit des conflits qui furent à leurs sources, l’histoire philosophique.
On y apprendra comment fut menée la guerre aux syndicats, imposé le « primat de la valeur actionnariale », conçu un contre-activisme d’entreprise ainsi qu’un management stratégique des « parties prenantes », imaginés, enfin, divers procédés invasifs de « détrônement de la politique ».
Contrairement aux idées reçues, le néolibéralisme n’est pas animé d’une « phobie d’État » unilatérale. Les stratégies déployées pour conjurer cette crise convergent bien plutôt vers un libéralisme autoritaire où la libéralisation de la société suppose une verticalisation du pouvoir. Un « État fort » pour une « économie libre ».
Grégoire Chamayou est agrégé de philosophie et chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Cerphi ENS Lyon.
La société ingouvernable de Grégoire Chamayou, éditions La Fabrique, octobre 2018, 336 p.



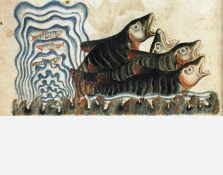








Un message, un commentaire ?