20 novembre 2025 | tiré de contretemps
Nous publions un extrait de l’introduction de Découvrir le marxisme écologique paru aux Éditions Sociales en août 2025.
Dans cet ouvrage, les philosophes Alexis Cukier et Paul Guillibert présentent dix textes (dans l’ordre des chapitres de l’ouvrage : Ted Benton, James O’Connor, Maria Mies, Ariel Salleh, John Bellamy Foster, Kohei Saito, Michael Löwy, Andreas Malm, Jason Moore, Alyssa Batistoni) qui permettent de saisir les principaux concepts du marxisme, ses liens avec d’autres courants, notamment l’écoféminisme, et ses enjeux politiques actuels.
L’introduction, intitulée « Un nouveau marxisme pour la révolution écologique » présente les principales caractéristiques du marxisme écologique – c’est l’objet de l’extrait ci-dessous, constitué de ses deux premières parties – puis les débats stratégiques qui le traversent et qu’il permet d’éclairer.
Alexis Cukier et Paul Guillibert, Découvrir le marxisme écologique, Éditions Sociales, 2025, 176 p., 12 euros
La catastrophe est déjà là. Partout sur la planète, des écosystèmes sont au bord de l’effondrement. Les températures ont augmenté si vite que certaines parties de la biosphère sont déjà en passe de devenir inhabitables. Alors que la hausse des températures globales n’a pas encore atteint 1,5 °C par rapport à la période préindustrielle, les pires scénarios climatiques sont en train de se réaliser. Et l’on entend brûler les feux assourdissants des flammes entretenues par les capitalistes fossiles avec le concours de leurs alliés néofascistes.
Pourtant, si la réalité de la catastrophe est désormais incontestable, l’écologie politique se dispute sur ses causes. Faut-il imputer la crise à des traits anthropologiques fondamentaux de l’espèce humaine, son insatiable et éternel désir de consommation ? Faut-il au contraire incriminer des modes de pensée typiquement modernes ? Ou alors, serait-ce le cumul de choix technologiques inadaptés qui nous aurait insidieusement conduits à la situation actuelle ? L’économie capitaliste serait-elle la principale responsable du désastre ?
Les différentes approches de l’écologie politique divergent sur la façon de comprendre l’histoire de la catastrophe. Elles proposent des pistes qui, sans être toujours contradictoires ou exclusives, n’en mettent pas moins l’accent sur des tendances différentes au sein des sociétés modernes. Certains insistent donc sur l’insatiabilité humaine dont témoignerait le désir effréné de consommation, d’autres sur la marchandisation, le productivisme et la croissance. Certains accusent la cosmologie « naturaliste » occidentale ou les technologies modernes, d’autres insistent sur l’histoire coloniale des plantations esclavagistes ou sur la domination conjointe des femmes et de la nature.
Les mobilisations écologistes elles-mêmes ont adopté des stratégies variées pour conjurer la catastrophe. Le mouvement écoféministe de la Women’s Pentagon Action et la lutte paysanne du Larzac ont ciblé l’institution militaire et ses infrastructures nucléaires. Le mouvement Chipko Andolan en Inde et le Mouvement des sans-terre au Brésil se battent pour la réappropriation des conditions naturelles de la vie, c’est-à-dire pour la communauté de la terre et contre la propriété privée. De Standing Rock à Notre-Dame-des- Landes, des activistes se défendent contre l’extractivisme et les grands projets inutiles. C’est dans ce panorama théorique et politique qu’a émergé le marxisme écologique.
Marx, le capital et l’Empire : les trois fondements du marxisme écologique
Marxisme(s) écologique(s), écomarxisme, green marxism, tous ces termes expriment la volonté de repenser le marxisme dans une perspective écologique, en rompant avec le productivisme qui a caractérisé une partie de l’œuvre de Marx et Engels et la très grande majorité des courants marxistes ultérieurs. Si l’on voulait dater la naissance de ce courant, la fondation de Capitalism Nature Socialism en 1988, revue à laquelle a participé la première génération d’auteurs écomarxistes importants (James O’Connor, Ted Benton, John Bellamy Foster, Paul Burkett[1] ou encore Ariel Salleh), ferait sans doute une borne chronologique pertinente.
En raison de sa diversité interne, nous préférons parler de « marxismes écologiques » au pluriel. Trois éléments principaux les distinguent des autres courants de l’écologie politique. Ces diverses théories matérialistes : 1) se concentrent sur le rôle du mode de production capitaliste dans la trajectoire écocidaire des sociétés modernes ; 2) se réclament d’un rapport étroit – qu’il soit critique ou apologétique – à la pensée de Marx et 3) développent des analyses de longue durée et à l’échelle mondiale, impliquant une critique de l’impérialisme écologique.
Les marxismes écologiques affirment d’abord que le capitalisme est le principal responsable de la crise écologique, un constat qui n’est pas unanimement partagé en écologie politique. À la différence des pensées de la décroissance, par exemple, les marxismes écologiques défendent que les tendances au développement infini de l’économie et au dépassement des limites planétaires ne sont pas d’abord liées à une croissance de la demande de consommation mais à un système de production fondé sur l’accumulation de capital. La reproduction cyclique de crises de surproduction est bien le symptôme que le problème écologique du capitalisme n’est pas réductible à l’augmentation de la demande en consommation (cf. chap. 2).
Comme l’ont fort bien montré l’économiste décroissant Timothée Parrique ou le philosophe écomarxiste Kohei Saito (cf. chap. 6), marxisme écologique et décroissance peuvent avancer main dans la main, à condition de reconnaître que la décroissance de la consommation globale de matière et d’énergie n’est pas l’objectif principal. La finalité stratégique de l’écomarxisme, c’est le dépassement du capitalisme, en d’autres termes, le communisme. La décroissance de la consommation globale de matière et d’énergie est légitime à condition de s’inscrire dans une stratégie anticapitaliste de bifurcation écologique. Le marxisme écologique élargit ainsi la définition marxiste du capitalisme comme un système fondé non seulement sur l’accumulation infinie de la valeur par la vente de marchandises pour le profit par l’exploitation du travail salarié, mais aussi sur l’appropriation gratuite et illimitée des forces naturelles.
À l’encontre, cette fois, des approches qui insistent sur le rôle du développement technique dans la trajectoire écocidaire des sociétés modernes, les marxismes écologiques montrent que ce développement est inscrit dans la logique de la valorisation capitaliste. Il est vrai que les écomarxistes ont parfois tendance à minorer le rôle des controverses scientifiques, des conflits technopolitiques et des logiques proprement technologiques dans l’instauration de rapports déprédateurs à l’environnement. Néanmoins, leur réponse générale aux approches techno-centrées consiste à démontrer la corrélation forte entre devenir technique des sociétés modernes et logique de l’accumulation du capital.
À cet égard, le travail d’Andreas Malm, chercheur en écologie humaine, nous semble fondamental (cf. chap. 8). En prouvant que l’adoption de la machine à vapeur alimentée au charbon était liée à l’histoire de la lutte des classes dans le capitalisme anglais du XIXe siècle, il a montré que la technique était impensable sans l’économie. Cela a permis de réinscrire la compétition technologique dans la loi de la concurrence capitaliste, et de montrer qu’il n’est pas possible de comprendre le moteur des innovations techniques responsables des désastres environnementaux indépendamment des rapports sociaux au sein desquels elles émergent. La place des forces naturelles dans le processus de production capitaliste a également eu une grande importance dans ces débats d’économie politique, comme le synthétise le texte d’Alyssa Battistoni sur le « travail de la nature » (cf. chap. 10).
L’une des controverses qui structure le champ du marxisme écologique et qui constitue son deuxième élément constitutif porte sur l’écologisme de Marx et d’Engels. On pourrait schématiser cette controverse en affirmant que deux positions antagonistes s’y sont exprimées. La première – développée notamment par Ted Benton (cf. chap. 1) ou James O’Connor (cf. chap. 2) – considère que la pensée de Marx et Engels est profondément structurée par une forme de productivisme. Certains textes marxiens sur le rôle des machines dans les Grundrisse témoigneraient par exemple d’une adhésion sans faille à l’idéal du développement humain par l’innovation technique et l’augmentation de la productivité industrielle.
L’autre approche, portée par des auteurs comme Paul Burkett, John B. Foster (cf. chap. 5) ou Kohei Saito (cf. chap. 6) insiste au contraire sur la dimension écologiste de la pensée marxienne, allant jusqu’à affirmer qu’on pourrait y trouver une pensée écologiste systématique. Ces auteurs se sont intéressés en particulier à l’usage par Marx des sciences naturelles – la géographie de Karl Fraas et l’agronomie de Justus Liebig notamment – et à sa formulation du concept de perturbation ou de « rupture du métabolisme entre les sociétés et la nature » dans Le Capital. Ces concepts marqueraient, selon eux, une rupture historique irréversible dans l’œuvre de Marx.
Dans ce débat, il nous semble que les positions les plus caricaturales ont été tenues et qu’il convient plutôt d’échapper à l’idée que Marx aurait été un « ange vert » ou un « démon productiviste », pour reprendre les mots de Daniel Bensaïd. C’est la perspective adoptée par Timothée Haug dans sa thèse de doctorat intitulée La rupture écologique dans l’œuvre de Marx : analyse d’une métamorphose inachevée du paradigme de la production. L’auteur démontre que Marx a amorcé une transformation radicale du paradigme productiviste qu’il défendait dans ses premières années – paradigme hérité notamment de Hegel –, mais que cette transformation inachevée laisse en place des schèmes productivistes jusqu’à la fin de son œuvre.
Il faudrait donc penser, dans le corpus marxien, un abandon progressif du productivisme au profit de l’écologisme et, en même temps, une tension persistante entre productivisme et écologisme. L’idée centrale de Haug est que cette évolution des rapports de Marx à la nature est liée à la coexistence de conceptions antagonistes de l’émancipation dans son œuvre : une émancipation vis-à-vis du travail qui suppose le développement de la production industrielle et du machinisme chez le premier Marx ; une émancipation dans le travail qui suppose la réappropriation collective des tâches de subsistance chez le second Marx et qui introduit une rupture, partielle, avec les schèmes productivistes du premier Marx.
Le dernier élément caractéristique du marxisme écologique relève d’une attention particulière aux logiques impériales-coloniales dans la trajectoire écocidaire du capitalisme sur la longue durée. C’est la raison pour laquelle l’histoire environnementale joue un rôle si important dans le développement des marxismes écologiques.
Les études de l’anthropologue Alf Hornborg sur les « échanges écologiques inégaux » ou encore le concept d’« écologie-monde » de Jason W. Moore (cf. chap. 9) en témoignent. Comme l’ont montré John B. Foster et Brett Clark, cette critique de l’« impérialisme écologique » trouve son origine dans les écrits de Marx, notamment dans des textes sur l’Irlande et le Pérou. Marx analyse comment, après avoir appauvri les sols de l’Angleterre, la puissance coloniale en est venue à piller les sols irlandais et à s’approprier les engrais naturels du Pérou, et suggère ainsi que la logique du capital conduit à une mondialisation de la crise écologique.
Nous avons fait le choix d’inscrire les travaux écoféministes de Maria Mies et de l’« école de Bielefeld » sur la division sexuelle et internationale du travail (cf. chap. 3) dans l’histoire des marxismes écologiques. Si ces autrices ne se sont jamais définies comme des écomarxistes, il nous a semblé néanmoins pertinent de les intégrer à cette anthologie.
D’une part, parce qu’elles partagent certaines des caractéristiques de ce champ : le « féminisme de la subsistance » (pour reprendre une expression de Geneviève Pruvost), co-fondé par Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen et Claudia von Werlhof, fait bien du patriarcat capitaliste et de la division sexuelle du travail la cause fondamentale de la catastrophe environnementale ; ces autrices établissent à cet égard un dialogue étroit, bien que critique, avec la pensée de Marx.
D’autre part, leur travail a eu une influence décisive sur le marxisme écologique, comme en témoignent les textes de James O’Connor ou de Jason W. Moore qu’on pourra lire dans ce recueil. Les mêmes arguments nous ont conduits à intégrer des textes de l’écoféministe socialiste Ariel Salleh (cf. chap. 4) : son rôle dans la création de l’importante revue écomarxiste états-unienne Capitalism Nature Socialism et dans les débats de l’époque lui donne une place remarquable dans la constitution de ce champ. Il nous semblait également important de montrer la proximité, et la distance, entre le marxisme écologique et certains courants matérialistes de l’écoféminisme.
Contraints d’arbitrer des choix difficiles lors de la composition de ce recueil, nous avons privilégié des extraits universitaires[2], dont certains sont inédits en français, pour donner à lire la grande diversité conceptuelle et la fécondité théorique des marxismes écologiques. Mais ces derniers ne sont pas seulement un courant académique, ils se présentent aussi, désormais, comme une tentative de renouveler le marxisme pour intervenir dans les débats stratégiques contemporains
Notes
[1] Paul Burkett (1956-2024), économiste états-unien et pion- nier de la lecture écologiste de Marx, est l’un des théoriciens écomarxistes majeurs que nous n’avons pas pu inscrire dans la table des matières de cet ouvrage, en raison de son format.
[2] Un ouvrage de synthèse sur le marxisme écologique, présentant une histoire complète et une analyse très utile, sera bientôt disponible en français. Voir Marius Bickhardt, Gauthier Delozière et Cannelle Gignoux, Le marxisme écologique, Paris, La Découverte, à paraître.








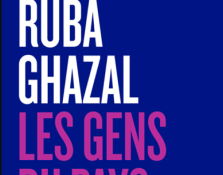



Un message, un commentaire ?