Tiré du blogue de l’auteur.
Le livre Découvrir le marxisme écologique, Éditions sociales, 2025, dirigé et présenté par Alexis Cukier et Paul Guillibert est une initiative intéressante car elle permet à un large public français d’entrer dans une problématique relativement récente. Elle est de plus originale car elle mélange des écrits de quelques penseurs faisant partie de ce courant écomarxiste[1] et des commentaires et explications sur les thèmes que ceux-ci abordent. Une dizaine d’entre eux sont ainsi présentés successivement : Ted Benton, James O’Connor, Maria Mies, Ariel Salley, John Bellamy Foster, Kohei Saito, Michaël Löwy, Andreas Malm, Jason W. Moore et Alyssa Battistoni.
La problématique est de mettre en évidence les intuitions de Marx concernant les dégâts écologiques engendrés par l’accumulation capitaliste, sans pour cela minimiser les possibles contradictions dues au « développement des forces productives » qui a longtemps été la pierre d’angle du marxisme, sinon de Marx lui-même.
Les auteurs présentés dans ce livre
On retiendra donc la relation entre le procès de travail et les limitations naturelles d’un Ted Benton. Également la mise en évidence de la « seconde contradiction » du capitalisme par James O’Connor (la première étant celle privilégiée par Marx entre les rapports de production et les forces productives de valeur) : celle entre rapports de production et conditions naturelles de production.
Suivent deux textes qui entreprennent d’intégrer ensemble théorie de l’exploitation et luttes féministes. Pour ce courant de pensée que représente ici Maria Miès, « la domination patriarcale ne peut pas se penser dans les termes généraux de l’oppression mais plutôt en termes d’exploitation, c’est-à-dire d’appropriation violente d’un surplus produit par la force de travail des femmes » (p. 57). D’une part, à notre avis, cela rompt avec une idée qui court parmi certains marxistes reconvertis à un certain idéalisme selon lesquels le concept d’exploitation doit être abandonné[2]. D’autre part, pour Maria Miès, « ce sont les capacités des femmes en tant que "productrices de vie" qui sont accaparées par le patriarcat » et « l’exploitation des femmes est incompréhensible sans une étude minutieuse de la division internationale du travail » (p. 57). De son côté, Ariel Salleh considère que « l’écoféminisme constitue un socialisme au sens le plus profond du terme » (p. 68 et 73). Elle réfute l’accusation d’essentialisme contre cette approche, car cette critique reproduit le dualisme consistant à assimiler les femmes à la nature tandis qu’elles sont infériorisées par apport aux hommes. Ainsi il s’agit d’« inscrire une dimension de genre dans la pensée écosocialiste » (p. 76).
Avec John Bellamy Foster, on rencontre l’un des auteurs qui a été le plus loin dans l’idée que Marx était, bien que le terme n’existait pas de son temps, un quasi-écologiste avant l’heure. Au nom du concept marxien de rupture de la relation métabolique que l’homme entretient avec la nature. Cukier et Guillibert notent que Foster se réfère à Paul Burkett, autre pionnier de la vision écologique de Marx, mais il est dommage que le travail de Burkett n’ait pas eu droit à un chapitre comme Foster, alors qu’ils ont aussi travaillé ensemble[3].
Parmi la nouvelle génération s’intéressant au Marx potentiellement écologiste, Kohei Saito[4] soutient que celui-ci a opéré à la fin de sa vie[5] un tournant lui faisant abandonner sa confiance dans le développement des forces productives pour s’orienter vers ce que Saito nomme le « communisme de décroissance » car « le développement soutenable des forces productives n’est pas possible dans le cadre du capitalisme » (p.103). Ainsi, les communes rurales russes préfigureraient selon Marx réinterprété par Saito comme « une cristallisation de sa vision non productiviste et non eurocentrée de la société future » (p. 106). Mais comme l’écrivent Cukier et Guillibert, « du point de vue du commentaire philosophique, il nous semble que les thèses de Saito sont le plus souvent exagérées : c’est peu de choses de dire qu’il est difficile de faire de Marx un penseur de l’écosocialisme et, à plus forte raison, un théoricien de la décroissance, lui qui est resté attaché aux "acquêts positifs" du marché mondial capitaliste jusqu’aux lettres à Vera Zassoulitch » (p. 110).
Le philosophe Michaël Löwy est l’un des théoriciens de l’écosocialisme. Selon lui, l’accumulation illimitée est impossible « sous peine d’une crise écologique majeure » qui menacerait « la survivance même de l’espèce humaine. La sauvegarde de l’environnement naturel est donc un impératif humaniste. » (p. 116). Cukier et Guillibert insistent sur le fait que la définition de l’écosocialisme par Löwy ajoute à l’aspect philosophique une composante stratégique à l’encontre du « capitalisme vert », cet « écoblanchiment qui permet la justification idéologique de la poursuite du business as usual en temps de catastrophe écologique » (p. 123).
L’aspect stratégique pour aller vers l’écosocialisme est au cœur des thèses défendues par Andreas Malm. Historiquement, le développement capitaliste s’est appuyé sur les fossiles alors que « l’eau demeurait à l’époque une énergie plus abondante, plus régulière et moins chère que le charbon » (p. 137). La raison principale se trouve dans « les rapports sociaux capitalistes » (p. 137). Il s’ensuit qu’il ne faut pas compter sur l’intérêt des acteurs économiques mais sur la puissance publique pour orienter cette transition » (p. 139). D’autant que cette transition est l’objet d’un conflit de classes.
L’originalité de Jason W. Moore au sein de l’écomarxisme est double. Il a intégré la critique de la dualité « Humain-Nature » des anthropologues Philippe Descola ou Bruno Latour à sa théorie de « l’écologie-monde du capitalisme »[6]. Et il a théorisé l’adjonction de l’appropriation de la valeur créée par la nature à celle créée par l’exploitation de la force de travail. Cette ajout renvoie aux « capacités de la nature à produire la vie » et à la « centralité du travail-énergie non rémunéré » (p. 144 et 146). Ainsi, Moore pense renouveler la théorie de la valeur de Marx en articulant exploitation du travail salarié et appropriation gratuite des forces naturelles. Et cela par analogie avec le travail reproductif gratuit effectué par les femmes.
Alyssa Battistoni est la dernière autrice écomarxiste présentée dans ce livre. Elle théorise le travail de la nature en redéfinissant le concept de travailleur productif pour y « inclure les humains et les non-humains » (p. 158)[7]. Elle pousse donc plus loin la logique latourienne jusqu’à « une "écologie politique des choses" qui accorde une puissance d’agir aux non-humains » (p. 162). Et Cukier et Guillibert en concluent que « c’est bien parce que le pétrole a une valeur marchande qu’on l’extrait et qu’on l’utilise » (p. 164). Eh bien, non ! pas du tout, c’est exactement, en bonne logique marxienne (et même classique de l’économie politique), l’inverse : c’est parce qu’on l’extrait (par le travail vivant et mort) que le pétrole a, dans le capitalisme, une valeur marchande.
Les auteurs écomarxistes et la théorie de la valeur de Marx
S’il y a un point sur lequel on peut s’accorder, que l’on soit d’accord ou non avec la théorie critique du capitalisme de Marx, c’est que le cœur de celle-ci est constituée par sa théorie de la valeur que l’on va résumer en une phrase (la gageure !) ainsi : la valeur des marchandises est déterminée par le travail socialement validé, étant posé qu’il s’agit bien selon lui du travail humain, on le souligne bien que ce soit redondant.
Il est heureux que Cukier et Guillibert aient placé à la suite l’un de l’autre et à la fin de leur livre les textes concernant Jason W. Moore et Alyssa Battistoni parce qu’ils permettent d’ouvrir une discussion sur la pertinence des approches dites écomarxistes et sur les désaccords entre les auteurs de ce courant.
Examinons le point auquel nous étions parvenus : selon ces auteurs, le pétrole (et, par extension, les ressources naturelles) aurait une valeur économique en soi, une valeur que certains appellent intrinsèque. « S’opposant aux éthiques environnementales et à l’écologie économique, Battistoni reconnaît cependant aux éthiques environnementale le mérite d’avoir montré que la nature a une valeur en soi et non seulement pour nous. Il faut donc penser ensemble la valeur intrinsèque et la valeur instrumentale » (p. 164). J’ai soutenu en de nombreux endroits[8] que cette notion de valeur économique intrinsèque est un oxymore. Le philosophe John Dewey l’avait aussi montré à propos de l’éducation parce que la valeur supposait une intervention extérieure à l’objet (ici, ce serait la relation de l’homme à la nature) :
« Il y a une ambiguïté dans l’usage des adjectifs "inhérent", "intrinsèque" et "immédiat", qui alimente une conclusion erronée. […] L’erreur consiste à penser que ce qu’on qualifie ainsi est extérieur à toute relation et peut être, par conséquent, tenu pour absolu. […] L’idée que ne pourrait être qualifié d’inhérent que ce qui est dénué de toute relation avec tout le reste n’est pas seulement absurde : elle est contredite par la théorie même qui relie la valeur des objets pris comme fins au désir et à l’intérêt. Cette théorie conçoit en effet expressément la valeur de l’objet-fin comme relationnelle, de sorte que, si ce qui est inhérent c’est ce qui est non relationnel, il n’existe, si l’on suit ce raisonnement, strictement aucune valeur intrinsèque. […] À strictement parler, l’expression "valeur intrinsèque" comporte une contradiction dans les termes. »[9]
Il s’ensuit que la catégorie valeur n’appartient pas à l’ordre naturel, elle est d’ordre socio-anthropologique. Mais là où Cukier et Guillibert ont raison, c’est de souligner que parler de valeur intrinsèque de la nature oblige à redéfinir le travail. Mais c’est, à notre sens, la deuxième faille de cette thèse. La théorie de la valeur de Marx associe le travail et la valeur économique dès lors que l’échange marchand valide le processus de production, tandis que la théorie néoclassique a rompu cette liaison en ne reconnaissant que le prix résultant des préférences individuelles. L’économie écologique, bien représentée au sein de la revue Ecological Economics, prétend avoir une troisième vision, rejetant les deux précédentes, pour adopter soit une conception de la valeur-énergie, soit sur une conception de la valeur naturelle appropriée, qui est aussi celle de Jason W. Moore. Cette dernière perspective s’appuie sur l’idée que les animaux travaillent (abeilles, animaux de trait…) ainsi que les éléments naturels (l’eau travaille, le pétrole travaille…).
La thèse sur le travail des animaux est très fréquente tant au sein de l’économie écologique que dans une partie du courant écomarxiste. Cependant, prenons deux essaims d’abeilles : l’un dans un rucher travaillé par un apiculteur, l’autre un essaim sauvage dans une forêt. Supposons que les deux essaims soient voisins et que toutes les abeilles butinent les mêmes fleurs, et que donc elles font à peu près le même miel. Quelle est la valeur économique du miel « sauvage » ? Nulle. Et pourtant il aurait la même valeur d’usage potentielle, sans avoir pour autant une quelconque valeur économique. La séparation entre valeur d’usage et valeur (la première étant une condition nécessaire de la seconde, sans que la réciproque soit vraie) est le fil conducteur qui va d’Aristote à Marx.
Tel est effectivement l’enseignement de Marx. Mais ce n’est parce qu’il l’a dit et répété que cela constitue une preuve. Or quelle est l’alternative ? La catégorie de travail et celle de valeur seraient-elles des catégories naturelles ? Épistémologiquement, il est préférable de penser que ces catégories sont anthropologico-socio-historiques. La croyance en des lois économiques naturelles chère aux classiques et néoclassiques trouve son alter ego dans l’économie écologique et se glisse chez des auteurs patentés marxistes.
Un autre point pourrait être mentionné au sujet de l’analyse de la crise capitaliste et qui pourrait être en revanche un point de ralliement entre écomarxistes et écologistes. L’évolution du taux de profit peut être décomposée en une variable de répartition (variation de la productivité du travail supérieure à celle du salaire) plus une variable d’efficacité du capital (variation de la production supérieure à celle du capital physique) qui peut coïncider avec la variation du taux de retour énergétique (EROI), sous réserve de l’hypothèse que les prix de l’énergie augmentent pour suivre la baisse de ce taux.
Malgré l’intérêt de l’ouvrage d’Alexis Cukier et de Paul Guillibert, il souffre de deux écueils qui pourraient être facilement surmontés. D’une part, il laisse croire qu’il y a une unité de pensée entre les auteurs dont le livre présente les travaux, en laissant dans l’ombre de nombreux travaux en partie critiques de ceux-là. Or ce courant, dénommé maintenant écomarxiste ou écosocialiste, est traversé de controverses importantes, notamment sur les deux points reliés entre eux, la valeur et le travail. D’autre part, on ne peut passer sous silence la dispute théorique importante entre Foster, Malm et Campagne opposés à Moore[10]. La récusation de toute coupure entre la société et la nature, défendue par Moore, est le pendant de l’élargissement de ces catégories de travail et de valeur aux non-humains et à la nature, tandis que la spécificité socio-anthropologique de ces catégories renvoie plutôt à une capacité relativement autonome des humains dans un cadre environnemental donné[11].
En conclusion, la question se pose de savoir dans quelle mesure le courant écomarxiste, dans sa diversité, se situe dans la perspective de Marx. D’un côté, il y a ceux qui font de lui un visionnaire écologiste de premier plan. À notre avis, ce serait plus sage de reconnaître ses intuitions indéniables, mais qui entrent en tension avec d’autres aspects de son œuvre. De l’autre, il y a ceux qui, sous couvert d’éclectisme intégrant les pires travers de l’économie néoclassique de l’environnement, transforment la théorie de la valeur en une suite de contresens. Il y a peut-être place pour plus de nuances[12].
Notes
[1] Pour simplifier, on retient ici à l’instar d’Alexis Cukier et de Paul Guillibert les termes de marxisme écologique, d’écomarxisme et d’écosocialisme comme synonymes au premier regard.
[2] Emmanuel Renault, Abolir l’exploitation, Expériences, théories, stratégies, Paris, La Découverte, 2023 ; recension critique : J.-M. Harribey, « Du travail et de l’exploitation, À propos du livre d’Emmanuel Renault », Blog Alternatives économiques, mars, https://blogs.alternatives-economiques.fr/harribey/2024/04/09/du-travail-et-de-l-exploitation-a-propos-du-livre-d-emmanuel-renault, et Les Possibles, n° 39, Printemps 2024, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/travail-exploitation.pdf.
[3] Paul Burkett and John Bellamy Foster, Marx and the Earth, Boston, Brill, 2016.
[4] Kohei Saito, Moins ! La décroissance est une philosophie, Paris, Seuil, 2024.
[5] Sur les derniers travaux de Marx, voir aussi Marcello Musto, Les dernières années de Karl Marx, Une biographie intellectuelle 1881-1883, Paris, PUF, 2023.
[6] Jason W. Moore, L’écologie-monde du capitalisme, Comprendre et combattre la crise environnementale, Paris, Éditions Amsterdam, 2024, traduction de Nicolas Vieillescazes, préface de Paul Guillibert. Voir ma recension dans J.-M. Harribey, « Le capitalocène de Jason W. Moore : un concept (trop) global ? », Contretemps, 4 octobre 2024, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/ecologie-monde-moore.pdf.
[7] Sur le travail de la nature, voir aussi Paul Guillibert, Exploiter les vivants, Une écologie politique du travail , Paris, Éd. Amsterdam, 2023. Et ma recension « Sur le livre Exploiter les vivants de Paul Guillibert », Blog Alternatives économiques, 15 décembre 2023, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/soutenabilite/exploiter-les-vivants.pdf.
[8] Notamment, Jean-Marie Harribey, La richesse, la valeur et l’inestimable, Paris, LLL ? 2013, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/ouvrages/livre-richesse-entier.pdf ; « Sur fond de crise socio-écologique du capitalisme, la théorie de la valeur revisitée », RFSE, 2020, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/theorie-valeur-revisitee.pdf ; En quête de valeur(s), Vulaines-sur-Seine, 2024 ; « La valeur est de retour », AOC, 14 mai 2025, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/valeur-de-retour.pdf.
[9] John Dewey, La formation des valeurs, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, La Découverte, 2011, p. 108-110.
[10] Voir le dossier publié par Actuel Marx, PUF, « Marxismes écologiques », n° 61, premier semestre 2017.
[11] Je renvoie à la communication que j’ai présentée en 2024 au séminaire d’Espaces Marx et en 2025 au colloque Historical Materialism : « Pourquoi le concept de capitalocène est-il l’objet de controverses théoriques et épistémologiques au sein même de la théorie marxiste ? » Conférence Historical Materialism, Paris, 26 au 28 juin 2025, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/conference-hm.pdf. Voir aussi mon article « Le capitalocène de Jason W. Moore : un concept (trop) global ?, Contretemps, 4 octobre 2024, https://harribey.u-bordeaux.fr/travaux/valeur/ecologie-monde-moore.pdf.
[12] Voir Timothée Haug, « La rupture écologique dans l’œuvre de Marx : analyse d’une métamorphose inachevée de la production », Thèse de doctorat de philosophie, Université de Strasbourg, 2022, https://theses.hal.science/tel-03774950v1/file/Haug_Timothee_2022_ED520.pdf
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d’avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d’avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

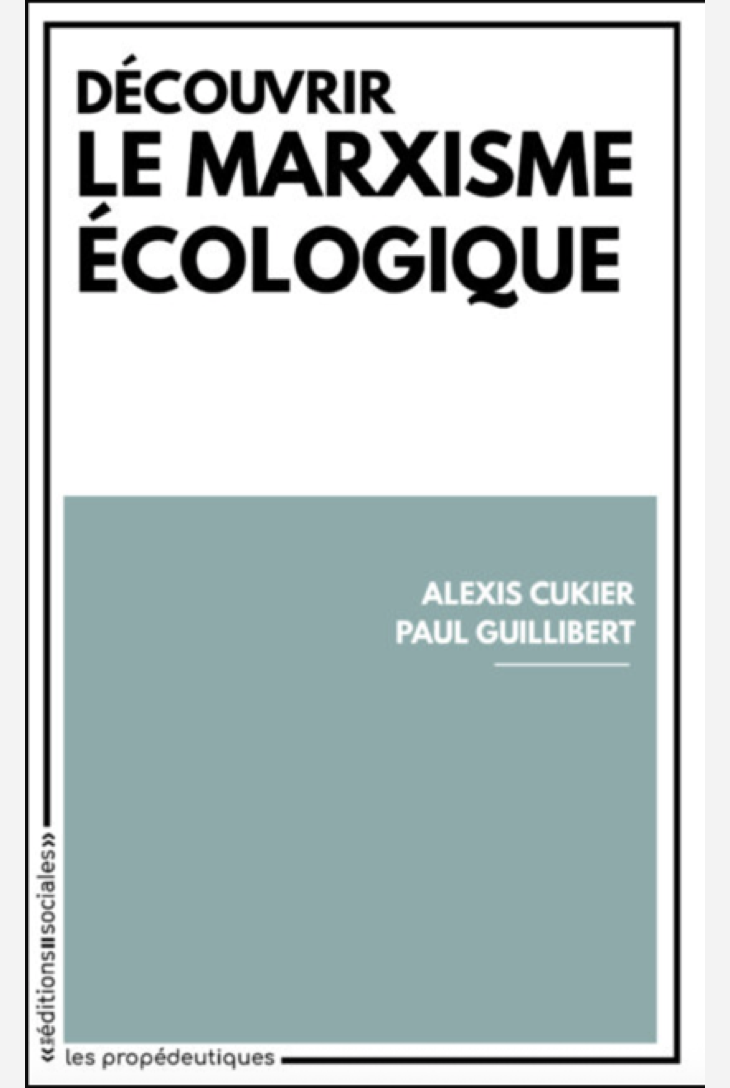










Un message, un commentaire ?