Je ne l’écris pas pour me plaindre, encore moins pour être prise en pitié, mais pour qu’on comprenne bien ce que ça signifie, être empêchée d’être soi-même, être forcée d’entrer dans un moule où l’on étouffe, sans lueur d’espoir à l’horizon. C’est mourir à chaque instant, et mourir encore. C’est n’être personne.
Le paradigme numérique
Conçu comme le cheval de Troie de la mondialisation néolibérale et de la société de consommation « pour tous », l’avènement de l’internet a ouvert, paradoxalement, un espace de liberté d’une ampleur sans précédent dans l’histoire humaine. Alors que la parole publique avait toujours été réservée à une élite, brusquement, n’importe qui pouvait atteindre simultanément tous les points de la planète, échanger avec des milliers d’inconnu·es de partout. Cette démocratisation de la production et de la consommation de l’information a produit du meilleur comme du pire, mais elle a exercé sur la vie humaine une influence aussi profondément transformatrice que la domestication du feu.
Les réseaux numériques ont notamment donné voix à des minorités qu’on avait ostracisées et bâillonnées jusqu’alors, ainsi qu’à des courants de pensée qui avaient été passés soigneusement sous silence. C’était un espace privilégié pour s’informer, échanger des renseignements, créer des liens. Bien sûr, le complotisme y a trouvé un terreau fertile, mais tout le monde n’a pas succombé à ses séduisantes propositions, et l’information solide et vérifiée a pu également circuler sans entraves. Outil de propagande, l’internet est ainsi devenu, en parallèle, un instrument de résistance à l’invisibilisation et à la désinformation.
À l’ère numérique, il n’y a plus d’excuses à l’ignorance. Dans mon enfance, dans les années 1960, je ne savais même pas que je pouvais exister. Je ne connaissais rien en-dehors de la binarité des genres. On me parlait des « tapettes » comme d’êtres méprisables, objets de risée et de dégoût dont il fallait se tenir loin, et j’étais terrifiée à la perspective d’en être une.
Depuis, il y a eu Stonewall, le mariage entre personnes du même sexe, les mouvements de la Fierté gaie – une fierté qu’on a bientôt étendue à l’ensemble des communautés LGBTQ+. Il y a eu des décennies de luttes qui ont mené à des lois un peu plus inclusives, permettant notamment à la majorité des personnes trans de changer leur nom et la mention de leur sexe à l’état-civil sans qu’il soit nécessaire d’avoir subi une chirurgie d’affirmation du genre. Bien qu’elle ait fait l’objet de vives controverses, cette mesure législative a rendu plus légère l’existence de milliers de personnes trans, sans rien enlever aux autres.
J’ai été parmi les premières à profiter de cette ouverture qui a changé ma vie. Cette reconnaissance officielle de mon identité de genre me permet enfin de marcher la tête haute, sans avoir à rougir de qui je suis.
Les spectres du vieux monde
Malgré ces quelques avancées, le vieil édifice de la binarité des genres tarde à s’effondrer, y compris au sein même des communautés LGBTQ+ qui sont loin d’être exemptes de queerophobie et de transphobie. Même après ma transition, je percevais encore les genres dans la perspective qu’on m’avait inculquée. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, et mon unique obsession était de convaincre que j’appartenais à la seconde catégorie, même si l’on avait toujours cru que je faisais partie de la première. J’étais très essentialiste dans le sens où j’affirmais être « née femme dans un corps d’homme », selon le stéréotype bien connu.
Je n’avais pas encore compris à quel point ces catégories genrées ne sont rien d’autre que des construits sociaux, ainsi que l’avait bien saisi Beauvoir, malheureusement sans aller au bout de sa réflexion. « On ne naît pas femme, on le devient », écrivait-elle avec justesse dans Le Deuxième Sexe, sans comprendre toutefois qu’on ne naît pas homme non plus, et que les garçons sont soumis à un conditionnement qui n’est pas moins violent ni moins contraignant et destructeur de l’être que celui qu’on inflige aux filles. À ses yeux, le genre masculin était le seul qui soit « naturel », libre de contraintes, ce en quoi elle se trompait lourdement.
La société patriarcale prend appui, en réalité, sur un double mythe, un double mensonge : celui de l’Homme et celui de la Femme. Des identités fictives, archaïques, fondées sur des dogmes, qu’on est forcé d’endosser, depuis l’invention de l’échographie, dès avant sa naissance. C’est la négation même de l’unicité de chaque être, qui s’anéantit dans l’uniformité totalitaire. C’est un carcan dont on ne s’extirpe pas aisément, à aucun moment de sa vie.
Queerisation
C’est parce que j’ai dû me battre si longtemps contre mon propre conditionnement masculin que j’ai pu échapper au piège de la binarité des genres. Je suis passée graduellement de femme trans, n’aspirant qu’à l’invisibilité parmi les femmes, à femme queer revendiquant fièrement ma différence, la singularité de mon identité. Je n’en suis pas moins femme pour autant, mais je ne m’agrippe plus à une féminité « conforme » aussi fantasmée qu’artificielle, qu’elle soit pur produit de la publicité ou émanation de la tradition. Ce n’est qu’une prison héritée du passé, tout autant que la masculinité qu’on m’avait imposée. J’embrasse les genres, désormais, non plus comme une ligne droite entre deux pôles mais plutôt comme un espace infini.
Depuis le premier jour de ma transition, il y a onze ans, chaque pas franchi, chaque victoire sur moi-même a été un intense soulagement, une libération, précédée toutefois d’une plongée vertigineuse dans le vide. Car notre éducation nous apprend surtout à avoir peur. De l’échec, de la défaite, du ridicule, du rejet, de ne pas correspondre aux attentes qu’on a placées en nous. Peur de l’inconnu, de la nouveauté, du changement. Peur de briser le moule et d’y perdre nos os. Peur, peut-être plus que tout, du jugement d’autrui.
J’ai dû vaincre ces peurs une à une pour pouvoir trouver mon bonheur dans le monde queer – un univers peuplé d’êtres libres, s’étant affranchis une fois pour toutes de la norme genrée et des contraintes qui l’accompagnent. Des êtres d’une force de caractère et d’un courage exemplaire, ayant fracassé les murs qui les enfermaient pour prendre leur place au soleil. Des êtres qui ont cessé de se juger eux-mêmes et de juger les autres sur la base de critères acquis, pour étreindre la vie dans sa totalité.
Les paniques morales de la droite identitaire
On s’identifie toujours à des fictions. Du roman national au mythe du self-made man, on s’accroche à ce qu’on peut pour ne pas sombrer, pour garder des repères immuables dans un monde en plein chaos, dont la survie même est menacée. De toutes ces fictions, la binarité des genres est sans doute celle qui est défendue avec le plus de hargne, parce qu’elle touche au plus intime de l’être.
Dans la croisade en cours contre les drag-queens – et aussi, par ricochet, contre les femmes trans – une chose m’a frappée : on semble encore percevoir toutes les pratiques transidentitaires comme des activités sexuelles, plus ou moins obscènes, qu’il faudrait donc impérativement dissimuler aux yeux des enfants. Comme si le sexe avait quelque rapport avec les transidentités ! Comme si le fait de porter une robe plutôt qu’un complet trois pièces constituait en soi un spectacle érotique !
L’orientation sexuelle et l’identité de genre, ce sont deux choses absolument distinctes : je ne peux pas croire que je suis encore obligée d’écrire ça en 2023. Personnellement, la prise d’hormones m’a rendue asexuelle, et c’est le cas de beaucoup de femmes trans de mon âge ou même plus jeunes.
Quant aux drag-queens, elles peuvent faire montre d’un humour assez salace dans leurs spectacles pour adultes, mais absolument pas quand elles s’adressent à des enfants. Ce sont des artistes, ce ne sont pas des imbéciles ! Néanmoins, beaucoup les voient comme des fétiches, comme des sexes offerts à la concupiscence.
Curieusement, des personnages adorés du public, comme la Môman de Serge Thériault dans La petite vie ou la Priscilla de Jean-Michel Anctil, ont échappé à cette fétichisation : c’est bien la preuve que ce n’est pas le travestissement d’un homme en femme qui pose problème. C’est plutôt le fait que les drag-queens soient associées aux milieux queers, socialement chargés de tous les stéréotypes à caractère libidinal.
Chose certaine, ce n’est pas nous qui sommes obsédé·es par le sexe. Comment appelle-t-on le fait d’instrumentaliser ses enfants pour dissimuler ses fantasmes les plus inavouables ?
La complosphère à l’assaut du monde queer
Si j’entreprenais de faire la nomenclature de toutes les idioties qui circulent au sujet des transidentités dans les médias sociaux, et trop souvent dans les médias conventionnels, je pourrais facilement écrire une brique de 800 pages. Dernier en date des dogmes complotistes à la mode : les transitions seraient un complot de Big Pharma pour vendre des hormones.
Je n’exagère pas en disant que les hormones m’ont sauvé la vie, comme elles ont sauvé des centaines de milliers de vies. Les effets de l’hormonothérapie s’estompent dès qu’on cesse de les prendre, contrairement à un autre mythe qu’on s’acharne à répandre partout : non, votre ado n’aura pas de séquelles permanentes s’iel décide plus tard de dé-transitionner – un cas de figure bien plus rare qu’on ne le laisse entendre. Seules les interventions chirurgicales sont irréversibles, raison pour laquelle on ne les pratique pas sur des mineur·es. La seule exception est la mastectomie, qu’il est possible d’obtenir à seize ans – mais pas avant.
Je n’ai ni plus ni moins de sympathie pour l’industrie pharmaceutique que pour l’industrie agroalimentaire ou celle de la confection : ce sont des entreprises capitalistes, leur but premier est d’engranger des profits. Cependant, contrairement à une croyance populaire, ce n’est pas avec les médicaments sur ordonnance que Big Pharma engrange les plus gros profits, encore moins avec la vente d’hormones qui ne concerne qu’une infime partie de la population, mais bien avec les médicaments en vente libre, des analgésiques aux sirops pour la toux en passant par les onguents et les pommades de toutes sortes.
Malheureusement, la plupart des complotistes sont sourd·es aux arguments rationnels comme à l’épreuve des faits. À plus forte raison quand iels s’agrippent à leurs organes génitaux, insistant pour se définir et définir les autres par ce détail de leur anatomie, comme si leur vie en dépendait.
On ne nous fera pas disparaître
Je voudrais m’adresser, en terminant, à ces braves gens qui s’indignent et poussent les hauts cris parce que certains parents ne voient aucun mal à emmener leurs enfants entendre… des contes pour enfants, lus par une charmante et très inoffensive drag-queen – et qui s’imaginent, dans la foulée, que la seule présence d’une femme trans dans la même pièce que ces chers petits serait de nature à les « contaminer ». Rassurez-vous : les transidentités ne sont pas des maladies contagieuses. Je n’ai pas attrapé la mienne sur un banc de toilette, et même le port généralisé du masque n’aurait rien empêché.
J’ai grandi dans un monde où les transidentités étaient tout simplement inconcevables. Et pourtant, me voilà. J’aurais bien aimé que des drag-queens me lisent des contes quand j’étais enfant : ça m’aurait sûrement fait gagner quelques décennies sur l’enfer de l’identité contrariée – le pire de tous, parce que c’est une condamnation à non-vivre, et qu’elle est sans appel.
Les temps changent, l’information circule comme jamais, et vous ne nous ferez plus taire. Vous pourrez inventer mille raisons de nous haïr, nous prêter toutes les mauvaises intentions du monde, nous diaboliser et nous déshumaniser à l’envi, vous ne nous ferez pas disparaître. J’ai mis une vie à me bâtir, et il faudra me tuer si l’on veut m’obliger à revenir en arrière. Mais même en nous exterminant toustes, sachez que vous n’échapperez ni à votre homosexualité latente ni à vos ambiguïtés de genre, encore moins à l’absurdité de votre vieux monde en décomposition.
Que ça vous plaise ou non, nous sommes là pour rester. Aussi bien dans votre décor que dans vos consciences effarouchées, ébranlées par notre existence. Débrouillez-vous avec vos hantises et vos démons : nous ne vous devons rien, et nous ne vous avons rien demandé. Ce n’est pas à nous de vous libérer, après tout. Ce combat intérieur, nous l’avons déjà mené pour nous-mêmes. Et devinez quoi ? Nous l’avons gagné.
Pascale Cormier, 30 avril 2023



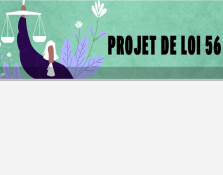




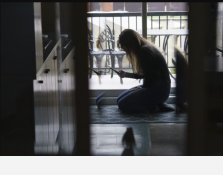


Un message, un commentaire ?