Est-ce dire que le système de l’aveu, défini par Michel Foucault, soit désormais désuet ? Deux réponses possibles : a) au contraire, il s’affiche dans toute sa puissance et renvoie automatiquement à des rapports de pouvoir qu’exposent justement les dénonciations ; b) avec la propagande publicitaire et Internet – plus particulièrement les médias sociaux –, le mensonge se propage partout et affaiblit la raison d’être de l’aveu qui, pour sa part, repose sur la vérité.
Si la dénonciation consiste à vouloir se libérer de l’emprise d’un autre, l’aveu vise à se libérer soi-même, du moins selon l’acception actuelle. Car, autrefois, l’aveu désignait plutôt une « garantie de statut, d’identité et de valeur accordée à quelqu’un par un autre », en nous référant à Foucault (1976 : 78), qui rappelle d’ailleurs que l’aveu fut institutionnalisé à titre de moyen de contrôle des fidèles chrétiens notamment et, qui plus est, a autorisé l’Inquisition à user de la torture pour le soutirer des soi-disant hérétiques. Ainsi, l’aveu est devenu une technique de création de la vérité ; une vérité que chacun et chacune a voulu par la suite révéler, afin de recevoir l’absolution dans la confession, c’est-à-dire une libération du péché permettant l’entrée éventuelle au paradis. Mais ce qui importe de retenir ici se résume au fait que le rituel de l’aveu s’associe au pouvoir, car, comme le dit encore Foucault (1976 : 83), « on n’avoue pas sans la présence au moins virtuelle d’un partenaire qui n’est pas simplement l’interlocuteur, mais l’instance qui requiert l’aveu, l’impose, l’apprécie et intervient pour juger, punir, pardonner, consoler, réconcilier […] ».
Notons cependant la combinaison nécessaire de l’aveu et de la dénonciation, puisqu’une personne abusée doit avouer tout d’abord les torts subis, pour ensuite parvenir à la dénonciation qui a pour objet d’exposer publiquement les préjudices reçus d’une personne ou d’un groupe abuseur. L’impression d’un affaiblissement de l’aveu, à cause d’une montée du nombre de dénonciations, reste donc illusoire dans la mesure où cette quantité doit être transposée aussi chez l’aveu. Or, l’aveu suppose la communication de la vérité, comme susmentionné. Mais est-ce toujours le cas ? Derrière chaque victime se cache un agresseur. Celui-ci semble pourtant immunisé de l’aveu, malgré l’institution judiciaire et étatique responsable de sa perpétuité. Il détiendrait donc un contre-pouvoir qui lui permettrait d’embrouiller la vérité, puisque cette voie choisie lui fait éviter, du moins pour un temps et peut-être même pour très longtemps, la sanction donnant raison à sa victime. Il craint en réalité deux types de sanction, à savoir une associée au tribunal formel, puis une seconde attribuée à un tribunal plus vaste et informel appelé « opinion publique », qui possède aussi un pouvoir par lequel cet individu perdra le sien – sans nécessairement être définitif toutefois.
L’aveu expose-t-il toujours sa sincérité ? Oui, dans la mesure où l’étendue de son influence dans le quotidien et dans la concrétisation d’une confiance commune (relative) a conditionné notre manière d’entretenir nos relations, c’est-à-dire par une intériorisation du rituel de l’aveu ou de la confession entraînant notre propre auto-jugement, voire une auto-culpabilisation lorsque la vérité doit être révélée et que nous avons volontairement ou par contrainte choisi de la dissimuler. Parce que, comme l’avancerait Freud (2016[1929]), l’habitude de la soumission pousse l’être humain à définir des balises sur lesquelles il peut se rabattre afin de diminuer ses peurs, ses craintes, mais surtout ses souffrances qui se divisent en trois sources : « la puissance écrasante de la nature, la caducité de notre propre corps, et l’insuffisance des mesures destinées à régler les rapports des hommes entre eux […] » (ibid., p. 29). Automatiquement, il se place devant une autorité morale qui lui dicte le bien et le mal, le sécurise donc en quelque sorte pour garantir la cohésion sociale qu’il souhaite, pour supprimer ainsi l’agressivité du prochain, même si pourtant cette même autorité s’avère responsable des peurs, des craintes et des souffrances auxquelles il veut échapper. Ajoutons que si la religion fut considérée soudainement telle une « névrose obsessionnelle », à cause d’une crainte envers la nature devenue au fil du temps une mère dangereuse, dévoreuse de ses enfants, sa maîtrise exigeant alors de se porter vers la protection du père – Dieu tout-puissant –, s’opposant non seulement à la nature, mais à la cruauté du destin ainsi qu’aux souffrances de l’existence, son remplacement souhaité et souhaitable ouvrit la voie à un autre protecteur nécessaire pour atteindre le bonheur. L’État inspire la réalisation « civilisationnelle » ou culturelle la plus phénoménale de notre espèce, désormais libérée des illusions religieuses. Par contre, son hégémonie implique toujours une soumission, un « sentiment conscient de culpabilité » et un « besoin de punition », dans le but de jouir de sa protection (ibid., p. 69).
Le « Surmoi » freudien constitue une instance morale développée suite à l’intériorisation des exigences et des interdits à la fois parentaux et sociétaux qui écrasent le « moi ». Et donc, l’État, comme père éternel, s’impose en protecteur, à l’aide de ses directives notamment, d’où le Surmoi sévère et dominant qui force le moi à se culpabiliser et à se punir lui-même par crainte de subir une sanction beaucoup plus pénible venue de l’extérieur ; voilà un processus que Freud attribue au développement même de la civilisation ou de la culture qui, au bout du compte, capitalise sur l’angoisse. Nous sommes donc angoissés parce que névrosés, obligés en plus de vivre dans cet état par ignorance de l’origine de nos maux et malaises, croyant ainsi satisfaire notre désir de bonheur, alors que les mécanismes structurels et psychologiques en place se destinent à nous retenir dans l’enfance ; en le disant autrement, nous recherchons encore la sécurité de notre père, cette fois-ci pour cause d’angoisse devant les forces qui nous surpassent et l’inexorabilité du destin. En l’occurrence, l’aveu semble vouloir nous libérer de ce qui nous tenaille de l’intérieur, du moins sert à atténuer une profonde contradiction entre nos aspirations véritables et les interdits extérieurs.
Or, si la contradiction subsiste en nous, il se peut fort bien que nos passions nous détournent des règles prescrites. Dans ce cas, les mécanismes de l’aveu subissent les contrecoups par lesquels une libération différente devient possible, du moins cette éventualité nous pousse à ne jamais être aussi sincères que nous le prétendrions. La névrose freudienne se transforme ici en mauvaise foi, telle que le décrirait sûrement Sartre, alors que l’être humain pour être sincère envers lui-même et envers autrui doit être ce qu’il est. Mais puisqu’il souffre d’une contradiction profonde, il se ment conséquemment à lui-même et fait du Surmoi son moi qu’il n’est pas. En société, nous jouons un ou des rôles, nous personnifions ainsi des êtres représentés par ce jeu qui nous détermine, et puisque nous ne sommes qu’une représentation, nous jouons donc des « faux-êtres », en raison du fait que nous les imaginons sous l’influence d’un cadre de régulation étranger. Force est donc d’admettre que si nous nous mentons à nous-mêmes, un simple pas suffit pour mentir à autrui et, par succession, le mensonge à soi devient un mensonge tout court. D’ailleurs, Sartre (1943 : 96-98) distingue les deux comme suit : « L’essence du mensonge implique […] que le menteur soit complètement au fait de la vérité qu’il déguise. […] [L]e menteur a l’intention de tromper […] », tandis que la mauvaise fois consiste, pour celui ou celle qui la pratique, à « masquer une vérité déplaisante ou […] [à] présenter comme une vérité une erreur plaisante ».
Mentir à nous-même expose un trouble de la conscience qui démontre bien le tiraillement intérieur auquel nous sommes confrontés, alors que nous recherchons notre bonheur. Le manque de sincérité envers nous-même affaiblit la force de l’aveu et concrétise cette maxime d’ailleurs reprise par Sartre d’un « péché avoué est à moitié pardonné », ramenant conséquemment la confession de nos passions, tout en acceptant de les renier pour assurer notre existence paisible au sein d’une collectivité qui nous épie. Et puisque nous nous sentons constamment surveillés, un désir d’évasion entraîne la création de mondes parallèles – virtuels –, grâce auxquels nous pouvons enfin bénéficier d’une liberté supposément plus grande. Qu’est-ce effectivement Internet et les médias sociaux, sinon un nouveau monde offrant une liberté d’expression, une évasion des restrictions de la morale terrestre, malgré leur proximité ? N’y observons-nous pas la nature humaine ainsi libérée de l’aveu, ou plutôt proclamant un aveu différent mais authentique, bien que les vérités alternatives et les mensonges y pullulent ? Mentir aux autres alors que nous nous mentons à nous-même, supposant ainsi que la vérité à laquelle nous adhérons est faussée à la source, n’est-ce pas une tentative de destruction créative utile à la découverte d’une réalité longtemps masquée ? Cette mauvaise foi intègrerait-elle la « mauvaise conscience » décrite par Freud, y compris par Nietzsche (2002[1887] : 192), qui nous met en conflit avec nous-même, au point de faire apparaître une vilaine maladie, c’est-à-dire cette névrose freudienne, voire celle nietzschéenne de « l’homme [ou plutôt l’humain] malade de lui-même » ?
À force de nous battre intérieurement, de refouler nos pulsions, une pression s’exerce en conséquence et exige un jour son évacuation. Voilà la justification des actions de certains internautes qui osent écrire dans les médias sociaux tout ce qui leur passe par la tête, qui osent même fabriquer des mensonges pour exprimer une différence, afin d’améliorer la note de leur évaluation sociale. Cette évacuation de la pression se transpose toutefois dans le monde réel, d’où un choc avec le système de l’aveu. En même temps nous sommes plongés dans un monde économique et publicitaire, là où la propagande du bonheur se produit à partir d’images idylliques de liberté possibles de concrétiser seulement par des actes de consommation, qui ne font qu’entretenir une accoutumance profitable à l’accumulation du capital. Le mensonge s’immisce ainsi dans la société des écrans, c’est-à-dire dans une société parallèle qui excite nos pulsions et notre imagination, de manière à nous faire oublier l’ensemble des mécanismes de coercition destiné à nous faire renier notre véritable moi. Cette volonté de nous libérer des systèmes responsables de nos névroses est elle-même tributaire de ces systèmes, compte tenu du fait que nous ignorons ce que nous sommes réellement, parce que nous préférerons habiter, du moins pour l’instant, une illusion de notre être. L’aveu implique alors la mauvaise foi et le mensonge, puisque nous l’exerçons de manière à éviter de nous voir plutôt que de nous libérer de ce qui nous empêche d’être nous-même. Par le mensonge, nous nous efforçons paradoxalement de relativiser nos absolus dans le but de retrouver peut-être ce que nous avons perdu en chemin.
Écrit par Guylain Bernier
Bibliographie
FOUCAULT, Michel (1976), Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, Collection tel.
FREUD, Sigmund (2016), Malaise dans la civilisation [1929], version numérique réalisée par Gemma Paquet, Chicoutimi, développée en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l’Université du Québec à Chicoutimi, Collection « Les classiques des sciences sociales ».
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm (2002), « La Généalogie de la morale. PAMPHLET [1887] » dans Françoise Kinot (dir.) Philosophie de l’existence. Nietzsche. Freud. Bergson, Vol. X, Paris, France Loisirs, Collection « Philosophies ».
SARTRE, Jean-Paul (1943), L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, Collection tel.







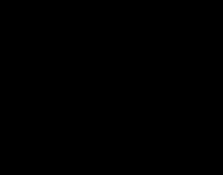



Un message, un commentaire ?