Tiré de Entre les lignes, entre les mots.
Beaucoup et très peu, devrait-on dire. Dans ces cas, il semble qu’il faille commencer par les éléments positifs : certains changements sont indéniables. Sur le plan législatif, l’Italie s’est alignée sur d’autres pays, avec des mesures telles que l’ordonnance de protection (2001) et la loi sur le harcèlement criminel (stalking) (2009) ; en 2015 a été introduit le droit à un congé payé d’une durée maximale de trois mois, pour les femmes intégrées dans les mesures de protection contre la violence. Avec la ratification de la Convention d’Istanbul2 (2014) et avec le plan gouvernemental extraordinaire contre la violence basée sur le genre (2016), l’Italie a adopté un cadre de référence et un cadre législatif qui permet de lire la violence comme un fait structurel, comme élément d’une situation plus générale de discrimination et de subordination des femmes, et de développer des mesures de prévention et de répression d’un point de vue global et multiniveaux.
Cependant, si nous observons ce qui se passe dans le monde réel, et pas seulement dans le domaine des lois, des plans et des projets, la lecture de la situation est très différente. Pour commencer : après tant d’années de luttes, d’activisme féministe, de changements législatifs, d’information et de sensibilisation, pouvons-nous dire que la violence masculine contre les femmes a diminué ? C’est une question cruciale, à laquelle il est difficile de répondre. Selon une recherche de l’Institut national italien de statistiques (ISTAT, 2015), de 2006 à 2014, certaines formes de violence ont diminué : en particulier, la fréquence de la violence psychologique exercée par le conjoint actuel est passée de 42,3 à 26,4%. La sensibilisation des femmes a également augmenté : elles considèrent plus souvent la violence comme un crime et la signalent aux forces de l’ordre ; plus souvent, elles en parlent avec quelqu’une et cherchent de l’aide auprès des services spécialisés et d’organismes de lutte contre la violence.
Les victimes sont également plus satisfaites des interventions policières, ce qui indiquerait une plus grande sensibilisation de ces secteurs de la société. Cependant, d’autres résultats de la même recherche contredisent ces tendances positives. En effet, lorsque les femmes subissent des violences, celles-ci sont d’autant plus graves : de 2006 à 2014, la violence engendrant des blessures a augmenté (de 26,3 à 40,2%) ainsi que, de façon cohérente, le nombre de femmes craignant pour leur propre vie (de 18,8 à 34,5%). C’est comme si, face à l’évolution des attitudes sociales devant la violence et face à certains changements positifs dans le comportement des femmes et des hommes, une partie des hommes (une minorité ?) réagissait avec encore plus de colère, de haine pour les femmes et de volonté de domination. Bref, à peine ébranlé, le noyau dur de la violence patriarcale résiste.
En Italie (et dans le monde), en outre, les femmes continuent d’être tuées comme des mouches : 117 assassinées en 2016, dans la majorité des cas par des partenaires ou ex-partenaires qu’elles souhaitaient quitter ou qu’elles avaient quitté, selon les données recueillies par la Casa delle Donne (Maison des femmes) de Bologne3. Une analyse des données sur les homicides volontaires en Italie de 2008 à 20134 révèle des résultats peu rassurants. Si le nombre d’homicides a diminué (en 6 ans, de 614 à 501), la proportion de femmes victimes a augmenté : de 24% en 2008, à 35% en 2013. Les meurtres « en contexte familial/affectif » ont décru au cours de la période observée ; cependant, en analysant les données en fonction du sexe, nous constatons une hausse de la proportion des femmes victimes.
Il est à noter que dans ce décompte tragique ne sont pas incluses les femmes qui, simplement, se volatilisent : prostituées étrangères sans permis de séjour ou mères de famille qui, soudainement, sans laisser de trace, disparaissent du soir au lendemain en laissant de jeunes enfants adorées, ainsi que des maris dont le comportement est pour le moins ambigu. Selon les données du ministère de l’Intérieur5, de 2007 à 2016 ont été signalés 4 979 cas de disparition de filles ou de femmes en Italie. Parmi elles, 3 520 (70%) ont été retracées (selon le rapport, « beaucoup avaient fui des abus et de la violence domestique ») ; 196 (4%) ont été retrouvés mortes, de nombreuses étant victimes de meurtres, d’autres s’étant suicidées ; et 1 263 femmes (26%) sont toujours portées disparues.
Une autre confirmation vient de Grande-Bretagne : la violence contre les femmes n’a pas diminué. La sociologue Sylvia Walby (Walby, Towers et Francis, 2016) a analysé les données nationales sur la violence de 1994 à 2014 : en corrigeant certaines erreurs méthodologiques, c’est-à-dire en tenant compte des cas de victimes de violence masculine chronique et répétée dans la sphère domestique, les résultats montrent que les crimes contre les femmes et, en particulier, ceux commis par des conjoints ou des ex-partenaires, ont augmenté. L’augmentation est observée à partir de 2009 et la chercheuse l’attribue à la crise économique et aux coupes dans les services sociaux et de bien-être dédiés aux femmes victimes de violence, ce qui a créé une situation qui leur rend plus difficile d’échapper à un partenaire violent6.
Tout aussi inquiétantes sont les données qui nous permettent de comparer la fréquence de la violence contre les femmes dans différents pays et zones géographiques. Les résultats de l’enquête européenne du Fundamental Rights Agency (2014) montrent que la violence est plus fréquente dans les pays d’Europe du Nord, en particulier au Danemark et en Finlande, où règne une plus grande égalité des sexes7que dans les pays d’Europe du Sud (y compris l’Italie), dans lesquels cette égalité des sexes est beaucoup plus ténue. Comment expliquer qu’il y ait plus de violence contre les femmes dans les pays où il y existe le moins de discrimination à leur encontre ? Selon une hypothèse optimiste, ce constat paradoxal pourrait s’expliquer par le fait que les femmes des pays nordiques, plus conscientes de leurs droits, répondraient plus ouvertement et plus sincèrement aux enquêtes sur la violence.
Cependant, il s’agit d’une explication discutable, ou du moins partielle : les questionnaires étaient anonymes ; les questions très précises ne laissaient aucune place aux interprétations subjectives quant à ce qui constitue ou non de la violence. L’autre hypothèse, décidément moins optimiste, est que nous assistons au phénomène de « contrecoup », à une contre-offensive (backlash) déjà décrite par Susan Faludi en 1992 aux États-Unis : l’acquisition de plus de droits, de pouvoirs et de libertés de la part des femmes déclencherait une réaction hostile de la part de beaucoup d’hommes et, conséquemment, plus de violence.
La méthodologie de recherche de l’Agence des droits fondamentaux a été critiquée (également par Sylvia Walby) et les comparaisons entre les pays doivent être considérées avec prudence. Cependant, les données italiennes sur les meurtres de femmes, fournies par le gouvernement8, vont dans le même sens : sur les 116 cas de féminicides examinés en 2016 (un de moins que ceux recensés par la Casa delle Donne de Bologne), plus de la moitié (53,3%) se sont produits dans le Nord, environ un quart (26,7%) au Sud et 20% au Centre. Parmi les régions italiennes, la Lombardie détient le triste record.
Une réaction violente à cette plus grande liberté des femmes est également observée dans d’autres contextes. Bien que les comparaisons temporelles soient difficiles, la diffusion de matériel pornographique caractérisé par une grande violence semble s’être multipliée grâce à Internet, normalisant les comportements sexuels violents ou considérés, jusqu’à il y a quelques années comme des niches et n’étant pas forcément appréciés par les femmes ou les filles (Romito et Beltramini, 2015). Va dans le même sens la normalisation culturelle de la prostitution, modèle d’une relation homme-femme structurellement inégalitaire, marquée par l’absence totale de réciprocité, éléments qui caractérisent d’autres violences masculines envers les femmes.
Une étude menée dans de nombreux pays révèle une forte association entre les rapports sexuels rémunérés et la violence sexuelle : des hommes qui paient pour du sexe sont plus susceptibles d’agresser ou de violer une épouse, une conjointe ou une autre femme (Heilman, Hébert et Gera, 2014). Nous n’avons pas de données pour l’Italie : il n’existe pas d’estimation précise du nombre d’adolescents ou d’hommes payant pour du sexe avec des femmes prostituées, ni de leurs caractéristiques, motivations et degrés de conscientisation. L’étude de deux sociologues (Dal Lago et Quadrelli, 2003), réalisée dans la ville de Gênes, ouvre une brèche fort inquiétante sur les croyances et comportements des hommes, les prétendus clients, qui considèrent les prostituées, surtout lorsqu’elles proviennent d’autres pays, comme « non humaines », décrivant sans gêne les humiliations et les violences auxquelles ils les soumettent.
En ce qui concerne la garde des enfants après la séparation du couple, la contre-offensive du patriarcat est violente et omniprésente. Ainsi, en Italie, depuis 20069, la garde partagée est devenue un mode d’élection. La garde exclusive d’un parent unique n’est prévue que dans les cas où la garde partagée est contraire aux intérêts des mineures ; cependant, ces cas, ainsi que la définition de « l’intérêt supérieur de l’enfant », restent mal définis (Pirrone, 2017). Cette pratique de la garde partagée est dangereuse quand l’homme a été et continue presque toujours d’être violent. Les intervenantes des centres contre la violence faite aux femmes (centri antiviolenza) documentent des situations dans lesquelles la violence masculine est minorée ou niée, tandis que les femmes qui tentent de protéger leurs enfants ou elles-mêmes sont considérées comme menteuses, paranoïaques ou manipulatrices, soumettant leurs enfants à un lavage de cerveau pour se venger de l’ex-partenaire.
La garde partagée est également imposée dans des cas retentissants, dans lesquels l’homme a déjà été condamné pour maltraitance ou a attaqué sa femme ou ses enfants devant les travailleuses des services sociaux. Dans d’autres cas, l’homme se voit accorder un droit de visite sans surveillance d’un enfant, pendant qu’il est jugé pour agressions à caractère sexuel à l’encontre d’autres enfants. Paradoxalement, des recherches étatsuniennes montrent que plus les femmes dénoncent la violence subie par le partenaire, moins elles sont susceptibles de protéger leurs enfants en obtenant la garde exclusive ; pas même de fortes suspicions d’agressions sexuelles sur des enfants ne se reflètent dans les décisions des juges relatives à la garde (Saccuzzo et Johnson, 2004). Silberg, Dallam et Samson (2013) ont suivi 27 cas dans lesquels une première décision du juge en faveur de la garde partagée ou de visites paternelles sans supervision a été infirmée, des années plus tard, par un jugement allant dans le sens contraire.
Dans les premiers procès, les allégations d’agressions à caractère sexuel sur des enfants, émises par des mères, ont été considérées comme non crédibles ; les expertes impliquées dans les évaluations ont invoqué le prétendu « syndrome d’aliénation parentale10 ». Dans les seconds procès, les juges et les expertes ont reconnu l’existence de l’agression et la mère a obtenu la garde exclusive ou, du moins, des visites supervisées du père aux enfants. Que s’est-il passé entre ces deux décisions discordantes ? Dans les seconds jugements, les expertes impliquées étaient compétentes dans le domaine de la violence faite aux femmes et aux enfants dans la sphère domestique ; les enfants avaient grandi et étaient considérées comme plus crédibles ; leur santé mentale s’était détériorée en vivant avec leur père et un tiers avaient tenté de se suicider ; le père avait été arrêté pour violence sur ses enfants. Entre le premier et le second jugement s’est écoulé en moyenne 3,2 ans (Silberg, Dallam et Samson, 2013).
Trois années ou plus au cours desquelles un système social complexe, payé par les contribuables, composé de professionnelles des services de santé et sociaux, de consultantes, de juges, avait décidé, par des procédures structurées, de laisser, « pour leur bien », des fillettes et des garçonnets entre les mains de pères violents, faisant vivre un enfer à ces enfants et à leurs mères. En Italie, une étude montre la même tendance : au moyen d’une série de tactiques et de stratégies – y compris la pratique de qualifier de « conflits » des cas déclarés de violence et d’imposer ainsi la médiation familiale11 –, il arrive que les pères violents obtiennent un libre accès à leurs enfants alors que les mères protectrices sont considérées comme paranoïaques, vindicatives ou « aliénantes » (Feresin, Lapierre, Folla et Romito, 2018) ; et comme dans d’autres pays, il arrive que, pour punir ces dernières, la garde exclusive soit attribuée au père abusif.
À la lumière de la littérature scientifique, corroborée par les récits des femmes et des intervenantes des centres contre la violence faite aux femmes (centri antiviolenza), force est donc inévitablement d’en arriver à une terrible conclusion : plus les femmes cherchent à protéger les enfants d’un homme violent, plus le système les punit. Il s’agit d’une réaction d’agacement, qui se traduit par une hostilité ouverte : comment osent-elles prétendre être des sujets autonomes, vivre avec leurs enfants, libérées de toute violence, ou plutôt, vivre tout court ? Un bon exemple est celui de Marianna Manduca, qui a été assassinée par son ex-mari le 3 octobre 2007. Pour la douzième fois, Marianna avait dénoncé la violence, les menaces, et elle avait mené une longue bataille juridique, son ex-conjoint violent et toxicomane ayant obtenu la garde des enfants et les empêchant de la voir.
Quelqu’un avait dû le considérer comme un « père suffisamment bon », même s’il avait répété à plus d’une occasion qu’il souhaitait tuer son ex-femme, lui montrant le couteau avec lequel il l’assassinerait finalement plus tard. La Cour d’appel de Messine a condamné les procureurs de Caltagirone pour « faute inexcusable », mais en attendant, Marianna est morte, et ses trois enfants sont orphelines (Somme, 2017). En mars 2017, grâce aux efforts du Réseau national des centres contre la violence faite aux femmes (DiRe), la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg a, pour la première fois, condamné l’Italie pour des raisons similaires : malgré les plaintes d’Elisaveta Talpis, son garçon et elle avaient été laissées sans protection, jusqu’à ce que le mari, essayant de poignarder la femme, tue le fils qui s’était interposé (Folla, 2017). Importante décision que celle de la Cour, mais n’empêche que le garçon, prénommé Ion, est mort et que la vie de sa mère a été détruite.
Comment ne pas lire dans ces histoires une adhésion aveugle aux valeurs du patriarcat : le droit de posséder des enfants et la dévalorisation des femmes ? Aucune intervenante des services sociaux ou psychologiques, aucune juge, ne se reconnaîtrait explicitement dans ces valeurs, se réfugiant plutôt derrière des formules théoriques – l’intérêt supérieur des mineures – ou psychologiques sur la nécessaire présence du père, même violent. Cependant, aucune théorie psychologique n’a démontré que l’intérêt d’un enfant soit de vivre avec un père violent.
Au contraire : les données illustrent que « l’exposition à la violence assistée (violenza assistita) » [être témoin de la violence subie par la mère] entraîne un préjudice psychologique pour les enfants, qui peut être encore plus grave que la violence directement subie ; être exposée à un père violent est également un facteur de risque, à savoir de devenir une adulte violente (CISMAI, 2017). Malgré les preuves scientifiques et les prises de position remarquables, de la Déclaration universelle des droits des enfants et des adolescents (1989) à la Convention d’Istanbul (2011), il arrive encore que dans un régime patriarcal, les droits à la tranquillité, à la sécurité et à la vie des femmes et des enfants – filles et garçons – soient subordonnés aux privilèges masculins historiques.
En Italie, le cas du petit Federico Barakat, tué à l’âge de 8 ans par son père lors d’une prétendue « visite supervisée » dans les locaux des services sociaux d’une ville de la province de Milan, constitue un exemple tragique. La mère avait signalé à plusieurs reprises la violence de son ancien partenaire ; elle avait tenté de protéger son fils et de suspendre ces visites, mais avait été considérée comme hystérique, mythomane et accusée d’« aliénation parentale ». La Cour a décrété la poursuite des visites père-fils « pour la protection du développement de l’enfant et son besoin de croissance et pour garantir le rétablissement et le développement harmonieux de la relation entre parent et enfant ». Le dernier acte de la tragédie : la mère a perdu la cause intentée contre les services sociaux pour négligence et devra payer les frais de justice (Betti, 2015).
L’analyse présentée dans ce livre, depuis 2005, est ainsi confirmée. La violence des hommes contre les femmes et les enfants ne peut s’actualiser qu’au moyen d’un système fondé sur le déni et le discrédit à l’égard des femmes, et qui repose sur la solidarité avec l’homme violent (considéré comme lésé dans ses droits) et sur la complicité à son égard. Nous ne devons pas oublier non plus les considérations économiques. Le refus de reconnaître la violence masculine exclut la prise de décisions simples et efficaces, comme l’octroi de la garde exclusive à la mère : se déclenche alors un processus de longue haleine, qui implique non seulement des services publics (sociaux et juridiques), mais aussi des psychologues, des psychiatres, des consultantes, des médiateurs/médiatrices, des avocates qui travaillent dans le secteur privé, auxquelles s’ajoutent les employées des associations qui accueillent les enfants enlevées à des mères accusées d’aliénation parentale12 ou qui « veillent » sur les visites supervisées pères-enfants.
Le déni, le discrédit des femmes et la complicité avec l’homme violent se traduisent par une affaire colossale : il ne faut pas mésestimer le fait que, parmi les raisons structurelles de la poursuite de la violence contre les femmes, figurent les avantages économiques au profit de plusieurs catégories sociales. Divers facteurs – intérêts économiques, ignorance, persistance des préjugés patriarcaux – contribuent ainsi à la mise en œuvre de pratiques et de décisions pouvant s’avérer létales pour les femmes et les enfants. Ces vies comptent-elles, au-delà de la rhétorique ? Manifestement, pas assez.
À la lumière de cette situation, il est difficile de comprendre l’enthousiasme, dénué de critiques, manifesté par nombre d’acteurs sociaux et d’actrices sociales à l’égard des programmes destinés aux hommes violents. Il s’agit d’interventions visant à modifier le comportement des agresseurs dans la sphère domestique et à prévenir de nouvelles violences, programmes qui commencent aussi à se propager en Italie, beaucoup plus tardivement que dans d’autres pays. La Convention d’Istanbul (article 16) demande aux États de soutenir ces interventions ; une position qui me laisse stupéfaite. Est-ce que ces programmes fonctionnent ? Après les avoir suivis, les agresseurs, comparés aux hommes qui ne les ont pas complétés, changent-ils de mentalité et de comportements et cessent-ils d’être violents ? Leurs compagnes acquièrent-elles plus de liberté, leurs enfants sont-ils plus sereins ? Étant donné l’importance de la question et le risque de prendre des décisions imprudentes, on pourrait s’attendre à ce que la décision de promouvoir ces programmes repose sur une évaluation de leur efficacité.
Cependant, les résultats des nombreuses évaluations menées jusqu’à présent ne sont pas encourageants : sur des centaines d’interventions analysées, personne n’a réussi à démontrer de façon convaincante que les hommes fréquentant ces programmes sont devenus moins violents13. En effet, dans certains cas, ceux qui ont participé au programme ont manifesté encore plus de violence : le programme avait, en somme, eu des effets négatifs (Feder et Williamson, 2005 ; Hagemann-White et Bohn, 2007 ; Walker, Hester et Turner, 2016). Comment alors expliquer cette indication de la Convention d’Istanbul, mais également l’enthousiasme avec lequel certains « centri anti-violenza » (centres contre la violence faite aux femmes qui sont gérés par des associations de femmes) en Italie ont promu ces programmes ?
Contrecarrer et prévenir la violence masculine par des interventions psychosociales durant quelques mois, voire quelques années, représente une solution facile et relativement peu coûteuse, en réponse à un problème énorme et complexe. Selon le modèle écologique (Organisation mondiale de la santé, 2010), les comportements violents trouvent leur origine tant dans l’histoire personnelle de l’homme (et surtout dans l’exposition à la violence exercée contre sa mère, avec les conséquences sur son développement psychologique et sur la légitimation de la violence), dans le contexte communautaire (des amis qui partagent une culture sexiste et misogyne, l’usage de la pornographie et du sexe rémunéré), que dans la société dans son ensemble (sexisme et misogynie dans la culture dominante, faible soutien aux victimes de la violence). Changer le comportement violent d’un homme adulte exige ainsi un engagement et des ressources énormes ; en admettant que la société soit prête à réaliser cet investissement14, les résultats pourraient être mesurés à l’échelle de générations, et difficilement à l’échelle individuelle d’une vie.
Une autre hypothèse, plus inquiétante, réside dans le constat que la société peine toujours à considérer la violence contre les femmes en tant que crime. De la confusion perpétuelle entre conflit et violence (Feresin, Lapierre, Folla et Romito, 2018), en passant par le maire d’une petite ville qui qualifie « d’enfantillage » un viol collectif commis sur une jeune fille15, à l’incapacité manifeste à réprimer et à punir les auteurs de violence (à moins qu’ils soient issus de l’immigration – voir Creazzo, 2012), tout indique que c’est un pas que la société ne veut toujours pas franchir. Les programmes psychosociaux destinés aux agresseurs permettent ainsi d’éviter de considérer la violence comme un crime et les maris ou partenaires violents comme des criminels. L’absurdité de cette situation devient manifeste lorsque l’on considère les réponses à d’autres types de crimes : peut-être que les escrocs et les voleurs pourraient aussi bénéficier d’un traitement psychosocial ? Nous savons que bien souvent, la répression ne paie pas et que la prison ne rend généralement pas les gens meilleurs, mais pourquoi commencer à proposer des programmes alternatifs uniquement à ceux qui violentent une femme ? Précisément pour ces crimes que la société peine à reconnaître comme tels ?
L’une des chercheuses féministes européennes les plus reconnues dans le domaine de la violence contre les femmes, Liz Kelly, conclut l’analyse de certains programmes pour hommes violents avec une note optimiste, sans toutefois contredire les évaluations négatives plus générales (Kelly et Westmarland, 2015). Il ne s’agit donc pas d’opposer un veto catégorique au développement de tels programmes : il existe des hommes violents engagés dans une démarche de changement qui pourraient en bénéficier. Toutefois, ces programmes doivent être considérés comme une drogue encore expérimentale (potentiellement utile, mais aussi très dangereuse) à étudier et à évaluer scrupuleusement et avec une prudence que je ne constate pas en Italie pour le moment.
L’analyse de ce qui s’est passé dans les 10 années (et même plus) depuis la première édition de ce livre ne donne pas de résultats encourageants. Dans la version publiée en 2005, j’ai décrit des cas aberrants observés dans d’autres pays, anticipant des situations qui sont maintenant également manifestes dans le panorama italien. Qu’avec seulement un décalage de quelques années, les réactions aux demandes de liberté et de sécurité des femmes soient si semblables dans des pays si différents est une preuve significative, même si elle est indirecte, de la vitalité du patriarcat en tant que système de référence commun.
Le constat de l’énormité de la tâche, des injustices et des souffrances causées ne doit cependant pas se traduire par un sentiment d’impuissance. En lieu et place, il est légitime de ressentir et de montrer de la colère, afin de susciter un engagement constant dans la pratique quotidienne et dans les lieux de vie et de travail de chacune d’entre nous. J’aimerais conclure par les mots d’une femme courageuse et les offrir comme une invitation aux lecteurs et aux lectrices :
Dans le flux des événements, chacune de nous ne peut faire qu’un peu plus que le grain de sable classique, mais même un petit grain de sable, rejoignant les autres, peut créer des barrages avec des courants dangereux, peut dérégler des engrenages et des mécanismes pervers. Il ne faut pas abandonner, renoncer au changement, même partiel, jamais définitif ou salvateur (Guidetti Serra, 2009).
Patrizia Romito
Notes
1- La postface a été traduite par Ève-Marie Lampron, professeure associée à l’Institut de recherches et d’études féministes de l’Université du Québec à Montréal.
2- Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul, 2011).
3- https://femicidiocasadonne.wordpress.com
4- Source : Direction centrale de la police criminelle – données opérationnelles.
5- www.interno.gov.it/it/search?search_api_views_fulltext=omicidi+donne
7- Voir le Gender Equality Index, http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/ gender-equality-index-2015-measuring-gender-equality-european-union-2005-2012-report
8- www.interno.gov.it/it/search?search_api_views_fulltext=omicidi+donne
9- Loi 54/2006, réforme législative 219/2012 et Décret législatif 154/2013.
10- Pour une critique du concept d’« aliénation parentale », voir Romito et Crisma (2017).
11- La Convention d’Istanbul (ratifiée en Italie avec la Loi du 27 juin 2013, no 77, et entrée en vigueur en août 2014) interdit la médiation familiale et les méthodes de conciliation en cas de violence ; manifestement, les juges qui l’imposent et les services qui l’implémentent ne semblent pas au courant (Feresin, Lapierre, Romito, 2018).
12- Dans ce dernier cas, il s’agit des « case famiglia », structures résidentielles gérées par le privé, bénéficiant de subventions étatiques. Cela représente un gros business en Italie.
13- L’efficacité d’une intervention est une condition essentielle à son implémentation et à sa diffusion : qu’il s’agisse d’un médicament ou d’une intervention psychosociale ou éducative, avant de l’utiliser il est nécessaire de l’évaluer et d’être raisonnablement certain qu’elle sera utile et non nuisible (Organisation mondiale de la santé, 2010). Le seul moyen sûr d’en arriver à cette conclusion est la méthode expérimentale. Dans le cas pré- sent, il doit être possible de démontrer que ceux ayant suivi un programme pour hommes violents améliorent significativement leur comportement en comparaison avec le « groupe témoin », c’est-à-dire des hommes ayant des caractéristiques similaires, mais ne l’ayant pas suivi. Le premier problème dans l’évaluation des programmes pour hommes violents est que certains quittent le programme avant la fin, préférant payer une amende ou risquer la prison plutôt que de se remettre en question. En conclusion, malheureusement, aucun programme n’a jusqu’ici été capable de démontrer des effets positifs clairs sur les hommes impliqués.
14- Il n’existe pas de signal fort comme quoi la société serait prête à réaliser ces investissements. Une enquête réalisée en 2013 a estimé le coût économique et social total de la violence contre les femmes en Italie à environ 16,7 milliards d’euros par an ; l’estimation des interventions de lutte et de prévention, sous forme d’investissements en capital humain, est de 6,3 millions d’euros. « Quanto costa il silenzio ? Indagine sui costi economici e sociali della violenza contro le donne » (2013). Disponible sur le site internet We World, https://www.weworld.it
15- Fabiana Coppola, « Pimonte, stupro di gruppo su una 15enne, frase choc del sindaco : “una bambinata” », La Voce di Napoli, 5 juillet 2017 ; <www.>



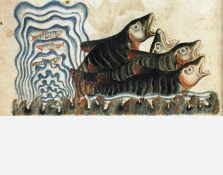








Un message, un commentaire ?