Contretemps
5 février 2021
Thomas Posado et Jean-Baptiste Thomas, Révolutions à Cuba, de 1868 à nos jours, Paris, Syllepse, 2020.
Résistances et premières victoires contre l’impérialisme
Au mois de mai 1959, le texte de la réforme agraire promise par Castro depuis 1953 est rendu public. Il est certainement plus ambitieux que le programme qui avait été élaboré dans la Sierra en 1958 par Humberto Sorí Marín, ministre de l’agriculture, mais la réforme reste modérée dans ses grands axes. Les très grandes propriétés sont visées, mais la loi prévoit plusieurs dérogations : les nationalisations sont ainsi exclues dans les exploitations de moins de 400 hectares et même de 1300 hectares dans le secteur sucrier et rizicole là où la production serait supérieure de moitié au rendement national moyen, voire dans le cas d’exploitations ou d’entreprises étrangères jugées utiles à l’économie nationale. Il est prévu d’indemniser les propriétaires sur la base de leurs déclarations fiscales par des obligations d’État à vingt ans. C’est déjà trop pour la bourgeoisie. L’annonce de la réforme provoque un séisme au niveau bancaire et une première fuite de capitaux.
À grand renfort d’encarts dans la presse, les associations patronales de producteurs et d’éleveurs s’étranglent. Plusieurs personnalités éminentes du gouvernement manifestent leur opposition au texte. C’est le cas du ministre de l’agriculture lui-même, mais aussi du président de la République, Urrutia, forcé de faire un pas de côté en juillet 1959 et remplacé par Osvaldo Dorticós, ou encore d’Huber Matos, dirigeant de la première heure du M26 et gouverneur de la province de Camagüey, qui démissionne en octobre[2]. La réforme décrétée le 4 juin au niveau national – un premier texte spécial ayant été promulgué pour la seule Sierra Maestra le 17 mai –, se réalise dans un contexte marqué par une forte agitation dans les campagnes et dans les villes, une grève générale étant lancée pour soutenir Castro dans son bras-de-fer avec Urrutia. Le 26 juillet, devant un demi-million de paysans, d’ouvriers et de jeunes rassemblés à La Havane, place de la Révolution (encore appelée « place Civique », à l’époque), pour commémorer l’assaut de 1953, Castro, qui a démissionné quelques jours plus tôt, annonce qu’il reprendra son poste de premier ministre.
Alors qu’une première campagne d’attentats à la bombe a secoué la capitale au mois de juin, l’automne 1959 est caractérisé, en province, par une série d’agressions perpétrées par des avionnettes contre des champs de canne et par le survol de La Havane par un B25 piloté par Pedro Luis Díaz Lanz, l’ancien chef de l’aviation révolutionnaire qui a fait défection en juillet. Il largue des tracts ainsi que des explosifs qui font deux morts et quarante-cinq blessés. Ces opérations, auxquelles il faut ajouter une série de sabotages, sont l’œuvre d’anticastristes autant que de partisans de Batista et ils opèrent, sans être inquiétés par les autorités états-uniennes, depuis la Floride.
La CTC réagit en organisant un grand rassemblement de plusieurs centaines de milliers de personnes où l’on demande la plus grande fermeté à l’égard des contre-révolutionnaires. C’est dans ce contexte, endeuillé de surcroît par la disparition, en octobre, du très populaire Camilo Cienfuegos dont l’avion disparaît en vol au cours d’un ouragan[3], que se crée, le 22 octobre 1959, la Milice nationale révolutionnaire qui va bientôt organiser jusqu’à un demi-million de jeunes Cubains et Cubaines. La tâche des miliciens, organisés par secteur d’activité (ouvriers, paysans et étudiants) est de seconder l’Armée rebelle – qui ne se transformera en Forces armées révolutionnaires qu’en décembre 1961 – pour faire face à toute agression.
C’en est trop pour les derniers représentants de l’aile bourgeoise libérale hostile à Batista du gouvernement et de la nouvelle administration. À l’instar de Felipe Pazos, président de la Banque nationale, ils démissionnent à la hâte fin novembre 1959 et quittent bientôt le pays. Ils rejoignent les quelque 100 000 Cubains qui, selon les estima- tions, fuient l’île entre janvier 1959 et le premier semestre 1961, avec armes, bagages et surtout portefeuille, horrifiés par ce qu’ils appellent « communisme » mais qui n’est jamais que la consolidation d’une mobilisation révolutionnaire des masses populaires. Guevara, qui remplace Pazos à la tête de la Banque nationale, signera les pesos cubains d’un simple « Che » ironique.
Si le gouvernement Castro développe une politique favorable aux classes subalternes, il s’attache cependant à limiter l’auto-organisation de la population ou, du moins, ne l’encourage pas. Dès l’année 1959, les conflits du travail qui éclatent avec l’effondrement de Batista et les libertés démocratiques qui en découlent sont contenus par la direction révolutionnaire. Souvent on demande aux ouvriers de ne pas faire grève et de laisser de côté leurs revendications alors que le capitalisme est toujours en vigueur. En contrepartie, des conciliations ont lieu au ministère du travail et donnent souvent raison aux employés et ouvriers. Les salaires sont augmentés ; le temps de travail hebdomadaire réduit à 44 ou 40 heures par semaine avec maintien du salaire à 48 heures ; les tarifs de l’électricité et du gaz sont baissés de 30% ; le prix du téléphone et les loyers sont divisés par deux.
Au cours de l’année 1960, les tensions entre partisans d’une solution radicale et modérés ainsi que les tensions politiques et sociales à l’échelle de la société cubaine s’aiguisent davantage. Alors que la réforme agraire s’accélère, puisque 600 000 hectares sont redistribués dans la seule première semaine de l’année, contre 850 000 entre août et décembre 1959, les bourgeois qui n’ont pas encore quitté le pays font leurs valises. Un prêt demandé par La Havane est refusé par Washington qui fait pression sur ses partenaires pour que les lignes de crédit en direction de Cuba soient gelées. Parallèlement, sur fond de recrudescence des opérations de sabotage dans tout le pays, un navire français transportant des armes belges, La Coubre, explose dans le port de La Havane le 4 mars 1960, provoquant un massacre chez les dockers. C’est au cours de la manifestation massive qui s’organise en protestation contre ce qui ressemble fort à un attentat qui porterait la marque ou, du moins, la complicité des États-Unis, qu’Alberto Korda fait de Guevara le portrait iconique qui rapidement deviendra un symbole des années 68 et au-delà. En juin, Washington annonce son intention de réduire drastiquement ses achats de sucre. Castro réplique qu’à chaque coupe dans la cuota azucarera il répondra par l’expropriation d’une centrale sucrière américaine. Dans la foulée, le gouvernement exproprie sans compensation les installations de Texaco et d’Esso puis de Shell, le 29 juin et le 1er juillet, car les dirigeants des filiales locales des deux multinationales refusent de raffiner le brut soviétique livré par un tanker en avril. En réponse, l’administration états-unienne bloque l’achat de 700000 tonnes de sucre.
Les Cubains réagissent en disant qu’ils envisagent de nationaliser toutes les entreprises nord-américaines, décision qui sera suivie par la nationalisation de toutes les banques américaines, dont la Chase Manhattan et la City Bank en septembre. Au même moment, alors que les États-Unis annoncent leur intention de mettre en place un premier embargo commercial contre l’île, le 13 septembre 1959, le second voyage de Castro à New York, pour se rendre à l’assemblée générale des Nations unies, est un exemple de guerre de communication des deux bords, mais aussi et surtout de provocation non nécessaire de la Maison Blanche : après qu’on a failli lui refuser un visa, Castro, qui réussit finalement à se rendre à New York, quitte l’hôtel dans lequel séjourne sa délégation pour protester contre les discriminations raciales que subissent les officiels afro-cubains et il s’installe à Harlem. À la fin de la visite, il doit quitter le sol américain à bord d’un avion soviétique car les autorités états-uniennes ont saisi celui de la présidence cubaine en raison d’impayés de La Havane vis-à-vis de bourgeois ayant quitté l’île, réfugiés à Miami et estimant, à juste titre, avoir été expropriés de leurs biens.
De ce point de vue, c’est bien l’entêtement, l’animosité puis l’hostilité manifeste de Washington qui vont finir par décider et sceller le rapprochement entre La Havane et Moscou, d’un côté, et la fraction gauche de la direction du M26 et les staliniens du PSP, de l’autre, sur fond de pression continue au niveau populaire, mais incapable de se transformer et de se structurer à travers des organismes de type conseilliste (comités autonomes ou conseils d’usine, de quartier, dans les campagnes ou sur les lieux d’étude). D’une part, la défection croissante de cadres et de personnels spécialisés (liés ou non à l’ancien régime, mais faisant le choix de quitter le pays ou de s’opposer à l’orientation du gouvernement) et l’insuffisance de cadres de direction issus du mouvement révolutionnaire force les castristes, à défaut de promouvoir une prise en main de leurs affaires par les masses mobilisées, à se rapprocher du PSP.
Le sérieux de ses membres, la discipline de parti et l’expérience militante sont une aide précieuse pour le nouveau gouvernement qui doit répondre à mille exigences et urgences. D’autre part, face à la montée de l’agressivité états-unienne, les Cubains se tournent de plus en plus vers l’URSS, relativement absente jusqu’alors de l’hémisphère américain. Contre vents et marées, les partis staliniens latino-américains liés à Moscou défendent depuis la fin des années 1940 une ligne de coexistence pacifique ou, a minima, un modérantisme extrême. À l’inverse de ce qu’affirme la droite états-unienne et cubaine, relayée par certains historiens, le choix de s’appuyer sur l’URSS est donc loin d’avoir été décidé en amont. Les rapports entre le castrisme et les Soviétiques seront d’ailleurs marqués, au moins jusqu’en 1968, par de multiples tensions et désaccords qui finiront par se résorber à travers un alignement définitif du régime sur le bloc de l’Est à partir de la fin des années 1960. Par ailleurs, les liens économiques entre l’URSS et Cuba sont bien plus anciens que l’arrivée des barbudos au pouvoir. Alors que les États-Unis menacent très tôt de réduire leurs achats de sucre cubain, les Soviétiques, qui se proposent d’acquérir 500000 tonnes de sucre en 1959 et s’engagent à payer 31,3 millions de dollars sur deux ans, se situent bien en deçà du niveau de leurs importations sous Batista, lorsque les commandes pouvaient atteindre jusqu’à 47,1 millions de dollars pour la seule année 1957.
Les tractations et les discussions entre La Havane et Moscou ont commencé par des canaux officieux, mais ce n’est qu’en mai 1960 que les relations diplomatiques sont rétablies entre Cuba et l’URSS[4]. Au cours de l’été, alors que le ton monte à Washington, les Soviétiques proposent, le 1er juin, de fournir à Cuba un quart du pétrole que l’île importe puis, le 7 juillet, d’acquérir la totalité des 700000 tonnes de sucre refusées par les États-Unis. À l’automne,Washington prend de nouvelles mesures de rétorsion. Un premier embargo commercial contre l’île est annoncé le 13 septembre 1960 et il est décrété le 16 septembre, renforcé par un second, qui exclut les médicaments et certaines denrées alimentaires, un mois plus tard. L’objectif ne saurait être plus clair : asphyxier l’économie cubaine pour favoriser le mécontentement et chasser les castristes du pouvoir.
La Chine populaire s’engage à son tour, le 30 novembre, à acheter un million de tonnes de sucre. À Washington, en réponse, on annonce le 16 décembre que les achats de sucre seront bloqués pour l’année 1961 et que la cuota azucarera n’a plus de raison d’être. Sur l’île, la récolte bat son plein et elle avoisine les 6 millions de tonnes, vendues jusqu’alors dans leur quasi-totalité au voisin du Nord. À l’hiver 1960, il est clair que les États-Unis veulent la mort du régime. Sur ce point, d’ailleurs, il est intéressant de souligner la concordance parfaite entre John F. Kennedy, qui vient de remporter les élections présidentielles, et son rival, Richard Nixon. Les opérations anticubaines mises en place sous Eisenhower vont d’ailleurs se poursuivre et monter d’un cran sous l’administration démocrate. Entre-temps, le 3 janvier 1961, Washington rompt tout rapport diplomatique avec La Havane. La situation est à un point de non-retour et les menaces d’intervention n’ont jamais été aussi précises.
Le régime n’a d’autre choix que de se radicaliser ou de périr. C’est pour n’avoir jamais répondu aux menaces des États-Unis que le président guatémaltèque Jacobo Árbenz, démocratiquement élu en 1951 avait fini par être renversé, trois ans plus tard, lors d’un coup d’État orchestré autant par la United Fruit Company que par la CIA. Tous, à commencer par Guevara, présent au cours de l’événement, ont en tête l’épisode de ce gouvernement progressiste d’un petit pays d’Amérique centrale balayé d’un revers de la main par la grande multinationale de la banane états-unienne qui s’était sentie menacée dans ses intérêts.
Ce n’est pas d’ailleurs sans émotion qu’Árbenz et l’ensemble des participants présents aux cérémonies de clôture du premier Congrès latino-américain de la jeunesse, le 6 août 1960, ovationnent le discours de Fidel Castro annonçant la nationalisation des entreprises nord-américaines. Lorsque Castro arrive au numéro 24 de sa liste de 26 entreprises états-uniennes et déclare l’expropriation de la United Fruit, il y a un tonnerre d’applaudissements. En passant sous le contrôle de l’État, ces entreprises changent de nom également et cette transformation onomastique n’est pas que symbolique. Dans la province d’Oriente, la centrale Delicias est rebaptisée « Antonio Guiterras » ; la Chaparra – la plus grande du pays, un temps gérée par l’ancien président Menocal, homme de paille du capital états-unien – devient « Jesús Menéndez », du nom du « général de la canne », afro-cubain et syndicaliste, l’un des plus grands dirigeants ouvriers de l’île, assassiné en 1948 ; quant à la centrale Manatí, elle devient, tout simplement, « Algérie libre », emblème de l’internationalisme du gouvernement révolutionnaire.
Ce dernier, poussé dans ses retranchements, a en tête les principales coordonnées de la situation à la lumière de l’expérience cubaine et latino-américaine depuis la fin de la colonisation espagnole : soit la voie de l’expropriation du capital privé et étranger se poursuit, accompagnée d’une mobilisation de l’ensemble de la population et de ses organisations, soit c’est l’échec qui guette le nouveau régime et, à terme, son renversement. Les provocations et l’agressivité nord-américaines, d’ailleurs, loin d’effrayer les Cubains ou d’alimenter leur mécontentement contre le gouvernement castriste, renforcent leur détermination à résister, à approfondir le processus entamé en janvier 1959 et les soudent autour du régime.
Sur l’île, au niveau militaire et des milices, la mobilisation générale est décrétée dès la fin 1960. En effet, tant les nouveaux services de sécurité cubains que l’agence de presse Prensa latina, fondée sous la houlette de Gabriel García Márquez, ont eu vent d’un projet d’invasion imminente organisée depuis le Guatemala. Dans les campagnes, dans la Sierra de l’Escambray et dans les grandes villes, une intense activité est déployée par les maquis anticastristes et les commandos urbains pilotés depuis la Floride. Le 12 avril 1961, le président Kennedy assure qu’une invasion de Cuba n’est pas d’actualité. Trois jours plus tard, pourtant, les aéroports militaires de La Havane, de Santiago et de Piñar del Río sont bombardés. Les B26 à l’origine des attaques portent un drapeau cubain sur leur fuselage mais il n’est aucun doute quant à leur origine réelle.
Le surlendemain, la brigade 2 506 pénètre dans les eaux cubaines par la baie des Cochons et débarque sur la Playa Girón, sur la côte méridionale du centre de l’île, à quelque 200 km de la capitale. Ils sont près de 1500 combattants, la plupart cubains, anciens policiers ou officiers du régime de Batista, repris de justice ou têtes brûlées, mercenaires sans scrupule ou anticommunistes convaincus, enfants de la bonne bourgeoise qui ont fui dès 1959[5]. Escortés par l’US Navy depuis le Nicaragua d’où ils sont partis, pourvus d’une couverture aérienne assurée par d’anciens pilotes de l’aviation militaire batistienne ou des lignes commerciales de Cubana de Aviación, la majorité des membres de l’expédition est acheminée par quinze chalands et bateaux de débarquement avec, à leur bord, de l’armement lourd, cinq tanks ainsi que des véhicules de transport de troupes.
Par ailleurs, un peu plus de 170 soldats sont parachutés derrière les lignes cubaines. Les combats sont extrêmement violents, commencent dès le 17 à l’aube, et durent plus de quarante-huit heures. Cela est insuffisant pour créer une tête de pont de façon à ce que l’administration nord-américaine reconnaisse le gouvernement provisoire qui était censé être proclamé et présidé par Miró Cardona, l’ancien premier ministre après la chute de Batista. De toute façon, c’est toute l’opération qui échoue face à la résistance conjointe opposée par les forces de police, l’armée, les miliciens ainsi que par la population locale, pêcheurs et charbonniers notamment, qui sont les premiers à riposter à l’attaque et refusent d’obéir aux ordres des officiers cubains de la brigade 2506 convaincus que les civils allaient se soulever contre Castro le « communiste ». C’est l’exact opposé qui a lieu.
Ce n’est pas pour autant que l’activité militaire contre le régime va cesser. Pendant quatre ans, jusqu’en 1965, des maquis vont perdurer, notamment dans la Sierra centrale de l’Escambray, nécessitant la mobilisation de près de 100 000 hommes et femmes sur l’ensemble de la période. Comme le souligne l’historien états-unien Howard Jones, pour « la Maison Blanche sous Kennedy, la baie des Cochons est davantage un contretemps qu’une défaite, et n’a pour objectif que de renvoyer à plus tard la tentative de renverser Castro »[6].
Washington, en effet, n’aura de cesse de poursuivre cet objectif. Cependant, en dehors du Bureau ovale, l’invasion manquée est un échec cuisant pour une administration états-unienne qui refuse d’en assumer la responsabilité mais qui l’a organisée, soutenue et menée à bien de bout en bout d’un point de vue logistique, militaire et politique. Pour l’île, c’est une victoire qui est le fruit d’une mobilisation populaire qui a commencé, en réalité, dès la fin de l’année 1958. L’écho de la victoire du peuple cubain, au niveau continental, et bien au-delà, est absolument majeur : pour la première fois, une intervention nord-américaine a été mise en échec.
Non seulement Cuba peut être considérée comme « le premier territoire libre d’Amérique », cristallisant enfin les rêves d’indépendance véritable des José Martí, Pancho Villa, Emiliano Zapata, José Carlos Mariátegui, Julio Antonio Mella, Augusto César Sandino ou Farabundo Martí. Cuba devient également, avec cette énième agression états-unienne, la première république socialiste d’Amérique. En effet, lors des funérailles nationales organisées pour les victimes des bombardements aériens du 15 avril 1961, Fidel Castro proclame le caractère socialiste de la révolution. Le 25 avril, après l’échec de l’invasion, Washington décrète l’embargo total et complet contre l’île. Une semaine plus tard, lors du défilé du 1er mai, le même Castro décrète qu’il faut désormais considérer l’île comme une république socialiste. Arrivés au pouvoir deux ans auparavant avec un programme antidictatorial, démocratique et de réformes modérées, le soutien dont jouissent les jeunes commandants de la Sierra au sein des classes populaires, de la jeunesse et du mouvement ouvrier est plus important que jamais.
Aux origines d’un État ouvrier déformé
La question centrale, d’un point de vue marxiste, n’est pas tant formelle que structurelle. Dans les années 1960 et 1970, nombreux sont les États, à l’instar de l’Algérie, de la Tanzanie ou du Yémen, généralement récemment libérés de haute lutte du joug colonial ou néocolonial, qui se proclament « socialistes » ou « populaires » et qui s’allient au bloc soviétique ou encore usent d’une politique de non-alignement pour mieux manœuvrer et renégocier avec les puissances impérialistes leur insertion sur l’échiquier géopolitique mondial. Cuba n’est pas de ceux- là. Davantage encore que le caractère socialiste de l’État proclamé par Castro au printemps 1961, le plus important est que, dans le cas cubain, la terminologie vient officialiser une transformation radicale des structures de l’île qui correspondent, à partir de cette époque et ce jusqu’au processus de restauration capitaliste en cours aujourd’hui, à celles d’un État ouvrier déformé.
Il s’agit d’un État ouvrier, à l’instar de la Russie soviétique des premières années de la révolution d’Octobre, dans la mesure où le capital national et étranger a été totalement exproprié sans indemnités et que la rupture avec le système impérialiste mondial est complètement consommée. Il s’agit néanmoins d’un État ouvrier déformé – et non dégénéré, comme dans le cas de l’URSS de la fin des années 1920, à la suite de la consolidation au pouvoir de la bureaucratie stalinienne – dans la mesure où le pouvoir politique à Cuba, dès le début de la révolution, n’est pas aux mains du mouvement ouvrier, de la petite paysannerie, des masses populaires et de la jeunesse, par le biais de leurs propres organismes d’autoreprésentation – les soviets, dans le cas russe.
Le pouvoir politique qui remplace celui de la dictature batistienne est contrôlé par un secteur, en l’occurrence la direction du M26 et ses alliés, qui dit agir au nom des travailleurs des villes et des campagnes, qui jouit d’un degré indéniable de légitimité et d’un consensus au sein de l’opinion populaire, sans pour autant que cela signifie une direction effective des masses sur leur propre devenir, sur les grands débats à affronter et sur les décisions à prendre, autant de conditions essentielles à la possibilité d’un socialisme réellement émancipateur et démocratique. Cela ne veut pas pour autant dire que le système cubain de la première époque serait comparable au socialisme de caserne, autoritaire et répressif, en vigueur en URSS à la même période, ainsi que dans ses satellites.
Cependant, à mesure que la dynamique révolutionnaire des premières années va se stabiliser, que la tendance guévariste au sein de l’appareil d’État va perdre en poids et s’effilocher et, surtout, que certains choix politiques et économiques vont se faire, reliant de plus en plus étroitement le sort de Cuba à celui du bloc de l’Est, le tout combiné à un abandon de la stratégie d’une internationalisation de la révolution cubaine, alors oui, les choses vont changer. C’est alors que le socialisme cubain deviendra, progressivement, plus proche de ce qui se fait à la même époque à l’est du rideau de fer, et quand bien même il survivra à la disparition de ce bloc, se distanciant du climat émancipateur et de la dynamique révolutionnaire qui, en dépit de toutes ses contradictions et de ses limites, caractérise la première décennie de la révolution cubaine.
Les ruades des grands propriétaires terriens et des entreprises étrangères contrôlant les principales centrales sucrières, l’hostilité des associations de producteurs et d’éleveurs ainsi que la réaction extrêmement violente et disproportionnée des autorités états-uniennes face aux premières mesures du nouveau gouvernement cubain en matière agraire expliquent pourquoi le gouvernement, poussé dans ses retranchements, radicalise son projet. Mais il faut également tenir compte, en contre- point, de la mobilisation constante de la petite paysannerie et du prolétariat rural poussant à la répartition des terres et exigeant que les promesses faites dans la Sierra soient bien respectées, ce qui explique également la plus grande radicalité de la réforme ainsi que les mesures d’expropriation contre le capital rural étranger qui sont prises. Cela n’allait pas de soi, si l’on s’en tient au texte initial de mai 1959.
Comme nous l’avons expliqué, la volonté de l’administration états-unienne de mettre le pays à genoux en réduisant par à-coups les achats de sucre cubain explique, parallèlement, l’accélération du processus. En réaction, le régime cubain n’a pas recours à de simples nationalisations contre indemnisation mais procède à des expropriations pures et simples des multinationales nord-américaines dans le secteur commercial, bancaire et industriel, ce qui est fort différent. Le processus, d’ailleurs, s’accélère à l’automne 1960. C’est ainsi le 13 octobre qu’entrent en vigueur les lois 890 et 891, absolument décisives. La première permet d’exproprier sans indemnisation 382 grandes entreprises cubaines, tous secteurs confondus : 105 centrales sucrières, l’ensemble des brasseries et distilleries du pays, dont Bacardí, mais également les lignes de chemin de fer et les installations portuaires, l’industrie chimique, métallurgique et textile ainsi que la plupart des supermarchés et des grandes drogueries dans les principales villes.
L’État contrôle alors environ 80% de la capacité industrielle de l’île. Avec la loi 891, le gouvernement nationalise l’ensemble du secteur bancaire, tant étranger que cubain, à l’exception des banques canadiennes. Le 15 octobre, c’est la réforme urbaine qui entre en vigueur.Après le premier décret sur la baisse des loyers pris au début du processus, le gouvernement envisage de répondre de façon encore plus radicale à la crise du logement. Pour ce faire, il confisque contre indemnisation les propriétés des familles qui possèdent plus d’une unité immobilière. Les loyers sont désormais payables directement à l’État, de façon à financer un grand programme de construction de logements publics et les locataires reçoivent, au bout de cinq ou quinze ans, leur logement en usufruit. Le 15 octobre, par ailleurs, une autre loi de nationalisation est également proclamée, permettant l’étatisation de 273 grandes entreprises cubaines.
C’est la quasi-totalité de l’économie de l’île, à l’exception des petites entreprises et du commerce de détail, qui se trouve aux mains de l’État. En mai 1961, selon des chiffres officiels cubains, ce sont les trois quarts des échanges extérieurs de l’île qui se réalisent avec les pays du bloc soviétique. Encore une fois, c’est tout autant l’intransigeance états-unienne suivie de l’agression de la baie des Cochons que la poussée constante des masses populaires qui décident de cette orientation qualitativement différente du gouvernement révolutionnaire par rapport à ses projets initiaux. C’est désormais l’ensemble des rouages économiques de l’île qui sont aux mains d’un État qui n’a plus grand-chose à voir avec cette république dépendante et sous tutelle, dirigée tour à tour par des gouvernements plus ou moins corrompus et plus ou moins autoritaires, et qui a vu le jour en 1902.
Néanmoins, comme nous le soulignions, cette restructuration complète de l’État, qui a nationalisé l’ensemble des moyens de production, de reproduction et de circulation du capital, contrôle le secteur bancaire et le commerce interne et extérieur, n’est pas corrélée à un contrôle politique complet et réel du processus par les principaux intéressés par ces réformes radicales, à savoir les classes subalternes cubaines et le monde du travail. En revanche, la société cubaine change de fond en comble, remettant en cause les hiérarchies sociales, raciales et de genre modelées par les rapports de propriété et de production caractéristiques du capitalisme semi-colonial et périphérique qui ont structuré l’île jusqu’alors.
Parallèlement, l’île fait des pas de géant en termes d’accès à la culture, à l’éducation, à la santé et à la prévention. Là encore, et indépendamment de la propagande officielle autour des succès cubains dans ces différents domaines, Cuba n’est pas un État ouvrier déformé ou « socialiste » en raison des politiques sociales ambitieuses qui sont portées par le nouveau régime. Les caractéristiques d’État ouvrier déformé sont liées au processus d’expropriation qui a été mené en amont. Ceci étant dit, ces mesures sociales radicales font figure d’exception au niveau latino-américain, autant à l’époque qu’aujourd’hui. C’est la forme du nouvel État, de même que la planification économique et des ressources, qui permettent des avancées absolument majeures dans plusieurs domaines.
Au niveau culturel et sportif, l’État investit massivement pour que les loisirs soient à la disposition de toutes et tous. Symbole de l’ancienne structure touristique héritée de la période antérieure, l’ensemble des plages du pays sont déclarées publiques le 17 mars 1959, les Cubains découvrant pour la première fois certaines portions de leur littoral qui étaient jusqu’alors réservées aux étrangers. Dans la foulée, le nouveau gouvernement fonde la grande maison d’édition et structure culturelle Casa de las Américas ainsi que l’Institut cubain d’art et d’industrie cinématographique (ICAIC) qui vont bientôt permettre un rayonnement majeur des productions cubaines ; des réalisateurs aussi connus que Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás ou Alejandro Álvarez vont ainsi jouer un rôle clé pour la popularité de la révolution à échelle internationale.
Les deux secteurs dans lesquels le gouvernement révolutionnaire va également investir massivement sont l’éducation et la santé. Dans le premier cas, une grande campagne nationale de mobilisation va être décrétée au cours de l’année 1961 de façon à libérer le pays de l’illettrisme. Selon le recensement de 1953, un million de Cubains, soit près du quart de la population, était analphabète. À la fin de la campagne, en 1961, ce chiffre tombe à 3,9 %. Le nombre d’écoles, sur l’île, passe de 7 750 en 1958 à près de 20 000 en 1975 alors que le corps enseignant passe, pour la même période, de 23000 instituteurs et professeurs à 166 000.
Au niveau de la santé et de la prévention, le gouvernement met en œuvre une politique ambitieuse de maillage territorial et de formation. Pour ne prendre que quelques exemples, cela implique la construction de plus de 150 hôpitaux au cours des quinze premières années de la révolution – le pays n’en comptant que 95 en 1959 –, la multiplication par cinq des dépenses de santé publique ainsi que l’éradication, entre autres, de la poliomyélite, de la malaria et une baisse notable de la mortalité en couche et de la mortalité infantile, les taux cubains rejoignant au cours des années 1970 les taux des pays « développés ».
Au niveau de la société cubaine, de nouvelles organisations voient le jour, massivement investies par les classes subalternes, par la classe ouvrière urbaine, par la paysannerie, par les femmes et par la jeunesse. Cependant, elles n’ont pas de rôle décisionnel dans la nouvelle configuration étatico-politique qui voit le jour.Tout au plus sont-elles associées aux prises de décisions, comme des organes consultatifs. Parfois, et ce de façon croissante à partir de la fin des années 1960, elles servent ou deviennent de simples courroies de transmission entre l’État et le reste de la société qui voit son niveau de vie global et ses conditions de travail faire un bond gigantesque pour un pays qui, la veille encore, charriait les tares et les problèmes d’un pays « sous-développé ». En sus de la Milice nationale révolutionnaire, parmi les organismes qui voient le jour en 1959-1960, deux d’entre eux sont particulièrement importants. D’un côté, la Fédération des femmes cubaines (FMC), créée le 23 août 1960, qui va bientôt organiser à travers toute l’île plusieurs centaines de milliers de femmes à partir des premières organisations de paysannes et des équipes syndicales féminines.
Elle assure des fonctions d’éducation populaire, de formation politique, de défense des intérêts des femmes dans une île qui n’a peut-être pas l’apanage du machisme et du virilisme par rapport à nombre de pays « développés » ou « sous-développés » à la même époque, mais où ces éléments restent très prégnants. La FMC est prise en main, dès sa création, par Vilma Espín, seconde femme de Raúl Castro, qui en sera la présidente de 1960 à 2007. La seconde organisation qui voit le jour alors que les menaces d’agression extérieure se précisent et que les opérations de sabotage sont monnaie courante est celle des Comités de défense de la révolution (CDR).
Présents dans chaque quartier ou pâté de maison dans les grandes villes, usines et administrations, les CDR assurent une fonction sociale d’éducation populaire et de prévention au niveau socio-sanitaire, mais également des tâches de contrôle et de vigilance. Très tôt cependant, après 1962, Guevara lui-même critiquera certains de leurs travers, le moralisme et la rigidité de certains de ses cadres, confondant vigilance politique contre les activités contre-révolutionnaires et intromission dans la vie privée des Cubains et des Cubaines. Cette tendance n’ira qu’en se renforçant au fil du temps, transformant les CDR en succursales des organes officiels de sécurité. D’entrée de jeu, les CDR sont tout sauf des conseils décisionnaires de quartier ou d’entreprise permettant l’exercice de la démocratie directe des producteurs.
Au niveau des entreprises et des centrales sucrières, dans les campagnes, une multitude de comités ont vu le jour à partir de 1959, investis par les militants les plus aguerris mais aussi et surtout par les travailleurs et les travailleuses s’éveillant à la vie politique. Ces comités assurent des fonctions de protection des unités de production et, souvent, de gestion de la production en l’absence des cadres et des anciens dirigeants patronaux qui ont été destitués ou ont fui. Parallèlement, comme nous l’avons vu, la Centrale des travailleurs cubains est purgée de ses éléments « mujalistes » liés à l’ancienne dictature et se retrouve dès le début de l’année 1959 dirigée par l’aile ouvrière du M26 qui y est hégémonique, y compris vis-à-vis des communistes du PSP.
Rapidement, néanmoins, les organismes de base vont être institutionnalisés à travers la mise en place de conseils techniques et de commissions de doléances dans les entreprises. Ces derniers n’auront jamais un pouvoir décisionnaire, se limitant à un rôle d’intermédiaire entre les collectifs ouvriers et les différents organes du pouvoir, à commencer par le puissant Institut national de la réforme agraire, le ministère de l’industrie, celui de l’économie et du travail. Les conseils n’existeront d’ailleurs qu’entre 1961 et 1962, alors que les commissions disparaîtront en 1964. Au niveau syndical, les staliniens sont remis en selle sur intervention express de Fidel Castro, à partir du 10e congrès de la CTC, organisé en novembre 1959. Comme le souligne Samuel Farber :
À plusieurs reprises, le ministre Ernesto Guevara demandera aux travailleurs de se soumettre aux nouvelles normes gouvernementales et, plus important encore, de renoncer à l’indépendance de leurs syndicats. Ce que les travailleurs ont en général accepté en échange de l’amélioration de leurs conditions de vie que leur a procuré le nouveau régime dont ils partagent par ailleurs les options anti-impérialistes[7].
Dès les premières années de la révolution, la CTC représente par conséquent davantage un appendice de l’appareil d’État qu’un organisme autonome de défense des intérêts du monde du travail.
Si l’on ne peut donc parler, à Cuba, de la structuration d’une authentique démocratie ouvrière – qui n’a de toute façon absolument rien à voir avec une démocratie formelle basée sur le suffrage universel et axée sur un système représentatif qui échappe au contrôle du monde du travail – le gouvernement met en place, parallèlement, des instruments répressifs dont le rôle et la fonction sont discutables. Face aux menaces internes et externes qui pèsent sur lui et dans un souci de protection de ses intérêts et de sa survie, tout régime révolutionnaire est généralement contraint de mettre sur pied des mesures et des structures d’exception qui n’ont de légitimité que tant qu’elles sont au service des intérêts des classes subalternes qui sont les acteurs du processus révolutionnaire et dans la mesure où elles sont appelées à disparaître.
Très tôt, à Cuba, à ces mesures d’exception qui s’inscrivent contre les éléments ouvertement contre-révolutionnaires – il suffit de songer aux exécutions conduites par Guevara à La Cabaña en janvier 1959 ou aux campagnes contre les maquis anticastristes jusqu’en 1965 – se superposent d’autres structures, davantage assimilables à une politique autoritaire et de répression d’opposants qui, très souvent, sont loin d’être des « ennemis » réellement menaçants pour le nouvel ordre révolutionnaire, lorsqu’il ne s’agit pas tout simplement de personnes accusées de « déviance ». On pensera ainsi aux Unités militaires d’appui à la production (UMAP) dans lesquelles sont internés des Cubains et des Cubaines jugés « asociaux », mais également des prêtres catholiques et des pasteurs protestants, des dissidents réels autant que des citoyens accusés d’anticastrisme ou des homosexuels. La rectification et la reconnaissance de ses erreurs par l’État cubain seront bien tardives et n’auront lieu qu’à la fin des années 1980. Sans jamais être comparable au système carcéral et répressif en vigueur dans les autres pays du bloc soviétique, la politique cubaine d’internement met néanmoins en relief, en sus d’une absence de démocratie révolutionnaire, d’autres traits extrêmement problématiques d’un État ouvrier déformé.
C’est enfin au niveau de la direction politique et de son monolithisme croissant que doivent également être analysées les limites du processus cubain du point de vue des nouvelles institutions. Au cours des premières années de la révolution, il existe dans les faits un pluralisme partidaire des courants défendant le processus de transformation. Il y a, bien entendu, le M26, mais également le Directoire révolutionnaire, bien plus réduit, ou encore le PSP et même le petit Parti ouvrier révolutionnaire, trotskiste, reconstruit en 1960. Ce dernier est d’ailleurs actif jusqu’en 1962, lorsque la répression gouvernementale s’abat sur ses militants et le démantèle. Avec l’aiguisement des tensions vis-à-vis des États-Unis et dans un souci – pragmatique – de centralisation et d’efficacité, Castro met en place une nouvelle structure politique qui voit le jour dans le sillage de la mobilisation qui préside à la défaite de l’invasion de la baie des Cochons.
Les Organisations révolutionnaires intégrées (ORI) sont officialisées le 22 mai 1961.Y confluent le M26, le DR et le PSP dont l’influence devient décisive au sein de la direction de la nouvelle organisation. C’est d’ailleurs une délégation des ORI qui représente Cuba au 23e congrès du PC soviétique (PCUS) en octobre 1961. En mars de l’année suivante, les ORI se transforment en Parti unifié de la révolution socialiste (PURS) qui est la base du Parti communiste cubain dont le premier congrès (si l’on exclut la première formation du même nom) s’ouvre le 3 octobre 1965, au cours duquel Castro donne lecture de la « lettre d’adieu » de Guevara.
Notes
[1] L’université de La Havane rouvre ses portes le 11 mai 1959, après trois ans de fermeture administrative sur décision de la dictature. Le centre universitaire devient l’un des principaux pôles d’agitation de la jeunesse dans la capitale, brassant bien au-delà des seuls étudiants.
[2] Certains historiens estiment que Castro a manœuvré pour obtenir le déplacement d’Urrutia et la déposition de Matos, qui est condamné à vingt ans de réclusion pour rébellion. Indépendamment de la façon dont la justice est rendue, tant Urrutia que Matos font valoir que leur positionnement est lié à leur opposition à l’« infiltration communiste du gouvernement », mais il s’agit, en vérité, d’une hostilité manifeste à l’égard d’une réforme des terres qu’ils jugent arbitraire et beaucoup trop radicale. Leurs partisans, lorsqu’ils ne s’exilent pas, gagnent les maquis contre-révolutionnaires.
[3] Cienfuegos disparaît en vol le 22 octobre 1959. Le corps et son avionnette ne seront jamais retrouvés. Dans l’opinion, on accuse immédiatement les partisans de Batista d’être à l’origine de sa mort.
[4] En novembre 1959, Tass, l’agence de presse officielle soviétique, ouvre un bureau à La Havane dirigé par Aleksander Alekseev, dont le rôle n’est pas simplement celui de couverture journalistique. En février 1960, Anastas Mikoïan, à l’époque vice-président du Conseil des ministres de l’URSS, réalise un premier voyage de prise de contact dans le cadre d’une tournée dans la région et prend langue avec nombre d’officiels cubains. Il incarnera par la suite le « lobby cubain » à Moscou.
[5] Selon les données collectées par la suite par les services cubains, les biens cumulés de 800 de ces volontaires cubains issus de la haute bourgeoisie auraient avoisiné, avant 1959, 375 000 hectares de terres, 10 000 maisons et bâtiments, 70 industries, dix centrales sucrières, cinq mines ainsi que deux banques.
[6] Howard Jones, The Bay of Pigs, Oxford / New York, Oxford University Press, 2010, p.153.
[7] Samuel Farber, Che Guevara : ombres et lumières d’un révolutionnaire, Montréal/Paris, M. Éditeur/Syllepse, 2017, p.96.



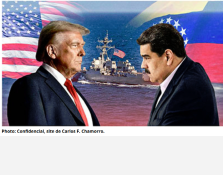




Un message, un commentaire ?