27 octobre 2025 | tiré de Jacobin
Zohran Mamdani :
Face à plus de 13 000 personnes réunies au Forest Hills Stadium, il serait tentant de croire que ce moment a toujours été écrit d’avance. Et pourtant, lorsque nous avons lancé cette campagne le 23 octobre, il y a un an et trois jours, il n’y avait pas une seule caméra de télévision pour la couvrir.
Quand nous avons commencé, mon nom n’était qu’une anomalie statistique dans les sondages. Quatre mois plus tard, en février dernier, notre soutien culminait péniblement à 1 %. Nous étions à égalité avec le candidat bien connu nommé « quelqu’un d’autre ». J’ai toujours su que nous pouvions le battre.
Lorsque nous avons lancé cette campagne, le monde politique n’y a guère prêté attention, car nous voulions bâtir un mouvement à l’image de la ville telle qu’elle est réellement, et non telle que les consultant·es politiques la voient sur un tableur.
Et à l’époque, dans les couloirs du pouvoir, on nous prenait pour une blague. L’idée de changer fondamentalement les personnes que le gouvernement sert dans cette ville était inimaginable. Et même si nous parvenions à gagner du terrain, demandaient-ils, comment pourrions-nous jamais surmonter les dizaines de millions de dollars d’attaques qui s’abattraient sur nous ?
Mais nous savions alors ce que nous savons encore aujourd’hui : New York n’est pas à vendre.
Alors que les jeunes se mobilisaient en nombre record, que les immigrant·es se reconnaissaient enfin dans la politique de leur ville, que des aîné·es longtemps sceptiques se remettaient à rêver, nous avons parlé d’une seule voix : New York n’est pas à vendre.
Et maintenant que nous nous tenons au bord de la reconquête de cette ville, arrachée des mains des politicien·nes corrompu·es et des milliardaires qui les financent, faisons retentir nos mots si fort ce soir qu’Andrew Cuomo puisse les entendre dans son appartement à 8 000 dollars par mois. Qu’il puisse les entendre même s’il est à Westchester ce soir. Et qu’ils résonnent jusque dans la Maison-Blanche, pour que son marionnettiste les entende aussi : « New York n’est pas à vendre. »
Treize jours après l’annonce de ma candidature, Donald Trump a remporté de nouveau la présidence. Le Bronx et Queens ont connu parmi les plus grands basculements vers la droite de tout le pays. Peu importe le journal qu’on lisait ou la chaîne qu’on regardait, l’histoire semblait la même : notre ville glissait vers la droite.
Des nécrologies politiques ont été écrites sur la prétendue incapacité des démocrates à toucher les électeur·ices asiatiques, les jeunes, les hommes. Encore et encore, on nous répétait que si nous voulions battre le Parti républicain, il nous faudrait devenir le Parti républicain.
Andrew Cuomo lui-même a dit que nous avions perdu non pas parce que nous n’avions pas su répondre aux besoins de la classe ouvrière, mais parce que nous avions passé trop de temps à parler de toilettes et d’équipes sportives.
Ce fut un moment où notre horizon politique semblait se rétrécir. Et à ce moment-là, New York, tu avais un choix : reculer ou te battre. Et nous avons choisi d’arrêter d’écouter ces « experts » pour commencer à t’écouter, toi.
Nous sommes allés dans deux des endroits qui avaient le plus basculé vers la droite : Fordham Road et Hillside Avenue. Ces New-Yorkais·es étaient très loin du cliché de l’électeur·ice trumpiste.
Ils et elles nous ont dit qu’ils avaient soutenu Donald Trump parce qu’ils se sentaient déconnecté·es d’un Parti démocrate devenu complaisant dans la médiocrité et qui ne consacrait son temps qu’à ceux et celles qui donnaient des millions. Ils et elles nous ont dit qu’ils se sentaient abandonné·es par un parti inféodé aux grandes entreprises, qui leur demandait leur vote sans jamais leur présenter une vision claire de ce pour quoi il se battait.
Ils et elles nous ont dit qu’ils ne croyaient plus en un système qui ne prétendait même plus offrir de solution au défi central de leur vie : la crise du coût de la vie. Le loyer était trop cher. Les courses aussi. La garde d’enfants aussi. Prendre l’autobus aussi. Et occuper deux ou trois emplois ne suffisait toujours pas.
Trump, malgré tous ses défauts, leur avait promis une politique qui mettrait plus d’argent dans leurs poches et ferait baisser le coût de la vie. Donald Trump a menti. C’était à nous de tenir la promesse faite aux travailleurs et travailleuses qu’il avait trahi·es.
Au cours des huit mois de la primaire, nous avons expliqué comment nous comptions affronter cette même crise de l’accessibilité. Et nous ne l’avons pas fait seul·es.
Ce mouvement a été porté par des dizaines de milliers de New-Yorkais·es ordinaires qui frappaient aux portes après douze heures de travail et téléphonaient jusqu’à en avoir les doigts engourdis. Des gens qui n’avaient jamais voté sont devenus des militant·es acharné·es. Une communauté s’est formée. La ville a appris à se connaître elle-même. C’était votre mouvement — et il le restera toujours.
À mesure que la neige fondait, notre campagne s’est mise à croître plus vite que quiconque ne l’aurait imaginé. Tant de petit·es donateur·ices ont contribué que nous avons dû leur demander d’arrêter : s’il vous plaît, arrêtez.
Nous avons grimpé dans les sondages plus vite qu’Andrew Cuomo ne pouvait composer le numéro de Donald Trump. Les gens ont appris à prononcer mon nom.
Et les milliardaires ont eu peur. Ou, comme l’a écrit le New York Times, « les Hamptons étaient en thérapie de groupe à propos de la course à la mairie ».
Ces grands donateur·ices et politicien·nes discrédité·es ont tout fait pour voler notre ambition, parce qu’ils et elles ne pensent pas que vous méritez la beauté d’une vie digne. Andrew Cuomo et ses ami·es corporatistes ont tout fait pour faire de cette campagne une campagne de peur et de petitesse. Ils ont dépensé des millions, allongé artificiellement ma barbe pour me rendre plus menaçant, peint notre ville en enfer dystopique, et ont travaillé jour et nuit à diviser les New-Yorkais·es.
Ils ont échoué.
Quelques jours avant l’élection, lorsque j’ai parcouru Manhattan à pied, des centaines de New-Yorkais·es ont marché à mes côtés. Nous avons traversé Times Square sous un panneau d’affichage qui donnait à Cuomo près de 80 % de chances de victoire. Nous savions déjà que les experts allaient encore se tromper.
Andrew Cuomo devait être « inévitable ». Et pourtant, le 24 juin, nous avons brisé cette prétendue inévitabilité.
Nous avons gagné avec 13 % d’avance, avec le plus grand nombre de votes jamais enregistrés dans une primaire municipale à New York. Certain·es de ces électeur·ices avaient voté pour Trump. Beaucoup n’avaient jamais voté. Et quand Andrew Cuomo m’a appelé à 22 h 15 pour concéder la défaite, il m’a dit : « Vous avez créé une force immense. »
Quand on construit une coalition qui fait de la place pour chaque New-Yorkais·e, c’est exactement ce qu’on crée : une force immense. Et cette force n’a cessé de croître au cours des quatre derniers mois. Nous comptons désormais plus de 90 000 bénévoles.
Nous avons parlé à des millions de New-Yorkais·es. Nous avons présenté des plans concrets : embaucher des milliers d’enseignant·es, mettre fin à la mainmise des consultant·es et des contrats privés dans l’administration, et affronter le « boss final » des infrastructures new-yorkaises : les échafaudages.
Mais ces dernières semaines, à l’approche de la fin de la campagne, nous avons vu se déchaîner une islamophobie qui choque la conscience.
Andrew Cuomo, Eric Adams et Curtis Sliwa n’ont aucun projet pour l’avenir. Tout ce qu’ils ont, c’est le manuel du passé. Ils ont cherché à faire de cette élection un référendum non pas sur la crise du coût de la vie, mais sur ma foi — et sur la haine qu’ils veulent banaliser.
Nous avons passé des mois à convaincre le monde que les New-Yorkais·es ont le droit de vivre dans la ville qu’ils et elles aiment. Et voilà que nous devons défendre l’idée même qu’un musulman ait le droit de la diriger.
Ces mêmes élites et politiciens corrompus veulent nous dépouiller de notre ambition, parce qu’ils pensent que vous ne méritez pas la dignité. Encore et encore, ils vous encouragent à rêver plus petit, car ils savent qu’un New York réinventé menace leurs profits. Mais moi, je crois que cette ville est comme l’univers : en expansion constante.
Nous méritons un gouvernement municipal aussi ambitieux que les travailleurs et travailleuses qui font de cette ville la plus grande du monde. Nous ne pouvons pas attendre que quelqu’un d’autre le fasse à notre place.
Attendre, trop souvent, c’est faire confiance à ceux et celles qui nous ont mené·es là où nous en sommes. Le 4 novembre, nous remettrons cette ville sur la voie qui doit être la sienne.
Et ce jour-là, nous répondrons à une question qui hante l’Amérique depuis sa fondation : Qui a le droit d’être libre ?
Certain·es entendent cette question et connaissent déjà la réponse. Ce sont les oligarques, ceux qui ont accumulé d’immenses richesses sur le dos de celles et ceux qui travaillent du lever du soleil jusqu’à la nuit tombée. Ces barons voleurs croient que leur argent leur donne plus de voix que le reste d’entre nous.
Je ne parle pas seulement des Bill Ackman ou Ken Langone de ce monde. Je parle de ceux et celles dont vous ne connaissez même pas le nom, qui donnent plus aux super PACs que ce que nous pourrions jamais leur imposer comme impôts, et qui se réjouissent quand leurs publicités diffusent le mot « djihad mondial » en surimpression sur mon visage.
Leur liberté ne se paie pas seulement au prix de la vérité et de la dignité. Elle se paie aussi au prix de la liberté des autres. Ce sont des autoritaires qui veulent nous maintenir sous leur pouce, parce qu’ils savent qu’une fois que nous nous serons libéré·es, nous ne nous laisserons plus jamais écraser.
Chacun de ces gens pense que New York est à vendre. Depuis trop longtemps, mes ami·es, la liberté n’a appartenu qu’à ceux qui peuvent se la payer. Les oligarques de New York sont les plus riches de la ville la plus riche du pays le plus riche de l’histoire du monde. Ils ne veulent pas que l’équation change.
Ils feront tout pour que leur emprise ne se relâche pas.
Mais la vérité est aussi simple qu’incontestable : nous avons tous et toutes droit à la liberté.
Chacun·e d’entre nous — les travailleurs et travailleuses de cette ville, les chauffeur·euses de taxi, les cuisinier·es, les infirmier·es, tous ceux et toutes celles qui cherchent une vie de grâce et non d’avidité — nous avons tous et toutes droit à la liberté.
Et le 4 novembre, grâce au travail acharné de plus de 90 000 bénévoles aux quatre coins de cette ville, c’est exactement ce que nous dirons au monde. Car pendant que les donateur·ices milliardaires de Donald Trump croient pouvoir acheter cette élection, nous avons un mouvement de masse. Un mouvement qui n’a pas peur de ce qu’il croit — et qui y croit depuis longtemps.
Ceux et celles qui s’inquiètent de ce que deviendra ce mouvement le 1er janvier sont les mêmes qui s’inquiétaient, le 23 octobre, de ce qu’il deviendrait aujourd’hui. Mais notre objectif n’a pas changé, pas plus que nos promesses.
Comme je l’ai dit le soir de l’annonce de ma candidature : le rôle du gouvernement est d’améliorer réellement nos vies. Et voici, mot pour mot, ce pour quoi nous nous battons :
Nous allons geler les loyers pour plus de deux millions de locataires à loyer stabilisé et mobiliser toutes nos ressources pour construire des logements pour tous ceux et toutes celles qui en ont besoin.
Nous allons supprimer le tarif sur toutes les lignes d’autobus et faire de ces bus — aujourd’hui les plus lents du pays — un réseau fluide et accessible.
Et nous allons instaurer un service de garde universel gratuit, pour que les New-Yorkais·es puissent élever leur famille dans la ville qu’ils et elles aiment.
Dignité, mes ami·es, est un autre mot pour liberté.
Ensemble, New York, nous allons geler les… [la foule crie « loyers ! »]
Ensemble, New York, nous allons rendre les bus… [« gratuits ! »]
Ensemble, New York, nous allons instaurer la… [« garde universelle ! »]
Nous ferons de cette ville un lieu où chacun·e peut vivre dignement. Aucun·e New-Yorkais·e ne devrait être chassé·e de quoi que ce soit d’essentiel à sa survie. Et nous avons cru, nous croyons, et nous croirons toujours que c’est le devoir du gouvernement d’assurer cette dignité.
En me tenant devant vous ce soir, je puise ma force dans l’héritage de celles et ceux qui, en Amérique, ont lutté pour la liberté, refusant d’accepter que le gouvernement soit incapable de répondre à l’urgence du moment. Quand le pouvoir du peuple surpasse l’influence des puissants, il n’est aucune crise que le gouvernement ne puisse affronter.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d’avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d’avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre








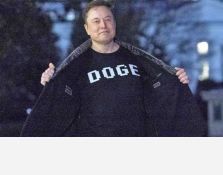

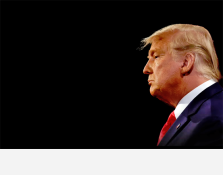

Un message, un commentaire ?