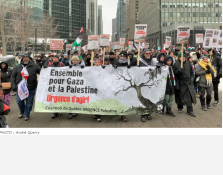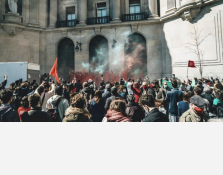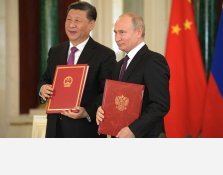Pour ce qui concerne Merkel et Sarkozy, leur arrogance de puissants en dit long sur leur cynisme et leur mépris de la démocratie. Il faut bien ça pour éviter d’avoir à reconnaître que ce sont les politiques néolibérales qui ont mené à la crise, la Grèce n’ayant finalement fait qu’appliquer jusqu’au bout le précepte en vogue partout : faire reculer l’impôt à tout prix, surtout celui des riches, de telle sorte que ceux-ci puissent prêter aux États, et amorcer ainsi l’engrenage de la dette.
La monnaie et la dette sont au cœur de l’extraordinaire crise que connaît le capitalisme mondial depuis plus de quatre ans. La finance ayant pris le pouvoir avec la bénédiction de tous les gouvernements pour imposer la « valeur pour l’actionnaire », les classes dominantes ont cru trouver la parade à la crise de suraccumulation du capital (tous les secteurs productifs sont en surcapacité de production), d’une part en développant une gigantesque spirale spéculative, d’autre part en palliant la stagnation des salaires par l’endettement. La catastrophe ne pouvait que survenir : partie du secteur de l’immobilier aux États-Unis, elle a gagné le secteur bancaire et financier, puis toute l’économie qui est entrée en récession ou stagnation, provoquant ainsi un accroissement des déficits publics. L’Union européenne et la zone euro, qui devaient être des remparts, ont été des bombes à retardement.
Les gouvernements des pays membres de la zone euro sont incapables de nous aider à sortir de la crise parce que, jusqu’ici, le rôle d’une monnaie et l’enjeu de la maîtrise de la création monétaire et du crédit ont été sciemment niés. Et il n’est pas étonnant que, au sein des mouvements sociaux, subsistent souvent des incompréhensions, voire des rejets, concernant ces questions.[1]
La création monétaire
Au cours d’une période donnée et au niveau de l’ensemble de l’économie, il y a création (ou émission) de monnaie lorsque le montant des nouveaux crédits dépasse les remboursements. Cette création est réalisée par l’ensemble du système bancaire, presque intégralement sous forme de monnaie scripturale, à la demande du système économique (les spécialistes parlent de monnaie endogène, alors que le taux d’intérêt déterminé par la banque centrale est exogène). Depuis que les banques ordinaires ont été systématiquement privatisées, la création de monnaie provient donc, pour l’essentiel, de leur fait. Ici commence la première difficulté : lorsque la demande de monnaie émane des ménages pour consommer et des entreprises pour investir dans des moyens de production nouveaux, la chose est supportable sans déséquilibres ; mais lorsque cette demande exprime les seuls besoins de placements financiers pour participer à la restructuration permanente du capital mondial (fusions, absorptions, concentration…) ou à la pure spéculation grâce à l’effet levier, au leveraged buy out, aux produits dérivés, ou aux contrats de types CDS, CDO, sur des marchés de gré à gré, le péril est dans la demeure.
Le risque est d’autant plus grand si la banque centrale restreint la création monétaire destinée à l’investissement et l’emploi et au contraire facilite le crédit appelé à nourrir les activités financières. Telle fut la pratique, entre autres, de la Banque centrale européenne (BCE) qui, depuis sa création, a affirmé ne tolérer qu’une croissance annuelle de la masse monétaire de 4,5 % (2 pour couvrir l’inflation acceptable et 2,5 pour accompagner la croissance économique de la zone euro), tout en la laissant croître à un rythme bien supérieur (plus de 11 % à la veille de la crise de 2007). Le premier rôle d’une banque centrale est en effet d’être le prêteur en dernier ressort : par le biais de son taux directeur, elle fait varier le taux du marché interbancaire sur lequel les banques ordinaires viennent s’approvisionner en monnaie centrale. Cette dernière est doublement nécessaire aux banques : d’abord pour compenser entre elles les multiples ordres de paiement, ensuite pour faire face aux menus besoins des agents économiques en billets et pièces.
La dette due à la crise
Or, on a vu récemment, au cours de la crise dite des dettes publiques, combien les banques pouvaient se refinancer à très bas coût auprès de la BCE (1,25 % actuellement) pour ensuite prêter aux États en déficit à des taux exorbitants pouvant aller, comme dans le cas de la Grèce, jusqu’à des dizaines de pour cent. L’affaire était, jusqu’à peu, juteuse pour les banques dans la mesure où, en vertu des statuts de la BCE, les États membres de la zone euro ne pouvaient émettre de bons du Trésor directement auprès de celle-ci et se trouvaient obligés de les placer sur les marchés financiers. Les banques les achetaient, pour leur propre compte ou celui de leurs épargnants, tous étant assurés jusqu’à la crise de percevoir une rente importante non rognée par l’inflation.
Ainsi, la baisse de la fiscalité sur les plus riches, l’interdiction faite aux États d’emprunter à taux zéro auprès de la banque centrale, le recours aux marchés financiers entraînant un effet de boule de neige dès que les taux y sont supérieurs au taux de croissance économique et l’effet récessionniste de la crise expliquent la montée générale des dettes publiques, sans que l’on note une augmentation des dépenses publiques significative.[2]
Comment faut-il comprendre cette obstination à empêcher que la banque centrale puisse prêter aux États, c’est-à-dire « monétiser » les déficits publics ? Cette interdiction date, en France, d’une loi de janvier 1973. Elle fut ensuite consacrée par le traité de Maastricht en 1992 et reprise dans tous les traités européens jusqu’à aujourd’hui. Elle s’inscrit dans le programme néolibéral qui s’ouvre pendant la décennie 1970 où la circulation des capitaux est libérée. Les gouvernements choisissent délibérément de donner la main aux marchés. En quelque sorte, la monnaie en tant que bien public est dépolitisée puisque cette décision vise à neutraliser la politique monétaire au regard de l’activité économique réelle.
Il ne faut cependant pas en conclure qu’avant cette décision la banque centrale était seule à créer de la monnaie. Les banques ordinaires créaient la plus grande partie de la monnaie par le crédit, mais la banque centrale pouvait exercer cette fonction à la demande de l’État. Dans le cadre de la zone euro, la BCE ne peut en théorie que contrôler l’émission de monnaie par les banques ordinaires.
Création de monnaie et développement
Pourquoi la perte de la politique monétaire et, par conséquent, de la possibilité d’émettre de la monnaie pour financer des dépenses publiques est-elle dommageable pour la collectivité ? Pour au moins trois raisons.
1) En enlevant à la puissance publique le droit de faire appel à l’émission de monnaie pour répondre à des besoins collectifs lorsque les impôts ne suffisent pas, la monnaie est dévoyée puisqu’elle n’est plus qu’un instrument d’enrichissement privé et qu’elle perd sa capacité à exprimer un lien social. Par exemple, la privatisation de la monnaie va de pair avec la privatisation de la sécurité sociale. Ainsi, il faut voir la monnaie comme une institution sociale qui suppose une double validation : par la légitimation politique qui garantit la confiance que lui accordent les membres de la société et par le travail productif qui lui confère réellement son statut d’à-valoir sur la production.
2) La banque centrale et sa politique étant explicitement mises au service de la rentabilité financière, il en est résulté le développement de mécanismes porteurs de spéculation, d’instabilité, de déréglements et, au bout, de crises.
3) Mais, et c’est l’aspect le plus méconnu, le recours au crédit est indispensable pour financer le développement économique. Il l’est évidemment pour le capitalisme dont la logique est de toujours accumuler davantage. Mais il l’est et le serait aussi pour une société qui, débarrassée de la logique du profit, déciderait de se développer. En effet, pour que le capitalisme récupère plus de monnaie qu’il n’en a engagé pour faire produire des marchandises par le travail et réaliser ainsi du profit monétaire, il faut qu’une quantité de monnaie supplémentaire soit mise en circulation par rapport aux avances. Et le raisonnement vaut aussi pour les services non marchands.[3] Donc toute création de monnaie se faisant par le crédit, si le développement est jugé nécessaire, il implique un endettement sur le plan macroéconomique.
De ce fait, il y a une suspicion, voire une condamnation, jetée à l’encontre du principe du crédit, qu’on trouve dans beaucoup de commentaires militants mais qui n’est pas justifiée.[4] Car le crédit est indispensable à une dynamique de l’économie (on suppose ici que la question du bien fondé de cette croissance est résolue s’il s’agit de biens et services utiles et soutenables). La perversion de la politique monétaire néolibérale a été de consacrer l’essentiel de la création monétaire au grossissement de la sphère financière, à la restructuration permanente du capital mondialisé et à la spéculation. Donc, lorsque le crédit est accordé pour le système productif dans son ensemble, il anticipe la création de richesses supplémentaires (par exemple un crédit destiné à augmenter l’investissement). C’est ce qui rassemble sur le plan théorique des grands auteurs comme Marx, Luxemburg, Keynes, Kalecki : l’accumulation n’est possible macroéconomiquement que si le système bancaire anticipe par le crédit l’accroissement de la production qui résultera de l’investissement.
La banque centrale au cœur du problème
Se greffe alors la question de savoir où se situe la frontière entre l’action directe et l’action indirecte de la banque centrale, autrement dit entre le rôle proprement dit de la banque centrale et celui des banques ordinaires. Dans le cas où la banque centrale achète directement à l’État des bons du Trésor (c’est encore possible aux États-Unis et au Royaume-Uni), il y a création de monnaie. Si la banque centrale revend ces bons à des banques de second rang, celles-ci les achètent sur fonds propres ou sur épargne déjà existante (dite préalable) des déposants et donc on peut considérer que la création précédente est annulée puisque la banque centrale va voir arriver dans ses caisses de la liquidité qui est retirée de la circulation. Si ce sont les banques de second rang qui achètent les bons du Trésor en première main pour leur propre compte ou celui de leurs déposants, la quantité de monnaie ne change pas. Ensuite, si elles revendent ces bons à la banque centrale, cette dernière met en circulation une quantité de monnaie supplémentaire. Cette frontière séparant le rôle direct et indirect de la banque centrale est souvent difficile à établir, l’imbroglio de la résolution de la crise de l’euro l’atteste.
La farce tragique
Si la situation n’était pas si dangereuse, on pourrait sourire de l’impuissance des gouvernements des pays membres de l’Union européenne ou de la zone euro à résoudre la crise que leurs politiques ont engendrée. La gravité des difficultés rencontrées par certains pays pour honorer leur dette publique (Grèce, Irlande, Portugal, Espagne, Italie…) a obligé la BCE à renoncer temporairement à son dogme : en quelques mois, elle a racheté 160 milliards d’euros de bons d’État aux banques ravies de se défausser d’une part de leur créances douteuses, ce qui a fait tousser les orthodoxes allemands et autres monétaristes. On remarquera que ces derniers ont été beaucoup moins sensibles au fait que les taux d’intérêt exigés sur les marchés étaient devenus usuraires, tandis que les cours des credit défault swaps (CDS) s’envolaient, puisque les spéculateurs pouvaient parier sur ces contrats d’assurance sans posséder les obligations publiques concernées.
Lors des Conseils européens des 22-23 et 26 octobre 2011, la capacité d’action du Fonds européen de stabilisation financière (FESF) a été accrue et il garantira les emprunts d’État jusqu’à hauteur de 25 %. Comme il lui reste 250 milliards sur les 440 que lui garantissaient les États contributeurs, il pourra donc assurer jusqu’à 1000 milliards de dettes publiques, d’où un effet de levier multiplicatif de 4. Mais l’effet de levier ne suffira pas (la seule dette italienne s’élève à 1900 milliards d’euros). Aussi un mécanisme appelé special purpose vehicle a été adopté, c’est-à-dire un fonds commun de créances ou encore fonds commun de titrisation, adossé au FESF et peut-être au FMI. Cela signifie que le FESF émettra des obligations à taux faible et les sommes levées seront reprêtées aux États en difficulté. Il pourra même placer hors bilan des créances grâce à la procédure de titrisation. Et les pays émergents (Chine, Brésil, Russie…) seront conviés à acheter de la dette européenne.
Cet accord n’a rien résolu au fond. Les gouvernements ont évité de remettre en cause le statut néolibéral de la BCE qui lui interdit de financer directement les États. La chancelière allemande, le président français, et le successeur de Jean-Claude Trichet à la tête de la BCE, Mario Draghi, ont encore imposé leur vision néolibérale. Disposant de fonds de garantie dont la fonction essentielle sera d’être des bad banks, les institutions financières spéculatrices achèteront des titres publics, certaines qu’elles seront de pouvoir ainsi s’en débarrasser. On réutilise donc les mêmes mécanismes financiers qui ont conduit à la crise : titrisation, effet de levier, CDS, CDO, garantie publique sans contrepartie exigée des banques. Pendant ce temps, l’austérité imposée aux peuples est renforcée. Et les « dix-sept » se sont engagés à inscrire la règle d’or d’équilibre budgétaire dans leur constitution avant la fin 2012. Sarkozy l’a dit : « un accord pour stabiliser et pacifier les marchés » ; les voilà désormais rassurés. Pourtant, ils devraient se méfier : l’affaire Dexia a prouvé que, à force de pratiquer des taux usuraires, le problème de l’emprunteur devenait celui du prêteur.
Devant ce triste spectacle, la proposition d’audit citoyen sur la dette publique[5] est une mesure de salubrité publique urgente, afin de déclarer illégitimes les dettes publiques engendrées par les politiques néolibérales et la crise et d’annoncer qu’elles ne seront pas honorées, en décidant à l’échelle européenne les pays prioritaires, compte tenu de leurs difficultés. Pour réussir cette opération, la socialisation de tout le secteur bancaire européen, la séparation étanche entre les activités de dépôt et de prêt et les activités de placement des banques, sont indispensables, de même que la restauration d’une forte progressivité de la fiscalité. Il n’y a là aucune impossibilité pratique, il manque seulement encore la volonté politique d’« euthanasier la rente »[6] par une annulation de celle-ci et le relèvement de la part salariale dans la valeur ajoutée. Ajoutons que trop de propositions apparemment iconoclastes se contentent de réclamer la « monétisation de la dette publique ». Or, il s’agit moins de faire racheter par la banque centrale les titres de la dette publique existante (accumulation des déficits passés largement dus aux politiques en faveur des riches) dont il faut annuler une grande partie, que de monétiser les investissements d’avenir pour une transition sociale et écologique, c’est-à-dire de les financer par création monétaire remise au service de la société. Si le crédit anticipe l’avenir en préparant les productions qui seront nécessaires et réalisées, le risque inflationniste est contenu. En l’absence d’une telle réorientation, nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Il serait donc temps qu’on cesse de parler de crise de la dette alors que la dette est due à la crise.
[1] Pour approfondir sans peine, voir la petite nouvelle policière « Le mystère de la chambre forte », in Attac, Le piège de la dette publique, Comment s’en sortir ?, Paris, Les Liens qui libèrent, 2011.
[2] Voir Attac, Le piège de la dette publique, Comment s’en sortir ?, op. cit.
[3] Voir J.M. Harribey, « Les vertus oubliées de l’activité non marchande », Le Monde diplomatique, novembre 2008.
[4] On ne peut que regretter les erreurs contenues dans les vidéos telles que « L’argent dette » de Paul Grignon, 2008, ou bien « Comprendre la dette publique », 2011, qui diffusent une vision complotiste de la création monétaire. Sans parler des affirmations niant le crédit comme création monétaire : voir J.M. Harribey, « De quoi l’argent est-il le nom ? », 2010, commentaire du livre de P. Jorion, L’argent, mode d’emploi.
[5] Appel pour un audit citoyen de la dette publique. Voir aussi F. Chesnais, Les dettes illégitimes, Quand les banques font main basse sur les politiques publiques, Paris, Raisons d’agir, 2011.
[6] L’expression est de Keynes