Avec la reprise en main par Jacques Parizeau en 1989 et la liquidation de la perspective d’affirmation nationale qu’avait défendue Pierre-Marc Johnson en 1985, le PQ s’est reconstruit. Il a pu, encore une fois, unir les souverainistes à l’intérieur du Parti avec le mot d’ordre de Parizeau : défendre la souveraineté avant, pendant et après les élections.
En 1994, le PQ reprend le pouvoir. L’année suivante, il organise un référendum sur la souveraineté-partenariat. Le gouvernement Parizeau n’envisage pas de convoquer une Assemblée constituante. Il adopte un projet de loi qui définit déjà clairement les grandes lignes de la souveraineté recherchée. La direction péquiste est engagée jusqu’au cou dans le néolibéralisme et veut désarmer la méfiance du gouvernement de Washington. Elle propose donc une souveraineté limitée.
Son projet prévoit l’association avec le Canada, la monnaie commune, la double citoyenneté, le soutien à l’ALENA et aux alliances militaires (OTAN et NORAD). Le Québec deviendrait souverain, mais les Québécoises et les Québécois pourraient demeurer citoyens canadiens. Le Québec deviendrait souve¬rain, mais il pourrait continuer à profiter de la monnaie canadienne. Le Québec deviendrait souverain, mais il continuerait à être partie à tous les traités et alliances signés par le gouvernement du Canada. Les fédéralistes auront beau jeu de tirer profit de ces contradictions évidentes.
En signe de bienveillance envers le gouvernement américain, Parizeau se présente comme l’avant¬garde du libre-échange sur le continent. Son projet de souveraineté limitée propose une « rupture tranquille » qui pourrait respecter la domination américaine.
Contrairement au référendum de 1980, la direction péquiste prévoit une consultation limitée et bien contrôlée. La Commission sur l’avenir du Québec est un bien pâle reflet de ce qu’aurait pu être une véritable démarche d’Assemblée constituante. Les gens du Québec auront le droit de se prononcer sur la souveraineté, mais non celui de décider collectivement de la réalité du Québec dans lequel ils veulent vivre.
Cette simple consultation a néanmoins démontré la force des aspirations démocratiques du peuple. La Commission sur l’avenir du Québec a tenu près de 300 audiences, reçu plus de 3 000 mémoires et réuni près de 40 000 personnes. La Commission des jeunes a tenu 20 forums dans 25 villes auxquels ont participé 5 000 jeunes. Nombre de personnes et d’organisations qui ont pris la parole devant les deux Commissions tenaient à lier les revendications sociales et les revendications nationales.
La démarche limitée de consultation a malgré tout insufflé un élan au camp du OUI qui l’a conduit à l’orée d’une victoire. Le PQ avait toutefois commencé dès mars 1995 à glisser vers une troisième voie pour se rapprocher de l’Action démocratique du Québec (ADQ).
Une campagne trop faible contre les forces du statu quo
Jacques Parizeau a adressé un discours à saveur social-démocrate aux classes populaires. Ce fut un facteur très important pour rallier un fort courant au camp du OUI. Les discours et la publicité associaient ce camp à la paix, à une société écologique et féministe. On cherchait à l’identifier avec les aspirations à une société égalitaire, une société qui n’est pas seulement centrée sur les possédants. Ce fut la base de la remontée du OUI bien plus que les discours modérés et rassurants de Lucien Bouchard. Les discours n’ont cependant pas été accompagnés de véritables mobilisations populaires ni d’engagements réels en termes de projet de société. Ils se sont bornés à une reprise médiatique des aspirations populaires.
Le camp du OUI a par ailleurs sous-estimé les forces d’opposition au projet de souveraineté du Québec. Contrairement à ses attentes, tous les secteurs importants de la bourgeoisie québécoise se sont rangés dans le camp du NON. Même les entreprises dont le développement avait profité du soutien actif de l’État québécois ont emboîté le pas.
Quant aux dirigeants canadiens, ils n’ont guère fait preuve d’un comportement démocratique. Ils n’ont reculé devant aucun moyen légal ou illégal pour empêcher la population du Québec de se prononcer librement. Avant le référendum, Jean Chrétien a même déclaré qu’il ne reconnaîtrait pas une victoire du OUI et il a d’ailleurs répété son refus après le référendum.
Le gouvernement américain n’a pas fait preuve de neutralité ; les dirigeants de tous les partis sont intervenus pour défendre l’unité canadienne. Bref, pour les chefs politiques canadiens et américains, la perspective d’une souveraineté même très limitée s’inscrivant dans un cadre libéral ou néolibéral était inacceptable.
En fin de compte, le OUI a raté la cible de peu : le NON l’a emporté avec 50,6 % des voix, soit à peine 54 000 votes de plus. À la lumière des manœuvres déloyales sinon illégales des fédéralistes, bon nombre de gens considèrent que le référendum de 1995 a été volé.
Les leçons du référendum de 1995
Pour l’Union des forces progressistes, le deuxième référendum sur la souveraineté montre la nécessité d’une démarche d’éducation populaire comme celle possible durant les travaux d’une Assemblée constituante. Pour s’opposer au camp de l’argent qui veut préserver le statu quo, il faut la plus large mobilisation possible. Les responsables du référendum de 1995 avaient compris l’importance d’une consultation, mais ils en ont limité l’envergure.
De plus, la direction péquiste n’a pas lié étroitement les revendications sociales et l’aspiration nationale à la souveraineté. Elle a préféré inscrire le projet social dans une démarche néolibérale et atlantiste. À notre avis, cela a empêché la population d’associer l’indépendance à des changements tangibles qui auraient pu consolider sa volonté d’aller de l’avant.
La direction péquiste a également négligé le caractère multinational et multiculturel du Québec pour miser davantage sur les francophones de souche. Selon l’UFP, cette erreur stratégique a permis aux fédéralistes de se présenter comme uniques défenseurs des communautés issues de l’immigration. Cette négligence niait la présence de membres de ces communautés dans le camp du OUI, mais elle réduisait aussi la portée du concept de la nation québécoise. La déclaration désastreuse de Parizeau sur les votes ethniques, le soir de la défaite, a confirmé cette incompréhension. À notre avis, le camp du OUI n’avait pas reconnu la force de sa démarche, soit l’ouverture aux aspirations démocratiques de toute la population.
Conclusion.
Les référendums de 1980 et de 1995 ont été deux autres moments où se sont exprimées les aspi¬rations nationales. Chaque fois, la campagne préalable offrait une occasion de mobilisation large. Malheureusement, la direction péquiste du camp du OUI a compté davantage sur la popularité des leaders et sur une approche de type marketing. Il faut souligner qu’en 1995, les stratèges ont nette¬ment sous-estimé la détermination des fédéralistes à stopper la vague souverainiste par tous les moyens. Parmi les manœuvres plus ou moins légales du camp du NON, mentionnons : la naturalisa¬tion accélérée de milliers de personnes immigrantes ; l’allocation de sommes astronomiques à Option Canada, un club du Conseil pour l’unité nationale ; une demande d’intervention aux États-Unis ; les dépenses illégales de la Marche pour l’Unité organisée à Montréal trois jours avant le référendum. Voilà seulement quelques-uns des actes commis au nom de l’unité canadienne contre la volonté populaire du Québec, actes qui viennent de faire surface dans l’enquête de la Commission Gomery et l’ouvrage de Robin Philpot, Le référendum volé. [1]
À la lumière des machinations des fédéralistes et des obstacles jetés sur le chemin de la souveraineté, notamment la Loi sur la clarté, une nouvelle stratégie s’impose. Pourquoi ne pas tirer des leçons des États généraux et des campagnes menées pour les deux référendums ? Chacune de ces expériences a montré la volonté des gens du Québec de s’exprimer sur leur destin. Chaque fois, la forte participa¬tion a confirmé la puissance des aspirations démocratiques. Chaque fois, le peuple a prouvé sa capacité de donner un contenu social et économique à l’avenir politique du pays.
Voilà pourquoi l’Union des forces progressistes propose la convocation d’une Assemblée constituante. Contrairement aux consultations des États généraux et des campagnes préréférendaires, l’Assemblée constituante sera pensée comme une démarche d’affirmation nationale et comme une rupture en soi avec le cadre fédéral. Le processus d’éducation populaire mené ne visera donc pas à convaincre la population de voter pour confier un mandat de négocier à un parti ou à un gouvernement. Il servira plutôt à faire surgir les visions collectives pour un Québec indépendant. Les besoins, les espoirs et les rêves exprimés s’incarneront dans un projet de Constitution, ce qui rendra visible le contenu social de la souveraineté.
L’ Assemblée constituante fera sortir la démarche de souveraineté des mains d’un seul parti politique, le Parti québécois, pour devenir enfin un projet citoyen. Elle cessera d’être une affaire d’experts pour devenir enfin l’affaire de tout le monde. Comme elle s’appuie sur une conception inclusive de la nation, elle permettra de travailler avec les communautés issues de l’immigration qui ont été auparavant négli¬gées. Selon l’UFP, une Assemblée constituante serait en effet sérieusement compromise sans la parti¬cipation de ces communautés. Elle le serait tout autant sans une reconnaissance concrète de la réalité nationale des peuples autochtones. Pour nous, cela signifie entre autres de leur offrir la possibilité de prendre part, d’égal à égal, à la démarche démocratique pour tracer les contours d’un Québec indépendant.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d’avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d’avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre


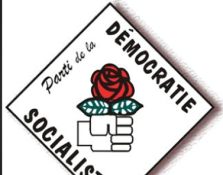


Un message, un commentaire ?