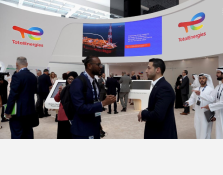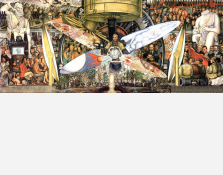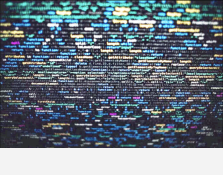New-York, nous voici !
Si l’on évoque fréquemment la crise de la dette des pays du Sud au début des années 80, c’est pourtant à New York que va débuter un processus de dépossession des classes populaires via la dette. J’emprunte l’analyse qui suit à David Harvey |2|. Dans son livre Brève histoire du néolibéralisme, il décrit un « putsch des institutions financières au détriment du gouvernement démocratiquement élu de New-York ». Dans les années 70, plusieurs éléments structurels (désindustrialisation, appauvrissement du centre-ville suite au développement des banlieues) entraînèrent la ville dans des difficultés financières. Résolues durant un temps par le déficit, ces difficultés s’aggravèrent en 1975 suite à la décision d’une banque d’affaire de refuser de couvrir la dette de la ville, provoquant de facto une sorte de défaut de paiement. Suite à ce défaut, l’administration du budget de la ville passa sous le contrôle de nouvelles institutions non élues, lesquelles visaient prioritairement le remboursement des créanciers. Débuta alors un refrain qui se généralisera rapidement aux quatre coins du monde : coupes budgétaires dans les services publics et sociaux, gel des salaires des fonctionnaires et affaiblissement des syndicats, notamment par l’obligation leur étant faite d’investir leur fond de pension en obligations de la ville. David Harvey donne une grande importance à cet événement « local » car selon lui, « la gestion de la crise budgétaire de New-York prépara la voie aux pratiques néolibérales, tant sur le plan national sous Reagan qu’au niveau international avec le FMI |3| dans les années 1980 ». Et d’ajouter qu’elle posa les bases du principe suivant : « dans le cas d’un conflit opposant l’intégrité des institutions financières et les bénéfices des actionnaires au bien-être des citoyens, on (les pouvoirs publics) privilégierait les premiers ». Par conséquent, « le gouvernement avait pour rôle de créer un climat favorable aux affaires plutôt que de prendre en charge les besoins et le bien-être de la population en général » |4|.
Étape suivante : le tiers monde
Après New-York, c’est le Mexique qui aura le triste privilège d’ouvrir le bal de l’austérité.
L’explosion des taux d’intérêt décidée unilatéralement par les Etats-Unis, appliquée conjointement à la chute des prix des produits d’exportation du pays vont conduire le gouvernement mexicain dans l’incapacité à honorer ses dettes. La méthode newyorkaise va dès lors être appliquée par le FMI et la Banque mondiale |5|. En plus des coupes budgétaires, ces derniers imposeront également des mesures structurelles telles que la réduction des barrières douanières, des privatisations massives et davantage de flexibilité du marché du travail |6|. Les conséquences seront doubles et augureront la nouvelle ère néolibérale : précarisation massive de la population mexicaine (entraînant une hausse de l’emploi informel, de la criminalité, de l’insécurité alimentaire, …) et enrichissement d’une « élite » étrangère (banques créancières, entreprises américaines) et nationale (24 milliardaires sont apparus suite aux différentes réformes imposées à l’économie mexicaine, dont Carlos Slim, un temps l’homme le plus riche de la planète) |7|. Les choses se dérouleront à peu près de la même façon pour une grande partie de l’Amérique du Sud, de l’Afrique et dans une moindre mesure de l’Asie. Pour bien des auteurs, dont David Harvey, il est clair que la crise de la dette fut à l’origine du virage néolibéral dans la plupart des pays du Sud |8|. Ce qu’il faut comprendre, c’est que la façon dont les choses se sont passées n’émanait pas du hasard mais était préparée de longue date, notamment par les disciples de Milton Friedman, lesquels ont peu à peu colonisé le FMI et la Banque mondiale. Naomi Klein résume : « confrontés aux chocs à répétition des années 80, les pays endettés n’avaient d’autre choix que de s’adresser à la Banque mondiale et au FMI. Ils se heurtaient alors au mur d’orthodoxie dressé par les Chicago Boys qui, en raison de leur formation, voyaient les catastrophes moins comme des problèmes à régler que comme de précieuses occasions qu’il fallait saisir au vol afin d’ouvrir de nouveaux territoires au libre-marché » |9|. Bien que le Nord ne fût pas épargné par cette attaque |10|, c’est suite à la crise de la dette grecque en 2010 que l’offensive de dépossession par les créanciers va être la plus brutale.
Une gestion de la dette au service du 1 %
Ce qu’il faut comprendre, et c’est ce qu’Harvey démontre de façon magistrale, c’est que le néolibéralisme n’est en réalité rien d’autre qu’une coquille idéologique dissimulant la réaffirmation d’un pouvoir de classe |11|. Ainsi, « la principale réussite de la néolibéralisation réside dans la redistribution, et non dans la création, de richesses et de revenus » |12|. Christian Vandermotten ne dit pas autre chose quand il écrit que « quelques soient les modalités de son apparition, le néolibéralisme se traduit par une réaffirmation du pouvoir économique des classes dominantes » |13|. Par conséquent, plus qu’une idéologie, il faut considérer cette vague néolibérale avant tout comme un projet politique de renforcement de la domination en faveur des détenteurs de capitaux. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les multiples entorses faites à la théorie néolibérale, même parmi les plus fervents défenseurs de ce système. La gestion des crises de la dette est probablement le meilleur exemple. « En donnant toute autorité au FMI et à la Banque mondiale pour négocier les allègements de dette, les États néolibéraux en venaient à protéger les principales institutions financières mondiales de la menace d’un défaut. En réalité, le FMI couvre, du mieux qu’il peut, l’exposition aux risques et aux incertitudes sur les marchés financiers internationaux. Pratique difficile à justifier par rapport à la théorie néolibérale, puisque les investisseurs devraient en principe être responsables de leurs propres erreurs » |14|. Joseph Stiglitz va dans le même sens. Prix Nobel d’économie et ancien économiste en chef à la Banque mondiale, il écrit : « dans l’économie de marché normale, si un prêteur consent un prêt qui tourne mal, il en subit les conséquences (…). Dans la réalité, à de multiples reprises, le FMI a fourni des fonds aux États pour tirer d’affaire les créanciers occidentaux » |15|. Il résume les choses de façon limpide : « si l’on examine le FMI comme si son objectif était de servir les intérêts de la communauté financière, on trouve un sens à des actes qui, sans cela, paraîtraient contradictoires et intellectuellement incohérents » |16|. Dans un registre similaire, les sauvetages bancaires suite à la crise de 2007-2008 aux États-Unis et en Europe dévoilent également des intérêts de classe : loin de l’idéal libéral de responsabilité des investisseurs, on assiste plutôt à un mécanisme de privatisation des bénéfices et de socialisation des pertes. Et tant pis pour le fameux aléa moral, pourtant invoqué pour justifier le remboursement de la dette par les pays du Sud.
Un autre point de discordance |17| par rapport à la théorie est le choix des priorités budgétaires. À de rares exceptions près, on remarque que dans la plupart des pays soumis à l’austérité, le budget militaire n’est pas ou peu concerné par les coupes dans les dépenses publiques. Il en était déjà ainsi sous Reagan, qui malgré une rhétorique très antiétatique, a maintenu des budgets militaires faramineux, financés pour l’essentiel par le déficit. Comme le note Harvey, « bien qu’en désaccord avec la théorie néolibérale, l’augmentation des déficits fédéraux a fourni une justification commode au projet de démolition des programmes sociaux » |18|. La double explication est sans doute d’une part l’existence et la puissance du complexe militaro industriel et ses liens avec l’administration américaine, et d’autre part un impérialisme toujours omniprésent de la puissance américaine vis-à-vis du reste du monde (Naomi Klein utilise l’expression capitalisme du désastre pour décrire le phénomène associant ces deux éléments). La gestion de la dette grecque conduit à une analyse semblable puisque le budget de l’armement du gouvernement, parmi un des plus élevés de l’Union Européenne, a été au début épargné des mesures d’austérité, au détriment des dépenses sociales, de santé et d’éducation. Le fait que la France et l’Allemagne soient deux des grands vendeurs d’armes à la Grèce n’y est sans doute pas étranger.
Crises et technocrates
Par ailleurs, la crise sert souvent de prétexte à l’imposition de mesures impopulaires. Naomi Klein a décrit ce phénomène sous le nom de stratégie du choc : en résumé, cela consiste à profiter du désarroi d’une population face à un évènement brutal pour imposer des mesures qu’il serait difficile, voire impossible de faire passer en temps normal. De nouveau, la crise de la dette, dans le tiers monde ou en Europe, illustre parfaitement ce phénomène. « La menace que représentent les dettes publiques pour la stabilité bancaire est devenue à la fois un écran de fumée pour dissimuler les responsabilités des banques et un prétexte pour imposer des politiques antisociales afin d’assainir les finances publiques » |19|. De plus, l’argument de la crise ou de l’insoutenabilité de la dette tend à évincer de plus en plus de processus démocratiques. En atteste « le goût des néolibéraux pour les institutions non démocratiques, qui n’ont de compte à rendre à personne ». Harvey résume l’imposture néolibérale : « de fortes interventions de l’État et un gouvernement des élites et des « experts », dans un monde qui n’est pas censé être interventionniste » |20|. Cinq ans après avoir écrit ces lignes, la gestion de la crise grecque et européenne lui donne entièrement raison puisqu’ont été placés au pouvoir différents « techniciens » directement en provenance du monde de la finance. Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, est d’ailleurs un ex-dirigeant de Goldman Sachs. Ce qui est regrettable, c’est de voir l’inertie de la sphère politique par rapport à cela. Ainsi, la fameuse règle d’or, qui grave l’austérité dans le marbre et impose des choix budgétaires faisant fi des choix électoraux des populations, n’a pour ainsi dire pas rencontré de protestation de la part des gouvernements en place et de la plupart des partis traditionnels. Pourtant, il est clair que nous sommes face à un nouveau processus d’accaparement des richesses par une minorité |21|. Tous les néolibéraux ne sont évidemment pas des êtres perfides et dépourvus d’état d’âme. Nombre d’entre eux sont sans doute de bonne volonté mais baignent dans un ensemble de croyances et de mythes |22| associés – souvent à tort – à l’idéal libéral ou capitaliste. Malgré ça, il existe bel et bien une élite, financière, politique, entrepreneuriale, qui bénéficie des mesures néolibérales imposées la plupart du temps de façon non démocratique. Reconnaître cet état de fait doit nous conduire à dénoncer et à lutter contre la dette illégitime et les plans d’austérité.
Notes
|1| Déjà au XIXe siècle, l’Empire Ottoman, l’Amérique latine ou la Chine on vu la généralisation de prêts bancaire en provenance des métropoles du nord (banques londoniennes) devenir un moyen de contrôle de leurs finances publiques et de leurs richesses. Voir à cet égard TOUSSAINT Éric, http://cadtm.org/Retour-dans-le-pas...
|2| HARVEY David, Brève histoire du néolibéralisme, Les Prairies Ordinaires, Paris, 2014, p76.
|3| Si le FMI, et sa consœur la Banque mondiale furent à l’origine crées respectivement pour stabiliser l’ordre économique mondiale et financer le développement des pays les plus pauvres, ces deux institutions vont rapidement être transformées en outil d’imposition du néolibéralisme, en particulier par les élites nord-américaines. Leur localisation à Washington ainsi que leur système de fonctionnement dominés par les pays occidentaux (et en particulier les États-Unis) expliquent largement cet état de fait.
|4| HARVEY, op. cit., p80.
|5| Cette façon de faire se combinera rapidement aux méthodes impérialistes américaines qui, contrastant avec le colonialisme européen, constituaient davantage en la mise en place d’un pouvoir « indépendant » mais entièrement soumis aux intérêts américains. L’endettement servira alors à la fois à la corruption de ces gouvernements fantoches mais également, du fait de la gestion par la Banque Mondiale et le FMI, à un transfert de richesses des peuples du Sud vers les élites financières (américaines ou autres).
|6| Ces mesures seront également encouragées par l’adhésion du Mexique au GATT ainsi qu’à l’ALENA en 1994.
|7| HARVEY, op. cit. pp149-154
|8| VANDERMOTTEN Christian, La production des espaces économiques, Éditions de l’ULB, Bruxelles, 2010, p345 ; KLEIN Naomi, La stratégie du choc, Acte Sud, Paris, 2008, pp256-261.
|9| KLEIN Naomi, op. cit, p252.
|10| Fin des années 70, la montée des taux d’intérêts suivie des tournants Reagan et Thatcher vont augurer la liquidation par divers moyens de l’héritage interventionniste omniprésent pendant les trente glorieuses. Par ailleurs, à l’instar de New-York quelques années auparavant, plusieurs villes feront office de laboratoire pour l’imposition de l’austérité dans les budgets publics. Tel fut le cas de la ville de Liège dans les années 80. Cette politique sera élargie à l’ensemble de la Belgique, notamment à travers le gouvernement Martens-Gol. Après quelques années de réformes progressistes, la France mitterrandienne s’engouffrera également dans la brèche néolibérale, tout comme les pays de l’Est après l’effondrement de l’Union Soviétique.
|11| HARVEY, op. cit., p223
|12| HARVEY, op. cit, p226.
|13| VANDERMOTTEN, op. cit., p339. Voir également TOUSSAINT Éric, Bancocratie, Aden, Bruxelles, 2014. Ce dernier écrit : « les politiques néolibérales généralisées depuis les années 80 ont permis aux capitalistes d’augmenter leur part dans le revenu national alors que diminuait la part qui revient aux salaires » (p56).
|14| HARVEY, op. cit., p115.
|15| STIGLITZ Joseph, La grande Désillusion, Fayard, Paris, 2002, pp321-322
|16| STIGLITZ Joseph, op. cit., p330.
|17| Il y en a évidemment d’autres. Un qu’il est intéressant de souligner est le décalage entre le fameux principe de concurrence libre et non faussée et l’existence dans de nombreux domaines de situation d’oligopoles qui contrôlent une grande partie du marché. La sphère financière est encore une fois emblématique puisque selon Éric Toussaint, « entre 1997 et 2010, les 5 plus grandes banques sont passées de 52 à 75% du marché en Belgique et de 50,9 à 86 % en France » (op. cit., p153). La situation est semblable dans bien des domaines d’activité, de l’automobile à l’aviation en passant l’agroalimentaire.
|18| HARVEY, op. cit., p136.
|19| TOUSSAINT Éric, Bancocratie, op. cit., p190. De nouveau, l’objectif n’est que théorique puisque les politiques d’austérité contractant la demande et donc diminuant les recettes fiscales, ne résolvent en rien la question des déficits. Le cas de la Grèce est emblématique.
|20| HARVEY, op. cit. p111.
|21| Pour s’en convaincre, il suffit de voir les statistiques quant au nombre de milliardaires et de millionnaires, partout en augmentation. Dans un même registre, le marché du luxe (sacs Vuitton, cigares haut de gamme, voitures de sport…) ne s’est jamais aussi bien porté.
|22| Parmi ces mythes, mentionnons la figure du travailleur entrepreneur, l’efficacité du marché, les bienfaits du libre-échange et de la liberté économique, le rattrapage économique des pays du Sud…
Renaud Duterme Auteur de Rwanda, une histoire volée , éditions Tribord, 2013 et co-auteur avec Éric De Ruest de La dette cachée de l’économie, Les Liens qui Libèrent, 2014.