Tiré du site des Nouveaux cahiers du socialisme.
Bien que cette décision soit indissociable du nationalisme américain auquel Trump a à la fois répondu et nourri, la position de Biden ne peut être réduite à un écho de « Make America Great » de Trump. Contrairement à Trump, le plan de Biden reconnaît et répond à la fois à l’environnement et à la nécessité de soutenir la syndicalisation. Quoi qu’il en soit, les progressistes canadiens eux-mêmes ont souvent fait valoir qu’il est éminemment sensé de lier les remises versées par le gouvernement à la protection et à la création d’emplois au pays.
Pourtant, compte tenu de la dépendance écrasante des industries automobiles canadienne et mexicaine vis-à-vis du marché américain, elles pourraient être dévastées par ce dernier stratagème Buy-American. Pour Chrystia Freeland, ministre des Finances et vice-première ministre du Canada, cette étape « risque de devenir l’enjeu bilatéral dominant entre les deux pays ».
Rabais pour les véhicules électriques
Essentiellement, les remises fonctionnent comme suit. À compter de l’adoption complète du projet de loi, une subvention de 7 500 $ sera accordée aux acheteurs de véhicules électriques, peu importe où ils sont fabriqués. Mais à partir de 2027, la subvention de 7 500 $ ne s’appliquera qu’aux véhicules fabriqués aux États-Unis. Une subvention supplémentaire de 4 500 $ sera ajoutée si – dans une affirmation remarquablement concrète du soutien de Biden au travail organisé – les véhicules sont fabriqués dans des usines syndiquées. Cela porterait la subvention potentielle à 12 000 $. (Il n’est pas clair si la mesure de « syndicalisation » s’applique uniquement aux usines d’assemblage ou aux pièces qui entrent dans l’assemblage.)
Les tensions soulevées par Freeland tournent autour de la question de savoir si l’action américaine contrevient à l’accord commercial que le Canada et le Mexique ont soutenu en grande partie précisément pour empêcher les États-Unis d’agir unilatéralement. Mais beaucoup plus doit être déballé ici. Les remises sur les véhicules sont-elles le meilleur moyen d’accélérer l’abandon des combustibles fossiles ? L’électrification des véhicules est-elle aussi essentielle pour résoudre la crise environnementale que le battage médiatique le suggère ? La préservation de l’accord commercial actuel est-elle la réponse au dilemme auquel le Canada est confronté face à la politique américaine ? Que peut faire le Canada si les États-Unis ne renversent pas ou ne modifient pas leur position ? Et la démarche pro-syndicale provocatrice prise par Biden est-elle sans ambiguïté positive ?
Il est possible qu’étant donné les intérêts des constructeurs automobiles américains à protéger leurs investissements canadiens récents et prévus et leurs options dans le choix des fournisseurs, les États-Unis pourraient cette fois accepter le Canada et le Mexique. Mais les tensions sont un autre rappel de notre déséquilibre de pouvoir avec les États-Unis et de notre vulnérabilité, accord commercial ou non, aux intérêts et priorités américains alors que les circonstances aux États-Unis changent économiquement ou politiquement.
Cette vulnérabilité doit-elle être acceptée pour des raisons « pratiques » ou devrions-nous, comme l’a suggéré le chroniqueur du Toronto Star Thomas Walkom, traiter cette dernière affirmation de la puissance de l’unilatéralisme américain non seulement comme une menace, mais comme une ouverture ? Pourquoi ne pas s’appuyer dessus pour commencer à atténuer notre dépendance excessive vis-à-vis des États-Unis ? Pourquoi ne pas contrer en déclarant un programme parallèle « Achetez au Canada » ?
Rabais
Il est utile de commencer la discussion menant à la question de Walkom par un examen du programme de rabais américain. Les remises gouvernementales sur les véhicules électriques ne sont pas elles-mêmes nouvelles en Amérique du Nord. En 2016, les libéraux provinciaux ont introduit un remboursement encore plus élevé de 14 000 $ en Ontario, la plus grande province du Canada et le centre de la production automobile. Cependant, à la mi-2018, lorsque les libéraux ontariens ont été remplacés par les conservateurs, cela a été annulé. Les libéraux fédéraux ont répliqué avec de nouveaux rabais en 2019 de 2 500 $ pour les hybrides, 5 000 $ pour les véhicules entièrement électriques – bien moins que le plan provincial initial. Le Québec, à 8 000 $, a actuellement le remboursement provincial le plus élevé ; avec le remboursement fédéral, cela s’élève jusqu’à 13 000 $.
Quelques jours après l’adoption du plan de rabais américain et dans les premiers jours d’une prochaine élection en Ontario, les libéraux provinciaux ont emboîté le pas en proposant des rabais sur l’achat de véhicules électriques qui correspondaient à ceux du Québec. Le NPD et les Verts ont déclaré que leurs propres programmes étaient en préparation. (Les conservateurs étaient impénitents ; Ford a plutôt choisi de construire plus d’autoroutes et de paver de vastes étendues d’une ceinture de verdure actuelle.)
Mais ce qui est particulièrement significatif dans ces réactions des politiciens provinciaux et fédéraux canadiens, c’est qu’aucun d’entre eux n’est allé jusqu’à présent dans la direction de Biden. Dans aucun d’entre eux, il n’y a de lien entre les remises et la question de l’investissement et de l’emploi intérieurs, encore moins la présence d’un syndicat.
Dans tous ces cas américains et canadiens, les remboursements obligatoires sont payés par le gouvernement, c’est-à-dire le contribuable, et non par les constructeurs automobiles. Il en est ainsi malgré la responsabilité première de l’industrie pour son rôle préjudiciable dans la résolution de la crise environnementale. Même maintenant, alors que GM se présente fièrement comme soucieux de l’environnement, il fait de son mieux pour vendre des camions gourmands en carburant et très rentables avant que la conversion aux véhicules électriques ne puisse plus être évitée.
Les remises se concentrent sur les incitations du marché pour le consommateur et chouchoutent les géants de l’automobile. Pourquoi ne pas plutôt, ou même en plus, s’attaquer au côté de l’offre et fixer directement des « objectifs » – fixer une date après laquelle les moteurs à combustion interne à base de combustibles fossiles seront interdits ? L’exemple pertinent ici est que le 1er janvier 1942, le War Production Board des États-Unis a émis une ordonnance présidentielle d’urgence pour interdire la production automobile dans un délai d’un mois afin que les installations et les matériaux automobiles puissent être convertis à la priorité écrasante de l’époque : la production militaire.
L’interdiction, malgré quelques grognements de la part des entreprises, a été remarquablement fluide et réussie : Staline lui-même (alors un allié des États-Unis) a noté que sans le virage américain vers la production militaire « nous aurions perdu la guerre ». Une initiative de transformation similaire ne devrait pas être, du moins techniquement , plus difficile, et probablement plus facile, aujourd’hui, compte tenu des avancées technologiques et institutionnelles depuis lors.
Si la crise environnementale est quelque part aussi grave que les scientifiques nous le disent frénétiquement, et que les inondations et les incendies ont forcé les sceptiques et les politiciens à le reconnaître de plus en plus, alors pourquoi la volonté politique ne peut-elle pas être organisée et mobilisée pour prendre les mesures décisives prises la dernière fois que la menace était proche de la menace mondiale à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui ? Pourquoi la réponse à cette urgence est-elle encore si discrète ?
Électrification
Pourtant, en discutant des remises sur les véhicules électriques, une question préalable ne peut être évitée. Dans quelle mesure l’électrification des véhicules automobiles privés est-elle la réponse pour échapper à notre trajectoire autodestructrice actuelle ? L’attention du public aux véhicules électriques est un indicateur bienvenu d’une prise de conscience croissante que « quelque chose doit être fait ». Et l’abandon du moteur à combustion interne est un pas en avant positif. Mais la contribution des véhicules électriques comme solution définitive à la crise environnementale est exagérée et reflète souvent un désir complaisant de continuer à vivre comme avant – ce qui n’est plus possible.
Les limites des véhicules électriques en termes d’autonomie et d’accès aux bornes de recharge sont susceptibles d’être dépassées. Plus inquiétant est que les batteries utilisées dans les véhicules électriques posent elles-mêmes de graves problèmes environnementaux dans l’extraction, la fabrication et le recyclage des matériaux (en particulier le lithium et le cobalt). Et si tout ce que nous faisons est de remplacer un type de voiture par un autre, sans interrompre l’expansion de notre culture automobile, alors les pressions environnementales seront encore aggravées par l’énergie utilisée dans la fabrication de ces véhicules supplémentaires.
Le problème n’est pas que les véhicules à moteur vont disparaître de nos routes, mais plutôt qu’un changement radical dans l’équilibre des transports au détriment des particuliers est devenu essentiel. La gratuité des transports en commun doit devenir aussi évidente que la gratuité des trottoirs. Nos routes devraient être de plus en plus occupées à la fois par des véhicules électriques fournissant d’autres services publics nécessaires (fourgons postaux, véhicules utilitaires, camionnettes de livraison, ambulances, minibus) et une utilisation plus durable des voitures électriques grâce au covoiturage (comme avec les stations de vélo) et aux taxis électriques de type uber pour compléter le transport en commun.
Surtout, parler de véhicules électriques ne doit pas nous détourner des enjeux sociaux plus larges posés par l’ampleur massive de la menace environnementale. Prenons seulement deux exemples : la relation entre les contraintes environnementales et les inégalités, et entre la planification environnementale et le contrôle privé sur l’investissement.
L’étendue des inégalités dans les sociétés capitalistes est elle-même un fléau. Mais les contraintes environnementales ajoutent une dimension supplémentaire. Dans le passé, les inégalités étaient atténuées par la croissance ; la croissance a tenu la promesse que tout le monde obtiendrait plus, même de manière inégale. Mais si la carte de visite du futur nécessite des limites à la croissance matérielle, la consommation excessive et le luxe des riches deviennent plus clairement exposés comme se faisant au détriment du plus grand nombre.
Les inégalités se confondent alors avec la crise environnementale, et les inégalités autrefois tolérées sont de plus en plus perçues comme intolérables. Une plus grande égalité devient une condition de toute acceptation générale des restrictions à la consommation individuelle.
De même, lorsque l’objectif de consommation individuelle prédominait, on pouvait affirmer (dans certaines limites, bien sûr) que les sociétés privées en concurrence pour les profits privés répondaient effectivement à ces désirs. Mais si le bien-être et la survie futurs nécessitent aujourd’hui un glissement significatif des biens de consommation individuels vers un poids plus important de l’égalité et des biens et services collectifs (santé, éducation, soins aux personnes âgées, transport gratuit, événements musicaux et culturels, etc.), et si, également, la prise en compte de l’ampleur de la crise environnementale nécessite une planification dans l’intérêt social, alors les droits de propriété privée des entreprises deviennent un obstacle majeur à la restructuration de la société d’une manière respectueuse de l’environnement.
Ce qui est donc contesté par les exemples ci-dessus n’est pas seulement une politique mais le capitalisme lui-même .
Acheter Canada ?
Alors que les libéraux fédéraux, renforcés par le soutien essentiel d’Unifor, doublent la mise sur l’accord commercial, il est essentiel de se faire appel à l’histoire. Au cours des années 1980 et 1990, les syndicats – et en particulier le Syndicat canadien de l’automobile – se sont battus contre de tels accords commerciaux. Ce qu’ils ont compris, mais qui semble maintenant perdu, c’est que les accords commerciaux ne visaient pas à protéger les emplois des travailleurs, mais plutôt les droits de propriété des entreprises. La « liberté » que défendaient principalement les accords de libre-échange était la liberté des entreprises d’agir dans l’intérêt de maximiser leurs profits sans tenir compte des impacts sociaux.
Ces accords ont verrouillé les droits des entreprises – les ont constitutionnalisés – afin qu’aucun futur gouvernement ne puisse les renverser. Dans le cas particulier de tels accords avec les États-Unis, les critiques ont compris l’évidence : les accords ne seraient pas, compte tenu du déséquilibre de pouvoir en faveur des États-Unis, aussi contraignants, d’autant plus que les circonstances économiques et politiques évoluaient. D’où le malaise persistant au Canada face aux accords commerciaux avec les Américains.
Les limites de l’USMCA étaient claires dès le début, alors même que les libéraux et le président d’Unifor, Jerry Dias, ont salué l’accord comme offrant aux travailleurs un nouveau niveau de sécurité. L’accord a été signé le 1er octobre 2018 ; environ six semaines plus tard, GM a annoncé brusquement que GM Oshawa, ainsi que plusieurs usines américaines, fermeraient. GM était convaincu que cela était autorisé par l’accord commercial, rappelant la promesse de GM en 2016 de maintenir Oshawa en activité au moins jusqu’en 2020 en échange de concessions et sa réclamation ultérieure – que le syndicat n’a pas légalement contestée – que la convention collective n’a pas bloqué ce mouvement. (À la mi-2019, GM est revenu sur sa décision, mais cela n’avait rien à voir avec l’ALE – c’était le résultat de l’évolution des conditions du marché et des capacités relatives dans diverses usines nord-américaines.)
Il se peut que doubler l’USMCA conduira à certains aménagements de la US Build Better Act. D’une part, l’administration Biden ne ciblait probablement pas tant le Canada et le Mexique qu’elle était absorbée par le chaos de la politique américaine et ignorait les répercussions de la loi sur ses « partenaires ». De plus, les grands constructeurs automobiles américains, qui avaient récemment annoncé des investissements importants au Canada, voudront eux-mêmes protéger ces investissements et préféreront ne pas réorganiser radicalement leurs chaînes d’approvisionnement, ce qui impliquerait d’importer davantage de composants des États-Unis pour passer le seuil de valeur (probablement 50 %) pour être considéré comme « fabriqué aux États-Unis ».
Pourtant, cela ne mettrait pas fin à la vulnérabilité de l’industrie automobile canadienne ni n’empêcherait les pressions sur le Canada si nous voulions prendre des directions qui ne plaisent pas aux États-Unis. C’est ce qui rend l’appel si prémonitoire de Walkom à penser au-delà de la mendicité pour la miséricorde, et à la place, entamer une discussion sur la lutte contre la politique Buy-American avec notre propre programme canadien.
Il y a cependant un hic à une politique d’achat au Canada axée sur l’industrie automobile. Bien qu’il puisse desservir une ou peut-être deux usines d’assemblage, la réalité est que l’industrie canadienne n’est pas assez importante pour compenser la perte du marché américain de l’automobile. L’alternative est donc beaucoup plus complexe. Il serait nécessaire d’aller au-delà de l’automobile pour convertir/diversifier les machines et les compétences existantes dans le secteur à d’autres usages sociaux.
C’est là qu’intervient la prise au sérieux de l’environnement. Si la crise environnementale signifie tout transformer dans notre façon de travailler, de voyager et de vivre – tout – et que cela nécessitera toutes sortes de biens matériels, alors pourquoi n’allons-nous pas résolument planifier pour ça maintenant ? Ce n’est pas d’accords commerciaux axés sur les affaires dont nous avons besoin, mais plutôt de l’utilisation planifiée de nos compétences et de nos capacités de production pour répondre aux besoins les plus pressants auxquels nous sommes confrontés.
Comme vous ne pouvez pas planifier ce que vous ne contrôlez pas, cela signifierait un défi fondamental pour les entreprises, y compris, comme Green Jobs Oshawa l’ a soutenu de manière convaincante, en détachant des installations productives pour répondre aux besoins sociaux, et non aux profits (comme cela aurait dû se produire pendant la pandémie). L’augmentation de ce montant et l’extension de la propriété publique impliqueraient, bien sûr, des risques et des incertitudes importants. Pourtant, si la crise environnementale est vraiment une crise existentielle nécessitant des étapes inimaginables auparavant, continuer à trébucher avec le statu quo est le plus grand danger de tous.
Pro-Syndical
Enfin, qu’en est-il de l’aspect intrigant et radical des ristournes liées à la syndicalisation ? En tant que geste envers les syndicats, il s’agit d’un pas impressionnant vers la légitimation de la centralité des syndicats. Offrir des rabais plus élevés pour les véhicules fabriqués par des syndicats fait valoir essentiellement que les syndicats sont un bien social qui devrait être soutenu. Le message est que la transition vers une économie verte doit également être une transition juste et, entre autres choses, cela exige la contre-voix démocratique des travailleurs par le biais de leurs syndicats.
Aucun autre président américain, premier ministre canadien ou autre chef d’État n’est jamais allé aussi loin. Au Canada, les libéraux fédéraux, qui consacrent une grande partie de leurs efforts à brandir leurs prétendues références progressistes, notamment par rapport aux États-Unis, ont signé un accord avec Amazon pour être effectivement le fournisseur de choix de l’État canadien pendant la pandémie. Contrairement à Biden, il ne leur est jamais venu à l’esprit (ou a été rejeté si c’était le cas) de prouver leur courage en conditionnant cela à l’introduction de normes de santé et de sécurité exemplaires et en ouvrant la porte à une campagne de syndicalisation sans restriction.
Il convient de noter que cette partie du projet de loi Biden ne verra peut-être toujours pas le jour (elle n’a pas encore été adoptée par le Sénat américain). Les républicains se battront contre cela, non seulement en principe, mais pour protéger les usines automobiles non syndiquées, en grande partie asiatiques et européennes, dans leurs circonscriptions. Ils seront également conscients que la présence de syndicats dans les communautés du sud des États-Unis tend à devenir une base de soutien pour le Parti démocrate. En outre, de nombreux démocrates, déjà mécontents d’une grande partie de la loi globale, seront également prêts à abandonner la clause de syndicalisation dans le cadre de nouveaux compromis dans le projet de loi.
Mais même en laissant cela de côté, nous devons également creuser plus profondément ici. La faiblesse du mouvement ouvrier américain s’étend bien au-delà de la faible densité syndicale. Après tout, ils avaient autrefois une densité syndicale plus élevée, mais cela ne les a pas empêchés de subir leurs profondes défaites. De plus, les syndicats canadiens ont deux à trois fois la densité des syndicats américains, mais les Canadiens auraient du mal à soutenir que le mouvement syndical canadien est aujourd’hui une force sociale plus dynamique et plus importante que leurs homologues américains.
Les problèmes du mouvement ouvrier américain résident dans son incapacité, au cours des dernières décennies, à se transformer à la lumière de nouvelles circonstances et de nouvelles attaques agressives contre ses institutions et ses membres. Leurs problèmes résident autant dans leur incapacité à organiser les groupes déjà organisés que dans leur intégration des usines non syndiquées.
Résoudre cela du haut vers le bas, même s’il s’agit d’un signal de soutien crucial, ne corrigera pas ce dilemme. Cela peut même retarder la réalisation des transformations nécessaires et laisser la porte plus ouverte à leur inversion, une histoire avec des précédents dans d’autres mesures favorables aux travailleurs. Et si le pouvoir potentiel que la syndicalisation apporte est compensé par un accent accru sur la compétitivité internationale – comme le fait décidément le projet de loi Biden tout au long – alors l’espace pour les gains syndicaux dans la négociation et la recherche de gains sociaux élargis sera réduit même si les institutions syndicales grandissent en taille .
Il ne s’agit pas de dénigrer le soutien de Biden aux travailleurs, mais plutôt de suggérer que le principal problème n’est pas “d’accorder” aux travailleurs un syndicat, mais de supprimer les obstacles très considérables qui empêchent les travailleurs de prendre des décisions démocratiques qui leur appartiennent sans aucune implication des entreprises . .
Mieux vaut prolonger les étapes positives du projet de loi Pro Act et faire valoir que puisque les entreprises ont accès aux travailleurs en vertu de leur rôle sur le lieu de travail, même sans réunions captives, les syndicats devraient eux aussi avoir accès à la main-d’œuvre : accès aux travailleurs qui seront impliqués dans la décision sur la syndicalisation (tout comme les partis politiques ont régulièrement accès aux listes électorales) et l’accès à un espace dans l’usine pour les réunions collectives afin d’expliquer les syndicats aux travailleurs et de répondre à leurs questions. Et si la voie syndicale est la bonne, alors pourquoi limiter cela à l’automobile ? Pourquoi ne pas donner aux travailleurs partout la liberté de facto de choisir comment ils sont représentés ?
Sommaire et conclusion
L’électrification de l’industrie automobile est beaucoup dans l’air aujourd’hui. Il y a un peu plus de cent ans (1920), Lénine décrivait le communisme comme « le pouvoir soviétique plus l’électrification de tout le pays ». Ce qui est si intéressant dans cette formulation, c’est qu’elle lie à la fois le social et le technique dans l’avancée révolutionnaire. Pour nous aussi, « l’électrification » est de plus en plus présentée comme la porte d’entrée vers un nouvel avenir. Mais sans révolution à l’horizon, l’électrification tend à être réduite à une solution technique pour préserver les modes de vie et les relations de classe que, alors que la science et la nature crient désespérément, notre planète ne peut plus se permettre.
Le passage aux véhicules électriques a un rôle progressif à jouer, mais a tendance à être survendu comme la « solution » à la crise de l’environnement. En tant que tel, il nous détourne du vrai défi de ce qui doit être fait. La crise de l’environnement est inséparable du monde des inégalités obscènes, des vies d’insécurité permanente et de la mince démocratie qui laisse notre présent et notre avenir entre les mains d’entreprises privées en concurrence pour les profits. Prendre soin de l’environnement est inséparable de faire face au capitalisme.
Éviter de telles questions au nom d’être « pratique » est, à ce stade du monde, la chose la moins pratique que nous puissions faire. Fermer les yeux sur la réalité garantit plus de la même chose, et plus de la même chose signifie un désastre inévitable. Il n’y a qu’une seule alternative : penser plus grand et plus radicalement et oser risquer au nom d’un autre avenir. •
Sam Gindin a été directeur de recherche des Travailleurs canadiens de l’automobile de 1974 à 2000. Il est co-auteur (avec Leo Panitch) de The Making of Global Capitalism (Verso), et co-auteur avec Leo Panitch et Steve Maher de The Socialist Challenge Today, l’édition américaine augmentée et mise à jour (Haymarket).
Traduction André Frappier
Notes de fin
* La citation dans le titre est attribuée à Porfirio Diaz, président mexicain 1884-1911, « Pauvre Mexique, si loin de Dieu, si proche des États-Unis.



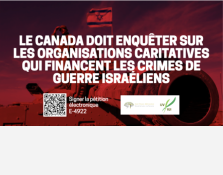







Un message, un commentaire ?