Oui, les États-Unis déclinent dans le monde et l’influence américaine y diminue sensiblement ; les coups de gueule de Trump n’y changeant rien. Ils confirment même cette diminution. Le déclin d’une puissance hégémonique se subit toujours selon les lignes dominantes de sa position géographique, de sa culture politique, de ses réseaux commerciaux, de sa force économique et de la puissance militaire qui en découle. Tous ces éléments modulent sa politique extérieure et intérieure, en particulier à notre époque de globalisation financière accélérée.
Les perdants et les perdantes des politiques militaires et commerciales américaines agressives sont nombreux, ils s’enfoncent toujours davantage dans le sous-développement et la dépendance à l’endroit des réseaux financiers dominants (qu’il s’agisse de nations ou de classes sociales spécifiques de la puissance en déclin) ; mais les rivaux de la dite puissance gagnent à leur tour du terrain à son détriment, du moins les rivaux les plus forts, comme la Chine.
Ces réflexions m’ont traversé l’esprit à la lecture de l’excellent compte-rendu que Pierre Beaudet a fait de la conférence magistrale d’Andrew Cockburn tenue le 9 septembre dernier dans le numéro du 8 octobre de Presse toi à gauche.
En soi, ces affirmations n’ont rien de bien original. Tous les empires passés ont subi leur phase de déclin avant de disparaître ou de se transformer en profondeur et d’éclater en différents États (L’empire romain) ou encore de devenir une puissance modeste (l’Espagne, le Portugal surtout,mis aussi dans une moindre mesure la France et la Grande-Bretagne entre autres exemples). La République américaine se trouve en ce moment sur une pente descendante. Jusqu’où descendra-t-elle ? La question demeure posée.
Il faut cependant éviter de confondre déclin et effondrement. Les États-Unis ne connaîtront pas le sort de l’Empire romain d’Occident disparu comme entité étatique centralisée au cinquième siècle de notre ère sous le coup des « invasions barbares », lesquelles ont entraîné l’établissement d’États indépendants sur un vaste territoire d’Europe occidentale. Mais on peut prévoir que devant la montée en force de la Chine, de la renaissance russe, de la compétition commerciale japonaise et européenne, les États-Unis vont continuer de voir diminuer inexorablement leur hégémonie au profit d’un monde plus fragmenté, « multipolaire ». Leur rôle de gendarme devient de plus en plus difficile à assumer. Ce qui ne pourra (cela se constate déjà) qu’affecter leur régime économique, financier ainsi que leur société, où on remarque une sorte de « Tiers-Monde », c’est-à-dire les multiples exclus du rétrolibéralisme, ce point de référence idéologique majeur de la classe politique américaine de Reagan à Obama.
Évidemment, un déclin ne peut jamais se dérouler avec désinvolture et encore moins résignation de la part des classes dominantes de l’État concerné. Elles sont secouées par toutes sortes de transes idéologiques et politiques, l’incohérence relative s’installe et les points de repère traditionnels se brouillent. La tentation de la fuite en avant devient forte et certains responsables politiques y cèdent. Quand les difficultés s’accumulent, tant à l’externe qu’à l’interne, les classes dominantes se morcèlent en différentes factions et l’ancien consensus idéologique (au moins apparent) se fait toujours plus factice, ce qui n’échappe pas à la population, surtout dans un régime libéralo-électoral comme l’américain où de surcroît la presse est libre.
Une hégémonie n’est jamais que provisoire, même si ce « temporaire » peut durer quelques siècles. Elle ne peut se gérer de manière tout à fait cohérente,cette gestion dépendant des rapports de force internationaux mais aussi des tendances idéologiques des dirigeants en cause à différentes époques.
Pensons à un continuum de présidents américains des années 1930 à maintenant : Franklin Delano Roosevelt qui fut l’artisan de l’hégémonie de son pays à la faveur de la Seconde guerre mondiale, au républicain Dwight Eisenhower qui l’a portée à son apogée (le complexe militaro-industriel a pris une ampleur jusque là inégalée et ce président fut l’artisan de la « nucléarisation » poussée de l’armée américaine), puis au charismatique John F. Kennedy mort assassiné au sommet de sa gloire, au « machiavélique » Richard Nixon qui a frôlé la destitution avant de démissionner sous la pression des circonstances en 1974, ensuite à l’accommodant Jim Carter auquel a succédé le néoconservateur Ronald Reagan (qui présente quelques points de ressemblance avec Donald Trump), un ancien acteur de second ordre à Hollywood qui a tenté de relancer la puissance américaine. J’ignore George Bush père pour arriver à Bill Clinton (le « libidineux ») et à George Bush fils sous le leadership de qui les États-Unis ont encaissé le coup dur des attaques du World Trade Centre en septembre 2001. Je pense au « vertueux » Barak Obama et finalement à l’actuel locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump.
Depuis les années 1970, les États-Unis sont connu des échecs politiques et militaires ; ils ont été obligé aussi d’affronter une concurrence commerciale et économique de plus en plus vive de la part de plusieurs pays. Je dirais en gros, que depuis Reagan, la classe politique américaine dans son ensemble et à divers degrés a choisi la fuite en avant, l’aveuglement volontaire devant la réalité d’un monde de moins en moins dépendant de leur supériorité commerciale et militaire, le tout marqué d’épisodes comiques et d’autres tragiques.
Pour terminer et de façon un peu sommaire je l’admet, on peut examiner la gestion de l’État et le sort de deux présidents notoires, chacune inoubliable à sa manière : John Kennedy et Donald Trump. Le premier qui a régné à une époque de grande prospérité à laquelle il a contribué mais il a aussi engagé son pays de manière décisive dans l’aventure vietnamienne, qui devait se révéler désastreuse ; toutefois la fin tragique de ce président a dans une certaine mesure préservé son auréole d’homme politique prestigieux ; le second, Trump est au contraire dénué de toute sophistication.
Cela m’amène à aborder une remarque que Friedrich Engels formulait en comparant le règne de Napoléon premier (« le grand ») avec celui de Napoléon trois ( « le petit ») à environ trois décennies de distance l’un de l’autre. Il disait à ce propos en substance :
L’histoire débute en tragédie et finit en comédie. Ainsi en est-il peut-être de la période de l’histoire américaine depuis John Kennedy.
À méditer...
Jean-François Delisle


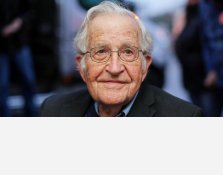


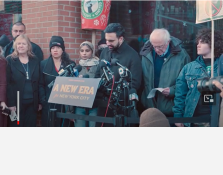






Un message, un commentaire ?