Par conséquent, toute analyse du travail présuppose, avant d’en parler davantage, une certaine définition de cet objet. Dans la vie de tous les jours, le terme « travail » possède une signification variable, plus ou moins précise selon le contexte où il est utilisé. Il s’agit par conséquent d’une notion polysémique, voire même, selon les autrices et les auteurs appartenant à différents courants théoriques, d’un concept potentiellement polémique. Cette notion ou ce concept pose problème dès que l’on cherche à distinguer et à définir le travail économique par opposition aux autres activités où il est utilisé (des activités domestiques, scolaires, etc.). Le problème de la définition de ce concept est également présent dans les analyses et les débats au sujet des « origines » et de la « fin » du travail. C’est en tenant compte de ces difficultés qu’il est possible d’amorcer une réflexion critique au sujet du passé et de l’avenir du travail en cette période de crise écologique et de crise socio-sanitaire en lien avec la pandémie de la COVID-19.
1. Travail et travail économique ?
Le travail existe-t-il depuis toujours, et ce dans toutes les sociétés ? S’agit-il d’une contrainte naturelle et indépassable de l’existence ou d’une contrainte imposée socialement ? Quels critères doit-on retenir socialement pour délimiter la sphère du « travail » de la sphère du « non-travail » ? La révolution technologique présentement en cours annonce-t-elle réellement, comme l’avancent certains auteurs, « la fin du travail » (Rifkin, 1996) ? Qu’en est-il maintenant du travail et de sa rémunération dans un contexte de crise économique attribuable notamment à une pandémie ? Quel avenir pour le salariat et les entreprises dans un contexte de pandémie et de crise écologique qu’on nous présente comme « inédit » ? Et quel moyen avons-nous pour trouver qu’il s’agit réellement d’un contexte « inédit » ? Telles sont les questions auxquelles nous tenterons non pas nécessairement d’apporter des réponses dans le présent texte, mais qui nous accompagneront encore très longtemps dans notre réflexion au sujet du travail.
2. Travail : le mot et la chose
Travail, disons-nous ? Le mot n’a pas toujours existé. Le travail humain, par contre, semble exister depuis qu’il y a des humains sur la terre. Partant de ce constat, le travail peut être analysé sous son angle à la fois humain et social. L’anthropologie et la sociologie sont probablement les disciplines qui peuvent nous être les plus utiles pour mener à bien une réflexion critique sur le travail. Elles nous semblent adéquatement outillées pour nous permettre de comprendre les dimensions objectives (l’objet du travail) et subjectives du travail (les sujets du travail) et les enjeux normatifs (la norme idéale) qui structurent cet univers de la pratique sociale qui a maintenant un caractère également économique (Gorz, 1988).
Les humains sont des êtres sociaux, des êtres grégaires qui vivent à l’intérieur d’un regroupement donné. Simplifions à outrance. Il a existé deux grands genres de regroupements humains : le nomadisme (mode de vie fondé sur le déplacement) et la sédentarité (le rattachement à un lieu fixe). C’est dans le cadre de regroupements sédentaires que l’activité productive a véritablement connu de grandes révolutions dans les manières de produire les biens essentiels à la vie et à la survie. Les regroupements sédentaires ont été, pour l’essentiel, de trois grands types différents : agricole, industriel et post-industriel. Types qui coexistent maintenant dans les sociétés développées dites de haut savoir (Lalonde, 1997).
Il y a nécessairement des fondements sociohistoriques au travail. Cette activité varie selon les systèmes sociaux présents dans les différentes sociétés. Les formes de travail ne sont jamais à l’identique, elles sont régulièrement reconfigurées. La nature et la dynamique de la rationalisation qui caractérise cette activité s’accompagnent de divers modes d’organisation et de divers processus de qualification. D’autres facteurs sont également présents dans l’activité qu’est le travail : des facteurs culturels et idéologiques en lien avec les éthiques du travail et les enjeux de la reconnaissance de la valeur du travail.
Puisque le portrait global vient d’être peint, retournons maintenant en arrière et essayons de concevoir l’appréhension d’autrefois relativement au travail, avant même que ce mot existe, pour ensuite renouer avec lui et suivre son évolution.
2.1 Chez les Grecs, les Romains et les Chrétiens
Durant l’Antiquité, on ignorait cette notion, du moins elle n’existait pas dans son acception qui viendra plus tard, comme nous l’avons dit. Chez les Grecs, on différenciait l’être libre de celui soumis par la nécessité. D’ailleurs, Platon (1993) avait sa propre définition de cette dualité, alors que l’homme s’abandonnant aux exercices de l’esprit y trouvait une liberté d’avenir, ce qui contrastait avec l’homme jusque-là condamné aux efforts physiques exclusivement, c’est-à-dire aux usages de la force humaine à des fins de nécessités terrestres. Trois grandes classes ou fonctions devaient toutefois caractériser la cité, à savoir celle de dirigeant (ou gouvernant), celle de protection (ou de gardien) et celle de subsistance (ou de laboureur). Bien entendu, dans cette hiérarchie, seuls les êtres affranchis des efforts physiques, puisque élevés dans les tâches de l’esprit, jouissaient de la liberté de gouverner, car ils avaient acquis la sagesse. Ainsi, cette hiérarchie exposait un processus d’affranchissement du labeur, à différents niveaux, puisque tout le monde ne pouvait diriger, mais avait néanmoins la possibilité d’acquérir les qualités pour en être capable, supposant ainsi que même un esclave pouvait être affranchi de son sort, devenir un libre (un citoyen) et bénéficier d’une ascension grâce au développement de son esprit. Mais cet idéal, ou utopie, était contesté par Aristote (1881), qui divisait en premier lieu le monde entre ceux aux aptitudes de dirigeant et les autres devant se soumettre. Cette division naturelle, forcément attribuée aux talents, aux qualités et aux forces distinctives de chacun, n’empêchait toutefois pas l’apprentissage, sans pour autant éliminer ce déterminisme.
Aristote reconnaissait également le besoin d’une division des occupations dans le but d’assurer le maintien de la cité, autant en cohésion qu’en nécessités. En ce sens, une morale, voire une politique, devait être instaurée afin que les apports de tous et chacun n’occasionnent point une valorisation des richesses au détriment de l’économie, c’est-à-dire en besoins d’usage, synonymes de subsistances. Autrement dit, chaque tâche impliquait à la fois un objectif de bien-être individuel et de bien-être collectif, en respect toutefois des capacités de chacun. De cet ordre politique était néanmoins conservé un idéal de perfectibilité recherché chez l’individu dans son existence sur terre. Mais cette morale fut bouleversée à l’époque romaine, dans la mesure où un impérialisme de démesure imposa aux territoires de la Méditerranée un rapport de domination de type métropole (Rome) et colonies. Nous apercevons ici les premiers signes de division internationale du travail, accentuée par des échanges marchands d’envergure entre les différentes régions de l’Empire (Montesquieu, 1734). Ainsi, les peuples conquis se soumettaient à Rome, œuvrant dans leurs spécialités pour élever sa grandeur – non plus la leur –, mais cette situation permettait aussi à certains d’entre eux de s’immiscer dans la structure des vainqueurs, autant à des fins profitables à la collectivité que pour des intérêts égoïstes. Appartenir à l’Empire ne signifiait point de recevoir ipso facto le titre de citoyenNE de Rome, car la majorité restait soumise et esclave. Compte tenu de ce fait, le travail, si nous osons le faire intervenir ici, continuait d’être « démonisé », en quelque sorte. Par contre, si l’affranchissement politique accordait des privilèges terrestres, l’esclave devenu libre devait continuer son labeur1, sans être retenu désormais par les chaînes d’un maître (Weber, 2001). Le travail désignait à la fois une soumission à un supérieur qui accordait un droit de vie en échange de l’exploitation de la force humaine, à une forme d’activité pour la subsistance personnelle (ou familiale) qui se combinait au devoir de verser un impôt exigé pour obtenir protection et droit de circuler.
Avant d’arriver au Moyen Âge, nous ne pouvons ignorer l’influence du christianisme sur la représentation du travail ou plutôt du labeur. En effet, l’Église deviendra une puissante institution qui en fera un instrument de servage, autant pour le monde terrestre que pour le monde céleste. Disons tout d’abord que le labeur imposé à la population par les Romains se christianisa graduellement, mais surtout grâce aux efforts d’institutionnalisation de la nouvelle secte religieuse – considérée comme telle au départ – effectués par saint Paul (Renan, 1869). N’oublions pas que ce dernier était un pharisien très impliqué et un citoyen romain par surcroît, et donc adonné, comme ses semblables, à la tradition juive dérivée du mosaïsme. Selon Spinoza (1965), Moïse avait su rallier le peuple hébreu en créant une théocratie, à savoir une alliance grâce à laquelle le gouvernement des hommes se réalisait par Dieu, qui avait choisi son représentant parmi eux. Par le fait même, le Temple devenait le parlement ou plutôt la demeure royale. La division du peuple en douze tribus augmenta la complexité, mais l’organisation de base resta la même, puisque les lois de Dieu continuaient de guider les existences terrestres. En l’occurrence, cela signifie que le travail, ou plutôt l’ensemble des activités humaines exigeant une dépense en énergie ou des efforts, autant pour la subsistance que pour les rituels destinés à rendre grâces à Dieu, suivait ces mêmes lois ; en bref, le travail consistait à obéir au Très-Puissant.
Cet enseignement reçu par saint Paul, auquel nous ajoutons son éducation obtenue à Tarse, sa connaissance de plusieurs langues ainsi que des administrations juive et romaine, faisait de lui un actif important pour la communauté chrétienne ; ses expériences et sa fougue de nouveau converti allaient faciliter sa progression, voire même aider à son organisation. Aux tâches sacramentelles se joignaient toujours celles destinées aux usages quotidiens, mais le désir d’expansion prêché par saint Paul exigeait des moyens afin de constituer une Église forte, pas seulement des communautés isolées dans leur communisme susceptible de disparaître en même temps que leurs instigateurs (Renan, 1869). Au fond, le christianisme, pour survivre, devait à la fois se romaniser et christianiser Rome. De là se justifient toutes les insinuations à un engagement collectif pour rendre grâces à Dieu et faire grandir son Église. En d’autres termes, saint Paul insiste ici sur l’implication de tous les fidèles à la grandeur du Christ, ce qui signifie d’éviter les persécutions romaines en acceptant de « rendre à César ce qui appartient à César », tout en accomplissant leurs rôles qui consistent à rendre « à Dieu ce qui est à Dieu ».
Subitement, les activités accomplies prennent un sens nouveau, puisque la soumission au Christ les libère du joug de Rome, bien qu’ils poursuivent leurs obligations de payer les impôts, car voulu par Dieu, mais en échange d’une immense récompense : un affranchissement. Pour le-LA croyantE chrétienNE, le labeur vécu sur terre possédait désormais une nouvelle raison d’être ; autrement dit, le travail devenait l’une des clés servant à ouvrir les portes du paradis, puisque veillez à son bien-être personnel et à celui d’autrui plaisait à Dieu. De plus, l’aide aux pauvres apparaissait dorénavant comme une activité émancipatrice (Renan, 1866), à savoir un altruisme conforme à la loi d’Amour ordonnée par Jésus-Christ, et de là, encore une fois, le travail ou toutes tâches exécutées devaient être entrepris en respect de cette loi suprême. Et saint Paul a su l’instrumentaliser de manière à convaincre les fidèles de se soumettre également aux lois romaines, car « si quelqu’un nous frappe, il faut présenter l’autre joue ».
Bien sûr, le christianisme vaincra Rome, convertissant l’empereur Constantin le Grand, puis devenant la religion officielle de l’Empire sous Théodose Ier. Mais ce qui est important de retenir sur cette première phase est l’absence d’un terme rattaché au travail en tant que tel, en dépit pourtant du fait que nous pouvons le reconnaître, autant dans ses types (production de biens et de services divers, sans pour autant parler des secteurs primaire, secondaire, tertiaire et encore moins quaternaire, comme nous les entendons aujourd’hui) que dans ses formes (relatives aux rapports sociaux, voire même au divin, dans des jeux de pouvoir, de commandement et d’allocations des ressources, mais surtout dans une structure hiérarchique de type dirigeant-dirigé) (Lalonde, 1997).
2.2 Une première définition de source médiévale
Par un saut qualitatif, nous nous éloignons maintenant de l’Antiquité pour nous rapprocher d’une première véritable désignation de ce que nous nommons le « travail », car, en réalité, ce mot est d’apparition assez récente. Le XIe siècle : 1080 pour être plus précis. Le Dictionnaire historique de la langue française nous informe que « travailler […] est issu (1080) d’un latin populaire tripaliare, littéralement tourmenter, torturer avec le […] trepalium […] nom d’un instrument de torture. […] En ancien français, et toujours dans l’usage classique, travailler signifie « faire souffrir » physiquement ou moralement […]. Il s’est appliqué spécialement à un condamné que l’on torture (v. 1155), à une femme dans les douleurs de l’enfantement (v. 1175), […] à une personne à l’agonie (v. 1190) […] ».
Avec l’effondrement de l’Empire d’Occident, l’Église chrétienne constitua la nouvelle centralité à partir de laquelle les territoires soudainement libérés demeureraient néanmoins unis, du moins dans leur allégeance à Dieu (Fontane, 1904). Car, sur le plan terrestre, des royaumes indépendants s’organisaient, notamment des cités-États qui aspiraient à conserver leur liberté acquise. Entre le désir de poursuivre librement des activités marchandes et l’ambition de reconstituer un empire, cette tergiversation presque interminable occasionna de nouveaux rapports de force entre la féodalité (comme régime du travail servile, surtout associé à l’agriculture et aux possessions terriennes) puis l’échange marchand en croissance dans les bourgs (comme régime du travail libéral associé au numéraire) (Fontane, 1904 ; Nys, 1898).
À plus d’une reprise le pouvoir théocratique chrétien subit des attaques, puisqu’on remettait en doute la foi du pontife, dont les agissements inspiraient davantage une concupiscence, voire une corruption scandaleuse, littéralement inadmissible pour celui se disant être le représentant de Dieu parmi les hommes. Dans ces circonstances, donc dans cette déchirure de l’union entre le céleste et le terrestre, annonciatrice de plusieurs conflits armés, le travail représentait à la fois une libération, un asservissement et un instrument de torture, selon les cas. Mais ce fut aussi dans ce contexte que le travail s’est institutionnalisé, alors que des associations d’artisans et de divers métiers se sont constituées dans le but de protéger des connaissances et de les transmettre (Fontane, 1904). Ce genre de regroupement institué par la nature même du travail illustre bien un souhait d’autodétermination, totalement opposé au système féodal également en cours lors de cette période. Nous sommes en plus toujours en présence d’un travail se transmettant de père en fils, sorte de reproduction sociale qui déterminait inéluctablement la position sociale de chaque individu au sein de la société. Autrement dit, un laboureur élevait un futur laboureur, un cordonnier transmettait ses connaissances à son fils aspirant à devenir cordonnier, etc. ; bien sûr, dans un régime patriarcal toujours effectif, pour ne pas dire dans une division sexuelle du travail presque irrémédiable – il y avait des tâches destinées aux hommes, puis d’autres aux femmes. Mais des exceptions avaient lieu, puisque le souhait d’améliorer le sort de leurs enfants – d’un talent quelconque – entraînait certaines familles à les placer auprès de maîtres qui leur apprendraient un art ou un métier. Or, encore à cette époque, l’Église profitait aussi de sa puissance pour gonfler ses rangs de futurs moines, frères (ou sœurs) ou prêtres, quoiqu’églises et monastères se concurrençassent (Fontane, 1904). À cela une nouveauté d’envergure se produisit en parallèle : les premiers bourgeois apparaissaient, s’impliquaient dans l’administration des cités-États et fondaient des corporations, dont l’ambition se calculait en argent. Plus que jamais le travail semblait être réhabilité dans son utilité désormais terrestre, de manière à le concevoir comme un moyen d’émancipation (tel un idéal théorique), d’affranchissement, permettant de satisfaire les besoins du corps en priorité, afin de réaliser un bonheur aussi important que celui de l’âme.
Soulignons donc que le travail humain est une activité inhérente à la condition humaine (la naissance, la mort) et concerne également des activités productives manuelles et intellectuelles, comme déjà dit. Homo n’est pas un être autosuffisant. Il dépend de ressources qui lui sont extérieures (immédiatement disponibles ou qu’il doit transformer) pour assurer sa vie et sa survie. Homo doit donc intervenir sur les ressources disponibles dans son environnement pour assurer sa production et sa reproduction. Dans le cadre du présent texte, nous définissons de manière non limitative le travail comme étant l’intervention de quelqu’un sur quelque chose, dans le cadre d’une activité rémunérée ou non2 .
2.3 Renaissance ou glorification du travail en devenir
Ce n’est qu’à partir du début du XVe siècle que le mot « travail » sera associé, dans la langue française, à une activité productive dans les domaines manuel et intellectuel (Denis, 1993 ; Lalonde, 1997). Et oui une activité productive, puisque le bonheur se joint à l’abondance dans des productions de toutes les sortes, tels des rappels d’une philosophie presque oubliée : l’épicurisme. Malgré les guerres d’ambition, les disettes et les grandes épidémies des XIIIe et XIVe siècles, la constitution des États-royaumes, en pleine progression, a permis de fixer certaines frontières, puis d’établir des trajectoires d’échange profitables à la classe bourgeoise montante (Delumeau, 1984). Bien que papes, rois et princes de diverses origines guerroyassent pour acquérir prestige et autorité suprême, cette ère d’abus contribua néanmoins à des développements culturels et techniques majeurs. Grâce à un retour à l’Antiquité, voire aux sources antiques originelles, sautant ainsi littéralement par-dessus les commentaires des scolastiques, la trouvaille des anciens philosophes ainsi que des architectes et des premiers mathématiciens, fit en sorte d’exciter un désir de vie terrestre jusque-là insoupçonné. Aux humanistes se joignit l’idéal bourgeois italien qui s’étendit partout en Europe. On s’aperçut des avantages de la monnaie comme jamais, devenu ainsi un moyen d’excellence pour faciliter la mesure et l’échange, au point même d’accélérer le processus coutumier et de créer rapidement la richesse (Delumeau, 1984 ; Denis, 1993). Mais un préalable s’avérait nécessaire : augmenter corrélativement la capacité de production. Conquérir pour conquérir, ou pour asseoir une autorité, comme l’a voulu l’Église, avec l’instrument des croisades (Fontane, 1904), n’engendrait que dilapidation et spoliation, sans garantie de succès et causant des pertes matérielles et humaines souvent colossales. Par conséquent, un besoin de paix plus que de guerre, voire une perspective de guerre différente et pacifique, demandait à être comblé par la classe bourgeoise en recherche de débouchés. Il fallait produire pour vendre ou échanger, trouver aussi de nouveaux marchés pour épuiser les surplus. Cet effort d’échange exigeait donc une plus grande production, qui a son tour sollicitait l’utilisation d’une force quelconque.
Ainsi, le travail transcendait en un salut ignoré durant l’Antiquité grecque, peu considéré par les Romains conquérants, pourtant entrevu dès les premiers pas de l’Église, mais bien compris par certains bourgeois et princes ambitieux. Et cette force productive supposait à la fois le travail humain, le travail animal de même que le travail naturel (le vent, l’eau et le feu) qui impliquaient des moyens techniques. Non pas que ces sources ne furent jamais exploitées auparavant. Bien au contraire. Nous sommes en présence d’une réforme du travail autant sur le plan idéologique que pratique, voire aussi importante que celle survenue au moment où l’être humain a appris à devenir sédentaire ; en revanche, ces sources étaient désormais mobilisées non plus pour la subsistance ou l’entretien des conquêtes, mais pour acquérir et faire croître la richesse des États. D’activité servant à acquérir les moyens de payer une protection, le travail se politisa davantage, en s’associant à la production économique nationale destinée à engraisser le Trésor des futurs États-nations, et ce, à l’aube de la modernité. Grâce aux innovations techniques, synonymes d’un retour vers la science perdue durant la période moyenâgeuse, les transporteurs maritimes, notamment, se sont développés et ont découvert un Nouveau Monde (Delumeau, 1984). En même temps l’industrie est apparue, à savoir ce symbole du règne de la production, en attente des prochaines innovations et d’une véritable organisation du travail. Il y eut bien sûr des hauts et des bas : la soif d’or enrichit et ruina l’Espagne. Sous l’illusion d’un mercantilisme triomphant, les royaumes se lancèrent dans une quête d’accumulation de monnaies ou de métaux précieux, au point d’oublier l’entretien des besoins essentiels ; la possession de colonies ramenait ainsi au goût du jour un désir de conquête, mais cette fois-ci de montagnes d’or et de nouvelles ressources (Delumeau, 1984 ; Nys, 1898). On exigeait le paiement des impôts en monnaie sonnant, mais les pauvres et la majorité des petits paysans n’en possédaient point. Allait survenir une transformation sociale susceptible d’accentuer l’exode rural, puisque l’argent se trouvait dans les cités ; certes, les laborieux des milieux urbains recevaient en échange de leur force de travail du numéraire. Autrement dit, les développements économiques de cette période associaient travail et monnaie dans une expectative de production de masse, autant pour les besoins intérieurs que ceux extérieurs.
Qui dit organisation de l’industrie, dit rapport de pouvoir politique, c’est-à-dire un rapport entre dirigeants et dirigés qui rappelle étrangement d’autres types en lien avec l’esclavage et le servage (Marx, 1968). Par un étrange paradoxe, la liberté des artisans et des gens de métier était mise à rude épreuve ; paradoxe mettant en évidence l’exploitation du travail à des fins d’enrichissement mercantile. Les corporations bourgeoises subirent elles aussi des mutations, pour constituer des compagnies, c’est-à-dire des entités utiles à la standardisation de la production et à l’ambition de profits, pour ne pas dire des machines à travail créées par et pour l’industrie qui versait des rémunérations en argent. Force est d’admettre qu’un pas suffisait pour faire balancer le monde occidental du côté d’un régime capitaliste, c’est-à-dire du côté d’une idéologie de l’accumulation rendue possible grâce à l’ingéniosité de l’industrie responsable de l’assujettissement par le travail.
3. Vers la modernité : le travail sous régime capitaliste
Parler du travail c’est nécessairement regarder ou examiner les régimes de propriété (privé, public ou coopératif) et les types de divisions du travail aux niveaux économiques, techniques, sexuels et culturels. Dans quel type de marché se déploie le travail ? S’agit-il d’un marché autarcique (fermé et replié sur lui-même) ou interdépendant (ouvert aux échanges avec l’extérieur) ? Qu’en est-il maintenant de sa segmentation et de sa spécialisation professionnelle ? La stratification sociale qui en découle nous met en présence de quelle dynamique de la conflictualité3 sociale ?
Les perspectives d’analyse anthropologiques et sociologiques peuvent nous aider à répondre à ces interrogations. Elles peuvent également nous permettre de décoder, en nous le rappelant bien, la présence des rapports sociaux (hiérarchiques ou non) et le type de relations sociales (relations fondées sur le sexe, l’âge et les nombreuses différences en lien avec les populations [autochtones, nationalitaires et ethniques], le genre, etc.) ou de relations entre les actrices et les acteurs sociaux (relations de coopération, de collaboration, de concurrence, de compétition voire même, selon les marxistes, une relation contradictoire d’opposition irréconciliable).
Puisqu’il est question des marxistes, faisons un autre bond qualitatif et rappelons que Marx et Engels (1973), dans Manifeste du parti communiste ont écrit que « la bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment […] les rapports de production ». Qu’en est-il au juste ? Le capitalisme est loin d’être un mode de production statique. De la fin du XVIIIe siècle à aujourd’hui, il nous est possible de synthétiser son évolution en trois temps.
3.1 La fabrique et la manufacture capitaliste (de la fin du XVIIIe jusqu’à la fin du XIXe siècle) et la négation du droit social
Au départ, nous assistions à la constitution d’un marché supposément « autorégulé ». Les entreprises naissantes, qui produisaient des biens, étaient détenues par des entrepreneurs privés. Elles avaient comme objectif de regrouper, sur leur lieu de travail, la production qui venait des maîtres et des artisans ; il s’agissait d’une spoliation des pratiques artisanes à des fins de production en série. De là s’ensuivit des conditions de travail foncièrement différentes : les ouvriers qui travaillaient dans les usines ou les vastes chantiers de construction recevaient une rémunération à la pièce ou au temps (Marx, 1968). Les relations de travail prenaient la forme d’un contrat individuel. L’État était alors présenté par certains auteurs libéraux – puisque le mouvement libéral incorporait en lui-même une idéalisation du travail – comme non interventionniste en matière de droit du travail (Supiot, 1994). Ce qui est faux, évidemment, puisque nous sommes en présence d’une économie politique à la base, telle que développée par Adam Smith (2009), celui-là même qui suggérait une division ainsi qu’une parcellisation du travail à des fins de productivité, facilement associable aux économies d’échelle et à une croissance des profits potentiels espérés pour la nation. Cela dit, les gouvernements des pays qui s’engageaient dans la première révolution industrielle allaient adopter des lois du travail qui eurent pour effet d’interdire la liberté d’association syndicale, le droit de négociation et le droit de faire la grève. Ainsi, les quelques gains obtenus durant le Moyen Âge disparurent en liant désormais la destinée des individus au joug du travail dit pourtant libéral.
Mais que s’était-il passé ? Débutons en signalant que l’assujettissement au catholicisme s’était dissipé de manière importante durant le XVIe siècle, suite à la Réforme protestante. Une autre ascèse, voire une autre discipline de vie, plus près des préoccupations du moment, contribua à donner au travail une valeur de destinée, sans revenir exactement aux enseignements de saint Paul, quoiqu’il inspirât Luther (1561 ; Weber, 2009). À vrai dire, le travail devait représenter une planche de salut pour l’existence mortelle, ou transcender vers une définition du bien par laquelle il deviendrait un devoir moral, c’est-à-dire un moyen singulier incomparable pour l’individu de prouver son utilité sociale et sa dignité personnelle. Cette conception fut reprise à l’intérieur de l’industrie qui incarnait désormais le lieu symbolique du progrès et d’une valorisation individuelle de la place de chacunE en société, et ce, grâce au travail. De là s’ensuivit une période de rodage et des tentatives d’organisation du travail pour en arriver à la fabrique, puis à l’usine, dans un prolongement de l’utilisation de la force humaine vers celle des machines, d’où le travail mécanique attribuable à la révolution industrielle.
Bien entendu, des bourgeois devenus capitalistes bénéficiaient de ce nouveau régime, aux effets dommageables pour la santé physique et psychologique des ouvrières et ouvriers, soudainement bernéEs par tant d’avantages prétendus, tandis qu’ils-ELLES s’appauvrissaient presque au même rythme de l’augmentation des heures passées en usine. La valorisation du travail comme devoir moral, comme affranchissement soi-disant de la misère, occasionna tout le contraire : aux accidents, aux maladies ainsi qu’à l’exploitation se joignit une nouvelle contrainte associée au travail, à savoir l’aliénation4 (Marx, 1968). Ce travail aliénant entraîna des critiques virulentes. De là apparurent des utopies socialistes, prônant un retour à la communauté, à un travail autonome dans lequel la machine se subordonne à l’être humain. Si l’industrie avait décimé les associations des arts et métiers d’autrefois, elle avait soudainement engendré un mouvement d’envergure qui exigeait de meilleures conditions de travail, mais surtout l’espoir de renouer avec l’idéal d’un travail émancipateur ou libre (notamment Claude, 2007 ; Engels et Marx, 1973 ; Saint-Simon, 1823-1824, sans compter les Owen, les Fourier, etc.). Mais la marche entreprise à l’intérieur du régime capitaliste imposa plusieurs luttes afin de donner des réponses aux nombreuses revendications. Il s’agit ici d’un prélude à une importante réorganisation du travail qui accentua davantage cet état d’aliénation (De Gaulejac, 2005).
3.2. Taylorisme, fordisme et sociale démocratie
Dans un deuxième temps, se développait la grande entreprise monopolistique. Le taylorisme et le fordisme s’imposaient alors comme principes d’organisation du travail dans ces entreprises gigantesques. L’autorégulation du marché était atténuée par la lente mise en place d’un système de relations de travail, qui légalisait d’abord la liberté d’association et le droit de grève (1872 au Canada) et, plus tard, le droit à la négociation collective (1944 au Canada et au Québec) (Supiot, 1994). Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale s’étendaient la production et la consommation de masse. Le salariat s’imposait de plus en plus comme le mode de rémunération dominant. Dans les entreprises, les rapports de travail étaient toujours hiérarchiques et le salarié se comparait, la plupart du temps, à un appendice de la machine. La division du travail entre la conception et l’exécution s’accentua. Durant cette période, par leurs luttes, les salariéEs syndiquéEs et les organisations syndicales parvinrent finalement à faire prendre en charge par l’État ou les entreprises, selon les pays, le coût de certains risques associés à la vie, du berceau au tombeau (assurance-maladie, assurance-chômage, pension de vieillesse, allocation sociale).
À partir de ce moment, les heures et les journées de travail seront limitées. Il en sera de même pour l’âge légal du travail salarié. Dans les économies capitalistes des pays développés, certains gouvernements afficheront, de temps à autre durant cette période (c’est-à-dire pas nécessairement de manière constante et permanente), un petit côté réformiste du genre sociale démocratie.
Mais il fallut une crise majeure pour susciter une écoute plus attentive des gouvernements et des capitalistes libéraux. Désirer l’abondance en produisant sans cesse ne pouvait qu’aboutir à des surplus astronomiques presque impossibles d’épuiser si la consommation se révèle incapable de suffire. Une réforme du capitalisme, du moins de ses principes classiques, devenait nécessaire. Et au-delà du système, le travail en avait aussi besoin. John Maynard Keynes (2002) y contribua en rappelant les bases de l’activité du travail, c’est-à-dire : un individu ne travaille pas par pur plaisir, mais parce qu’il désire acquérir des biens disponibles par le salaire que lui procure son travail (Gazier, 2014). En ce sens, même si le travail se compare à un sacrifice volontairement rattaché à un devoir – par souci de persuasion –, nous devons renouer avec notre nature afin de prendre conscience d’un déséquilibre survenu ; notre temps libre sacrifié doit être compensé par notre satisfaction obtenue par les biens acquis grâce au salaire gagné. Autrement dit, Keynes désignait le travail comme une contrainte, quoique nécessaire, et anticipait la mise en place de mesures afin de favoriser son appréciation, de réduire l’aliénation et l’insatisfaction, et d’en arriver à un état d’esprit manifestant le souhait de travailler davantage, de gagner un meilleur salaire et finalement de consommer. Par cet effort de réorganisation demandé aux entreprises, dans le but d’améliorer le climat de travail notamment et d’en faire des milieux plus humains, les effets désirés se répercuteraient sur l’ensemble de l’économie, créeraient une réduction du chômage et gonfleraient le nombre de salariéEs capables de consommer pour épuiser la production. Or, les conjonctures divergent constamment de la théorie, alors que l’économie balance entre des périodes de croissance et de crises. Afin de limiter la durée des temps plus sombres, les entreprises ne parvenant plus à entretenir leurs salariéEs, une intervention de l’État se révèle alors indispensable. L’objectif consiste à rééquilibrer trois grands marchés, c’est-à-dire du travail, du capital et des biens ou produits (Gazier, 2014) ; ainsi l’État doit soutenir les travailleur-EUSE-s, les investissements et l’innovation. Ces postulats servirent à l’État-providence qui a su agrandir son champ d’intervention.
Bien que cette tentative fût utile à mettre en évidence l’importance de soutenir la demande autant que l’offre, l’économie poursuivait ses aléas instables, justement parce que les développements techniques, technologiques et les nouveautés persistantes de l’offre fragilisaient la permanence des entreprises ainsi que certains secteurs d’activités. Cela a été démontré par Joseph Schumpeter (2002) qui constata dans le régime capitaliste une récurrence de destructions créatrices, dont la phase de destruction occasionnait de l’instabilité jusqu’au moment ou la phase créatrice assurait des innovations propices à une croissance. Mais automatiquement le monde du travail en subissait les effets immédiats, puisque l’instabilité causée par les crises créait des licenciements et du chômage, tandis qu’une période d’ajustement s’installait pour ouvrir la voie aux nouvelles conditions du marché innovant. Or, les chômeurs avaient besoin de formation, afin de faire face à ce qui les attendait. Ce processus persistant dans son cycle perpétuel annonçait une réalité du travail beaucoup plus précaire qu’imaginé. Qui plus est, la réforme ouvrait la voie au retour du libéralisme. Pour éviter un déficit éventuel dans la demande, une seule solution : la création d’un marché mondial.
3.3 Changements technologiques, économie du savoir et néolibéralisme (du milieu des années 1970 à aujourd’hui)
Dans un troisième temps, la pensée néolibérale se fixa comme objectif, dans la foulée de la révolution informatique et de l’émergence de l’économie du savoir, de libérer le marché des contraintes réglementaires en provenance de l’État, de restructurer les lieux de travail pour les rendre plus flexibles et de ronger sur les conquêtes sociales de la période précédente. Les chantres du néolibéralisme réclamaient, rien de moins, que le retour au marché autorégulé et à l’État minimal. Les employeurs et les gouvernements valorisaient la précarisation du travail et la négociation contractuelle individuelle ; justement en raison du fait que la réactualisation libérale se combinait encore à un individualisme qui encourageait une compétition dont le prix à gagner serait une mobilité sociale basée sur le mérite, c’est-à-dire dans un marché du travail qui rend chaque individu responsable de ses succès et de ses échecs. Les droits syndicaux et les programmes sociaux étaient ainsi remis en question de manière frontale. À l’ère de la mondialisation et du capitalisme cognitif (fondé sur l’économie du savoir) s’installaient la déréglementation, la privatisation et les restructurations des services, les fusions d’entreprises, la délocalisation, la désindustrialisation, la négociation des concessions, la stagnation des salaires, etc. (Gagnon, 1996 ; Latouche, 2005).
Le marché du travail, issu de la flexibilité, ne répondait déjà plus aux besoins de l’ensemble des membres de la société. Il se caractérisait de plus en plus par une insuffisance du nombre d’emplois et une piètre qualité de ceux créés (Paugam, 2000). Deux phénomènes particularisaient les emplois disponibles sur le marché du travail d’alors. En premier lieu, nous pouvons observer une segmentation de ce marché désormais porteur de discriminations systémiques à l’égard de certains groupes de salariéEs (comme les femmes, les jeunes, les autochtones et les membres issus des groupes ethniques). Ensuite, nous constatons une segmentation au sein même des entreprises, qui a eu pour effet de fractionner les statuts d’emploi. Dans les firmes d’aujourd’hui, certainEs salariéEs se retrouvent d’ailleurs dans une situation de surtravail (les workaholics, les performantEs et ceux-CELLES qui ne cessent de cumuler les heures de travail supplémentaires), de travail normal (ceux-CELLES qui se limitent à leur horaire, qui peut varier de 32 à 40 heures) ou de sous-travail (ceux-CELLES qui travaillent à temps partiel).
Dans ce bouleversement de situation d’après-Réforme, le mercantilisme est réapparu sous les attributs d’un monétarisme promu en grande pompe par les gouvernements Thatcher et Reagan, car il fallait renverser la tendance à l’endettement étatique ; mieux valait une conversion au néolibéralisme, telle que suggérée par des économistes (voire des disciples de la théorie de Friedman et al.) vantant entre autres l’avenue d’une financiarisation de l’économie, c’est-à-dire un passage désirable vers un secteur tertiaire 2.0 en services financiers, alors que les nouveaux moyens de communications conjecturaient la potentialité d’accélérer le rythme de circulation de la monnaie, d’amplifier ou de multiplier les occasions permettant d’échanger de l’argent contre de l’argent avec profit, précisément d’en arriver à le massifier (Généreux, 2011 ; Latouche, 2005). Tout devenait possible ; « The sky is now the limit ! » Mais rejoindre ce paradis exigeait un laisser-faire, voire une totale liberté de circulation de la monnaie. Personne ne devait la contraindre, ni même l’État. Cette inclination au gain, à la multiplication de l’argent, rappelant en quelque sorte la tragédie des Espagnols de la Renaissance qui n’agissaient que pour obtenir de l’or, expose une excessivité qui pousse un système au bord du gouffre qu’il a lui-même créé. Bien sûr, cette quête effrénée s’est automatiquement transféré dans le monde du travail, au point où l’aliénation industrielle se transforma en deux extrêmes, c’est-à-dire l’obsession d’y adhérer et d’y consacrer presque tout son temps, et la précarisation du travail à grande échelle (De Gaulejac, 2005 ; Gagnon, 1996 ; Paugam, 2000).
Force est d’admettre que cette guerre économique et pacifique voulue par les bourgeois du Moyen Âge s’est accentuée sous l’effet d’une illusion dépassant les limites du raisonnable. La recherche de l’abondance dans un but d’éliminer la misère et la pauvreté, mais surtout de créer un monde de richesses, a certes permis de grandes réalisations, sans pour autant renverser la réalité des inégalités socioéconomiques. Qui plus est, le travail libérateur est devenu une utopie, compte tenu de la dépendance qu’il crée, de l’exploitation, de l’aliénation, de l’obsession et de la précarisation générées en cours de route suite aux développements techniques et technologiques. Et la mondialisation néolibérale a provoqué en plus un déséquilibre entre les pays riches et les pays pauvres, ce qui a eu pour effet de transformer le marché international du travail en une zone de guerre à la fois entre les pays et entre les individus. L’affranchissement désiré semble alors repoussé à plus tard.
Par ailleurs, n’y a-t-il pas meilleure preuve d’assujettissement que cette comparaison qui consiste à se demander : quel événement parmi les deux suivants se révèle le mieux connu ou reconnu entre la fête du Travail et la fête des Travailleurs et des Travailleuses ? Lorsqu’une activité ou un concept déclasse les personnes, cela signifie que nous sommes en présence d’une idéologie dominante, voire d’une croyance qui conditionne fortement notre manière de vivre. Tout compte fait, quel étrange paradoxe de glorifier un concept de torture pour envisager une libération ! Au fond, le travail semble nous dire qu’il faut souffrir pour être libre, du moins à la lumière de notre révision des différents régimes dominants qui l’ont l’instrumentalisé au cours de l’histoire.
4. La crise socio-sanitaire de 2020
Nous sommes présentement en crise. Cette crise de type socio-sanitaire a un impact majeur sur l’activité économique. Le taux de chômage au Québec est passé d’environ 5 à 17 % en moins de deux mois au printemps 2020 (Desrosiers, 2020). La question qui se pose, à ce moment-ci, est la suivante : quel avenir pouvons-nous envisager pour le travail salarié ?
4.1 Le jeu des prédictions
De Platon à Schumpeter en passant par Condorcet, Comte et Marx, la liste est longue de personnes qui ont tenté de dessiner les voies de l’avenir. Plus près de nous, dans la foulée de la crise économique de 1982-1983 (où le taux de chômage a atteint 14 % au Québec), André Gorz (1988) et Jeremy Rifkin (1996) ont parlé de la raréfaction de l’emploi et de la nécessité de le partager ou encore de « la fin du travail » proprement dite.
Il va sans dire qu’au petit jeu des grandes prédictions, ces personnes se sont cassé les dents. Nous ne nous engagerons donc pas dans les mêmes avenues que celles qui ont été empruntées par ces grands maîtres à penser. Nous sommes d’avis qu’à court terme, nous pouvons nous attendre à un processus de « destruction créatrice » tel que conçu par Schumpeter (2002). Dans la foulée de la présente crise économique, certaines entreprises périront et d’autres, celles qui sont capables d’innovations, pourront éventuellement tirer leur épingle du jeu et croître. Qu’en sera-t-il des rapports hiérarchiques au sein des entreprises de l’avenir ? Tant et aussi longtemps que la propriété des entreprises restera de type capitaliste, nous devons nous attendre à des rapports capitalistes de travail, c’est-à-dire des rapports hiérarchiques d’exploitation et de domination. Le télétravail et la robotisation se propageront au sein d’une multitude d’entreprises, et pour cause : nous sommes passés d’un type de travail dominé récemment par un secteur tertiaire – qui a littéralement transformé les anciens quartiers ouvriers des villes en des places de sièges sociaux, de banques et pour les marchés financiers – à un secteur quaternaire attribué aux technologies de l’information et des communications, voire à un monde virtuel encore à ses premiers jours. Avançons que la bureaucratie aura toutes les chances de se transformer en exocratie, justement dans un univers de télétravail permettant des économies d’échelle, mais surtout favorisant un redéploiement des emplois contractuels, alors que la précarisation s’étendra de manière à créer un nombre élevé de pigistes qui s’arracheront sur Internet les contrats disponibles dans un jeu des plus offrants, c’est-à-dire dans une quête de sacrifice pour remporter quelques-unes des batailles seulement. Ajoutons aussi les éventuels répercussions de l’intelligence artificielle dans la surveillance, le contrôle, les analyses de données, les scénarios statistiques et de modélisations mathématiques, les moyens de transport autonome, les découvertes en eugénisme et dans l’élaboration de vaccins servant à contrer les nouveaux virus, dans l’aide médicale et en chirurgie, dans l’anticipation de l’avenir, etc. Si le travail a subi l’ère des machines, des chaînes de montage et d’une première phase de robotisation, l’avenir demeurera riche en nouveautés insoupçonnées. D’ailleurs, dans un monde de distanciation sociale susceptible de refroidir la chaleur des relations sociales, quel rôle joueront les robots intelligents ?
Il y aura possiblement une commission d’enquête qui s’interrogera au sujet de ce qui a mal ou bien fonctionné durant la présente crise du « grand confinement ». Cette commission proposera diverses mesures. Des mesures concernant l’hygiène au travail et portant également sur les programmes de soutien du revenu des salariéEs, des programmes d’aide financière pour les entreprises. Peu importe toutefois les conclusions de cette rétroaction, l’État s’est subitement ouvert les yeux sur les impacts de son désengagement, lui qui avait pourtant juré de protéger et de veiller au bien-être de ses citoyenNEs. Comme point positif à ce drame, les services jugés non productifs pour l’appareil capitaliste, comme les soins et la santé, ont exposé à la face du monde leur rôle essentiel dans l’équilibre de l’organisation sociétale de laquelle découle la santé de l’économie et du monde du travail. Dans la division et la spécialisation du travail, chaque implication, aussi réduite soit-elle, a son importance, surtout lorsqu’il s’agit de garantir le bien-être individuel et collectif.
Il est donc souhaitable que la présente crise suscite une grande réflexion et débouche sur un programme de réformes du type Rapport Beveridge et Welfarestate. Bref, un programme de restructuration et de réorganisation aussi important que celui qui a été mis en place à la suite de la Grande Crise des années trente et de la Deuxième Guerre mondiale. Un programme de développement économique, souhaitons-le, plus respectueux de l’environnement accompagné de mesures du genre « flexsécurité danoise ». Il serait étonnant toutefois que le télétravail, si nous y revenons, remette en question le caractère hiérarchique et hétéronome du travail salarié. Pourquoi ?Parce que dans notre société, il n’y a qu’une seule source de création de la richesse : cette source réside dans le travail (salarié ou non). Il y a certes d’autres sources d’enrichissement personnel, mais elles n’ajoutent rien à l’enrichissement collectif. Il s’agit d’un accroissement de richesse attribuable à la spéculation, à un transfert de revenus ou dit plus crûment au vol, pour parler comme Proudhon (1851).
Si les nombreuses crises qui ont marqué l’imaginaire au XXe siècle ont engendré de grandes souffrances et ensuite de grands moments d’enthousiasme collectif, permettant un retour à la normale et à l’« anormale » également, l’avenir sera nécessairement fait de rapports de force entre les grands acteurs sociaux présents dans la société ; entre ceux qui créent la richesse et ceux qui voudront se l’accaparer. Il se peut même que surgissent des remises en question qui déboucheront sur l’adoption de contre-réformes. Néanmoins la fin de la conflictualité sociale au sortir de la présente crise de la COVID-19 demeure impossible. Puisque la pratique humaine et sociale a nécessairement un caractère paradoxal, comme nous l’avons vu, il serait étonnant que le travail s’extirpe du paradoxe humain.
Nous nous en remettons davantage à Marcel Proust (1999, p. 1844) qui écrivait : « Mais nous nous représentons l’avenir comme un reflet du présent projeté dans un espace vide, tandis qu’il est le résultat souvent tout prochain de causes qui nous échappent pour la plupart ».
Yvan Perrier et Guylain Bernier
5 juin 2020
Bibliographie
Aristote. 1881. La Politique. Paris, France : Garnier Frères.
Claudel, P. 2007. TRISTAN FLORA – 1803-1844. Encyclopedia Universalis, [en ligne], consulté le 15 mai 2020. URL : https://uviversalis-vieuxmtl.proxy.collecto.ca/veille/2007/10/flora-tristan-u.html.
De Gaulejac, V. 2005. La société malade de la gestion. Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social. Paris, France : Seuil.
Delumeau, J. 1984. La Civilisation de la Renaissance. Paris, France : Arthaud, Collection.
Denis, H. 1993. Histoire de la pensée économique. Paris, France : Presses Universitaires de France.
Desrosiers, É. 2020. « Le taux de chômage atteint 17 % au Québec », Le Devoir, article publié le 9 mai.
Engels, F., & Marx, K. 1973. Manifeste du parti communiste [1848] et préfaces du manifeste, Paris, France : Éditions sociales.
Fontane, M. 1904. Histoire universelle. Les Croisades (De 1096 à 1327 ap. J.-C.). Paris, France : Alphonse Lemerre.
Gagnon, M.-J. 1996. Constitution et ébranlement de la société salariale. Dans Le travail : une mutation en forme de paradoxes. Québec, QC : Institut québécois de recherche sur la culture, Les Presses de l’Université Laval.
Gazier, B. 2014. John Maynard Keynes (2e édition). Paris, France : Presses Universitaires de France.
Généreux, J. 2011. La Dissociété. À la recherche du progrès humain – 1 (3e édition). Paris, France : Seuil.
Gorz, A. 1988. Limites de la rationalité économique. Dans Métamorphoses du travail. Paris, France : Galilée.
Keynes, J. M. 2002. Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie [1936] (Livres I à III) (version numérique réalisée par Jean-Marie Tremblay, en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l’Université du Québec à Chicoutimi). Chicoutimi, QC : Les classiques des sciences sociales.
Lalonde, M. 1997. Le travail. Dans Comprendre la société. Une introduction aux sciences sociales. Sainte-Foy, QC & Rennes, France : Télé-Université-Université du Québec / Presses Universitaires de Rennes.
Latouche, S. 2005. L’Occidentalisation du monde. Essai sur la signification, la portée et les limites de l’uniformisation planétaire. Paris, France : La Découverte.
Luther, M. 1561. Traicté tres excellent de la liberté Chreftienne, composé par Martin Luther : auquel eft viuement defcrite la iuftification de la Foy, & la fin ou fe doiuent reduire toutes bonnes oeuvres. Auec vne epiftre dudit Luther, enuoyée au Pape Leon dixieme. s.l., s.n.
Marx, K. 1968. Le Capital [1867] (Livre I). Paris, France : Gallimard.
Montesquieu, C.-L. (de Secondat). 1734. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Amsterdam, Pays-Bas : Jacques Desbordes.
Nys, E. 1898. Recherches sur l’histoire de l’économie politique. Paris, France : Albert Fontemoing.
Paugam, S. 2000. Le Salarié de la précarité. Paris, France : Presses Universitaires de France.
Platon. 1993. La République. Du régime politique. Paris, France : Gallimard.
Proudhon, P.-J. 1851. Idée générale de la révolution au dix-neuvième siècle. Choix d’études sur la pratique révolutionnaire et industrielle, Paris, France : Garnier et Frères.
Proust, M. 1999. À la recherche du temps perdu. Paris, Gallimard.
Renan, E. 1866. Les Apôtres (Livre II qui comprend depuis la mort de Jésus jusqu’aux grandes missions de saint Paul (33-45)). Paris, France : Michel Lévy Frères.
. 1869. Saint Paul (Livre III qui comprend depuis le départ de saint Paul pour sa première mission jusqu’à l’arrivée de saint Paul à Rome (45-61)). Paris, France : Michel Lévy Frères.
Rifkin, J. 1996. La Fin du travail. Paris, France : La Découverte.
Saint-Simon, C.-H. (de). 1823-1824. Catéchisme des industriels. Paris, France : Librairie Générale.
Schumpeter, J. 2002. Capitalisme, socialisme et démocratie. La doctrine marxiste ; le capitalisme peut-il survivre ? Le socialisme peut-il fonctionner ? Socialisme et démocratie [1942] (Parties I et II, chapitres 1 à 14) (version numérique réalisée par Jean-Marie Tremblay, en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l’Université du Québec à Chicoutimi). Chicoutimi, QC : Les classiques des sciences sociales.
Smith, A. 2009. La richesse des nations [1776]. Paris, France : Flammarion.
Spinoza, B. 1965. Traité théologico-politique [1670]. Paris, France : GF Flammarion.
Supiot, A. 1994. Critique du droit du travail. Paris, France : Presses Universitaires de France.
Weber, M. 2001. Les causes sociales du déclin de la civilisation antique. Dans Économie et société dans l’Antiquité [1896]. Paris, France : La Découverte.
. 2009. L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme [1904-1905]. Paris, France : Flammarion.






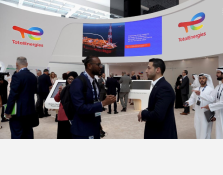

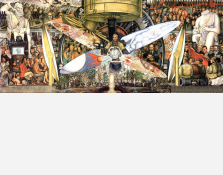


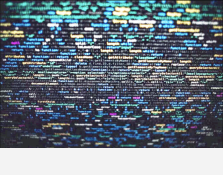

Un message, un commentaire ?