Trump fait la manchette autant dans son pays qu’à l’échelle planétaire. Pas moyen de s’y soustraire. Dans certains articles on le présente souvent comme un personnage « bizarre », « vulgaire », « raciste », « misogyne », « anti-intellectuel », « anti-scientifique », « antiwoke », etc., qui aimerait, malgré ses travers, faire l’unanimité autour de lui, compter sur une quantité phénoménale de supportrices et de supporteurs, avoir de nombreux émules et pouvoir s’appuyer sur un vaste réseau d’alliés ou de dirigeantes soumisEs. Hélas pour lui, il est très controversé, et ce même s’il est parvenu à créer, autour de son personnage politique, des copies sur divers continents. Pensons ici à Orban (Hongrie), Meloni (Italie), Milei (Argentine), Netanyahou (Israël) et Modi (Inde). Sans oublier, parmi des dirigeants qui ne sont plus aux pouvoirs, les Boris Johnson (Royaume-Uni) et Jair Bolsonaro (Brésil), etc.. Comment est-il possible de rendre compte de la présence sur la scène politique de ce type de dirigeantE qui adopte des politiques visant à réduire les fonctions régaliennes de l’État ; à mettre au pas l’élite universitaire et intellectuelle ; à dicter les orientations des décisions des tribunaux ? Voire même à chasser les immigrantEs et les personnes qui demandent l’asile politique ? À brimer les droits des groupes minoritaires opprimés et dominés ? Etc. ? Comment expliquer ce type de politicien qui est en rupture à plusieurs égards avec plusieurs de ses prédécesseurs (mis à part Richard Nixon) ?
La nouvelle donne depuis les années quatre-vingt du siècle dernier
Commençons par constater que nous vivons dans un monde au sein duquel nous pouvons observer une crise profonde des régimes parlementaires nationaux dominés par un capitalisme-impérialiste prédateur qui n’a plus de modèle alternatif pour le concurrencer. Les États-nations aujourd’hui sont, de moins en moins, en mesure de se définir à l’extérieur de leur rapport avec certaines organisations internationales (OMC, Banque mondiale de développement) ou sans envisager des traités de libre-échange avec d’autres pays. Il en est ainsi depuis les années quatre-vingt du siècle dernier. Même si Donald Trump semble vouloir aller à contre-courant de cette tendance, en adoptant une politique protectionniste (via l’imposition de tarifs douaniers aux produits importés sur son territoire), il s’agit là pour nous, à ce moment-ci, d’une parenthèse étasunienne dans la mondialisation, dont il est trop tôt pour conclure quoi que ce soit à ce sujet. L’heure du repli protectionniste n’a pas encore sonné aux USA. Trump semble chercher, pour le moment, à travers des négociations bilatérales avec divers pays, à rétablir la balance commerciale en faveur du sien. Attendons voir avant de conclure trop rapidement au sujet de cette politique héritée de l’époque du mercantilisme.
Pour comprendre le phénomène Donald Trump en politique, il faut revenir sur certaines caractéristiques du monde dans lequel nous vivons depuis l’élection de Margaret Thatcher (1979 à 1990) et de Ronald Reagan (1981 à 1989) et surtout depuis l’effondrement des régimes communistes du bloc de l’Est (de 1989 à 1991). Manifestement, la situation générale d’aujourd’hui, à l’échelle planétaire, est celle de la victoire complète du capitalisme à l’échelle mondiale. Il n’y a plus, en ce moment, que quatre régimes politiques qui se réclament du communisme ou du socialisme et il s’agit des suivants : Cuba, Vietnam, Corée du Nord et République populaire de Chine. Cette dernière se présente comme un « État socialiste de dictature démocratique populaire » dont le modèle de développement économique correspond à une « économie socialiste de marché ». Bref, un capitalisme d’État. La grande menace communiste, qui a donné le ton aux relations internationales de 1917 à 1991 semble avoir été éradiquée. Le grand gagnant de l’affrontement est-ouest est incontestablement le bloc de l’Ouest. Or, les implications de la victoire du capitalisme global à l’échelle mondiale sont nombreuses.
Dans un livre intitulé Trump, Alain Badiou (2019) a mis en évidence quatre implications découlant de ce triomphe :
1) La première c’est celle des inégalités : « de nos jours, deux cent soixante-quatre personnes possèdent, par héritage ou par revenu, autant que les sept milliards d’autres qui peuplent le monde. C’est là un déséquilibre bien plus important que ce qui a été possible du temps des monarchies absolues. » (p. 19).
2) La deuxième implication concerne les positions que le « sujet contemporain » (p. 45) peut occuper dans ce système d’inégalités. Le philosophe français en identifie quatre : être un « propriétaire industriel ou terrien, bref un capitaliste » ; « être à la fois un salarié et un consommateur, c’est-à-dire de vendre sa force de travail pour acquérir des marchandises quelconques » ; « être un pauvre paysan » en Afrique (ou dans un pays sous-développé) ; et, enfin, « n’être rien du tout, ni un consommateur ni un salarié, ni un paysan, ni un capitaliste » (pp. 45-46).
3) La troisième implication découle des deux précédentes et notre auteur l’énonce comme suit et concerne les populations démunies qui sont errantes et migrantes : « Il semble […] que le capitalisme lui-même soit incapable de procurer du travail à la totalité de la population mondiale […] parce que, comme vous le savez, les capitalistes offrent du travail uniquement s’ils peuvent espérer faire du profit » (p. 47). Il résulte de cette situation un excédent de gens démunis et sans avenir, les quelques milliards qui ne sont rien du tout, qui ne devraient pas exister, et dont une partie erre à travers le monde à la recherche de moyens de subsistance.
4) Dans ce champ planétaire, du capitalisme, dont la loi primordiale est la circulation de l’argent, les politicienNEs, et c’est là la quatrième implication, ne peuvent œuvrer que dans les limites étroites de la sphère nationale. Or, de la brutalité du capitalisme global associée à l’absence de choix politiques réels, à l’échelon national, résultent une frustration populaire, une peur de l’avenir et un sentiment généralisé de désarroi, ceci au sein d’une fraction de la classe moyenne, mais surtout parmi les pauvres. D’où une base électorale pour des politiciens à la Trump.
Sur le plan idéologique, last but not least, Badiou définit le monde dans lequel nous vivons par l’absence d’une autre orientation stratégique que celle du capitalisme. Autrement dit, le capitalisme ne prétend plus, comme jadis, être le meilleur système d’organisation économique et sociale ; il prétend tout simplement être le seul possible (pp. 15 à 17).
Depuis environ plus de trente-cinq ans, soit depuis l’effondrement des régimes communistes (1989-1991), l’humanité semble s’être résignée au fait qu’il n’y a plus de modèle alternatif, qu’il n’y a donc, par conséquent pour elle, qu’une seule voie à suivre. Ce qui implique qu’il n’y a plus de politique à proprement parler, la politique étant essentiellement une opposition entre deux visions antagonistes du monde et la voie jadis considérée comme alternative — le communisme à la soviétique ou à la chinoise — s’est dissipée dans les vapeurs de différentes substances : l’autoritarisme, le déviationnisme idéologique et politique, la corruption, les scandales, etc..
Trump n’est pas une exception : « [F]ace à l’oligarchie politique traditionnelle nous voyons apparaître, plutôt que des politiciens bourgeois chevronnés, une nouvelle espèce d’activistes, qui défendent des propositions violentes et démagogiques et semblent prendre de plus en plus pour modèle les gangsters ou la mafia » (p. 22). En effet, justement parce que l’argent-roi domine l’esprit capitaliste qui ne fait pas de distinction entre le respect des lois et le hors-la-loi. Tout est une question de tirer profit des circonstances, dans le but indispensable d’accumuler toujours davantage et davantage encore. De là, l’illusion d’une limite, et ce, même si les ressources planétaires en ont une… Grave problème qui peut être renversé par l’avenue de l’autre monde — le cyberespace — où l’argent est débarrassé de son corps physique pour devenir entièrement virtuel. Ainsi, l’avenir de l’enrichissement capitaliste passera à l’intérieur de cet autre monde à conquérir (une autre conquête). Voilà pourquoi les grandes puissances du monde terrestre s’allient aux grandes compagnies Internet et s’infiltrent donc dans le monde virtuel, tout en entreprenant des guerres de « hacking » aux effets profitables — d’où pourquoi aussi d’autres pays cherchent aussi à s’enrichir de la sorte au nom de leur souverain. Et sur ce point Badiou a raison de comparer leurs agissements à celui des groupes illégaux, car seul l’enrichissement compte ici.
Pour le philosophe, c’est la domination stratégique du capitalisme global qui règne internationalement, quelles que soient les pseudonouvelles politiques, et face à laquelle le trouble et la frustration des peuples n’y peuvent rien puisque ce « capitalisme démocratique » leur est présenté comme la seule voie possible envisageable.
Badiou revient sur la nécessité d’une autre voie, une autre stratégie pour la vie de l’humanité… : « Ce dont nous avons besoin c’est d’une idée, d’une grande idée […] il est possible de résumer cette idée par quelques points très simples, qui sont en réalité les points retenus par le communisme » (p. 69). Or, le communisme fait encore peur.
La mondialisation compétitive et conflictuelle
Nous vivons dans un monde qui a comme point cardinal la mondialisation. Celle-ci s’effectue dans un mode compétitif qui est foncièrement désorganisé, se définit et se déploie à travers des conflits et des rivalités entre différents pays. Les compétiteurs, que sont les USA, la République populaire de Chine et la Russie, cherchent à imposer leur domination dans différentes zones de la planète. Nous ne pouvons pas affirmer que les dirigeantEs politiques qui dominent la scène politique sont toutes et tous des personnes qui ont lu Kant et qui agissent en fonction de l’impératif catégorique suivant : « Agis de façon telle que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans toute autre, toujours en même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen. » Les rivalités à l’échelle internationale s’activent. Trump parle souvent « d’état d’urgence », « d’ennemis », « de guerre », etc.. Or, nous savons que les libertés fondamentales ne sont respectées dans les pays occidentaux qui se présentent comme étant des démocraties libérales parlementaires qu’en proportion inverse de l’intensité des conflits internationaux. En cas de conflits ouverts, les libertés sont sévèrement restreintes et limitées, les gouvernements exigent une loyauté inconditionnelle à l’égard de l’État et imposent diverses restrictions à la liberté d’expression (contrôle de la presse, des centres de recherche et des universités ; surveillance des citoyens ; expulsion de certains ressortissantes et ressortissants de l’étranger, etc.). Il faut préciser ici qu’en dehors de l’état de guerre ouverte ou présumée, ces restrictions aux droits et libertés diminuent sans réellement disparaître complètement.
D’un monde bipolaire, à un monde unipolaire et pourquoi pas maintenant multipolaire…
Nous aurions donc évolué dans un monde bipolaire du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et ce jusqu’à l’effondrement des régimes communistes des pays du bloc de l’Est. De 1991 jusqu’au début de l’an 2000 environ, il pourrait être question d’un monde unipolaire et, depuis le début du XXIe siècle, un monde multipolaire aurait émergé, avec à sa tête un triumvirat composé des USA, de la République populaire de Chine et de la Russie. Le monde compterait maintenant au moins deux super puissances plus une ex qui multiplie les efforts pour reprendre du gallon ou du poil de la bête.
Il faut savoir au sujet de la République populaire de Chine — l’Empire du Milieu — qu’elle revient de loin, de très loin même. Comment qualifier autrement que de victime de prédation le sort réservé à un empire chinois affaibli, à partir de la première guerre de l’opium, par à peu près tout ce que le monde comptait au XIXe siècle de puissances navales ? Par une ironie de l’histoire, la Chine, aujourd’hui est redevenue superpuissance, se retrouve assise à la table des prédateurs (Heisbourg, 2024) avec ses deux grands tantôt partenaires ou tantôt rivaux.
Il est à souligner que ces trois grands pays impérialistes déclinent en ce moment leur stratégie en exploitant les interdépendances pour en extraire tous les avantages possibles. Sur ce point, disons d’abord que la Chine est devenue une cyberdictature qui cherche à s’approprier les technologies européennes et américaines, à détacher l’Europe des États-Unis, à intégrer l’Europe dans l’espace eurasiatique, notamment via la 5G, tout en se réservant l’option de l’intervention militaire (à Taïwan notamment). Ensuite, forts de leur suprématie militaire et de leur capacité d’innovation, cyberpuissance avérée, pays détenteur de la devise monétaire qui permet encore largement les échanges commerciaux internationaux, les USA ont, avec Donald Trump, abandonné (provisoirement) le libre-échange et, pour au moins les quatre prochaines années, leur prétention à l’exemplarité pour verser dans le transactionnalisme à courte vue, le bilatéralisme et l’imposition de tarifs douaniers en vue de réduire les impôts des particuliers les plus riches. Enfin, reléguée par sa faiblesse économique dans une autre catégorie que les deux autres puissances, la Russie est animée par une démarche révisionniste vis-à-vis de la perte de son statut de superpuissance, ainsi que de l’ordre de sécurité européen de l’après-guerre froide. Elle compense son manque de ressources en se montrant conquérante et belliqueuse tout en essayant de déstabiliser ses adversaires par la désinformation.
Ce sont ces pratiques de prédation qui se déploient en ce moment un peu partout dans le monde. La Russie veut gruger des territoires de l’Ukraine et obtenir le contrôle éventuel de la route maritime de l’Océan Arctique ; la Chine veut s’annexer Taïwan et développer sa zone d’influence sur le continent Africain ; les USA ont annoncé une politique d’annexion territoriale agressive à l’endroit du canal de Panama, du Groenland et du Canada. Trump a même annoncé vouloir chasser la population palestinienne de la bande de Gaza pour en faire une zone touristique sous le contrôle d’Israël. Au milieu de ce champ de forces, l’Union européenne offre aux prédateurs les atours de ses divisions internes et de son absence de moyens de défense stratégiques.
Mais est-ce si différent des temps passés ? La conquête de territoires n’a cessé d’animer un type de dirigeant qui se croyait être l’Un parmi les autres. Ce qui animait donc l’Asie et l’Europe de l’Antiquité — étant sûrement tout autant le cas en Amérique, même si notre connaissance reste limitée sur cette période en ce territoire —, possible de rappeler aussi durant le Moyen Âge, lors de la formation des États-nations, se poursuit tout simplement. Là où la mainmise sur la Méditerranée devient ensuite un contrôle des blocs continentaux, on en vient tout naturellement à vouloir contrôler le monde entier avec son cyberespace — et pourquoi pas ensuite tout ce qui concerne l’espace extraterrestre et non virtuel. Pour se faire, il faut devenir puissant, créant alors un cycle perpétuel binaire entre la nécessité de conquête pour être puissant et le désir d’être puissant qui oblige la conquête, donc dans une vision limitée des choses ; cela revient à dire qu’après la paix vient la guerre et après la guerre le besoin d’une pause dans la paix. En bref, le contexte international actuel n’a rien de surprenant. C’est la nature humaine qui est en cause ici : répondre à des besoins et des désirs. Mais il existe une frange qui ambitionne plus que les autres, ne pouvant se contenter. À cela se joignent évidemment des excès de la personnalité qui rappellent les Augustes, les Césars, les Empereurs ou les Rois-tyrans d’un temps bizarrement pas aussi révolu que nous pouvons le croire.
Plus près de nous, il y a la suite des deux Grandes guerres, où les puissances poussent dans ses extrêmes retranchements la formule de l’État, reposant sur une autorité centralisatrice et structurée. Autrement dit, on revient même à l’ancien questionnement portant sur la grosseur idéale de l’État, de son régime politique, économique et social à prioriser — en dépit de ce qui a été dit plus haut au sujet de la solution unique ou de la voie de salut offerte par le capitalisme. En réalité, notre mode de pensée continue d’être mené par le passé de conquêtes et de religiosité. Le désenchantement du monde de Weber ou de Gauchet intervient certes ici de façon à supposer sa prochaine phase consistant à le généraliser, alors que nous évoluons toujours dans un monde très religieux, qui en plus reconnaissait la place des Empereurs et des Rois au sein d’une division entre la Cité céleste et la Cité terrestre qui ne possède pas seulement les traits augustiniens. Il existe toujours dans l’esprit humain cette grandeur qui dépasse l’humanité, parce que, comme le disaient les Descartes, Kant, James et Bergson de ce monde, nous avons besoin de croire. Par contre, son inaccessibilité physique, dans un certain sens, exigeait de l’exprimer concrètement à travers ce que nous avons généré en termes de hiérarchie — avec ses dérives. La catégorisation des choses, comme le dirait Foucault, accentue aussi les discriminations sur le plan humain. Au-delà des forts et des faibles, des êtres intelligents et des sots, s’ajoute une hiérarchie basée sur le sexe (ou le genre), sur la race, le sang, la couleur et ainsi de suite. Cela s’est évidemment répercuté dans une recherche de suprématie qui, dans un contexte de mondialisation et d’immigration de toute provenance, n’a plus sa place, selon un certain point de vue toutefois et malgré le capitalisme qui n’a rien à faire des différences, hormis entre les riches et les pauvres, soit la seule hiérarchie qui le concerne. Voilà qui expose une quête allant au-delà des richesses promises par le capitalisme.
Nos sociétés continuent de présenter ce caractère craintif par rapport aux différences, par rapport donc à l’inconnu. La crainte de perdre des repères, de ne plus savoir où aller, voire même à quoi ou qui croire, stimule d’ailleurs le besoin de retourner vers des bases connues et jugées solides, même si elles ont causé toutes sortes de désagréments et, au plus, des destructions massives. Pourtant, on reconnaît certaines valeurs jugées universelles et, en l’occurrence, rattachées à une vie en commun harmonieuse, mais cette idéalité se confronte à une réalité de besoins qui ramène l’intérêt égoïste en avant-plan — d’où le capitalisme. On veut manger, avoir un toit sur la tête et suffisamment d’argent pour éviter le manque et, au meilleur, s’offrir un temps pour soi et nos proches. Au fond, la plus grande difficulté que nous avons à faire face est de rendre compte de l’humanité, c’est-à-dire de donner forme à une seule espèce humaine ou de rentrer dans cette unité ses multiples expressions. Car, comme l’a bien dit Bergson (2012[1932]), c’est la religion qui en est la cause première, cherchant à créer un homogénéité basée sur la foi plutôt que sur le territoire ou la tribu. Malheureusement, notre tendance à repousser la différence (ou à combattre celles et ceux qui ne font pas partie de notre tribu) entre en opposition avec cette vision de l’humanité, ce qui pourrait alors expliquer également cette tendance des conquêtes et des frictions entre superpuissances. Autrement dit, le réenchantement du monde en misant sur cette forme de lien fraternel qu’est l’humanité exige conséquemment une nouvelle forme d’État ou de gouvernement ; à savoir une autre façon de coordonner les relations humaines autrement que par une hiérarchie propre à élever les uns sur les autres. C’est là que des organismes, en songeant à l’ONU, peuvent servir de pont, afin de ramener les divisions vers une compréhension plus générale de l’humanité dans ses formes de distinction étant à la source même de sa splendeur. Ce réenchantement exige en plus un rééquilibre entre l’humain et la nature, puisque les deux sont conjointement liés : envisageons-nous alors un retour vers le jardin d’Éden, comme voie de sortie du capitalisme impérial ?
Conclusion
Cette nouvelle dynamique géopolitico-économique de la présente phase de la mondialisation, qui nous expose à une authentique alternance gouvernementale sans possibilité d’une alternative politique, pourrait (en partie) expliquer l’émergence du type de politicienNE aux caractéristiques comportementales à la Donald Trump. La fin de la guerre froide entre les pays des blocs de l’Ouest et de l’Est a permis l’émergence de politicienNEs pour qui la fin justifie les moyens et où la raison cède le pas à la déraison, ce qui se répercute sur une population des pays du centre craintive et préoccupée par son avenir, entre autres sur le marché du travail et de l’emploi. Cette population redoute les affres du chômage et les conséquences de la perte ou de l’érosion de son pouvoir d’achat. Une frange importante des électrices et des électeurs adhère au diagnostic simpliste selon lequel la situation économique s’est détériorée à cause supposément d’une immigration massive et également en raison de politiques en faveur des groupes discriminés. Mais ces dirigeantEs de l’ultra-droite, qu’une frange importante de l’électorat est prête à accorder son vote, prônent et adoptent, une fois installéEs au pouvoir, des politiques qui ont pour effet d’accentuer les écarts entre les riches et les pauvres. « Tout fonctionne normalement, ça tourne en rond évidemment », comme dirait l’Autre… Jusqu’à ce que la masse décide d’en finir et choisisse la voie de la révolution. Mais, à la chute des impériaux, viendra des périodes troubles susceptibles de créer une marche de recul. Car pour avancer, il faut une direction avec une destination. Le temps est venu de se pencher sur des alternatives au capitalisme impérial, à des solutions qui exigeront de transformer la mentalité actuelle : à commencer par notre relation avec la richesse et avec autrui.
Guylain Bernier
Yvan Perrier
26 avril 2025
18h
Références
Allès, Delphine, Frédéric Ramel et Pierre Grosser. 2023. Relations internationales. Paris : Armand Colin, 318 p.
Badiou, Alain. 2019. Trump. Paris : PUF, 97 p.
Bergson, Henri. 2012[1932]. Les Deux Sources de la morale et de la religion. Paris : Flammarion, 446 p.
Canivez, Patrice. 2013. Qu’est-ce que l’action politique ? Paris : Vrin, 125 p.
Heisbourg, François. 2024. Le temps des prédateurs : La Chine, les États-Unis, la Russie et nous. Paris : Odile Jacob, 238 p.
Manzagol, Claude. 2011. La mondialisation : Données, mécanismes et enjeux. Paris : Armand Colin, 191 p.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d’avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d’avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :







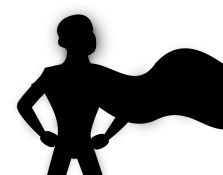

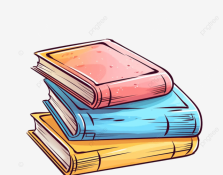



Un message, un commentaire ?